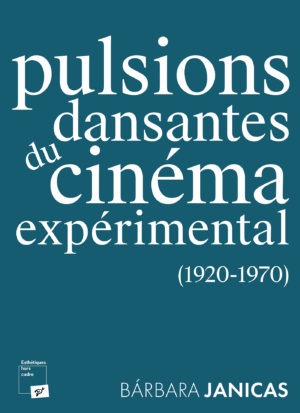Benjamin Thomas
Introduction
Lorsque, au début des années 1910, une société de production cinématographique américaine ou un critique de film invitaient expressément les acteurs à tourner le dos à la caméra1, il s’agissait bien sûr d’en finir avec les regards dans l’objectif. On ne voulait plus voir les œillades de l’actrice qui appuyait ainsi son geste tout en donnant l’impression de chercher l’approbation du metteur en scène habitant le hors-cadre, comme dans A Little Girl Who Did Not Believe in Santa Claus (1907) d’Edwin S. Porter. Le temps n’était plus aux clins d’œil de Georges Méliès, magicien dont l’art requérait un lien de connivence avec son auditoire, quand bien même il serait rassemblé devant lui en son absence. On ne souffrirait plus longtemps les apartés – pas nécessairement accompagnés d’un regard à la caméra, du reste – par lesquels Mazamette (Marcel Levesque), dans Les Vampires (1915) de Louis Feuillade, faisait le point sur l’action passée ou à venir, vers le public, au service de sa totale compréhension des détails ou des enjeux de chaque scène. Tout cela devait être oublié.
À son rythme propre, le cinéma semblait ainsi découvrir l’impériosité des préconisations de Diderot pour le théâtre et la peinture, formulées près d’un siècle et demi auparavant : prétendre que le spectateur n’existe pas, proscrire l’adresse au public, comble du « mauvais goût »2. Le philosophe réclamait en effet aux peintres et aux comédiens des personnages se comportant comme s’ils ne savaient pas qu’ils étaient regardés, fussent-ils ou non absorbés dans quelque action. Il ne s’agissait pas, bien entendu, de provoquer ainsi une mise à distance définitive et littérale du public, mais, par un paradoxe qui définit toujours l’être-spectateur culturellement dominant, une mise à distance qui garantit en fait un sentiment prégnant d’immersion dans la fiction. C’est bien ce dont témoignent déjà les écrits de Diderot dans lesquels, face à une œuvre répondant à ses critères, le philosophe se raconte comme s’il vivait à l’intérieur du tableau3. Diderot voulait qu’on fît mine de dédaigner le spectateur, non pas dans un geste moderniste avant l’heure nourrissant le projet d’ébranler l’idée même de représentation, mais bel et bien pour décupler la puissance de son regard, qui, s’exerçant désormais « à l’insu » du monde représenté, pouvait en jouir pleinement, à discrétion. Et c’est pour les mêmes raisons que le cinéma au fil de la première décennie du xxe siècle se met à réclamer des dos : pour réapprendre l’humilité aux visages, pour rétablir un équilibre des figures par lequel le film ferait enfin comme si son existence n’était pas déterminée, justifiée par un regard.
Des dos qui n’auraient pas l’outrecuidance de devenir des présences autonomes, donc. Il en va ainsi des dos et nuques, innombrables, des personnages en amorce dans pléthore de champs-contrechamps, qui ont pour seule fonction de donner limpidement à lire la situation (dramatique et spatiale) tout en lui donnant les atours de la vraisemblance et de l’évidence. Mais les dos demeurent tout aussi « inaperçus », car « fonctionnels », dans bien d’autres types de plans. Qui – outre l’observateur traquant déraisonnablement le motif – prête attention aux dos de deux jeunes femmes, en bordure d’un plan de La Marseillaise (1938) de Jean Renoir, silhouettes dont on ne doit pas voir les visages, puisqu’il leur revient d’incarner le peuple indivis, et donc de se « désister » afin que l’œil s’attarde sur les faces réjouies des héros partant la fleur au fusil ? Ces dos doivent être perçus furtivement, ne frapper l’œil qu’à l’oblique, pour laisser cette impression diffuse d’une masse populaire (admirative) dont se sont détachés Bomier, Arnaud et leurs compagnons.
Il en va de même des dos « palimpsestes », chargés d’apprendre au spectateur quelque chose de l’histoire et du personnage – chez Fritz Lang, celui de Peter Lorre, dans M le maudit (1931), qui laisse voir la marque portée par le protagoniste à son insu, ou celui de Jeremy Fox dans Les Contrebandiers du Moonfleet (1955), marqué, scarifié, donnant à lire les traces que la société a laissées sur la peau, dans la chair de l’individu ; elles disent l’histoire sans le recours au visage, à la voix, qui peuvent toujours tromper ou feindre. De ces dos, le spectateur voit surtout ce dont ils sont les supports.
De même, quand le dos, sans être palimpseste, est au service total de la narration, il convient qu’il demeure « imperceptible ». On en prend toute la mesure face à certains plans dans lesquels l’action simple d’un personnage doit être l’unique donnée transmise, lorsqu’elle est la seule information d’importance au regard du récit. Si cette action s’y prête, c’est alors de dos que le personnage se fera oublier afin que ce qui l’occupe se donne à lire sans partage et sans équivoque. Dans La Marseillaise, encore, lorsqu’il faut faire part simplement et clairement de la multiplication des pamphlets à l’encontre du pouvoir, le plan d’un imprimeur anonyme de dos survient, qui prend bien soin de ne pas durer outre mesure et laisse place à plusieurs inserts rapides sur divers journaux et libelles. Mais il en va ainsi dans d’autres types de scènes, moins spécifiques. Par exemple : quoi de moins troublant que le dos d’un personnage pris en filature ? En effet, à moins qu’il s’agisse d’une certaine Madeleine (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958), l’enjeu de la scène sera sans doute le trajet du personnage, les lieux fréquentés, ses actes observés à la dérobée, peut-être son identité, mais pas son dos en tant que pure présence.
Enfin, le motif n’est pas plus perceptible en tant que tel lorsqu’un film le mobilise pour s’assurer la captation du spectateur, non pas encore par l’intrigue, mais « simplement » par la diégèse, c’est-à-dire par un monde de fiction pas encore informé et rythmé par les raisons ordonnatrices d’une histoire. Souvent, les films procèdent ainsi en recourant à une forme d’empathie perceptive que peut générer la représentation d’un dos et que Christian Doumet a très bien analysée en ces termes : « Voir de dos, ce n’est pas voir l’autre, c’est voir ce que l’autre voit ; accompagner son regard ; entrer dans sa vue4. » Il s’agit alors, dès l’ouverture du film ou d’une scène, avant que les péripéties n’aient tout à fait requis le personnage et l’attention du spectateur, de « coller » le second « aux talons » du premier, dans un plan rehaussé d’un mouvement d’appareil plus ou moins sophistiqué. Et ce que relève Doumet y est tout à fait opérant : le regard n’achoppe pas sur ce dos qui, de concert avec la caméra mobile, invite le spectateur à s’intéresser avant tout à ce qui se présente, à la face occultée du personnage, aux lieux – et bientôt aux événements – dans lesquels il pénètre. Autrement dit, si ce parti pris rend la forme cinématographique plus sensible, il n’en garantit pas moins, phénoménologiquement, l’immersion du spectateur dans la fiction et l’histoire, projet central de la forme dominante du récit cinématographique, de la période hollywoodienne classique à aujourd’hui. Le procédé, en effet, décuple la puissance d’identification au personnage (à l’aide du dos qui fait « entrer dans la vue de l’autre »), mais il vise aussi à exalter le sentiment d’une entrée dans le monde diégétique (avec le secours du mouvement d’appareil accompagnant ce dos ou suscité par lui, qui assure une autre forme d’identification, plus fondamentale : l’identification à la caméra, par laquelle, ainsi que l’a montré Christian Metz, le spectateur tient le rôle de sujet « tout-percevant5 », la fiction faisant mine de se donner sans réticences à son regard, comme si elle se mettait à exister par lui et pour lui). Le cinéma hollywoodien classique n’était pas rétif au procédé, mais la forme dominante du film de fiction, aujourd’hui, semble en faire un usage plus systématique, toujours avec une certaine mesure. C’est, par exemple, le cas de Two Lovers (2008) de James Gray, Narc (2003) de Joe Carnahan, L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (2007) de Dominik Andrew, ou encore The Wrestler (2009) de Darren Aronofsky. Et là encore, le dos n’a droit de cité qu’en tant qu’il demeure discret, secondaire, soutient les effets escomptés et ne remet pas en cause les attentes spectatorielles forgées par la conception dominante du film narratif de fiction.
Mais il arrive que ces prescriptions, ces usages normatifs du dos jusqu’ici évoqués ne soient pas observés.
Cela peut résulter d’une altération, d’un petit dérèglement. Si l’on en reste à l’utilisation du dos pour aiguillonner le sentiment d’immersion dans la fiction, il suffit ainsi d’une quelconque atteinte à ce que l’usage a imposé comme le point d’équilibre du dispositif, sa forme « acceptable ». Il suffit, par exemple, que le monde fictionnel et ce qui s’y trame s’obstinent à se donner comme un réel incertain, rétif à une mise en intrigue intelligible, pour que le dos, soudain, soit là. Ainsi, incapable de s’installer confortablement dans la vue du personnage – dont la clarté des desseins est alors elle aussi mise à mal par la nature même de ce monde insaisissable –, le spectateur est forcé de considérer ce dos. En d’autres termes, on ne suit pas le dos de Mickey Rourke dans The Wrestler comme on suit celui de Lars Rudolph dans Les Harmonies Werckmeister (Werckmeister Harmóniák, 2000) de Béla Tarr.
Dans Elephant (2003) de Gus Van Sant, l’intrigue, qui s’inspire d’un fait-divers, est connue d’emblée par le spectateur, à moins qu’il ne se fût prémuni contre le bruit médiatique, les recensions ou, plus tard, les résumés qui figureront sur les jaquettes des vidéogrammes. Il sait donc que les couloirs du lycée dans lesquels s’enfoncent les divers protagonistes, que l’on suit très souvent de dos, sont voués à être les lieux d’une tuerie gratuite. Le dos, ici, se met donc à exister pour d’autres raisons. En effet, Van Sant accorde aux vues de dos une durée « trop » longue. « Trop » selon les pratiques normatives, bien sûr. Jean Mitry a montré que la fugacité ou l’étirement du temps sont ressentis au cinéma dès lors qu’est octroyée à un plan une durée trop courte ou trop longue par rapport à la durée de l’événement représenté6. Or, il semble que le seuil d’« impatience » du spectateur soit bas lorsqu’il s’agit d’un personnage marchant, de dos, et que tarde à survenir telle ou telle péripétie. On peut ajouter que Van Sant décuple l’effet du jeu sur la durée, d’abord par la récurrence de ces dos ainsi autonomisés en tant que motifs et, ensuite, en intégrant au film des images d’un type de jeux vidéo dans lequel le joueur dirige un personnage vu de dos. En effet, par un contraste vivace, lorsque les images de Van Sant viennent s’opposer à ces images-là, le spectateur fait pleinement l’expérience de ce qui différencie les unes des autres : il ressent alors avec force que, contrairement au joueur face à son écran, il n’a aucun pouvoir sur ces dos de cinéma.
C’est sur la durée que joue également Takeshi Kitano pour pervertir l’usage de ce que l’on appelait plus tôt le dos « palimpseste ». Dans L’été de Kikujirô (1999), dans Aniki, mon frère (2000), le cinéaste recourt à de lents travellings sur l’échine de ses personnages, anciens yakuzas, dépris ou bannis de leur clan, mais dont le dos est encore orné du tatouage indélébile qui clamait cette appartenance. Métonymie complexe de la société japonaise, dans les films de Kitano, le clan yakuza a imprimé sa marque sur ce corps. Il le réclame, d’une certaine manière. Mais, le temps accordé à cette image invite à considérer le dos sous le tatouage et le corps dont il est la face visible. Alors, l’image dit bien plus que l’appartenance passée au clan, qu’aurait montrée un plan plus rapide sur le tatouage. Alors, on sent presque peser l’encre. On remarque le dos se courbant sous le poids des désillusions suscitées par la croyance déçue en la cohérence, l’assise et les liens que les personnages esseulés pensaient trouver dans cette famille de substitution. Ces plans agissent comme des aspérités dans l’écoulement fluide des images, ils outrepassent leur fonction, mais c’est pour mieux donner à percevoir, sur un mode purement sensible, l’un des thèmes majeurs travaillant le cinéma kitanien.
Dans Dolls (2002), Kitano va plus loin et semble même refuser l’assignation d’un sens aussi prégnant au motif. Il lui reconnaît en somme une indocilité réelle. Ainsi une scène d’errance du couple central, deux amoureux qui se sont volontairement retirés du monde, s’ouvre-t-elle sur les deux personnages se tenant dos à la caméra, tout à fait immobiles. La posture devient « anti-cinématographique », en ce qu’elle vient redoubler, rendre plus sensibles encore les moments de vide narratif que met en place le cinéaste, friand de ces instants où les images échappent à toute finalité, à toute fonction illustrative. Mais alors, ce refus d’un assujettissement momentané de l’image à l’intrigue, ce refus passager du sens est lui-même un geste qui fait sens, d’une certaine manière, puisqu’il situe le cinéma de Kitano. Il l’inscrit dans une histoire japonaise des formes cinématographiques et plus spécifiquement dans une des tendances dont se compose cette cinématographie, et qui vise à se servir du médium suivant des préceptes esthétiques japonais différents de ceux que la pratique dominante (occidentale) lui a associés durablement7.
Pour autant, tous ces exemples, de Tarr à Kitano, outre qu’ils ne sont pas exhaustifs quant à la manière dont le motif se rend soudain sensible en tant que tel, ne doivent pas laisser penser que le dos s’« émancipe » plastiquement au cinéma sur le seul mode de la transgression ou de la subversion des conventions. Il y a en effet davantage à en dire.
Le cinéma d’horreur, par exemple, fait un usage assez fréquent de la vue de dos, notamment quand il convoque ses monstres et autres personnages « timériques8 ». Ne citons qu’un film, par lequel un célèbre cinéaste aurait renouvelé le genre : Psychose (Psycho, 1960). Distillant l’inquiétude, une scène montre Lila Crane découvrant Mme Bates de dos, assise dans le sous-sol de la maison ; la jeune femme hésitante s’approche lentement afin d’amener la vieille dame à se retourner, pour découvrir enfin un cadavre momifié. Mais avant cette acmé, ce dos inquiétant a bel et bien existé en tant que pure présence, il ne s’est pas résumé à une phase transitoire vers un retournement. Dans le cinéma horrifique, montrer le dos d’un personnage, c’est susciter la peur d’une autre façon qu’en le mettant en scène frontalement. C’est préparer à l’émergence de la peur sans l’amoindrir pour autant. Que l’on pense alors être à la parfaite intersection de la monstration et de la suggestion, ou que l’on considère avoir affaire à d’autres catégories – une science de la peur qui se fonderait sur le dévoilement et s’opposerait à une conception de la terreur basée sur le surgissement –, il n’en demeure pas moins qu’un constat s’impose : loin de remettre en cause les effets escomptés par la fiction, le motif du dos, ici, y participe pleinement.
Autre cinéaste, autre dos, qui n’existe pas dans un plan proprement transgressif, mais n’en est pas moins littéralement considérable, riche de plusieurs lectures possibles : Jean Renoir, et La Marseillaise, encore. Lorsque Bomier, d’abord sensible à ses devoirs de fils, renonce à s’enrôler avec ses camarades, une scène le montre chez sa mère. L’élan qui pousse ses amis à rejoindre la lutte et à monter vers Paris le tiraille toujours. Ne tenant plus en place, il se lève et se dirige vers la fenêtre. C’est alors qu’un plan rapproché d’une quinzaine de secondes nous présente le dos de Bomier, tandis qu’il ouvre la fenêtre et met en mots l’attrait de cet Ailleurs vers lequel s’apprêtent à partir ses compagnons. À un premier niveau, ce dos sert sagement le récit : il lui revient de figurer l’immobilité subie de Bomier et l’appel de l’action, hors champ, qui en devient irrésistible et auquel il cédera bien vite. Et cela fonctionne : l’extérieur est à ce point occulté par ce dos que l’on partage avec plus d’urgence encore le désir du personnage d’aller y voir. Mais le motif dit ici bien d’autres choses, (même) si l’on s’extrait du simple plan narratif. Esthétiquement, il est un des moments où se donne à voir limpidement un parti pris qui travaille le film dans sa totalité et trouve à s’exprimer en bien d’autres plans : la volonté de Renoir d’interdire que l’on oublie la présence du hors-champ. Dans ce plan, loin de n’être qu’une obstruction de la vue, le motif du dos – dont il n’importe plus alors qu’il fût celui d’un personnage nommé Bomier – fait exister l’au-delà du cadre. Autrement dit, en faisant mine de toucher aux limites de la représentation, Renoir en libère de singuliers pouvoirs : elle rend tout à fait prégnante la présence de ce qui la déborde, elle pointe avec insistance vers ce qu’elle ne peut pas (ou ne veut pas) montrer, mais dont le spectateur n’aurait pas même conscience si, précisément, elle ne mettait pas en scène sa propre incapacité de le montrer. Ce qui recouvre un autre propos, au croisement de l’esthétique et de l’éthique, sur la manière de se saisir de l’Histoire au cinéma. En effet : ne jamais permettre que l’expérience sensible du film se rapporte au seul espace du cadre, c’est rappeler sans cesse que, mettant l’Histoire en images, on ne prétendra pas tout en dire, qu’elle n’est pas réductible aux découpages auxquels la soumet le cinéma.
Ravivée par tous les plans évoqués jusqu’ici, la question dont est né le présent ouvrage pourrait se formuler ainsi : qu’en est-il lorsque la proposition « tourner le dos à la caméra » est prise à la lettre ? Que nous disent les plans sciemment composés pour cadrer ce que l’on pourrait appeler « l’envers du personnage » et en faire leur motif central, parfois à l’exclusion de tout autre ? On tente de formuler la question, donc, mais, aussi et surtout, face à la variété des exemples sur lesquels il a semblé impérieux de s’attarder pour lui donner consistance, on est invité à l’humilité. Car si le point commun de toutes les images convoquées ici est que le dos y atteint le statut de pure présence, on voit bien qu’il peut servir à stimuler des sensations qui enrichiront l’expérience narrative proposée par le film, qu’il peut y soutenir ou y inquiéter des postures esthétiques, qu’il peut consolider, étoffer, ordonner ou au contraire faire vaciller le sens. En même temps qu’il révèle sa puissance, le motif engage donc celui qui entreprend de l’étudier à se prémunir contre l’outrecuidance de croire qu’il pourra le cerner tout à fait.
Avec L’Homme de dos, Georges Banu livrait, il y a dix ans, une étude du motif dans le théâtre et la peinture. Il rencontrait, dans les tableaux et sur les planches, d’entêtantes apparitions de dos, sous des formes multiples et variées, qui décourageaient salutairement toute prétention à leur assigner à coup sûr tel ou tel sens, telle ou telle fonction. Ainsi, avec Hans Blumenberg, Banu pense-t-il le motif comme une métaphore, c’est-à-dire une figure qui demeure toujours amarrée « à un réel dont les charges d’incertitude restent intactes9 », quoi qu’on veuille lui faire dire. En outre, au détour d’un paragraphe, effleurant la question du dos au cinéma, Banu formule un vœu : « un essai mériterait de lui être consacré 10 ». C’est en écoutant la fascination suscitée par le motif, par l’impossibilité même d’en dresser une typologie, que le présent ouvrage aimerait répondre à l’invitation de Georges Banu. L’indocilité de la vue de dos n’est donc pas ici un constat fait après coup, elle fait office de prémisses. Sur celles-ci se déploient donc les douze chapitres qui composent le présent ouvrage. Tous s’emparent de questions similaires à celles qu’ont fait affleurer les plans cités jusqu’ici, quand ils n’en formulent pas d’autres, parmi celles, latentes et inépuisables, que contient le motif.
Les vues de dos qui ont provoqué le vacillement de la rencontre dont naît le besoin d’écrire sont de celles qui ouvrent des brèches, inquiètent, invitent à des détours. Et emprunter les détours que propose la vue de dos, c’est poser des questions au cinéma ; des questions que le motif figure, cristallise, sur ce qu’implique le fait de regarder, sur la place du spectateur, sur les présences inédites que peut susciter l’image cinématographique, sur les tensions qui la constituent, entre donner à voir et conter. Mais c’est aussi interroger la polysémie du motif, dont des genres et des cinéastes inventent et réinventent les usages.
Le cheminement que propose l’ouvrage aimerait rendre compte de cette capacité du motif à négliger les ornières d’une route rectiligne. Les cinq premières études partent d’un film, d’une image, pour très vite interroger le cinéma lui-même, ou tracer des chemins de traverse entre des œuvres dont le rapprochement est parfois inattendu, mais que la « vue de dos » unifie. Les sept chapitres suivants, au contraire, s’attachent plutôt à l’usage du motif dans les limites d’un genre, de la filmographie d’un cinéaste, voire d’un film. Ils impliquent ainsi que leurs conclusions ne sont opérantes que dans un corpus ou une œuvre. Mais, ce faisant, ils n’en pointent pas moins, eux aussi, la variabilité du motif, c’est-à-dire sa stimulante insoumission, sa richesse inouïe.
Daniel Serceau repère, chez des cinéastes aussi différents que Christine Pascal, Alfred Hitchcock et Kenji Mizoguchi, un attachement certain au caractère équivoque de la vue de dos. Dans leurs films, le motif signale un usage de la forme cinématographique rétif aux stricts devoirs illustratifs envers le récit, mais qui, loin d’en menacer la cohésion, l’enrichit en le rehaussant d’un faisceau cohérent de possibles. Et l’enjeu n’est pas qu’une certaine idée du film narratif de fiction, c’est aussi une conception du rôle du spectateur.
Maxime Scheinfeigel s’attache quant à elle à l’expressivité de ce qu’il convient d’appeler la figure du dos à l’écran. Chez Hitchcock et Minnelli, d’une part, chez Murnau et Hitchcock, d’autre part, elle distingue deux manières d’user de cette expressivité au cinéma : en conteur ou en plasticien. Mais toujours, dit-elle, le motif inquiète, qu’il « repousse les limites figuratives des images » ou semble « comploter contre le cours ordinaire des récits filmiques ».
Repousser les limites de l’image, « agrandir le monde », pour citer Jean Grémillon, c’est l’idée qui est au centre du chapitre suivant, signé par Philippe Roger. De Vertigo à Manoel de Oliveira, en passant par Grémillon, Ophuls et Tourneur, Philippe Roger s’attache tout particulièrement à ces moments où, faisant écran, le dos fait l’écran. C’est-à-dire ces plans dans lesquels, loin d’être une obstruction, le motif donne à voir de singulière façon, ouvre l’image vers ce qui la creuse, l’entoure, la dépasse.
Pour Jean-Michel Durafour, le dos fait plus que l’écran, il fait le cinéma. Il met en exergue, en tout cas, l’un des pouvoirs du médium cinématographique. En effet, le cinéma, nous dit l’auteur, malgré ou grâce à ses qualités photoréalistes, a cette particularité : il peut mettre à mal l’attente qui consiste à vouloir que les choses ressemblent à leurs images. Edward Yang évoquait cette idée dans son film Yiyi (2000), par une facétieuse mise en abyme, à l’aide du motif du dos déjà, lorsqu’un personnage, déconcerté, découvrait une photo de cette face cachée de lui-même prise à son insu. Pour Jean-Michel Durafour, c’est face à l’apparition du dos de Laura, héroïne éponyme du film d’Otto Preminger (1944), que l’on prend réellement toute la mesure de cette capacité du cinéma à rendre sensibles « d’inédites présences ».