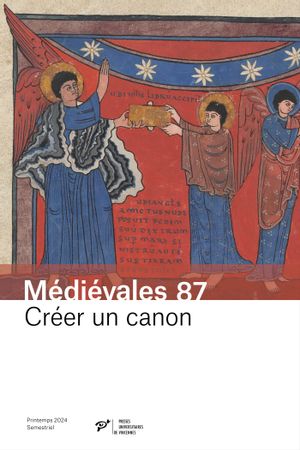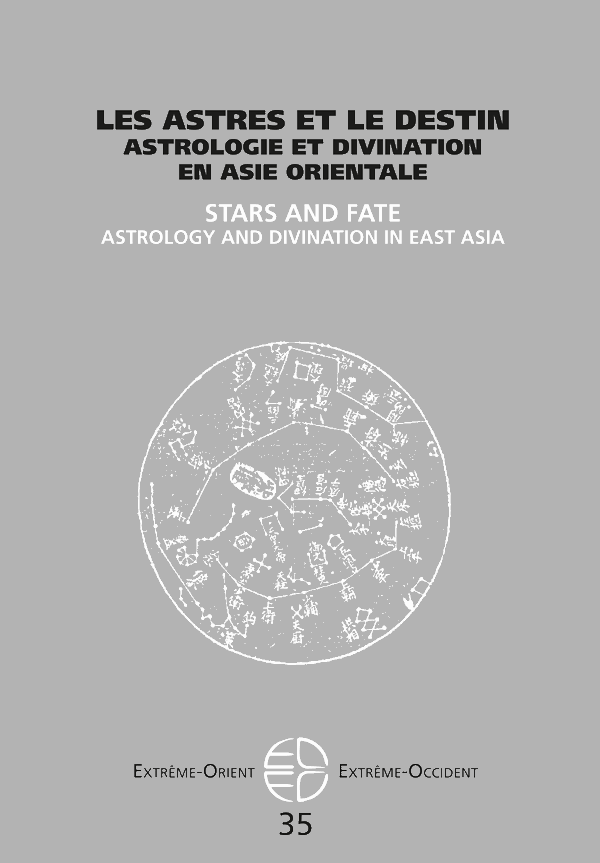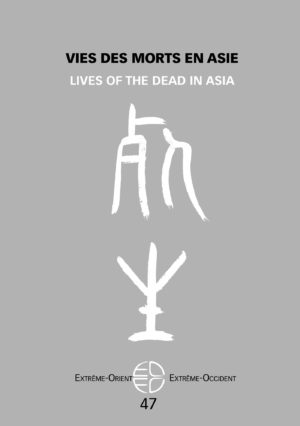Introduction
Jean-Noël Robert
Au tout début, il avait été envisagé de consacrer ce recueil à une question plus générale : les méthodes de transmission du savoir traditionnel en Extrême-Orient considérées dans leur aspect transculturel. Les « trois doctrines » semblaient constituer en l’espèce une excellente matière ; le bouddhisme aurait permis de montrer comment un ensemble de pensée, de croyances et de pratiques passant de la Chine au Japon, extérieurement dans une même langue – le chinois classique – s’était trouvé engagé, en raison même de cette identité de surface, en un remaniement en profondeur qui lui assura une implantation peut-être plus solide dans l’ensemble de la société et de la culture japonaises qu’en Chine même ; comment le maintien d’une ferme distinction des traditions d’enseignement en écoles séparées, lesquelles finirent par fusionner entre elles en Chine, obligeait l’historien des doctrines bouddhiques à chercher dans l’archipel la suite de l’histoire doctrinale qui avait pris son essor sur le continent ; comment s’est maintenu, voire élaboré, au Japon, à partir de précédents chinois qui échappent à l’historien dans le détail, le procédé de la dispute scolastique, distinguée de la controverse entre sectes, écoles ou religions, selon des formes dont on ne trouve guère qu’au Tibet de frappantes analogies. De la même façon, la diffusion du confucianisme à travers le système des examens au Viêtnam et, pendant une période relativement brève, dans le Japon médiéval, ou encore à travers son intégration dans l’enseignement monastique bouddhique, puis dans le réseau des « académies » (juku) d’Edo, avant de faire partie du curriculum universitaire occidentalisé, aurait constitué un excellent sujet comparatif. Le taoïsme, enfin, aurait apporté le contraste très intéressant, si nous nous en tenons toujours à l’exemple japonais, d’une diffusion moins manifeste dans ses cheminements mais d’autant plus remarquable puisque, ne pouvant jouir dans la même mesure que le bouddhisme et le confucianisme des soutiens monastiques et académiques, il semble s’être propagé avant tout à la faveur du shintô, dont nombre de pratiques y feraient écho, mais aussi dans les traditions médicales. On aurait très certainement trouvé dans les autres pays sinisés des faits parallèles qui auraient permis l’élaboration d’un panorama général où l’on aurait aussi insisté sur les questions de l’enseignement de la langue chinoise classique et de son incorporation dans les différentes langues « locales ».
Certaines circonstances ont cependant amené à changer assez rapidement l’orientation de départ. Bien qu’il ne fût pas question, à l’origine, d’accorder une attention particulière à l’astrologie ou à la divination, il est cependant vite apparu, lorsque l’on commença à passer en revue les possibles contributeurs à un recueil sur les méthodes d’enseignement traditionnel, qu’un assez grand nombre de chercheurs se consacraient à ces domaines dans une perspective voisine des thèmes qui étaient envisagés dans le contexte décrit plus haut. Bien mieux, de telles recherches étaient menées non seulement dans le monde sinisé, mais plus généralement dans l’ensemble du domaine asiatique qui s’étend de la Haute-Asie à l’Asie du Sud-Est, de la Mongolie au Cambodge, en passant par les aires culturelles indienne et tibétaine. Il apparut donc souhaitable de restreindre le thème tout en élargissant le périmètre concerné. Il faut bien évidemment prendre avec un grain de sel l’idée de « restreindre » le thème à l’astrologie et à la divination (avec en plus la science calendérique, inévitable compagne des deux arts), mais on comprendra aisément que le sujet ainsi redéfini paraisse plus abordable que la transmission des enseignements dans les trois doctrines. Un projet fut donc élaboré sous le titre provisoire virgilo-manilien Conscia fati sidera (« Les étoiles, qui connaissent le destin » ou « complices du destin »), et les points suivants proposés aux éventuels collaborateurs :
– L’existence de centres distincts pour l’étude de l’astrologie, du calendrier ou de la divination.
– L’inclusion de ces centres au sein d’institutions politiques ou religieuses plus vastes, ou leur indépendance de telles institutions.
– Le statut de l’enseignement de ces arts : spécialisé ou inséré dans un curriculum plus large.
– La langue de l’enseignement : existe-t-il une rivalité entre les langues d’enseignement (par exemple tibétain/mongol ou chinois/japonais), ou bien une gradation selon le niveau d’enseignement ?
– L’existence de corpus écrits ou oraux et leur transmission.
– La coexistence ou la concurrence de traditions différentes (tibétaine ou chinoise en Mongolie par exemple, ou bouddhiste et taoïste).
– La diffusion de ces arts hors des institutions spécialisées : est-elle orale ou écrite, existe-t-il des corpus populaires ? Rôle des moines errants et des devins professionnels.
– Les stratégies de survie et de transmission de ces savoirs traditionnels dans les sociétés modernes.
Alors qu’il était prévu d’accepter un maximum de six articles, pas moins de huit spécialistes acceptèrent de contribuer au recueil selon les thèmes proposés, et lorsque les articles arrivèrent, ce fut sans doute cette même joie qui avait jadis envahi Porphyre à la découverte de la structure parfaite des six fois neuf traités de son maître Plotin qui ravit cette fois les rédacteurs en découvrant que ces huit textes non seulement couvraient la plupart des grandes aires culturelles de l’Inde et de l’Asie Orientale, mais tissaient entre eux, pour la plupart, un réseau d’analogies qui devraient stimuler d’autres recherches. Partant du monde chinois, continental et insulaire, l’enquête se poursuit en effet dans la péninsule coréenne, au Japon et au Viêtnam, avant d’aborder l’autre foyer primordial, l’Inde, et l’un des plus anciens royaumes « hindouisés » de l’Asie du Sud-Est, le Cambodge, puis un dernier centre de rayonnement culturel, le Tibet, en finissant par le domaine mongol, qui a reçu du Tibet le bouddhisme et les arts indiens de l’astrologie et de la divination.
Presque tous les auteurs ont accepté de traiter un certain nombre des thèmes proposés dans la présentation d’origine et donnent ainsi au lecteur quelques repères qui pourront être utiles dans le foisonnement de faits nouveaux qu’il trouvera ici, en même temps que des perspectives tout aussi innovantes. On devrait s’apercevoir aussi que, malgré sa diversité, ce recueil trouve une cohérence qui devrait en faire un livre de référence en plusieurs domaines encore peu explorés. L’une des impressions d’ensemble qui ressort de sa lecture est le caractère singulièrement bigarré de la plupart des traditions abordées, même celles qui se réclament de la plus grande antiquité et de la plus stricte orthodoxie de lignage. Que ce soit en Chine, en Inde, au Japon, au Tibet, l’éclectisme est de mise ; les spécialistes de ces arts n’hésitent pas à incorporer dans leurs pratiques et leurs enseignements des éléments extérieurs, étrangers, ou tout simplement inventés par eux-mêmes, leur conférant une unité de surface, un lissé que leur prête une tradition réinventée. Ici plus qu’ailleurs, il serait justifié de parler de « bricolage ». En même temps, ces arts traditionnels font preuve d’une étonnante faculté d’adaptation et de facilité à changer de registre, passant d’une transmission présentée comme immémoriale et exécutée sous le sceau de l’ésotérisme à la diffusion par l’enseignement universitaire moderne. Présentées comme matières scientifiques ou historiques et philologiques, l’astrologie et la divination regagnent ainsi le prestige qu’elles risquaient de perdre dans des milieux valorisant l’éducation moderne, tout en maintenant leur statut dans les croyances populaires. Ces arts ont donc su habilement user de la modernité pour déjouer les obstacles qu’elle devait leur poser. Le résultat est manifeste : en Inde comme en Chine, les arts divinatoires en général comptent sans doute plus de pratiquants professionnels et de clients fidèles que jamais auparavant dans l’histoire. L’Internet a de plus, comme chacun sait, donné à ces pratiques une diffusion et une audience inimaginables il y a une génération, mais c’est une question qu’il est peut-être encore prématuré d’aborder de façon globale. Il ne s’agit pas cependant d’une simple question de nombre ; nous voyons aussi changer et s’adapter le discours de ces arts, accentuant soit leur scientificité, soit leur antiquité.
Le premier article de ce recueil, celui de Stéphanie Homola, consacré comme de juste à l’exemple chinois, illustre au mieux la complexité des négociations qui s’opèrent au sein d’une même culture, stimulées par une influence extérieure que les acteurs les plus engagés s’efforceront d’oublier. Le cas de Taïwan, considéré dans la première partie, est très révélateur des détours que peut prendre la reconstitution d’une tradition : alors que le Guomindang avait combattu les « superstitions » sur le continent et que les autorités coloniales japonaises avaient fait de même sur l’île, après 1949 se constitua peu à peu et se répandit une technique divinatoire fortement inspirée des modèles japonais, qui avaient eux-mêmes évolué à partir d’anciennes transmissions chinoises. Alors que la transmission privée de type ésotérique a connu un essor important, les efforts pour transformer l’horoscopie en discipline universitaire à l’instar de la médecine traditionnelle chinoise révèlent la recherche d’une légitimité conforme au monde moderne. En contraste, l’enquête de terrain menée par l’auteur en Chine continentale montre la créativité qui peut se déployer pour former une pseudo-tradition fondée sur le secret de la transmission.
Yannick Bruneton présente un tableau d’ensemble de la divination en Corée à l’époque de Koryŏ (xe–xive s.), malgré la difficulté d’en recueillir les éléments dispersés dans les sources. On voit se constituer l’« école de Tosŏn », dont l’influence se fera sentir jusqu’à l’époque contemporaine. Les japonisants seront très intéressés d’apprendre l’apparition, au xiiie siècle, d’idées sur la Corée comme lieu de séjour des bouddhas et bodhisattvas, et singulièrement de Mahâvairocana, phénomène qui doit inciter à rechercher de possibles connexions avec les idées voisines développées au Japon.
Matthias Hayek donne une description détaillée de l’essor des sciences divinatoires dans le Japon d’Edo, époque de la généralisation commerciale du livre, et montre ici aussi la constitution d’un nouveau savoir à partir du « recyclage » de procédés plus anciens, chinois et japonisés, l’innovation étant légitimée en soulignant l’accord avec les sources chinoises anciennes tout en s’appuyant sur la diffusion en langue japonaise.
On doit à Alexei Volkov ce qui est sans doute la première présentation systématique des sources vietnamiennes sur l’astrologie et l’hémérologie ; elles sont constituées de textes chinois ou rédigés en chinois, mais aussi en vietnamien « démotique » (nôm), ce qui montre leur propagation au-delà des cercles lettrés officiels.
Caterina Guenzi brosse un panorama particulièrement éloquent de la fortune indienne de l’astrologie et montre comment cette science aux origines fort diverses, reconstruite à partir de traditions grecques et arabo-persanes, se trouva enchâssée dans une tradition censée remonter aux Védas. Cette nouvelle tradition, convenablement indianisée, fait à présent l’objet d’un enseignement universitaire qui entend se plier à la méthode scientifique.
François Bizot illustre par le cas cambodgien un autre exemple singulier de synthèse culturelle, où les douze animaux du « zodiaque » chinois sont mis en relation avec un système de divination fondé sur la version khmère, bouddhisée, du Râmâyana. On a ici un nouvel exemple de divination par le livre, analogue aux sortes virgilianae, aux poèmes de Hâfiz, au Kim Van Kieu, qui appelle d’urgence une étude d’ensemble de ce phénomène.
Charles Ramble apporte une autre illustration de l’importance de l’astrologie comme marqueur d’élaboration identitaire avec l’incorporation du système d’astrologie bouddhique Kâlacakra dans la religion bon, elle-même extraordinaire mosaïque d’éléments provenant des aires circum-tibétaines, y compris la chinoise.
Brian Baumann, enfin, dont l’important ouvrage Divine Knowledge sur l’astrologie mongole avait contribué à suggérer le thème de ce recueil, a choisi ici de se propulser hors des limites de la sphère des étoiles fixes pour aborder directement la vision allégorique du Ciel dans les conceptions politiques mongoles.
À la lecture de ces riches études, on découvrira que les arts divinatoires, que les pratiquants sont toujours soucieux de présenter comme remontant en toute pureté de tradition à d’immémoriales origines, sont l’un des lieux intellectuels les plus propices à l’emprunt, au recyclage, au démarquage, et que les étudier revient à reconstituer le cheminement de l’appropriation d’enseignements divers et de l’élaboration plus ou moins stable de ces derniers en systèmes se voulant à la fois traditionnels et originaux, mis en œuvre par des adeptes aspirant au statut de maître.
Il reste le plaisant devoir de remercier tout d’abord les contributeurs, qui ont eu le courage de relever le défi, les anonymes relecteurs qui n’ont ménagé ni leur peine ni leur temps, et, pour avoir bien voulu apporter à ce recueil l’éclairage enrichissant d’un « regard extérieur », le professeur Charles Burnett. Enfin, la plus élémentaire justice exige que soit pleinement reconnu ici le rôle fondamental de Pierre Marsone, à qui est due la totalité du travail rédactionnel proprement dit, c’est-à-dire celui qui commença aussitôt après qu’une première idée, toute virtuelle, eut été lancée. C’est à lui que revient l’entier mérite de la réalisation de ce numéro.