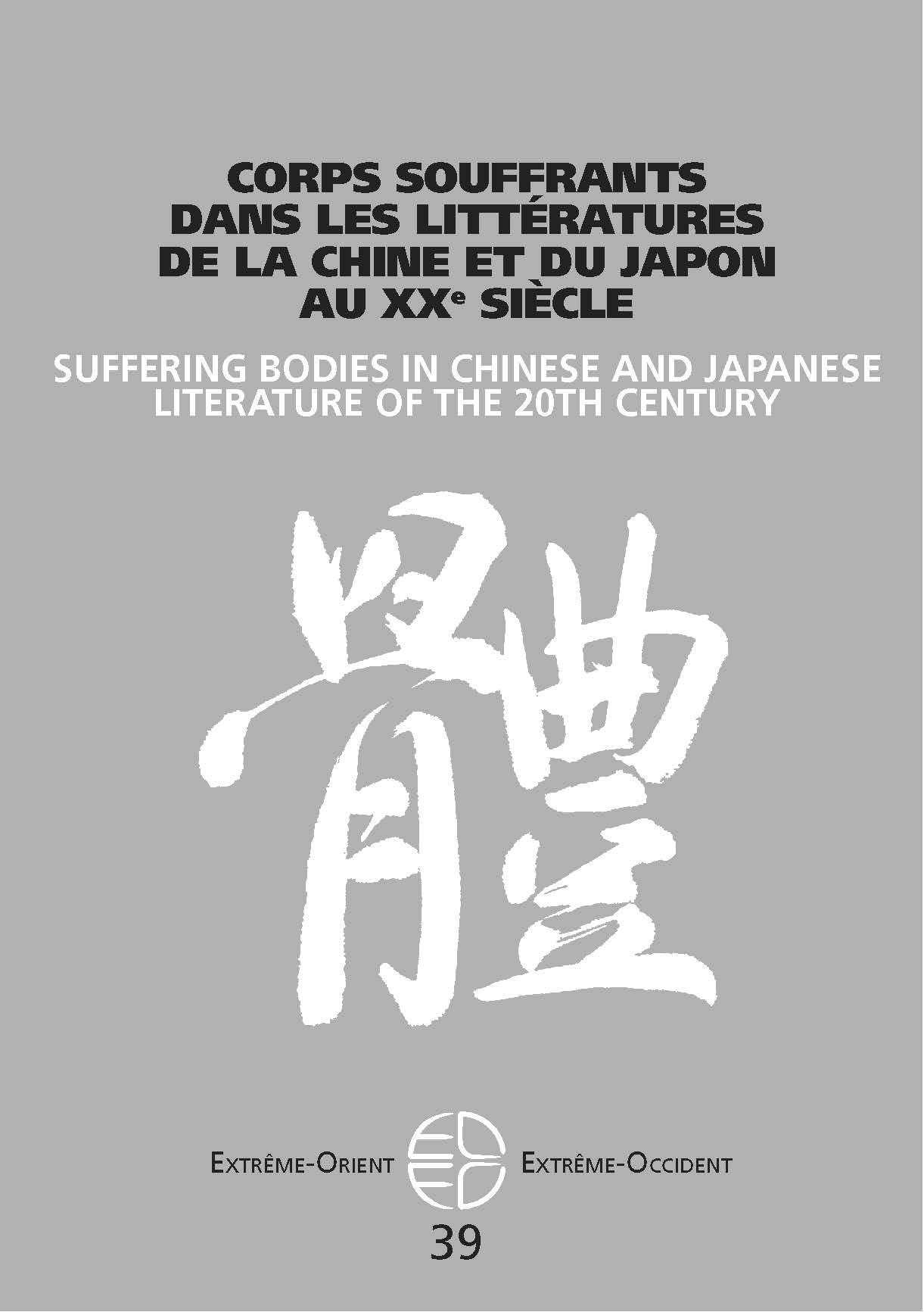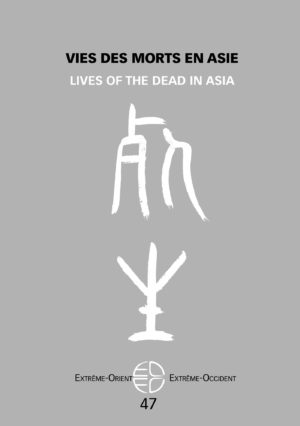Les épreuves du corps en littérature
Les cas de la Chine et du Japon
Cécile Sakai, Gérard Siary et Victor Vuilleumier
« Le corps humain référent des descriptions devient métonymie ou métaphore de l’ordre du monde. Le corps, métaphore de l’ordre rêvé, est dans ses défaillances métaphore de tous les désordres. »
Le présent numéro d’Extrême-Orient Extrême-Occident, « Corps souffrants dans les littératures de la Chine et du Japon au xxe siècle », s’inscrit dans le prolongement du programme transversal 2014-2018 du Centre de recherches sur les civilisations de l’Asie orientale (en partenariat privilégié avec l’Université de Genève) : « Imaginaires du corps et des identités dans les littératures de l’Asie orientale au xxe siècle ».
Si la problématique du corps est devenue depuis les années soixante-dix un fort enjeu de la recherche transdisciplinaire en Occident, elle s’est développée plus tard en Asie orientale, ces toutes vingt dernières années, dans le sens de l’interrogation sur l’existence d’un « corps asiatique » spécifique, et ce selon quatre directions : les études foucaldiennes, féministes et culturelles ; l’anthropologie médicale ; les recherches sur la pensée néo-confucéenne et identitaire ; les développements du concept de body culture/culture du corps. Du côté de la science de la littérature, les travaux sur la représentation du corps ont montré combien l’objet est aussi présent que mouvant, voire fuyant et difficile à cerner car il n’est souvent, sous son enveloppe apparente, que « signe renvoyant à autre chose que lui-même », et « toujours disséminé dans un tissu de relations qui le dépassent ou le sous-tendent », relié à l’affirmation de quelque identité, ethnique, sociale, culturelle, intime.
Comme la problématique générale du corps en Asie orientale sous-tend le travail présenté ici sur le corps souffrant à travers les littératures locales, la question se formule en termes de mouvement et d’expression des corps dans un espace-temps pertinent, à savoir le Japon et la Chine continentale, que le choc de l’intrusion de l’Occident amène, voire oblige, à se réformer. Il s’agit, en l’occurrence, d’une modernisation entre tradition et modèles occidentaux, adhésion volontaire et résistance nationale, groupe et sujet émergent, qui cherche à adapter et adopter les savoirs, les pratiques, les idéologies et les technologies d’importation qui touchent à ce corps. Autant qu’une autre forme de discours, l’art de la littérature, lui-même soumis à mutation – ne serait-ce que de langue –, rend compte du devenir du corps et des corps à maints niveaux, de l’anatomique au métaphysique en passant par le national.
À l’orée du xxe siècle, avec l’expansion ultra-marine de l’Occident, l’Asie orientale subit le choc des forces et des connaissances qui bouleversent ses repères et l’obligent à opter pour une mutation conçue comme salutaire. Le corps est au carrefour des stimuli qui le balisent, le verbalisent, l’enlisent aussi parfois. De ce corps qui devient enjeu à l’échelle de la nation et bientôt de l’individu, de ce corps qui s’impose peu à peu face au sujet, la littérature, elle aussi soumise à mutations – notamment avec la modernisation de la langue : baihua chinois, genbun.itchi japonais –, s’attache à rendre compte, autant que d’autres discours, au fil d’une histoire à rebondissements et reconfigurations multiples.
Pour aborder le corps souffrant, l’approche littéraire recourt à une philologie renouvelée, qui lui fournit la première base d’acception du sens syntagmatique, sans rien anticiper de son irisation textuelle et de la multiplicité des interprétations possibles. Elle recourt aussi aux sciences humaines, la philosophie et la sociologie au premier chef, l’histoire et la géographie culturelle ensuite, en tant qu’elles peuvent lui apporter le contexte et un substrat conceptuel, qui viennent renforcer l’analyse littéraire proprement dite, fondée sur la microlecture socio-poétique des textes.
Bien que l’expression linguistique du corps varie selon l’aire culturelle et au sein d’une même aire, bien que des concurrences puissent apparaître entre corps chinois et corps japonais, le corps sino-japonais peut corroborer sans mal, mutatis mutandis, le postulat global d’un « corps asiatique », réductible à nul autre, et notamment opposable au corps occidental. Cela dit, non sans paradoxe, la mondialisation est inhérente à ce « corps asiatique » qui, amené à se réinventer, doit parfois composer jusque dans sa chair avec l’Autre occidental. Il importe de préciser que si, comme nous le rappellent les études postcoloniales, l’expression de ce « corps asiatique » s’est bien déployée dans l’imagination exotique occidentale, ici notre lecture se construit à partir des textes eux-mêmes et des auteurs qui nous racontent une certaine histoire du corps, écrite depuis l’autre rive. C’est bien leurs propositions que nous analysons, sans déterminisme culturel ni rémanence orientaliste.
Plus précisément, pour dire le corps, le chinois ancien offre des termes voisins qui recoupent ce que les langues européennes – pour en rester à ce parallèle – entendent par corps : « xing signifie plutôt la forme actualisée, shen plutôt l’entité personnelle, le moi individuel, et ti plutôt l’être constitutif. Aucun de ces termes ne coïncide tout à fait avec la notion européenne parce qu’ils répondent eux-mêmes à des termes divers et parce que, fonctionnant en binôme, ils s’éclairent également à partir de leur vis-à-vis ». L’ensemble s’entend en rapport (à la fois d’opposition et de complémentarité) avec la dimension transcendante-animante (shen) précédant toute actualisation ; « l’entité personnelle » va de pair avec la fonction de conscience morale et la connaissance du cœur-esprit (xin), qui la régit ; « “l’être constitutif” a pour partenaire le souffle-énergie (qi) dont il est la matérialisation par condensation-concrétion ». À l’époque moderne, le terme évolue en fonction des enjeux sociaux de la période considérée, notamment le binôme « corps-personne » (shen) et « cœur-esprit » (xin). Les termes xing, ti, et shen tendent à désigner le « corps » comme expression extériorisée de la personne et selon qu’il est plus ou moins perçu sous l’angle de l’objectivation ou du corps propre. Le champ lexical du corps humain est très riche sur les rapports avec la personne (shen), avec sa matérialité et sa corporalité (tipo, tige, tili), ou sa carnalité, voire sa sensualité (routi), ainsi que pour la vie intérieure et les émotions du sujet. Ce lexique s’accroît dès la fin du xixe siècle de l’apport de xénismes, de termes étrangers, ainsi que de termes anciens resémantisés à la faveur de l’apparition de nouveaux phénomènes. Au tournant du xxe siècle se développe aussi l’idée du corps comme une « carcasse » (qu, quke), inerte et dépersonnalisée, qui fait obstacle à l’émancipation des citoyens d’une nouvelle nation à construire, comme chez le réformiste Liang Qichao (1873-1929), et qu’il convient donc de dresser ; cette représentation dualiste ne restera pas étrangère à la littérature des années 1920.
Quant à la souffrance, le terme japonais de kumon, souci, ennui ou morosité à l’origine, passe ou plutôt revient en chinois avec le sens nouveau de souffrance romantique existentielle, en même temps que le lexique clinique des maladies nerveuses, telle la « neurasthénie » (shenjingshuairuo). Parmi les troubles intérieurs, un mot comme fannao est plus que fréquent dans la littérature chinoise des années 1920, avec le sens de « tourments » et une nuance werthérienne. Les composés formés de teng ou tong peuvent déployer, eux, des connotations autant physiques que morales, bien que le sens premier soit corporel. Certains mots sont composés à partir de ji, « maladie », qui exprime par dérivation la souffrance ou le mal — tel jiku, « souffrances, malheurs », avec « ku » pour ce qui est « pénible » car « amer » (voir la transcription moderne de kuli pour « coolie »). Le lexique de la blessure ou cicatrice (hen, shanghen), de la faiblesse (ruo, shuai), de la maladie (bing, ji) complète cet inventaire qui, en littérature chinoise moderne, exhibe une souffrance avant tout spirituelle, psychologique et mentale.
La langue japonaise, qui hérite du chinois – tout en ayant conservé son propre fond lexical –, dispose d’au moins quatre mots : shintai (sino-japonais), le corps au sens froidement objectif ; shin (sino-japonais)/mi (japonais), ou soi-même, avec une distance réflexive et une connotation corporelle et physique, mais non psychosomatique ; karada (japonais), ou corps organique ; sei (sino-japonais), qui peut traduire l’idée de nature en tant qu’état inné et originaire des choses, ainsi que le sexe. Le préfixe kara de karada se réfère à l’enveloppe, à la coquille, voire au vide, par opposition à mi, qui dénote le contenu – qu’on pense au jaune ou au blanc d’œuf : kimi et shiromi. Karada, utilisé jusqu’au xviie siècle au moins pour désigner le cadavre, produit un effet visuel à la lecture selon qu’il est écrit en kanji ou en hiragana, donnant une impression beaucoup plus sensible dans le syllabaire. À ces quatre vocables peuvent s’ajouter d’autres termes, en sino-japonais ou en japonais, tels nikutai, pour l’expression du corps purement charnel, et les réfléchis, jibun, pour dire « soi(-même) », et jishin, qui inclut le caractère shin (corps). Pour la souffrance, les termes de base sont surtout nayami et kurushimi ; kunô et kumon sont aussi fréquents pour signifier plutôt la souffrance intellectualisée, avec une gradation de nayami à kunô puis à kumon ; kutsû existe également, mais se rapporte davantage à la douleur.
Il n’est ainsi que de constater l’étendue lexicale des termes liés au corps et à la souffrance, un champ de surcroît amplifié par la transdisciplinarité associée à l’approche littéraire. L’examen philologique informe le sens du mot, mais ne préjuge pas de sa production de sens en langage, objet de la praxématique, seule à même de régler le mot en contexte, de lui donner sa portée en tant que construction sociale et vision du monde. Et c’est à la littérature et à la linguistique qu’il revient de déterminer le réglage du praxème.
La philosophie est d’un apport précieux en ce qu’elle aide à dépasser, dans l’approche du corps, la polarité classique, voire stéréotypée, qui oppose au corps-esprit de l’Asie orientale la division cartésienne du corps et de l’esprit en Occident. Opposition toute relative, d’ailleurs, qui tend à s’estomper avec le processus d’alignement sur ses propres normes et modèles que ledit Occident, dans la seconde moitié du xixe siècle, impose plus ou moins à la Chine et au Japon, mais aussi avec l’orientalisation de l’Occident plus présente qu’en apparence. Une opposition toutefois assez forte ici ou là pour informer les représentations immanentes aux textes.
Et c’est à la phénoménologie qu’il revient, surmontant le clivage corps-esprit, d’opposer la théorie du corps subjectif à celle de la subjectivité pure et désincarnée de Kant et de lier le corps-effet au moi-cause sans remonter discursivement de l’effet extérieur à la cause intérieure. Le philosophe Michel Henry définit le corps subjectif comme un mouvement subjectif qui n’est pas intermédiaire entre l’ego et le monde car il est intentionnalité ou volonté intentionnelle : « Ego, corps, mouvement, […] ne font qu’une et même chose. » Il n’y a pas d’en-soi du corps. En ce sens, la parole, qui remanie les émotions, peut être une bénédiction autant qu’une malédiction, et la violence verbale, devenir un mode de l’intersubjectivité des corps. Ici, le mouvement subjectif unifiant, qui deviendra la chair dans la philosophie tardive de Michel Henry, s’accorde avec la nature historiquement mouvante d’un objet comme le corps, qui se décline aussi dans et par la progression du récit.
La philosophie apporte encore d’autres arguments non négligeables pour définir le corps souffrant. Paul Ricœur distingue ainsi douleur physique et souffrance psychique, en déclinant le souffrir selon deux axes : l’axe soi-autrui, où le corps, par degrés, se perçoit à vif, endure la douleur physique, peine à la communiquer, la subit de la part d’autrui et finit par se sentir élu par elle ; l’axe agir-pâtir, où le corps se trouve dans l’incapacité de dire, de se dire, d’agir, est donc diminué, mais c’est en parvenant à cet état de crispation que le sujet se met en état de décharger la parole qui peut le libérer. De même que le sujet se dit et s’affirme identitairement par l’expression de sa souffrance – en psychanalyse –, de même en littérature, mais à une nuance près, l’écriture est celle du non-dit, voire du silence sur la douleur éprouvée : d’où le recours à la litote, l’allégorie ou la métaphore. Les modes ou niveaux de construction textuelle du corps vont de la sensation sensori-motrice intersubjective à l’incorporation textuelle au moyen de quelque symbole. En fin de course, dans la régie littéraire du corps souffrant entre dire, vouloir dire, ne pas pouvoir dire et ne pas vouloir dire, c’est bien à la littérature qu’il revient de négocier cette tentative de verbalisation et, par là, de dire autre chose, entre quête de vérité et accomplissement esthétique – plutôt que ce qu’en disent les autres voies et disciplines du savoir et de la création.
De ces éléments définitionnels, d’ordre historique et philosophique, la critique littéraire peut tenir compte ou pas. Certes, elle ne peut pas ne pas croiser les sciences humaines et la philosophie, elle peut même adopter certains de leurs points de vue, mais elle peut aussi procéder par induction, interroger le tissu textuel avec ses propres outils. Par exemple, le style kinésique, repérable dans le texte à la dénotation d’un geste ou d’une mimique du personnage, expression parfois difficile à imaginer pour le lecteur mais significative, peut être rapporté à l’un des enjeux, voire à l’enjeu principal d’une œuvre. Le caractère intentionnel du mouvement implique, à partir du réflexe sensori-moteur, palpable par autrui, une dynamique intersubjective, inscrite dans la trame textuelle, repérable dans l’enchaînement des actions.
Ce qu’apportent les sciences humaines ne saurait infléchir, sauf à enfermer le texte littéraire dans une grille, la capacité de l’imagination poétique à renouveler l’approche du corps souffrant et à ouvrir – ne serait-ce qu’à partir d’un hapax apparent – des pistes inexploitées et donc à sonder. C’est sans doute l’originalité de la littérature que d’embrasser le réel autrement que par pur reportage, de le dépasser pour le subvertir, pour l’anticiper, pour ajouter du monde au monde. Par là, elle touche à des zones inouïes, pertinentes ou moins pertinentes, mais qui ouvrent d’autres possibilités d’approche de ce réel. Mais si l’analyse littéraire est susceptible, travaillant sur un matériau autre que le document historique ou sociologique, de déboucher sur des résultats inédits, il convient de les comparer, à terme, avec ceux des autres disciplines. Ainsi parviendra-t-on à une approche plus substantielle de l’histoire du corps souffrant dans tous ses états…
L’originalité du projet tient à son approche en étendue : la Chine, le Japon, et en corpus : canonique et populaire. Voilà deux aires, deux littératures nationales qui, après avoir vécu sur une image sensiblement identique du corps, voire du corps malade, affrontent, non sans un décalage socio-économique, le cortège des nouvelles empiricités, et expérimentent d’autres modes du corps, entre recompositions des anatomies (mannequins, etc.) et constructions de corps robotisés (cyborgs, androïdes, clones) ou virtuels, qui se confrontent aussi avec l’émergence de la notion de sujet.
L’enjeu de cette recherche concerne autant la spécificité de la représentation du corps souffrant en Asie Orientale que celle de chacune des littératures visées, de Chine et du Japon. Dans quelle mesure leurs représentations littéraires de la corporéité en souffrance – entre le dedans et le dehors, le physique et le mental, la nature et la culture, le réel et le virtuel – se rejoignent-elles, et pourquoi ? Comment articulent-elles l’incorporation lettrée du corps en mal de lui-même avec le corps du texte inscrit dans un corps social en proie à d’autres malaises, certes, mais aussi en quête d’équilibre ou d’une certaine esthétique ? Le processus d’hybridation et de métabolisation socio-culturelle, suscité par la réponse à l’étranger, est-il de la même nature sur la scène littéraire chinoise et japonaise, mais aussi sur d’autres ailleurs littéraires à l’heure de la mondialisation ? L’hypothèse de travail est qu’on passe d’une extériorisation du corps, produit d’importation, à son intériorisation subjective, mais que la pression des stimuli extérieurs – de la biopolitique en particulier – induit une tendance oscillant entre normalisation et esthétisation des corps en régime de souffrance…
Le même mouvement de spectacularisation du corps souffrant se retrouve partout. Entre pure et simple dénotation du corps et sa constitution en forme-sens (métaphore, allégorie, prosopopée, etc.), on passe, degré par degré, d’un corps absent ou présent en creux à un corps présent et pressant, qui compromet le sentiment qu’a le sujet (ou le groupe, pour le corps national) de son intégrité, de ce qui le constitue en tant que tel, et l’amène à réagir à la douleur et à la souffrance, c’est-à-dire à leur faire obstacle ou à les exploiter, toujours avec un ou des sens à la clé. Le rapport entre le genre littéraire et le mode d’écriture du corps importe à l’affaire. Alors que le corps est le plus souvent implicite au récit et n’a pas à être dit – il va de soi que la personne, l’actant si l’on veut, dispose d’un corps, faute de quoi pas de récit et pas d’identification possible du lecteur au personnage –, il est des genres axés sur la spectacularisation du corps, sur l’effet dramaturgique en somme – avec primat de l’hypotypose –, et ce à plus forte raison quand ce corps est en souffrance. C’est le cas du roman policier et du roman de cape et d’épée, ainsi que du théâtre, où le montreur, le corps exhibé et le public voyeur font bon ménage. Mais ce spectacle ne cesse d’osciller entre vérité et esthétique.
Du point de vue de l’évolution historique, le corps réagit d’abord comme il peut au choc de l’intrusion de la machine occidentale. Le malaise du corps se fait alors symptôme d’un mal de civilisation. Lu Xun pâtit du spectacle du corps démembré de ses compatriotes. Nagai Kafū (1879-1959) affecte d’une fièvre typhoïde le jeune héros de La Sumida (1911), dont le corps ne peut pas plus se plier aux exercices de gymnastique imposés par l’État de Meiji qu’à la mort annoncée de ce lieu des traditions qu’est la ville basse – shitamachi – à Tôkyô.
Mais la littérature se renouvelle aussi par l’exploitation proprement dramaturgique des nouvelles facettes du corps introduites en partie par la science occidentale, la scientia sexualis, sans renoncer pour autant à l’ars erotica. Ici, le récit de cape et d’épée de la Chine exhibe à souhait la souffrance de corps soumis au supplice, de corps dont la douleur physique est à hauteur de la noirceur morale du personnage qui la subit. Là, le polar japonais joue à découper les corps et à les recomposer à des fins d’esthétique, et, de la sorte, à susciter par empathie un mélange de souffrance et de jouissance auprès du public, et ce non sans quelque lien avec le cadavre exquis des surréalistes ou certaines techniques locales de composition poétique à plusieurs.
Il est vrai que, dans le cas japonais, la pathologie et même la psychopathologie de l’Occident sont passées par là et que le sadomasochisme trouve un terreau, qui lui permet de prendre du champ. Tout l’œuvre de Tanizaki Jun.ichirô (1886-1965) en prend acte. De même l’émergence du sujet à l’occidentale, avec l’amour dit romantique à la clé, est-elle à prendre en compte, car le naturalisme japonais, choisissant l’introversion plutôt que le discours social, exploite la dissection de ses tourments et place la chose sexuelle au centre de ses préoccupations.
La même insistance sur la maladie romantique, la subjectivité maladive et rongée de névroses dues à la frustration, notamment sexuelle, est développée par des auteurs chinois à partir du début des années 1920, en particulier Yu Dafu (1896-1945) ou Guo Moruo (1892-1978), qui ont découvert au Japon « roman du moi » et fantaisies macabres, ainsi que la théorie de Kuriyagawa Hakuson (1880-1923) sur la création comme expression symbolique de la frustration et de la mélancolie, thème qui sera au centre de la vie littéraire chinoise jusqu’à la moitié des années 1920. Quant à la thématique « décadente » d’un Tanizaki, elle continue occasionnellement à nourrir l’imaginaire littéraire chinois jusque dans les années 1940. Ces thématiques d’importation sont assimilées par les auteurs chinois, qui trouvent ainsi matière à exprimer leur propre discours de contestation de la famille, de la tradition, mais aussi de recherche d’affirmation nationale, et le thème libidinal se double alors ici de celui de la frustration en particulier face au Japon et à sa modernité.
À ce stade, il semblerait que la littérature de Chine ait pour enjeu le corps national plutôt que le corps individuel en souffrance ou, du moins, qu’elle ait eu souvent des difficultés à les dissocier l’un de l’autre et, de fait, elle évolue dans le sens d’un réalisme socialiste au service du peuple avant de céder le pas à une littérature des cicatrices, qui dresse le bilan effrayant de la Révolution culturelle. Mais la littérature du Japon, sensible aussi aux idéologies d’importation, produit une prose prolétaire sui generis, où le corps ploie jusqu’à la mort sous l’exploitation capitaliste, comme dans Le Bateau-usine (1929) de Kobayashi Takiji (1903-1933).
De la période de la République (1911-1949) jusqu’à nos jours, la Nouvelle littérature chinoise est en quête de l’expression qui rend sa voix à l’individu, au peuple, à la nation, aux victimes des violences politiques et historiques du xxe siècle : ainsi, un Mo Yan (1955-) cherche à démonter ou subvertir les récits officiels par la parole locale, un Han Shaogong (1953-) à réinventer une parole primitiviste. La littérature, républicaine en particulier, s’inspire autant de la pièce du dramaturge soviétique Sergueï Mikhaïlovitch Tretiakov (1889-1937), Hurle Chine ! (1926), que de la gravure expressionniste de Munch ou du jeu « biomécanique » de Meyerhold pour produire le cri de l’éveil. D’ailleurs, dès les années 1900, via les étudiants chinois au Japon, le théâtre moderne rejette la gestuelle et le chant codifiés et stéréotypés de l’opéra traditionnel au profit du « théâtre parlé » sur le modèle occidental : c’est la parole et la langue nationale nouvelle contre le corps hiératique du passé. L’élite aux idées modernes rejettera ensemble l’opéra classique « barbare » ; le grand acteur d’opéra Mei Lanfang (1894-1961) sera accusé par un révolutionnaire comme Chen Duxiu (1879-1942, l’un des fondateurs du PCC) de se complaire à jouer des rôles féminins devant les spectateurs japonais. Cette affirmation obsessionnelle du rôle masculin pour redonner une voix virile à la Chine affaiblie s’exprime par exemple dans le roman populaire best-seller de 1941, Bégonia (Qiuhaitang) de Qin Shou’ou (1908-1993), plusieurs fois adapté au cinéma, en théâtre, en série TV jusque dans les années 2000 : un jeune acteur de l’opéra chinois, au