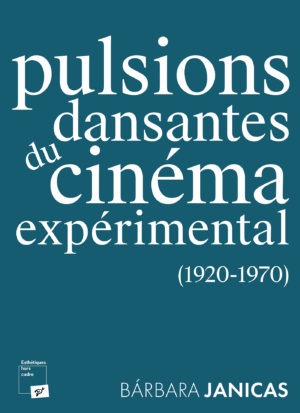La révélation des images
« […] ces pages représentent moins le souvenir des films que leurs traces, car seules ces traces, une fois reconstituées, permettent de remonter à l’origine du souvenir, – celui, quel qu’il soit, qui parlait dans une œuvre. »
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, L’Écran de la mémoire. Essais de lecture cinématographique (Seuil, 1970).
Mai 2014 : je vais voir dans une salle de cinéma un film qui m’intéresse mais ne me séduit pas vraiment. Il ne m’emporte pas complètement dans la réalité de sa fiction, il m’ennuie un peu, sa forme, ses formes me semblent belles mais elles sont trop visibles, trop léchées en tout cas pour que je me laisse agréablement couler dans le fleuve des images. Et soudain quelque chose arrive, un mouvement intempestif perturbe le flux plutôt calme de mes émotions. C’est une image toute blanche, elle dure quelques secondes et je sais immédiatement quel signal elle m’envoie : « Attention, danger. » Le film s’appelle L’amour est un crime parfait et il est l’avant-dernière réalisation d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. On y reviendra.
Cette sorte d’émotion met en prise directe la perception d’une image et l’idée d’un ailleurs, les superposant dans une coïncidence si exacte qu’elles se fondent l’une dans l’autre. Elle peut surgir à la faveur d’un travail de la mémoire qui sédimente les souvenirs en strates variées et spécifiques. La cinéphilie aura été une des formes vives et quasiment institutionnalisée de ce travail mémoriel qui a eu un écho intense et durable. Elle n’est plus de mise désormais. En effet, à quoi bon garder dans le coffre-fort de son seul cerveau des images qui sont disponibles pour n’importe quelle forme de reproductibilité collective et personnelle ? Les cinémathèques sont devenues chez les particuliers des vidéothèques en VHS puis en DVD, et à présent elles sont comprimées dans des disques durs dont la capacité d’emmagasinement d’images est virtuellement interminable. Pourtant, le travail de la mémoire continue à exercer son empire sur les spectateurs restés curieux du cinéma autant que des films. Et le temps aidant, la cinémathèque idéale de chacun ne cesse de se constituer, en partie selon la volonté de tous, en partie selon celle des films dont des images s’impriment dans la mémoire des spectateurs qui y consentent, parfois sans le savoir. Cette cinémathèque est mentale, elle est comme un pays singulier parce qu’il est construit par un seul maître d’œuvre et il en est le seul à arpenter les paysages, les routes principales, les sentiers dérobés, les lieux familiers, les lieux plus lointains, plus étranges. Or en ce lieu où se trouvent des images isolées, des séquences d’images, des titres de films, des noms de cinéastes, d’acteurs, d’actrices, de scénaristes, de monteurs, de monteuses, des dates, des appellations de studios, de courants esthétiques, d’écoles, de genres, etc., l’espace est construit par la mémoire. Elle est sélective parce que dans nos synapses les traces de faits perçus ou ressentis se conservent d’autant plus et d’autant mieux quand ils sont marquants, laissant ainsi une empreinte plus durable dans les neurones.
En matière de cinéma, comme de toute autre forme d’expérience de l’art, l’émotion esthétique est un moteur puissant et c’est bien notre mémoire du plaisir ou déplaisir esthétique qui donne la mesure du travail qu’elle accomplit à l’intérieur de nos pensées pour que des images s’y forment comme autant d’analogons plus ou moins fidèles de celles qui ont été vues sur un écran et ont provoqué un affect. Ainsi se souvient-on autant des films bien ou mal aimés que des films pas aimés dès lors que les uns et les autres ont exercé par endroits un pouvoir d’attraction suffisant pour que les fragments concernés se gravent dans notre mémoire. Et l’inventaire de tout ce qui s’y trouve comme ordonné dans une construction temporelle révèle quel pays de cinéma chacun habite. Car, au-delà de la simple mémoration, vient d’emblée la nécessité de la parole qui sert à décrire les objets mémorisés. Se souvenir d’un film ou d’une séquence amène immanquablement à les décrire, et donc à déjà en faire la critique, voire l’analyse, la mémoire étant un des outils qui aide à la constitution de ce que l’on peut alors appeler un « corpus ». Il s’agit bien d’un ensemble dans lequel se rangent des objets appariés selon les choix que notre mémoire a opérés. Certes, c’est une affaire de goût, d’inclination pour telle ou telle cinématographie, mais les émotions cumulées de chaque spectateur devant tous les films qu’il voit provoquent une parole réflexive et sont ainsi les leviers d’un accès à une forme de connaissance du cinéma. Cinéphilique ou non, savante ou profane, cette connaissance liée à une émotion esthétique d’empathie ou, au contraire, de désaffection est expérimentale et elle ouvre la possibilité d’une rencontre plus approfondie avec le cinéma. Elle permet notamment de repérer des communautés de films dont les affects de chaque spectateur ont débusqué des traits, ceux que son travail mémoriel, aiguisé par ses émotions, fait justement monter à la lumière d’un savoir conscient.
Corollairement, un deuxième fait, essentiel lui aussi, est à prendre en compte : désormais les films sont visibles ailleurs et autrement que dans les salles obscures. On les regardait assis dans la pénombre obligée d’une salle ad hoc et puis avec les magnétoscopes, les téléviseurs et les cassettes vidéo, on s’est mis à les visionner sur des petits écrans, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, n’importe où, chez soi ou dans des espaces publics. À partir de ce changement technologique majeur, qui a radicalisé la transformation de la vision des films, les spectateurs ont eux aussi changé et nul n’y a échappé. Les cinéphiles d’antan et les actuels manipulateurs de téléphones portables, de tablettes et de consoles en tous genres se retrouvent pareillement en position de maître du dispositif spectaculaire. Cela ne les empêche pourtant pas d’être comme leurs prédécesseurs des salles obscures dans les mêmes dispositions de croyance volontaire dans la réalité des récits filmiques. L’industrie du cinéma n’a pas cessé de viser cette disposition pour ainsi dire congénitale des spectateurs. Ils allaient au cinéma pour faire semblant de croire que, oui, le monde projeté était bien réel mais cette réalité avait ses limites, celles de la durée de la projection. Rien n’a changé à cet égard, les studios continuent à fabriquer des films qui créent des mondes dont la réalité est pure illusion et qui racontent des histoires dont la véracité est pure construction. Pour le spectateur cinéphile, ou critique ou théoricien de cinéma, un saut qualitatif s’est quand même accompli. En France, deux livres notoires en ont rendu compte ou, plutôt, en sont des symptômes parfaitement convaincants. En 1979, Raymond Bellour publie L’Analyse du film et, en 1988, Jacques Aumont et Michel Marie écrivent ensemble L’Analyse des films1. Les deux ouvrages laissent clairement apparaître comment le visionnement des films désormais possible plan par plan a été l’outil idéal d’un moment crucial dans l’histoire de la théorie du cinéma et des procédures d’analyse des films. C’est en effet la pensée de Christian Metz, demandant à chacun de dépasser la vision critique des films par une observation méthodologique, qui nourrit les fondements de ces deux ouvrages. La méthodologie en question est celle de la sémiologie et pour y parvenir il faut en passer par l’analyse la plus littérale qui soit, la plus exigeante aussi, comme une science exacte – découper le tout du film en la moindre de ses parties –, et le magnétoscope comme sa télécommande se sont alors mis au service d’un tel projet d’exhaustivité analytique.
Ce n’est pas tout. La méthode d’approche du cinéma par l’analyse sémiologique des films n’est pas une fin en soi. Surtout, elle est nourrie par un dehors du cinéma. Sur son versant esthétique, tous les arts et techniques de la représentation figurative, tous les modèles de récits la concernent. Sur son versant expressif, certaines sciences humaines sont présentes. La sémiologie metzienne, autant traversée par la linguistique de Ferdinand de Saussure et Roland Barthes que par la psychanalyse de Sigmund Freud et Jacques Lacan, en est un bon exemple. Mais par ailleurs, l’anthropologie de Claude Lévi-Strauss, la sociologie d’Edgar Morin, l’histoire de l’art de Rudolf Arnheim, Ernst Gombrich ou Erwin Panofsky, la psychologie de Hugo Münsterberg, la philosophie de Platon et celle de Gilles Deleuze, et aussi la sociologie, l’histoire, l’économie, etc., sont venues irriguer ce que l’on considère comme la théorie du cinéma. Chacune de ces sciences, elles-mêmes liées à des contextes idéologiques variables (exemples notables du structuralisme en sciences humaines dans les années 1950/1960 ou du règne des neurosciences aujourd’hui) lui ont en effet apporté des idées, des concepts, des savoirs sur des contextes différents, ainsi que des cadres méthodologiques spécifiques. C’est pourquoi l’évolution des approches théoriques du cinéma en passe aussi par l’évolution des méthodes de l’analyse des films. L’analyse sémiotique, initiée par Christian Metz à la lumière de la linguistique structurale et appliquée à un horizon de dévoilement des forces cachées agissant dans le for intérieur des protagonistes des récits filmiques, s’est peu à peu laissée glisser vers d’autres rivages de la pensée du cinéma. L’analyse selon Christian Metz était notamment fondée sur le concept freudien de « figurabilité ». Puis, regardant du côté de Jean-François Lyotard, l’analyse s’est assumée comme « figurale », s’aventurant ainsi plus avant dans ce que Luc Vancheri appelle « la voie d’une anthropologie figurative2 ». La conjonction des deux termes renvoie à l’histoire des images depuis leur surgissement figuratif dans les lointaines contrées du néolithique jusqu’à leur métamorphose technologique qui agrandit à l’infini le champ des possibles. Elle renvoie aussi à toutes les informations sur l’humain, ou l’humanité, que la moindre image laisse transparaître. L’anthropologie, il ne faut pas l’oublier, examine toutes les apparences des êtres, celles que la nature a imprimées sur le corps de chaque individu et aussi celles qui les font ressembler à d’autres individus, qui les lient à ces autres dans un espace-temps donné, qu’on l’appelle une civilisation ou une société. L’anthropologie s’intéresse aussi à ce qui n’est pas visible mais laisse pourtant des traces dans les profondeurs indicibles des individus et des sociétés. C’est ainsi par exemple qu’un même homme, Georges Devereux, a pu être à la fois un psychiatre et un ethnologue et qu’il fut l’un des fondateurs d’une nouvelle science humaine surgie dans les années 1960, l’ethnopsychiatrie. Le cinéma est allé à sa rencontre puisqu’en 2013, Arnaud Despleschin a adapté un de ses écrits, Psychothérapie d’un Indien des plaines : réalités et rêve3, récit d’une analyse qu’un Indien pieds-noirs des États-Unis entreprit avec Georges Devereux.
Il n’est alors plus impossible de se retourner sur l’analyse filmique elle-même. En la considérant pour ce qu’elle est substantiellement – un outil méthodologique servant à l’élaboration et à l’exploration d’une « science » du cinéma –, elle est prise dans le courant de l’épistémologie qui traverse et détermine tous les savoirs. Le mot « analyse » et la sorte d’opérations intellectuelles qu’il désigne concernent tout le champ des sciences dites « humaines » et des sciences dites « dures » ou « exactes ». Ainsi est-il riche d’une polysémie qui peut entraîner des variables dans la posture analytique. L’une d’entre elles, parfaitement bien symbolisée par la rencontre que l’on vient d’évoquer entre ethnopsychiatrie et cinéma, fait cristalliser la double nature de l’opération de l’analyse. Devant son écran, l’analyste de film observe et décrit les images en fonction des paramètres filmiques qui les constituent en objets de cinéma. Dans son cabinet de travail, l’analyste écoute et ordonne la parole de ses patients en un tissu qui raconte des récits insoupçonnés de ces derniers. Par-delà l’apparence des images, l’analyste de films rend compte du travail de la caméra, du montage, des acteurs, etc. Au-delà des mots articulés par ses patients, l’analyste rend explicite le travail de bascule entre le conscient et l’inconscient de ces derniers. Il « interprète » leurs paroles pour autant qu’il les engage dans l’auto-analyse. Il n’est pas impossible, ou pas interdit, d’analyser les films en conjuguant les deux postures, encore faut-il prendre quelques précautions à la fois sur la méthode et sur l’objet.
On entre ici, en effet, dans le domaine d’une analyse filmique dont on peut dire qu’elle sera « interprétative », plutôt que « sémantique » ou « sémiotique ». La psychopathologie connaît l’analyse interprétative. Elle est liée à une approche phénoménologique des patients. Leurs récits apportent au thérapeute une matière subjective à son écoute qui est elle aussi subjective, et l’interactivité entre les deux est le moteur agissant d’une construction analytique commune : pour les patients, les processus selon lesquels ils mènent l’analyse avec leur thérapeute deviennent conscients car ils contribuent à les élaborer au fil de la cure4. Mais avant la moderne psychopathologie, il y eut Sigmund Freud et sa « technique psychanalytique ». On peut lire dans un article homonyme ce conseil qu’il donne à de futurs analysants : « Dites tout ce qui vous passe par l’esprit. Comportez-vous à la manière d’un voyageur qui, assis près de la fenêtre de son compartiment, décrirait le paysage tel qu’il se déroule à une personne placée derrière lui5. » Ne croirait-on pas voir dans un tel propos une annonce du premier chapitre de L’Œil interminable dans lequel Jacques Aumont compare le spectateur du cinéma au voyageur du train ? Mais aussi bien, dans Le Vocabulaire de la psychanalyse de Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, on trouve déjà un écho saisissant de la phrase de Sigmund Freud quand les auteurs donnent leur définition d’un processus utilisé dans la cure psychanalytique, l’association libre :
Association libre : méthode qui consiste à exprimer sans discrimination toutes les pensées qui viennent à l’esprit, soit à partir d’un élément donné (mot, nombre, image d’un rêve, représentation quelconque), soit de façon spontanée6.
L’association libre autorise en effet que l’on dise, comme Sigmund Freud le préconisait, « tout ce qui [nous] passe par l’esprit » et le train qui emmène le voyageur sur des rails invisibles, qui enroule le paysage tout au long d’une ligne à la fois discontinue et ininterrompue, est une machine à créer à partir d’un paysage bien réel de l’illusion, de l’inattendu, de l’intempestif. Si un voyageur se prend à dire ce qu’il voit, il y a de fortes chances pour que son récit soit celui d’une fiction vécue par lui, et lui seul. On peut évaluer un film comme un voyageur le fait d’un paysage traversé par un train. C’est un objet déformé par la vue et l’écoute que l’on en a. C’est un objet paradoxalement subjectif. En fait, il est singulier.
Qu’est-ce à dire ?
Le protocole d’analyse des films, du moins de ceux qui sont conçus pour être vus sur les grands écrans des salles de cinéma, est déplacé, à la fois dans l’espace-temps et dans ses modalités. L’analyse interprétative se met en place en effet dès lors que la projection commence. Les images se font voir, se font entendre, les péripéties s’organisent en récits, les protagonistes se construisent en personnages, se devinent en acteurs, le film suit sa pente naturelle jusqu’à la fin qui elle-même s’abîme dans le courant plus ou moins abondant d’informations en tous genres sur ce qui, dans le hors-cadre, s’est trouvé derrière les caméras pour que celles-ci puisse fabriquer les images de tout ce qui a été posé devant elles. Soit. Mais, incluses dans ce même espace-temps du spectacle filmique, d’autres péripéties – voire d’autres évènements – peuvent advenir. Chaque spectateur en son lieu est concerné. Il est bien sûr « le spectateur tout-percevant » de la sémiologie metzienne, une instance collective. Il est aussi une singularité, et l’histoire que chacun voit et entend n’est peut-être pas tout à fait la même que celle perçue par son voisin assis dans un fauteuil semblable au sien, mais lui aussi installé en son lieu propre. Le constat est certes banal. Pourtant, il faut encore se dire que les images des films, quoiqu’offrant une apparence univoque pour tous les spectateurs d’une même projection, sont elles aussi des singularités. S’inscrivant sur l’écran collectif, extérieur, elles viennent dans le même temps s’imprimer sur l’écran intérieur de chacun, dans la boîte noire du cerveau qui est lui-même une fabrique d’images et de récits, par exemple quand la mémoire travaille ou quand des rêves se forment. L’analyse interprétative s’engendre à cet endroit précis de la rencontre entre deux mondes d’images, deux modalités de leur mode d’existence. Pour le dire autrement, les images venues du dehors à la rencontre de leurs spectateurs peuvent faire se lever dans leur cerveau des images qui y sont peut-être déjà, ou qui n’attendent que de naître pour venir former une nouvelle cohorte d’images que les films ne montrent pas mais dont ils provoquent le surgissement dans l’imaginaire – ou l’imagier – intime de chacun.
C’est à cet endroit que le processus de l’association libre est susceptible de jouer un rôle dans l’analyse de film. On peut en effet se servir des images ainsi révélées – à tous les sens du terme – pour revenir vers les films et les interroger à la lumière de l’éclairage qu’elles leur apportent. On entre alors dans le monde de l’interprétation puisque les films analysés sont abordés comme on aborderait un rêve. Les images qu’ils disposent devant nous et qui s’ordonnent dans des histoires souvent archétypales renvoient à d’autres images, qui elles ont une existence purement virtuelle et ne font leur preuve que sous le mode de la projection mentale. Or n’est-ce pas ainsi que Sigmund Freud avait conçu le statut des « images latentes » servant de matériau de base aux images de rêves, les faisant cristalliser en constructions oniriques plus ou moins mystérieuses et déchiffrables après coup ? Et l’on sait que les neurosciences contemporaines, pourtant très critiques par rapport à la psychanalyse classique, admettent que la méthode freudienne d’exploration permet bien d’accéder au contenu latent des rêves7. Quand les films sont considérés par leur analyste comme le tenant-lieu de rêves, le rêveur dont il s’agit est lui-même, mais c’est un autre moi, un alter ego, à savoir le spectateur qu’il aura été pendant un certain temps, immergé dans une parenthèse spatio-temporelle dont on a déjà si souvent souligné qu’elle était nocturne ou pseudo-nocturne, qu’elle faisait de chacun un être clivé, passif et content de l’être. Après coup, revenant vers les films, l’analyste est éveillé, il l’est doublement. En tant qu’outil d’une connaissance spécialisée, le regard analytique porté sur les films prend en compte tout ce qui fait d’eux des objets cinématographiques offerts à l’étude et que l’on peut répertorier comme tels. Dans le même ordre d’idées, chaque film est un élément dans un réseau qui peut être esthétique, historique, commercial, sociologique, etc. Et enfin, chaque film parle une langue, celle du réalisateur, au sens large (cinéaste, équipe technique, acteurs, actrices, studios, producteur, pays, etc.). L’analyse sémiologique parlerait aussi de « l’énonciateur », elle évoquerait les modalités d’organisation de la « diégèse » par le « récit ». Avec l’analyse interprétative un autre niveau de déchiffrement intervient en parallèle à ce premier niveau. Considérant que les films énoncent ce qu’ils disent et qu’ils figurent aussi bien ce qu’ils ne disent pas, surgit la question si répandue de l’auteur (au sens large là encore), de ses intentions. Elles n’importent pas à l’analyse interprétative puisque celle-ci, à partir de la perception synchrone des images vues et des images cachées, déchiffre les faits filmiques comme des symptômes, des traces d’un discours adressé à son déchiffrement à travers des signes visuels et sonores qui en sont les manifestations déguisées. C’est ainsi que certains films peuvent être pour l’analyste le tenant-lieu de rêves qu’il n’a pas faits. Ils semblent bel et bien porteurs d’images, de sons, de figures, de récits qui sont disposés – pour tel ou tel spectateur isolé dans sa libido analysandis – comme autant de formations de rêves. C’est en ce sens qu’il y a interprétation puisque l’analyste construit un va-et-vient descriptif et discursif entre les images réellement perçues par lui lors de la projection et celles qui, par le jeu d’associations à l’origine incontrôlées, se sont levées dans sa vision intérieure.
Et l’analyste peut bien savoir que s’il interprète tel film plutôt que tel autre, c’est parce que le film choisi vient justement à lui comme un morceau de rêve. Sorti du rêve, il peut faire comme le patient sur le divan du psychanalyste, il peut continuer à pratiquer le jeu des associations libres. Cette fois, il s’agit pour lui de construire un réseau d’images à partir de celui éclos lors de la projection, qui en sera ainsi le fondement génétique. On ne vise pas la seule intertextualité cinématographique et ses nombreuses déclinaisons8. En effet, l’intertextualité ici mise en œuvre est plutôt du côté de l’analyste, de sa mémoire des effets que des images ont produits sur lui. Elle est corrélée à une approche des films par l’analyste qui n’est pas seulement fondée sur sa culture du cinéma mais sur une pensée plus large. S’il est « tout-percevant », il est aussi « tout-pensant » selon un dispositif dont les avancées technologiques successives n’ont fait que renforcer la possibilité. En effet, ce dispositif de la projection est maintenant domestiqué et le spectateur innocent du cinéma en salles n’existe plus. Il n’y a alors plus de premier degré du spectacle cinématographique. C’est à cet endroit que le spectateur tout-pensant peut souhaiter récupérer ce trésor peut-être perdu. Comment faire ? Telle est la question de l’analyse interprétative, celle qui demande aux spectateurs d’être très attentifs aux effets de la projection. Et quand ils entrent après cela dans le territoire de l’analyse, ils peuvent asseoir le visionnement des images étudiées sur ce matériau. Geste banal mais, à travers lui, on peut aller au-delà du déchiffrement des signes que les images projetées ont émis à l’intention de leurs spectateurs. Ces derniers se lancent des signes à eux-mêmes et c’est la rencontre des deux, leur reflet mutuel dans un miroir déformant, qui donnent le cadre à l’intérieur duquel chaque analyse peut se déployer.
C’est ce que l’on a fait ici. On a été attentive aux coïncidences concrètes et pourtant immatérielles, abstraites entre quelques images, quelques séquences, quelques films qui ont déclenché le travail de l’analyse, comme on le dit du travail du rêve. On est alors parti à la recherche du cinéma perdu dans les tréfonds de la mémoire afin de construire un réseau d’images par lequel se manifeste une histoire de certaines formes du cinéma. Elle en passe par des films a priori éloignés. C’est qu’à partir des quelques films visés par l’analyse, d’autres ont surgi après coup. Les films premiers, La Dame de Shanghaï, Les Harmonies Werkmeister, Holy Motors,