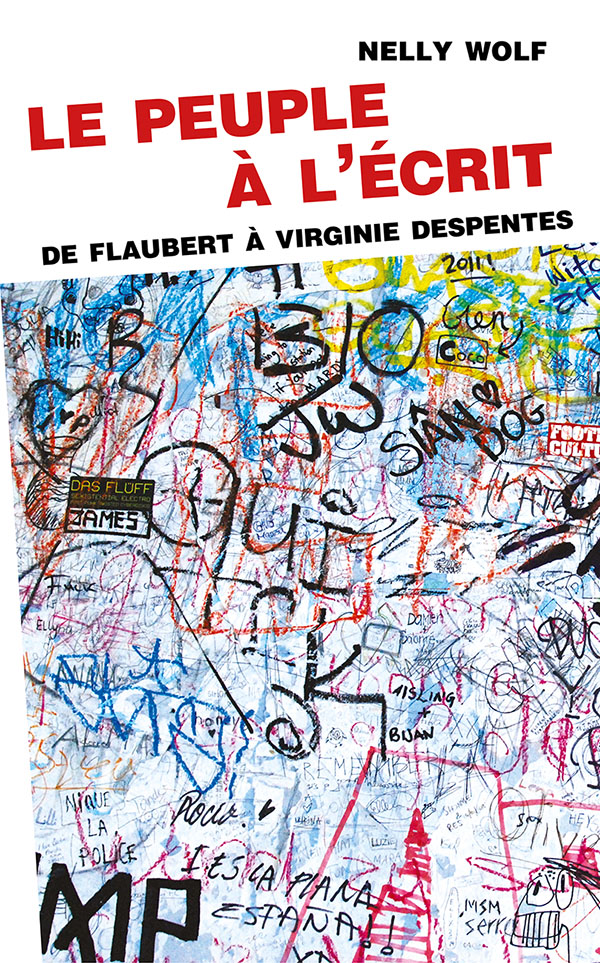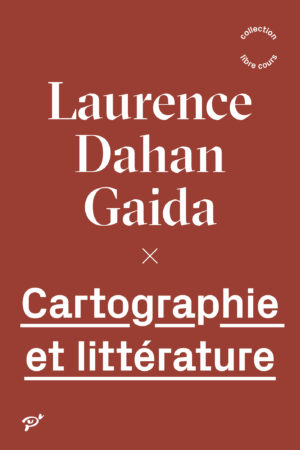Introduction
L’avènement d’internet a été pour beaucoup d’intellectuels, pour peu qu’ils fussent nés avant l’ère du numérique, un phénomène déroutant. Ils ont vu affluer sur la Toile la foule des quidams et des anonymes dont la prose souvent affranchie des règles de l’orthographe et de la syntaxe leur soumettaient des raisonnements qu’ils jugeaient simplistes et des préjugés qui n’étaient pas les leurs. Espace public global, internet était devenu le lieu et la place d’un universel commentaire. Tout le monde et n’importe qui s’autorisait désormais à écrire sur tout et n’importe quoi, et parfois n’importe comment. Cette gigantesque prise d’écriture par le tout-venant a exercé, sur les professionnels de la chose écrite, à la fois de la séduction et une pression anxiogène. D’un côté, on a espéré que la généralisation des activités rédactionnelles apporterait un exceptionnel progrès démocratique sur les plans culturel et politique. D’un autre côté, on a craint la défiguration de la culture écrite. L’apparition des sites de création littéraire et des plates-formes d’autoédition a suscité de nouvelles interrogations, soulevé de nouveaux défis. L’écrivain était voué jusqu’à présent à raconter non seulement sa propre vie mais aussi d’autres vies que la sienne. Allait-on se passer de lui dès lors que tout un chacun pouvait, s’autorisant de soi-même et indifférent à toute évaluation ou consécration institutionnelle, publier son propre récit ?
Or, si on est attentif à l’histoire, on constate qu’un phénomène identique s’est déjà produit. Il a débuté au xixe siècle et a répandu ses effets sur les époques suivantes. Après la Révolution française les classes laborieuses et les gens ordinaires se sont emparés des pouvoirs de l’écrit. À mesure que progressait la scolarisation, des populations entières jusque-là éloignées du savoir graphique ont eu accès à ses symboles et à ses signes. Non seulement les nouveaux scripteurs se sont familiarisés avec les pratiques rédactionnelles domestiques et privées (correspondance, agenda, liste) mais ils se sont infiltrés dans les sphères lettrées et savantes ou se sont mis à interagir avec elles : ils ont adressé des lettres aux auteurs, aux journaux, ont tenu un journal intime, et finalement écrit et publié à leur tour des discours, des articles, des poèmes, des pièces de théâtre, des romans.
Comment la littérature, comment les écrivains professionnels, qui jusqu’alors détenaient sinon un monopole, du moins un magistère sur la langue écrite dont il leur incombait souvent de fixer l’usage, ont-ils accueilli ce nouveau partage ? Comment ont-ils réagi à cette concurrence inédite ? Y ont-ils vu une ressource ou une menace ?
Ce livre tente de répondre à de telles questions, non pas en recherchant dans les archives des écrivains telle déclaration de presse pour ou contre l’accès des masses à l’écriture, tel jugement sur l’art d’écrire du peuple, mais en explorant les textes littéraires eux-mêmes. Un personnage original, le scripteur populaire, un actant singulier, le peuple à l’écrit, se sont introduits dans les fictions littéraires. On a tenté d’étudier les formes qu’ils y ont prises. Un ordre communicationnel s’est instauré, différent de ceux qui l’avaient précédé. On s’est attaché à détecter sa présence et mesurer ses répercussions dans les intrigues littéraires, y compris les intrigues linguistiques. Ce faisant, on a rencontré, bien entendu, des déclarations pour ou contre l’accès des masses à l’écriture, et des jugements sur l’art d’écrire du peuple.
Le premier chapitre, « Écritures ordinaires », a une visée plus ou moins panoramique. Sans prétention à l’exhaustivité, il s’agissait approximativement de recenser les transformations induites dans le champ littéraire par la démocratisation de l’écrit : nouveaux profils d’auteurs, nouvelles typologies narratives, nouvelles possibilités stylistiques. On a traité à part, dans le deuxième chapitre intitulé « Apprendre à écrire ? », le cas d’espèce constitué par les épisodes et les romans scolaires. L’école est l’atelier où le peuple est mis à l’écrit. Pour la littérature, c’est le laboratoire où se fabrique une langue, où s’expérimente un partage linguistique qui conditionnent et modifient sa propre situation dans l’espace communicationnel, et qu’elle est donc appelée à observer avant d’en tirer des modèles à suivre ou des motifs de rejet. Le troisième chapitre, « La revanche de l’oral », part d’un constat : traditionnellement, quand on représente la langue des classes populaires, on met en scène leur parole vive, leur oralité. Dès lors que cet imaginaire traditionnel est contesté par l’apparition du peuple scripteur, des équilibres sont rompus, d’autres sont établis. Ce troisième chapitre est conçu pour être un prolongement du deuxième, car une grande partie de la négociation entre écrit et oral se joue à l’école et c’est bien là que les écrivains la localisent. Enfin dans le dernier chapitre, « La faute et la marge », on s’est intéressé à l’association fréquemment répétée entre la faute d’écriture et les marges sociales. Autant et même peut-être plus que la faute orale, il semble que la rédaction défectueuse contribue à définir et redéfinir, entre stigmatisation et sublimation, la représentation littéraire des pathologies sociales, des vies précaires, des destins déviants, des dérives criminelles.La réflexion s’appuie principalement sur un corpus de huit auteurs témoins, dont l’œuvre, ou les œuvres, coïncidant avec les principaux moments de l’histoire contemporaine, éclaire les principaux enjeux de la confrontation entre écriture littéraire et écriture ordinaire. Ces huit auteurs sont Marcel Proust, Colette (début du xxe siècle), Louis Guilloux, Henry Poulaille (années 1930), Annie Ernaux, François Bon (deuxième moitié du xxe siècle), François Bégaudeau et Ivan Jablonka (début du xxie siècle). Autour de ce noyau dur ont été convoqués d’autres écrivains qui, depuis Gustave Flaubert jusqu’à Virginie Despentes, ont mis en scène le scripteur populaire et noué une intrigue autour de son activité rédactionnelle. Les textes étudiés sont presque exclusivement des romans, mais le théâtre est également cité en exemple.
Ce livre fait écho au Peuple dans le roman français de Zola à Céline, publié il y a presque trente ans et qui déjà posait la question de la représentation de la langue du peuple, à l’oral et à l’écrit. À l’époque, afficher le mot « peuple » au fronton d’un ouvrage d’histoire littéraire ne soulevait pas d’objection majeure. Quelques années auparavant, Geneviève Bollème avait publié Le Peuple par écrit. Depuis, le vocable s’est opacifié ; la dénomination des classes populaires s’est fractionnée en syntagmes divers, à la suite des transformations sociales et des déplacements symboliques qu’elles ont entraînés. Pourtant, le peuple est par essence un concept problématique. Il renvoie au moins à trois réalités, désignées dans l’Antiquité par trois mots différents : demos, ethnos et plebs, soit le corps politique, la nation, et la foule qui fait l’opinion. Aux xixe et xxe siècles les démocraties occidentales prétendent faire fusionner ces entités (en particulier la souveraineté politique et le principe national), mais, note Pierre Rosanvallon, au prix d’une scission entre la composante sociologique et la composante politique de la démocratie. La fraction dominée du demos, confinée dans une citoyenneté incomplète, ne participe pas vraiment à la souveraineté. De toute manière, le terme reste contradictoire, « monstrueux » même, selon Valéry, renvoyant à la fois au tout – la société – et à la partie – les classes défavorisées. Malgré ce contenu problématique, le mot a continué à circuler, chacun le dotant du référent de son choix.
Aujourd’hui, cependant, le mot semble en fin de carrière. Le titre du recueil publié en 2013 par Alain Badiou est emblématique : Qu’est-ce qu’un peuple ? L’article défini a été abandonné. Le peuple ne fait plus les titres. Au plan politique, il n’apparaît plus guère que dans le discours populiste, notamment à l’extrême-droite, qui l’emploie dans son acception ethnico-politique (le peuple français), ou pour l’opposer aux « élites ». Jean-Luc Mélanchon invoque aussi volontiers « le peuple », opposé à l’« oligarchie », mais redoublé par un singulier syntagme : les gens. Le reste du personnel politique les imite parfois, par opportunisme. Ailleurs, dans la langue des sociologues et des historiens, dans celle des médias ou autres « faiseurs d’opinion », le terme s’est fait rare. On le trouve plus volontiers sous sa forme adjectivale. On parle des classes populaires, des quartiers populaires, plutôt que du peuple. Souvent, il est remplacé par d’autres syntagmes parmi lesquels « les gens ordinaires », les « vrais gens », remportent la palme du succès ou de la… popularité.
On s’aperçoit alors que le peuple était un concept qui servait surtout à signifier, et en la signifiant à la construire, la place centrale du prolétariat national dans le contrat démocratique. Le prolétariat réalisait la fusion impossible du corps social et du corps politique de la démocratie.
À mesure qu’on s’éloigne de la Seconde Guerre mondiale, ce cadre notionnel se dissout. Le rôle économique et social de la classe ouvrière a décliné. Largement investie par les populations immigrées, elle n’est plus identifiée au prolétariat national.
Si nous avons conservé le terme dans notre titre et nos développements, c’est que, jusqu’à Annie Ernaux au moins, il est encore opératoire pour rendre compte des personnages et des situations fictives présents dans notre corpus. En revanche, il n’est pas sûr que les marginaux de Bon, les collégiens de Bégaudeau, soient encore « le peuple ». C’est pourquoi nous avons recouru, dans la rédaction des chapitres, à la palette des synonymes et termes de substitution. Nous avons notamment eu recours à l’adjectif « ordinaire ». Renvoyant à la notion d’ordre normal, au banal, au quotidien, ce terme se rapproche d’une valeur quasi stylistique. Il qualifie ce qui appartient à tous et ne distingue personne. Dans cette acception, le peuple, c’est le tout un chacun de la démocratie. Un collectif qui est une collection d’individus.
Nelly Wolf