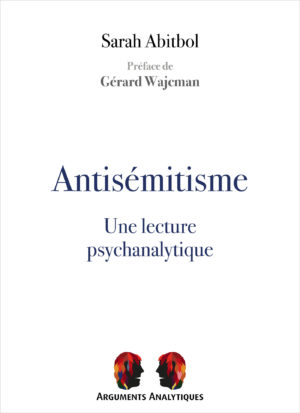Préface :
Avant de se figer sous la forme de la familière bille bleue immortalisée par la NASA, la Terre a eu moult visages. Terre liquide, terre magnétique, terre creuse, elle a fait l’objet d’études et de spéculations nombreuses. Tout au long de la Renaissance, on s’interroge sur ses profondeurs, sur les usages du sol, sur l’histoire des montagnes et sur la provenance des fossiles. On en fait un corps parcouru de courants secrets et de flux souterrains. Loin du globe lisse auquel nous pensons en entendant le mot Terre, c’est une entité plurielle, multiple, mouvante, complexe, vivante et riche qui surgit des textes et images de cette époque : Ex terra. Vivre avec les sous-sols 1, de Phillip John Usher, donne à voir la multiplicité de ces terres oubliées qui forment le socle de notre modernité. Dans ce parcours fascinant à travers les mondes souterrains, on croise démons des mines, lutins et taupes. Mais ce sont moins les trolls et autres créatures fantastiques souterraines qui intéressent Usher, que la manière dont ils manifestent une conscience aiguë de l’animation propre de la matière. Le livre donne à voir une terre au travail, magnétique et sensible, changeante, capricieuse, fascinante et indomptable. Dans toutes ses strates, il y a du vivant, de l’animé, que les textes et images de l’humanisme européen tentent de décrire et de saisir. La Terre qui se fabrique tout au long du xve et du xvie siècle est tout sauf inerte. Que dissimule sa surface ? Quelle forme, quelle taille, quelle nature, quelle structure, quelle origine et quelle fin attribuer à cette planète dont on commence à prendre la (dé)mesure ? Ce sont de telles questions qui animent les auteurs, ingénieurs, cartographes et savants du xvie siècle, période qui pose à nouveaux frais la question du statut de la Terre, fondant les bases d’une géographie étendue touchant aux domaines que nous nommons aujourd’hui archéologie, cartographie, climatologie, géologie, hydrographie, topologie, météorologie, géomorphologie ou stratigraphie. Cette Terre multiple fait l’objet de nombreux débats : un débat cosmogonique sur les origines du monde, un débat cosmologique sur son statut de planète ou d’astre, mais aussi un débat économique et écologique, en quelque sorte, concernant ses représentations et ses usages. C’est sur ce point précis, particulièrement vif pour nous aujourd’hui, que se situe l’enquête de Phillip John Usher.
Grand animal, éponge, corps sensible et réactif : l’idée d’une terre vivante et animée est une évidence à la Renaissance. Usher nous permet de comprendre non pas l’étrangeté de cette idée, mais plutôt celle de l’abandon de cette idée. Comment l’âge classique a-t-il réussi à effacer si radicalement cette notion ?
La coupure entre sciences de la terre et sciences de la vie, entre deux conceptions antagonistes de la Terre – la terre des vivants et la terre des non-vivants – est ancienne, et perdure jusqu’à aujourd’hui. Or, depuis la fin du xxe siècle, une nouvelle image de la Terre se dessine. Les sciences du système-Terre associées à la biologie transforment en profondeur notre relation au monde qui nous entoure, au point d’accomplir un renversement vertigineux : nous sommes en train de comprendre que les vivants ne se contentent pas d’occuper le monde, mais aussi qu’ils le font, le créent et le sécrètent. Une autre image se dessine : non plus des humains « sur » une Terre ou « dans » une Nature dont les bienfaits sont disponibles, exploitables ; non plus des humains en « interaction » avec leur environnement et les autres vivants ; mais une tout autre vision, nourrie des recherches contemporaines sur le système Terre, qui rejoignent souvent les intuitions de la Renaissance.
Par l’exploration des textes qui tentent de la saisir, Usher parvient non seulement à retracer une autre histoire de la Terre, mais aussi à en multiplier les images, redonnant ce faisant une plasticité à nos représentations, et brouillant la frontière entre l’inerte et l’animé. Dans cette entreprise pour décliner les visages de la Terre, la pluralisation concerne aussi et surtout les disciplines et les niveaux épistémologiques à l’intérieur desquels la question se pose. Il s’agit moins de répertorier les différentes propositions cosmologiques et géologiques qui se multiplient du xve au xvie siècle que de montrer que ce que l’on croyait être un simple problème épistémologique est aussi une énigme artistique, littéraire, technique, économique. Par les textes, les artefacts, les machines, les récits qu’il analyse, Usher offre des pistes passionnantes pour répondre à cette question devenue pour nous si urgente : que signifie habiter avec une Terre réactive ?
Dans ce qui est à la fois une plongée dans les profondeurs de la Terre et dans les profondeurs du temps, Usher excave une histoire complexe et tourmentée de la relation des humains au terrestre, dans toutes ses acceptions : la Terre, la terre. Car à cette période se construit progressivement le modèle esthétique et politique de la Terre comme globe, cet astre révélé par le regard surplombant et vertical qui s’invente au xvie siècle. Cette image fascine, par la beauté de la Terre vue de loin, par l’efficacité de cette vision globale. Mais elle oblitère la terre comme lieu arpenté, sensible, appréhendé par un regard de proximité, par un corps se déplaçant et construisant une perception de l’espace au plus près des gestes, des mains qui creusent le sol, cueillent les plantes, ramassent les pierres, en font des abris. Comment retrouver l’expérience phénoménologique de ce que signifie « habiter la terre » ? Usher part à la recherche d’autres images, plus épaisses, plus rugueuses que nos images lisses. Cette quête se fait avec des outils variés : textes littéraires, images, traités techniques. L’ouvrage va de la Terre à la terre et fait de ces textes érudits, techniques, poétiques ou philosophiques du xve et du xvie siècle son terrain : c’est là une manière singulière de mettre la main dans la glaise, d’accéder à la matérialité du sol. On passe du territoire au terrestre, au sens de Bruno Latour, en un va-et-vient constant, et fructueux, entre la matière et la théorie. Ou plutôt, l’ouvrage démontre combien les questions matérielles sont toujours déjà des questions philosophiques. C’est autour de ces gestes, pratiques et objets de la culture minière que se rejoignent et s’articulent l’histoire humaine (technique, économique, littéraire) et l’histoire géologique, dans une concaténation du temps long de la géologie et du temps humain que Dipesh Chakrabarty a nommé la géohistoire. Ce faisant, de mines en forges, c’est un concept singulier qui émerge au cours de l’enquête : l’exterranéen. Le terme désigne le processus complexe par lequel l’invisible, le caché, le souterrain, devient visible, extérieur, utilisable et, ce faisant, exploitable. On est là au cœur d’un sujet qui occupe nos journaux comme nos poumons : Usher rappelle une évidence qui est l’un des impensés de notre temps (et des grands traités internationaux sur le climat) : de même qu’il n’y a pas de fumée sans feu, il n’y a pas d’émissions sans extraction.
Portrait de l’humain en animal qui creuse, le livre décrit l’extraction comme fait anthropologique majeur. Comment rendre compte de cette compulsion à creuser ? de cet étrange tropisme vers les sous-sols ? de cette irrépressible envie d’extraire ? Les textes fondateurs de notre relation à la Terre apparaissent ainsi sous un nouveau jour : Montaigne permet de révéler le lien profond entre colonisation et extraction ; la Cosmographia de Sebastian Münster, le rapport entre globalisation et extraction ; le De re metallica de Georgius Agricola éclaire d’une lumière crue le lien entre destruction et extraction. Dans sa lecture approfondie et sophistiquée de cette « bible des mineurs », Usher analyse les contradictions logiques et les apories de la défense de l’activité minière par Agricola, analyse qui pourrait être utilement appliquée aux justifications contemporaines de l’extractivisme.
Résultat de l’extraction, la terraformation est ici abordée dans une perspective nouvelle, celle du temps long. De fait, la question de l’influence néfaste de l’intervention humaine (on ne disait pas encore forçage anthropique) sur la croûte terrestre est posée depuis au moins Ovide, nous rappelle Usher, et ce, de manière nuancée : ce n’est pas la terraformation en tant que telle qui est condamnée, mais plutôt un certain type de terraformation, celle qui abîme la Terre au point de s’opposer à cette autre terraformation, vitale, elle, qu’est l’agriculture.
Issues de cette archéologie littéraire foisonnante, quelques pépites : la Terre comme mère dont les entrailles sont profanées par les mineurs ; la Terre et son manteau tissé d’animaux et de végétaux, mais qui se révèle troué et abîmé par les excavations ; la Terre fertile dont la puissance de vie (et notamment la capacité à produire des vignes) est asséchée par son mésusage. Corps déchiqueté, violenté jusqu’au sang, violé et profané : c’est toute une sédimentation méta-phorique que Usher, en archéologue des textes, dévoile patiemment. La méthode est dictée par les textes mêmes, et associe l’étude des pratiques et l’étude philologique, l’attention aux gestes et aux mots, l’étude des textes et la lecture des images.
Il faut s’attarder sur le sous-titre de l’édition américaine, qui donne le cadre méthodologique et conceptuel de l’étude : Extraction dans l’Anthropocène humaniste. C’est un dialogue vertigineux à travers les siècles entre l’homo de l’humanisme et l’anthropos de l’Anthropocène que met en scène l’ouvrage. Ce faisant, en historien de la littérature et en érudit, Usher propose de tester l’une des hypothèses les plus audacieuses du dernier Latour : notre proximité avec la période qui se situe juste avant la Modernité. C’est là l’une des originalités et des forces conceptuelles du livre, qui fait dialoguer avec brio non seulement des périodes historiques éloignées, mais des disciplines et des épistémologies différentes : va-et-vient entre œuvres contemporaines et œuvres de la Renaissance, entre analyse philologique et expérimentations artistiques contemporaines. Il s’agit tout autant d’un dialogue entre écologie et littérature, dans le contexte d’une « écopensée » qui ne se limite pas à l’écopoétique et à l’écocritique mais qui embrasse les questionnements des humanités environnementales, de l’anthropologie de la nature et de la philosophie contemporaine, de Michel Serres à Bruno Latour. Car le livre pose la question essentielle de la position du sujet : si l’anthropos reste extérieur (car le terme même suppose l’objectivation du sujet, symptôme de la posture moderne), l’homo de l’humanisme s’inclut, lui, d’emblée dans le tableau : « How this subject position can lend its agency to the undifferenciated anthropos of our time ? » L’ambition théorique de cet ouvrage à l’érudition impressionnante est, on le voit, résolument tournée vers le présent. C’est l’humain du xvie siècle qui vient à la rescousse de l’anthropos du début du xxie siècle, en lui offrant un sujet.
Frédérique Aït-Touati
1. NdE : le titre original de l’ouvrage de Phillip John Usher est Exterranean. Extraction in the Humanist Anthopocene (New York, Forham University Press, 2019), qui se traduit littéralement en français par : Exterranéen. L’extraction dans l’Anthropocène humaniste.