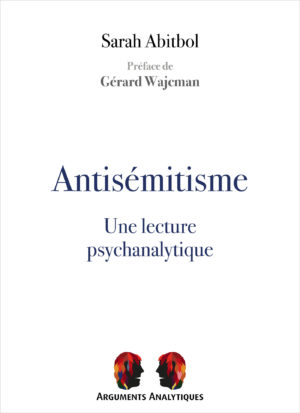Introduction. Sur les chemins de la créolisation et de la déconstruction
1.1. El Biar/Bezaudin
Ils sont nés respectivement en 1928 et 1930. Édouard Glissant le premier, sur les hauteurs de Sainte-Marie, au Morne Bezaudin, près des chemins escarpés d’une commune rurale et boisée, située au nord-est de la Martinique. Jacques Derrida, lui, à El Biar, dans le faubourg d’Alger, quartier où fleurissent les oliviers et bougainvilliers, avec une vue dégagée sur la baie portuaire de la ville.
Pour l’un et l’autre, l’enfance est ce paysage gravé dans la mémoire, inaccessible : leur œuvre singulière peut chacune se lire comme la tentative d’en préserver le souvenir, malgré la distance du temps. La mémoire de l’enfance est un évènement fissuré et fracturé. Il s’agit d’en retrouver la trace et d’en restituer les voix. Derrida et Glissant portent un regard complexe sur le passé et son éloignement : la disparition du jadis est une présence à maintenir, à rejouer, à traverser dans le présent devenu lieu de langue et étendue de mémoire. Comme le fait aussi Albert Camus, lui qui garde, dans l’œil et le cœur, les ruines berbères et romaines de Tipaza, avec le mont Chenoua en point culminant et la mer à perte de vue.
D’El-Biar, Jacques Derrida se souvient des rites de lumière ou de la fête de Pourim. Une fois les bougies allumées, les enfants mangent les mandarines, dégustent les gâteaux aux amandes ou avalent avec gourmandise les galettes blanches, couvertes de sucre glacé et trempées dans le sirop. Loin de là, à Case-Pilote, à l’ouest de la Martinique, sur la côte Caraïbe, au pied des Pitons du Carbet, le jeune Glissant assiste à l’exercice des bouviers. L’adolescent voit ces hommes qui travaillent la terre agiter le chiffon rouge, faire dévaler le troupeau. Le soir venu, il est temps de rassembler les bêtes, de réunir zébus ou taureaux, dont la force impressionne le jeune garçon.
L’attachement à la terre natale rend d’autant plus difficile à Derrida et Glissant, encore jeunes hommes tous les deux, le temps du départ et le voyage vers l’ailleurs. On peut voir l’émotion de Derrida et de Glissant lorsqu’ils reviennent, bien plus tard, sur le lieu de leur enfance : dans le film Édouard Glissant, la créolisation du monde1, le poète accompagne son plus jeune fils, Mathieu, dans le village natal, le lieu du souvenir, le Bezaudin. Édouard Glissant montre le lieu où se trouvait la maison de sa mère et de ses grands-parents, désormais recouverte de végétation, suite à un éboulement. La maison familiale a complètement disparu : « La case où je suis né est rentrée sous terre », dit Glissant à son fils, lui rappelant soudain que son seul souvenir de cet endroit est le bruit de la rivière, qui coule non loin de là.
Dans le film D’Ailleurs, Derrida2, sur fond d’images d’archives, qui présentent sa maison d’enfance, « à la bordure d’un quartier arabe et d’un cimetière catholique, au bout du chemin du Repos3 », Derrida évoque ses souvenirs d’Algérie. Il formule aussi l’idée que le lieu d’origine est toujours un terrain de passage, un espace fuyant et instable. L’ancrage initial relève à la fois de la temporalité provisoire et de la ruine précaire. À ce moment précis du film, lorsqu’il évoque l’Algérie, Jacques Derrida précise : « Tout ce que je fais, que j’écris ou que j’essaye de penser, a une certaine affinité de synchronie avec la postcolonialité4. »
1.2. À l’épreuve de la contre-voie
Vivre l’exil est une épreuve douloureuse d’arrachement et de séparation. De l’exil, le penseur Edward Saïd – qui, par ses origines multiples, se définit comme « un étrange composite5 » — en donne une définition bouleversante : « L’exil […] est terrible à vivre. C’est la fissure à jamais creusée entre l’être humain et sa terre natale, entre l’individu et son vrai foyer, et la tristesse qu’il implique n’est pas surmontable6. » À trois ans d’intervalle, chacun de son côté, les deux garçons Jacques Derrida et Édouard Glissant, encore jeunes, embarquent pour un long périple solitaire. Devant la mer, face à l’avenir, l’adolescent s’engouffre dans le bateau et expérimente la douleur de la traversée.
En septembre 1946, après dix jours sous la voûte de la cale obscure d’un paquebot transatlantique de 155 mètres de long – « Le Colombie grondait en douceur dans la masse immobile, semblant ne pas avancer7 » –, Glissant, âgé de dix-huit ans, débarque enfin au port du Havre. Il prend ensuite le train et va rejoindre la capitale hexagonale. De son côté, en septembre 1949, Derrida, âgé de dix-neuf ans, quitte Alger. Il est seul lui aussi, au moment de monter à bord du Ville d’Alger. Après « vingt heures de mal de mer et de vomissements8 », son bateau arrive à Marseille, port d’arrivée. Le jeune homme ne s’attarde pas dans la cité phocéenne et va à Paris, également en train. Depuis Le Havre ou depuis Marseille et surtout depuis la Martinique ou l’Algérie, c’est un long périple à parcourir, qui mène sur les chemins de la créolisation et de la déconstruction.
Le voyage maritime est vécu par Derrida et Glissant comme une épreuve, un moment difficile. La traversée en bateau ne s’expérimente pas à la manière d’une liberté acquise ou d’une aventure qui commence. C’est dans une tension extrême, pénible, ressentie dans le corps, que se vit le malaise de l’exil. Les étapes se succèdent. Le voyage en bateau laisse place ensuite au trajet en train. Un autre épisode du décentrement se précise : le transport ferroviaire vers Paris (depuis Le Havre pour l’un ou depuis Marseille pour l’autre) est une manière de vivre l’errance. Peu à peu se dessine une expérience singulière, presque irréelle, située entre l’étrangeté et le nomadisme9.
À sa façon, chacun perçoit un trouble, une gêne, une subjectivité confuse. La discontinuité par la mer, à la fois rupture et découverte, est prolongée ensuite par un autre hublot. Ce sont les vitres du train, le long des terres normandes ou provençales. Pour la première fois, ce qui défile devant les yeux semble un monde énigmatique et déconcertant. Plus la ville d’arrivée se rapproche et la distance avec elle se réduit, plus l’éloignement augmente et l’inaccessibilité se ressent. L’approche de l’arrivée renforce le sentiment d’une expérience du déracinement, qui bouleverse Derrida autant que Glissant. Le chemin irait-il à contre-voie ?
Dans le roman Tout-monde, à travers le personnage de Raphaël Targin, double littéraire et alter ego fictionnel, Glissant évoque les paysages étranges et insolites, vus à travers les vitres du wagon. Il décrit les géométries fixes et plates du décor rural, enfumées par les gaz de la locomotive, « sans un bouillon, sans un cassis d’eau, sans une roche tourbillonnant, comme si elles avaient maîtrisé le temps et dévoré l’espace. Mais il ne voyait rien de ses nouveautés, il les survolait, il les mettait en réserve10 ». Dans Le Monolinguisme de l’autre, Derrida expérimente, quant à lui, le découpage symétrique de la campagne, son ordonnancement strict en formes géométriques. C’est le signe d’une terre aménagée, en adéquation avec des formes réglées, segmentées et figées : « Ce fut l’expérience d’un monde sans continuité sensible avec celui dans lequel nous vivions, presque sans rien de commun avec nos paysages naturels ou sociaux11. »
Vécues dans la jeunesse par deux des plus grandes figures de la pensée française, ces expériences initiales portent déjà avec elles des questionnements philosophiques profonds. Le mal de l’appartenance, l’effondrement de l’enracinement, le refus du propre et de soi-même…, autant de perspectives culturelles et linguistiques, qui évoquent un déplacement de l’identité, une plasticité du sujet ou une vibration de l’être.
Par la déliaison ou la relation, par la dislocation ou le divers, par la dissolution ou le multiple, l’identité n’est jamais identique à elle-même. Depuis longtemps, ethnologues, historiens et anthropologues ont réfléchi aux multiples reconfigurations de notions idéales ou idéologiques, comme l’autochtonie et ses différentes composantes (telles la terre, le sol, le sacre, la nation, la racine, le sang, les ancêtres, etc.). C’est un fantasme élevé au rang de mythidéologie, comme le rappelle l’historien Marcel Detienne, dénonçant l’hypertrophie du moi identitaire dans le refus de l’hybridité : « Les Bons Autochtones, c’est Nous, sortis d’une terre dont les habitants sont restés identiques, “les mêmes”, depuis les origines. Sans discontinuité12. »
Ce questionnement essentiel s’inscrit directement dans la pensée de la déconstruction et dans la philosophie de la créolisation. Contre l’identité stable fantasmée, le sujet dérivant et le moi errant sont des thématiques présentes au cœur des débats et des échanges entre Derrida et Glissant. De l’étrangeté au tremblement, de la déambulation intérieure à l’ouverture multiple au devenir-monde, de l’opacité du secret à la diffraction par l’imaginaire, tels sont quelques-uns des points de départ à la rencontre, éléments venus des bords et des marges, vers le centre de la discussion. « Si peut-être nous avons tous les deux quelque chose en commun », dit Derrida en s’adressant à Glissant, « c’est d’être venus d’ailleurs dans la langue », comme une évocation du chemin à contre-voie, qui place l’altérité au cœur de l’identité.
En diverses occasions, débats publics, séminaires ou colloques, Derrida et Glissant vont échanger, dialoguer ou polémiquer. À l’université de Bâton Rouge (l’État américain de Louisiane), au Parlement des écrivains (dans la ville de Strasbourg) ou à la Fondation européenne du dessin à Meina (région italienne du Piémont), ils discutent sur l’évènement, la langue, l’identité ou la religion. Ensemble, ils abordent les présocratiques, Rimbaud, Nietzsche ou Freud. Ils questionnent des couples de notions, comme le sensible et l’intelligible ou le bilinguisme et le monolinguisme. Apparaissent alors les grandes questions de leur œuvre respective, comme la politique de la langue ou la présence concrète de l’imaginaire.
Notes
1. Film de Yves Billy et Mathieu Glissant, production Auteurs associés, coll. « Empreintes », 2010.
2. Film de Safaa Fathy, Gloria films/Arte, 2000.
3. Jacques Derrida, Circonfession, dans Jacques Derrida et Geoffrey Bennington, Jacques Derrida, Paris, Seuil, 1991, p. 257.
4. Lire, à ce propos, le texte de Chantal Zabus, « Encre blanche et Afrique originelle. Derrida et la postcolonialité », dans Michel Lisse (dir.), Passions de la littérature. Avec Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1996, p. 261-273.
5. Edward W. Saïd, Dans l’ombre de l’Occident, traduit de l’anglais (États-Unis) par Léa Gauthier, Paris, Petite Biblio Payot, 2014, p. 40.
6. Edward W. Saïd, Réflexions sur l’exil et autres essais, traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Woillez, Arles, Actes Sud, 2008, p. 241.
7. Édouard Glissant, Tout-monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 142.
8. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996, p. 75.
9. Lire, sur le thème du nomadisme, l’autobiographie de J.M.G. Le Clézio, Identité nomade, Paris, Robert Laffont, 2024.
10. Édouard Glissant, Tout-monde, op. cit., p. 154.
11. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, op. cit., p. 76.
12. Marcel Detienne, « Des métamorphoses de l’autochtonie au temps de l’identité nationale », Quaderni di storia, n° 67, gennaio/giugno 2008, p. 7.