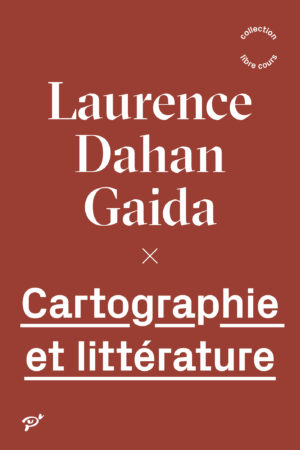Introduction
Emma Bovary, Salammbô, Frédéric Moreau, Bouvard et Pécuchet sont morts. Leurs vies sont déjà faites, et non à faire – derrière eux, plutôt que devant. Ce n’est pas dire que les personnages de Flaubert ne survivent plus dans la mémoire d’aucun lecteur aujourd’hui. Morts, ils l’ont toujours été, incapables de s’animer, dépourvus de futur dès leur première apparition sur la page. Flaubert serait, en somme, l’auteur d’une littérature déjà posthume.
L’accusation est étonnamment persistante depuis le milieu du xixe siècle. Elle s’est prêtée à diverses idéologies et opposée chaque fois à une définition particulière de ce que serait la vie de la fiction ; mais chaque génération se l’est appropriée, réitérant et consolidant l’association de Flaubert à la mort, à l’inerte, à l’inanimé. Comment l’expliquer ? Que nous dit-elle du romancier et de son œuvre ? Ce sont les traces de cette réception que suivra cet ouvrage, en s’engageant dans les voies qu’elle a ouvertes pour penser une manière singulière d’être dans le temps et d’écrire le temps. Il ne s’agit évidemment pas de poursuivre la critique des détracteurs de Flaubert, et l’analyse ne se situera pas sur le terrain – à la fois politique, moral et esthétique – de ceux qui lui ont reproché de ne pas pratiquer le « bon » roman. Elle partira cependant de ce que les lecteurs ont éprouvé de façon récurrente, en posant l’hypothèse que ces impressions de lecture dispersées pourraient permettre de concevoir autrement l’œuvre de Flaubert comme le devenir du roman moderne.
Le roman posthume
La notion de posthume se trouve au cœur de l’analyse qu’ont fait de nombreux lecteurs de l’héritage romanesque du xixe siècle, à commencer par Jean-Paul Sartre. Dans l’article célèbre qu’il consacre à François Mauriac, il dénonce le « temps mort » d’œuvres encore imprégnées de l’influence des grands prédécesseurs, où « l’avenir [s’]étale comme le passé, [ne] fait que répéter le passé ». Au lieu de laisser place à l’indétermination, à l’ignorance, à l’incertitude, au lieu de ménager un espace pour la dynamique de projection qui constitue l’existence selon Sartre, le roman se résume à l’exposition d’événements déjà terminés. Ainsi la perspective de l’auteur dépasse toujours celle du personnage : il se trouve au-delà de son histoire, écrite et donnée à lire depuis sa fin, empêchant du même coup au lecteur d’exercer sa liberté, de sentir que « tout peut encore être autrement ». Roland Barthes se souvient de cette critique au moment de déclarer que « [l]e Roman est une Mort », le genre d’une société qui s’imagine elle-même dans le temps clos, achevé, du prétérit. Dans Le Degré zéro de l’écriture, le roman est présenté comme un « appareil à la fois destructif et résurrectionnel » – tuant le temps, le transformant en passé défunt, pour ensuite le faire revenir à la vie par le souvenir. Raconter, dans le roman, serait nécessairement commencer par la fin, prendre le récit à l’envers, « attraper le temps par la queue ». La critique de Sartre ira plus loin encore dans sa biographie inachevée de Flaubert, L’Idiot de la famille, où il suggère que ce sont les personnages qui ont atteint le terme de leur vie, plus que le romancier le terme de son histoire. Frédéric et Deslauriers ne meurent pas dans L’Éducation sentimentale, écrit-il, mais ils « sont déjà morts. N’auront plus d’histoires. […] Quand on voit Emma pour la première fois, elle est déjà morte. »
Si Sartre et Barthes en ont offert les images les plus mémorables, la génération précédente avait déjà entériné l’association du roman de la seconde moitié du xixe siècle au posthume. Dans son essai « Le roman d’aventure », Jacques Rivière distingue l’œuvre à faire de celles laissées par le mouvement dit symboliste. Selon le critique de la Nouvelle Revue française, l’auteur symboliste aurait son histoire derrière lui, dans un passé sur lequel il lui faut revenir : « il s’arrange pour faire arriver le plus possible d’événements avant le moment où il prendra la plume ». S’intéressant uniquement aux réverbérations des faits dans la conscience, il se situerait de lui-même à la limite de l’existence. L’écrivain de demain doit se mettre « en état d’aventure », écrit Rivière, car celui du xixe siècle était « en état de mémoire ». Tityre, le héros de Paludes, avait peu de temps avant identifié en lui-même une semblable « maladie de la rétrospection ». On ne fait pas : on refait, remarque-t-il, dans des termes qui anticipent le « Mauriac » de Sartre. Le présent n’est pas ouvert, mais plutôt enfermé dans les gestes, déjà accomplis, de la veille. La littérature du siècle antérieur (et spécifiquement le roman, pour André Gide) aurait imposé sur la vie le point de vue de la mort. Mais le fait de la narration rétrospective ne suffit pas à expliquer les remarques de Rivière et de Gide. Pour Georg Lukács, étonnamment proche de ses contemporains de la Nouvelle Revue française dans sa description des œuvres sinon dans ses positions politiques, le roman à partir de Flaubert est incapable de montrer une évolution dans le temps : il serait, plutôt, peuplé d’êtres déjà achevés. « Ce n’est pas un homme vivant, connu et apprécié de nous comme tel, dont on voit au cours du roman le capitalisme tuer l’âme, mais c’est un mort qui traverse un décor d’images statiques, toujours plus conscient de sa condition de mort. »
Le problème du genre, pour plusieurs de ses praticiens et de ses critiques du début du xxe siècle, serait d’être devenu tout à fait posthume. Il semble bien que la crise étudiée par Michel Raimond ne puisse être pensée sans prendre en compte ce renversement de la temporalité. La critique est formulée plus nettement encore par un contemporain de Sartre, Julien Gracq, dans ses carnets de lecture.
Le tempo de Flaubert, dans Madame Bovary comme dans l’Éducation, est, lui, tout entier celui d’un cheminement rétrospectif, celui d’un homme qui regarde par-dessus son épaule – beaucoup plus proche déjà par là de Proust que de Balzac, il appartient non pas tant peut-être à la saison de la conscience bourgeoise malheureuse, qu’à celle où le roman, son énergie cinétique épuisée, de prospection qu’il était tout entier glisse progressivement à la rumination nostalgique. Essayons de relire les grands romans du dix-neuvième siècle comme s’ils étaient le coup d’œil final du héros sur sa vie, cette saisie illuminatrice remontant le cours de toute une existence qu’on attribue au mourant dans ses dernières secondes : une telle fiction est rejetée d’emblée par Le Rouge et le Noir comme par Le Père Goriot, qui s’inscrivent en faux contre elle à toutes leurs pages, mais constitue l’éclairage même, le seul éclairage plausible de Madame Bovary, avec les points d’orgue engourdis, stupéfiés, où viennent s’engluer une à une toutes ses scènes : une vie tout entière remémorée, sans départ réel, sans problématique aucune, sans la plus faible palpitation d’avenir. Tempo songeur et enlisé, à coloration faiblement onirique, qui ne tient pas seulement, loin de là, à une constance personnelle et aux exigences d’un sujet, mais qui est la basse sourde et rythmique de toute une époque, et qui fait, si l’on veut, alors que leurs pôles imaginatifs coïncident, de L’Éducation sentimentale une réplique des Illusions perdues presque totalement méconnaissable.
Le passage précise la charge de Rivière et de Gide, suggérant que Madame Bovary et plus encore L’Éducation sentimentale ont amorcé le déclin du mouvement romanesque, son enlisement dans le temps mort. Les carnets de Gracq montrent bien Flaubert comme « le premier des grands romanciers chez qui cet élan commence à se paralyser », épuisement dont Proust serait le « terminus ». Le moment Flaubert-Proust apparaît alors comme une parenthèse dans l’histoire, caractérisée par un mauvais usage du roman. Le changement de tempo auquel Gracq se montre attentif organiserait l’histoire du roman contre lui-même – contre les ressources propres du genre, contre sa vitesse, son rythme, son mouvement prospectif. Flaubert se serait privé d’une valeur que Gracq appelle le « tremblement vers l’avenir », « cette élation vers l’éventuel qui est une des cimes les plus rares de l’accomplissement romanesque », fournissant au lecteur « la matérialisation même de la liberté ». Ainsi l’auteur de L’Éducation sentimentale ne se déleste pas simplement de Balzac pour avancer vers le roman nouveau : plutôt, le récit flaubertien est profondément lié au récit balzacien, dépendant de lui, en ce qu’il en est l’image inversée, l’image en camera obscura.
L’histoire qu’esquissent ces pages d’En lisant en écrivant n’a rien pour surprendre le lecteur d’aujourd’hui. En effet, le xxe siècle a achevé d’opposer Balzac et Flaubert, comparés déjà au cours de leur propre siècle par d’autres praticiens du roman voulant retracer son progrès ou son déclin. À partir des années 1950, ce qu’on pourrait appeler une deuxième crise du roman s’explique et se réfléchit en réactivant la mémoire du genre. Si, pour la plupart des écrivains réunis sous la bannière du Nouveau Roman, Balzac est décrété « périmé » tandis que Flaubert se voit octroyer le titre de « précurseur », il existe une autre réception, plus discrète, qui ne contredit pas cette histoire antagoniste mais lui attribue un autre sens. Pour tout un ensemble de romanciers, en cela proches de Sartre et de Gracq sans que rien ne les associe a priori, l’œuvre à faire continue de se penser contre Flaubert, à qui est sans cesse rattaché le lexique du posthume. Ce que touche Flaubert doit mourir – telle semble être l’idée reçue. Romain Gary, dans son Pour Sganarelle, dénonce en termes gracquiens ce qu’il considère comme une absolutisation « stérile » du langage, « incarnation d’une classe complètement couchée dans la stagnation ». Nathalie Sarraute évoque quant à elle le « style glacé » de Flaubert, André Malraux ses « beaux romans paralysés » et Jean Prévost « la plus singulière fontaine pétrifiante de notre littérature ».
L’idée n’est pas tout à fait neuve : elle était, plus exactement, promise à une longue postérité dès la parution de Madame Bovary. Pensons à Duranty déplorant en 1857 qu’« [i]l n’y a ni émotion, ni sentiment, ni vie dans ce roman, mais une grande force d’arithméticien ». Jules Barbey d’Aurevilly compare encore Flaubert à une « machine à raconter », dont l’écriture aurait « l’aridité foncière d’un homme qui n’a plus rien à dire de vivant ». La critique du réalisme et de ses procédés articule tout de suite Flaubert à l’inanimé dans les années 1850 : elle se fonde le plus souvent sur une opposition entre la reproduction mécanique de la réalité et l’impression vive laissée par celle-ci sur l’écrivain. Pour les contemporains, les personnages de Madame Bovary s’apparenteraient ainsi à des « créature[s] intermédiaire[s] entre l’homme créé par Dieu et un automate », ou à « des mannequins ressemblants ». À partir du long article de Charles-Augustin Sainte-Beuve se répand dans le discours critique l’image de Flaubert maniant la plume comme un scalpel, accomplissant par l’écriture « une dissection cruelle ». Nouvelle métaphore, nouvelle manière de nier la vie de l’écriture flaubertienne, en inscrivant la mort dans le temps : il y a eu vie, mais il n’y a plus dans le roman que la dépouille. Pour Gustave Vapereau, par exemple, Madame Bovary est « une étude minutieuse, froide, imperturbable, d’une sorte d’exhibition scientifique » ; tandis que le roman est pour Philarète Chasles l’occasion d’une « autopsie cadavérique ». Plutôt que d’imiter la vie, de chercher à en produire l’illusion, Flaubert se pencherait sur une matière morte, qu’il contribuerait à tuer davantage par un roman en forme de post-mortem. Valéry Vernier mène la métaphore à son terme, faisant de Madame Bovary un « roman-cimetière » où serait enterré, après avoir été disséqué, tout sentiment humain. Les critiques sont, en somme, nombreux à donner raison à Charles de Mazade, qui, élisant Flaubert comme représentant de la littérature romanesque du milieu du siècle, déclare qu’elle « s’agite plus qu’elle ne vit, [qu’]elle se démène plus qu’elle ne marche ». Flaubert, parce qu’il écrit des romans depuis la fin, à propos de personnages finis, serait un romancier de la fin du roman.
Le rythme intime d’une époque
Si la critique flaubertienne s’est très tôt intéressée à la question du temps, elle n’a pas tout à fait suivi la voie tracée par ces discours. Le célèbre article de Proust est emblématique de la direction empruntée : Flaubert saurait donner « l’impression du Temps », mais ce serait avant tout en refusant d’intervenir dans son écoulement. L’auteur de la Recherche juge en effet que « la chose la plus belle de L’Éducation sentimentale, ce n’est pas une phrase, mais un blanc ». L’idée s’est vue généralisée dans les études portant sur le reste de l’œuvre : Flaubert donnerait à ressentir le temps pur, ce passage monotone, répétitif, des heures et des jours, sur lequel la forme n’a pas de prise. Jean Rousset loue ainsi « ces grands espaces vacants » de la fiction de Flaubert. « Le miracle, c’est de réussir à donner tant d’existence et de densité à ces espaces vides, c’est de faire du plein avec du creux. » La particularité de la fiction de Flaubert serait de porter son attention non pas aux événements, mais à tout ce qui se situe entre eux. Jean-Pierre Duquette avance également que le « livre sur rien » appelé par Flaubert serait fondé dans un vide temporel, une attention portée à « ce qui se passe quand il ne se passe rien ». Le manque serait constitutif de cette œuvre, qui laisse le temps se présenter dans le retrait du récit, dans ses « silences », pour le dire comme Gérard Genette. Il ne convient pas ici de rappeler dans le détail ces études avec lesquelles nous renouerons au fil de cet ouvrage, mais seulement de noter que le traitement du temps chez Flaubert a été lié au travail essentiellement négatif qu’on lui attribue – à un travail que l’on pourrait dire de soustraction, appliqué non seulement aux idées reçues mais aux formes traditionnelles du roman. Comme le résume Raymonde Debray-Genette en 1970, dans une anthologie de textes consacrés au romancier, « [l]a patiente destruction, par les moyens les plus divers, du romanesque qui fondait le roman, est le premier trait qui ait frappé les contemporains. » Ce sont bien les termes de la « crise » telle que la présente Michel Raimond, posés dès le xixe siècle et repris chez certains romanciers du siècle suivant – cette crise issue d’une « volonté de briser les cadres tout faits, de libérer le roman de ses contraintes