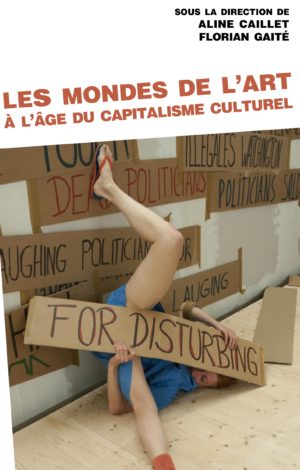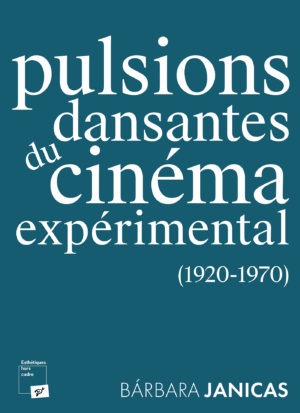Jérôme Glicenstein et Paul-Louis Rinuy, historiens de l’art
Yann Potin et Clothilde Roullier, archivistes
Archives, disparition, recréation : jeu et rejeu dans les arts
« Art : Ça mène à l’hôpital. À quoi ça sert ? puisqu’on le remplace par les archives qui font “mieux et plus lentement”. » [d’après Gustave Flaubert]
La relation passionnée de l’art contemporain à/aux
(l’)archive(s) procéderait-elle des idées reçues du moment ? La définition amusée de l’art, donnée par Flaubert dans son fameux dictionnaire, pourrait sans aucun doute servir de viatique, si l’on substitue à la « vitesse » de la mécanique la « lenteur » des archives. L’analogie n’a pas qu’une valeur distrayante ou ironique. L’art contemporain de Flaubert est « réaliste » et tente de résoudre, à l’âge de la propagation de la photographie, le défi de la représentation. Tout se passe comme si, à l’ère de la dématérialisation des œuvres, dans l’espace comme dans le temps, la création artistique tentait aujourd’hui de résoudre un autre défi, celui de la « représence ». Cette capacité à rejouer et faire rejouer l’acte créatif, qu’il relève de la performance ou de l’installation, ne peut se penser sans une tension, parfois radicale, entre l’œuvre et son archive. Au point que la dernière tend à se substituer à la première, lorsqu’il s’agit d’enregistrer, d’échantillonner, de collectionner, et pour tout dire de constituer les archives de l’art en train de se faire. Cette disposition de la production artistique actuelle, sous toutes ses formes et à travers tous les supports possibles, à remettre en présence les œuvres immatérielles ou corporelles rejoint, de manière sourde et discrète, une faculté bien répertoriée de mobilisation imaginaire du passé dans le présent par les archives. En tant que matérialité différée d’une souveraineté passée, en tant que traces d’une parole encapsulée par le pouvoir d’enregistrer et de contraindre, les archives ont été en effet instituées, au xixe siècle, comme les sources possibles d’une démarche de reconstitution des actes, au fondement même de l’écriture de l’histoire. Jules Michelet, avec d’autres, a sa part dans l’invention d’une poétique savante qui vise à la « résurrection intégrale du passé ». Cette modalité du jeu et rejeu de la réalité, par la fiction d’archives en acte, a partie liée avec les conditions de la production artistique contemporaine. Un genre d’art-chives se propage donc aujourd’hui, avec plus ou moins de bonheur. Ce néologisme est assurément promis à un succès certain, d’autant plus fragile qu’il est d’ores et déjà galvaudé. Par-delà l’exploration de ce moment « archive » de l’art contemporain, le volume qui suit se propose d’examiner les tensions fécondes qui animent deux univers professionnels et culturels antinomiques en apparence. La dénivelée entre le monde des artistes contemporains et celui des historiens, de l’art contemporain ou des archives, est ainsi autant une donnée première de cette recherche que le fondement même de son existence et de sa vitalité. On la trouve à l’œuvre, en acte, dans les variations marquées de format, de ton, de voix entre les différents articles ; la plupart des textes d’artistes se retrouvent dans la rubrique « Chantiers », puisqu’ils correspondent à des instantanés sur des travaux en cours, qui ont vocation à se prolonger sous des formes autres que l’écrit.
Art et archives, gare de triage généralisée
Dans son texte « Fonction de l’atelier » (1971), Daniel Buren expose un certain nombre de principes qui rappellent étonnamment la fonction du dépôt d’archives. L’œuvre, écrit-il, « parce que produite en atelier, ne peut être conçue qu’en tant qu’objet manipulable à l’infini et par quiconque ». À une date presque miroir, en 1790, la souveraineté nationale, constituée en Assemblée nationale, donne à ses titres et procès-verbaux le nom d’Archives nationales, et par la loi du 7 messidor an II [25 juin 1794] est institué le libre accès aux documents : « Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment » (article 37). Venant encore renforcer ce fondement, la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité sans délai des archives. C’est dire que la manipulation « à l’infini et par quiconque » des archives publiques est au principe même de leur organisation et que les archivistes ont pour fonction d’y œuvrer.
Ce rapprochement opéré, force est de constater que l’atelier de l’artiste et le dépôt d’archives se situent pourtant à deux extrémités du processus de production : tandis que l’œuvre d’art « se trouve à sa place », pour reprendre les mots de Buren, dans l’atelier, le dossier administratif ne parvient au dépôt qu’une fois soustrait à son lieu d’origine. Si, « dès sa production en atelier, l’œuvre se trouve isolée du monde réel », comme l’écrit encore Buren, le dossier d’archives est bien davantage dans le monde réel, c’est-à-dire dans son contexte d’origine remplissant sa fonction première, dans le bureau où il a été produit, que lorsqu’il atterrit dans le dépôt d’archives et est compulsé par des mains étrangères, généralement attirées par son intérêt dit secondaire, dépassant son inscription dans le processus administratif de l’affaire qui fut sa raison d’être.
Mais ce décalage dans les trajectoires finit en réalité par se résorber, sur deux points essentiels au moins. En premier lieu, le déplacement même subi par l’œuvre d’art et le dossier d’archives, aussi bien du point de vue physique qu’intellectuel, est assez similaire. C’est au moment de sa production en atelier, écrit Buren, que l’œuvre « est le plus proche de sa propre réalité. Réalité dont elle n’arrêtera pas ensuite de s’éloigner pour parfois même en emprunter une autre que personne, pas même celui qui l’a créée, n’a pu imaginer […]. D’où une contradiction mortelle pour l’œuvre d’art, et dont elle ne se remettra jamais, puisque sa fin implique un déplacement dévitalisant quant à sa réalité propre, quant à son origine ». Le transport des fonds d’archives vers les institutions patrimoniales qui les accueillent, les modalités du déracinement, font aujourd’hui l’objet d’une attention scientifique et réflexive beaucoup plus grande qu’auparavant, mais il est bien évident que cet arrachement est constitutif de tout carton d’archives consultable en salle de lecture.
En second lieu, l’atelier, pour Buren, « premier cadre de l’œuvre », est en fait un filtre qui va servir à une double sélection, celle faite par l’artiste d’abord, hors du regard d’autrui, et celle faite par les organisateurs d’expositions et les marchands d’art ensuite pour le regard des autres ». Il n’en va pas fondamentalement autrement du processus de sélection dans les documents produits par l’administration : une partie de la production est supprimée au fur et à mesure du travail en cours par les agents à l’origine des dossiers (en particulier les doubles, les brouillons…), au moment où les archives sont dites « courantes », puis les archivistes procèdent, à leur tour, à un tri respectant les prescriptions émises par les Archives de France. Le métier d’archiviste est en effet le seul métier du domaine patrimonial où l’on détruit plus ou autant que l’on ne conserve.
Là encore, les temporalités se croisent. Tandis que Buren parle de l’atelier comme d’une « gare de triage », de « lieu de production d’une part, de lieu d’attente d’autre part, et enfin – si tout va bien –, de diffusion », les opérations de tri (après le passage du temps…), puis de mise à disposition du public n’ont pas forcément lieu dans le même bâtiment. Il est intéressant de ce point de vue de noter que les archives, en français, désignent aussi bien l’ensemble des documents conservés que le bâtiment qui les abrite. Le tri des archives – la gare de triage – ne s’effectue pas nécessairement aux Archives, mais parfois sur le lieu de production (l’équivalent de l’atelier) ou dans un tiers lieu de stockage, désigné par la profession comme « intermédiaire ». Les archives elles-mêmes sont alors, à ce stade, qualifiées d’« intermédiaires », avant de devenir, pour une partie d’entre elles seulement, celles qui sont élues, « définitives » ou « historiques ». À l’intensité – voire à l’incandescence – des enjeux présents dans l’atelier, les archives empruntent ainsi nombre de caractéristiques, en les diffractant simultanément en plusieurs lieux. D’une certaine manière, avec les archives, l’atelier est partout.
L’art contemporain et l’archive, une histoire en cours
Les archives, ou l’archive plutôt, telle que la théorise au singulier Michel Foucault dès la fin des années 1960, sont définies rigoureusement comme « un système d’énoncés » qui « instaure les énoncés comme des événements (ayant leurs conditions et leur domaine d’apparition) et des choses (comportant leur possibilité et leur champ d’utilisation) ». Jacques Derrida publie, au début des années 1990, son célèbre essai Mal d’archive : une impression freudienne, dans lequel il pointe ce qu’il est un des premiers à nommer l’archive fever, titre qu’il donne à la publication en anglais de la conférence qu’il a tenue en juin 1994 devant les membres de la Société internationale d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Le philosophe accorde surtout à l’archive une importance renouvelée en fondant son analyse sur l’étymologie même du mot dont il rappelle le sens originairement double, puisque le nom grec arkhè signifie à la fois le « commencement » et le « commandement », voire le « lieu du pouvoir ». Ces considérations paraissent à première vue éloignées de la sphère artistique en elle-même, qui se préoccupe de mettre en évidence plus que d’interpréter l’accumulation des archives dans la création contemporaine, comme dans l’exposition Deep Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art qui voyagea de Munich à New York via Seattle. Et c’est au début du xxie siècle, une fois réellement closes l’aventure moderniste et la croyance en une compréhension univoque possible de l’avènement de l’art contemporain, qu’apparut une véritable effervescence des analyses sur les usages de l’archive ou des archives dans la création artistique contemporaine, telles que le colloque organisé par les Archives de la critique d’art en 2001, Les Artistes contemporains et l’archive, l’ouvrage synthétique d’Anne Bénichou, Un imaginaire institutionnel : musées, collections et archives d’artistes, ainsi que l’article cardinal d’Hal Foster, « An Archival Impulse », qui fait de l’archive, au sens très large du mot, et précisément de la pulsion d’archive, un outil essentiel pour comprendre l’art post-moderne. Plus récemment, Hal Foster est revenu sur cette analyse dans son ouvrage Bad New Days : Art, Criticism, Emergency, où il fait de la catégorie de « l’archive », à côté de celle de « l’abject » ou du « post-critique », un des cinq concepts clés pour comprendre l’art depuis les années 1990. Et, dans ces années 2010, on ne compte plus les ouvrages qui analysent le rôle central joué par les archives dans l’inventivité artistique contemporaine : citons, pour la danse et les arts vivants, le panorama très complet L’Archive dans les arts vivants, ou, dernièrement, sur les pratiques contemporaines de l’archive, Archives au présent, ou encore Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques et la revue Intermédialités, avec son numéro intitulé Refaire/redoing.
Les ouvrages parus au sujet de la relation entre archives et art contemporain abordent un champ large et hétérogène, d’autant plus que nombre d’artistes ont mis la question des archives au centre de leur pratique. Certains d’entre eux se contentent d’évoquer la forme des boîtes d’archive dans leurs œuvres, voire restituent l’ambiance des couloirs poussiéreux où celles-ci sont censées être stockées. C’est le cas de nombre d’œuvres de Christian Boltanski, où des alignements de boîtes de biscuit figurent des sortes d’archives imaginaires mêlant histoire personnelle et images d’actualité, exhibant parfois des portraits flous, violemment éclairés qui évoquent à demi-mot les victimes de la Shoah. De tels ensembles renvoient librement à une mémoire à la fois systématiquement encadrée et impossible à cerner parfaitement. D’autres artistes prennent la question de l’archive de manière plus littérale, figurant des meubles de rangement inspirés des méthodes archivistiques en choisissant de mettre davantage en valeur leur fonction documentaire. On pense aux immenses fichiers produits par le groupe anglais Art and Language à l’occasion de la Documenta 5 en 1972 ou plus récemment à The File Room (1994) d’Antoni Muntadas. Dans le premier cas, il s’agissait de rendre compte des activités du groupe, sachant que celui-ci ne produisait pas tant des œuvres, au sens traditionnel, que des textes en forme de protocoles, de processus ou de discussions : les fichiers contenus dans des grands meubles à tiroirs contenaient des documents rendant compte de la constitution des mêmes fichiers. On est ici au cœur d’un processus tautologique propre à l’art conceptuel, sur le modèle de la Card File de Robert Morris (1962), un ensemble de fiches descriptives liées entre elles et qui présentent toutes des informations à propos de l’œuvre elle-même. Pour ce qui est de Muntadas, le projet est plus ambitieux, puisqu’il s’agit de mettre sur pied une base de données évolutive des cas de censure de toutes les époques et de tous les pays, pouvant être enrichie et consultée par tous lors d’expositions, puis sur Internet, lorsque ce médium de diffusion s’est développé.
Les « archives » qui viennent d’être évoquées ne sont évidemment pas des archives au sens des pratiques institutionnelles, mais plutôt des représentations artistiques de ce que peuvent être ou signifier les archives. Ni Art and Langage ni Antoni Muntadas ne livrent au public les protocoles ayant présidé à la constitution des archives qu’ils exposent ; quant à Boltanski, il se contente de montrer des boîtes, à la manière dont Hanne Darboven multipliait des feuilles d’écriture abstraites, alignées telle une documentation scientifique, sans que leur contenu soit accessible.
Les artistes constituent d’autres archives, même si elles ne sont généralement pas exposées en tant que telles. Elles contiennent des documents personnels (correspondance, photographies intimes, souvenirs) et d’autres qui sont davantage liés à leur activité professionnelle (devis de fournisseurs, contrats de production, liste de collectionneurs, curriculum vitae, documentation liée aux œuvres ou à leur exposition, etc.). Ces archives ne sont pas produites de la même manière que pour ce qui est des institutions publiques et il est donc difficile d’en rendre compte systématiquement. De fait, traiter de la relation des artistes aux archives peut sembler une tâche impossible, tant les situations sont hétérogènes, ne serait-ce que parce que la constitution d’une archive accompagne constamment le mouvement même de la création (et parfois s’y mêle). Certains artistes conservent absolument tout ce qu’on leur a donné, toute leur correspondance et toutes leurs factures et classent l’ensemble de manière assez personnelle ; d’autres ne conservent rien du tout, ce qui complique le travail des historiens de l’art. Ceux-ci sont d’ailleurs les premiers concernés par l’existence ou non de ces « archives réelles », puisqu’elles leur permettent d’obtenir nombre d’informations sur les artistes qui les ont constituées.
Dans certains cas, les archives d’artistes décédés peuvent aussi faire l’objet d’un double travail de constitution et de dépouillement par des chercheurs. C’était le cas récemment avec le travail d’inventaire du fonds Philippe Thomas, au sein de la bibliothèque Kandinsky, par Émeline Jaret, dans le cadre du doctorat qu’elle consacrait à cet artiste. Bien entendu, cette archive n’a pas été voulue par l’artiste (décédé en 1995) ; elle permet néanmoins de présenter aussi fidèlement que possible tous les documents qu’il a accumulés au fil des ans et qui ont trait à sa pratique, par-delà leur dispersion post mortem.
Mais le sujet de notre livre est tout différent, puisqu’il se définit par l’analyse des différentes modalités de recréation d’œuvres contemporaines par le replay ou le rejeu plus exactement – pour employer un mot français ordinairement utilisé en géographie physique ou en musicologie – d’archives réelles, conservées institutionnellement.
Genèse de notre projet « Replay, restitution, recréation… Pour une typologie de la reprise
des archives »
Les observations qui ont présidé à la mise en œuvre de notre projet de recherche ont reposé, dans un premier temps, sur le constat d’une étrange et inattendue symétrie de situation et de fonctionnement entre les Archives nationales et le Centre national des arts plastiques (Cnap) : il s’agit dans les deux cas d’institutions qui n’ont pas toujours été libres de leurs acquisitions ou enrichissements, recueillant au plus large les traces de l’activité de l’État d’une part, et celles de la création contemporaine d’autre part. À l’inverse des musées, elles ne font pas collection, mais collectent des fonds pour constituer un ensemble représentatif, sinon systématique. Le mélange des genres ne doit pas effrayer : les commandes publiques et acquisitions qui relèvent de la responsabilité du Cnap ont d’abord été réalisées pour soutenir la création artistique, mais ont également parfois pour fonction d’incarner et décorer l’État administratif, dont par ailleurs le principal produit subsistant est constitué par les fonds d’archives qui forment les quelque deux cents kilomètres d’archives de l’État central conservés aux Archives nationales depuis la Révolution française. Ajoutons que le bureau des Travaux d’art, dont procède le Cnap actuel, est l’héritier de la troisième division du ministère de l’Intérieur, créée en 1793 – dans ces mêmes années où les Archives nationales se structurent –, chargée des « sciences, arts, académies et spectacles », ainsi que des « encouragements aux artistes ».
Le Cnap et les Archives nationales souhaitaient ausculter la manière dont la démarche rétrospective se situait au cœur de leurs missions et conditionnait l’existence d’un patrimoine, dont ces deux institutions sont les dépositaires et les gardiennes. Le Cnap s’est engagé, depuis 1997, dans une vaste opération de récolement visant à identifier et à localiser les multiples œuvres mises en dépôt, depuis 1791, dans de nombreuses administrations publiques et dans des musées sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans les représentations diplomatiques à travers le monde. Ce travail de récolement nécessite une immersion dans les fonds conservés aux Archives nationales, en particulier dans les archives du bureau des Travaux d’art, actif de 1800 à 1965. Il a conduit, dans certains cas, à constater l’existence d’œuvres relevant de la commande publique, mais ne possédant pas de numéro d’inventaire, et partant, de statut juridico-administratif. Le Cnap a ainsi procédé à l’inventaire rétrospectif de près de 10 000 œuvres grâce à une fouille dans les fonds d’archives qui a révélé l’existence arch&eac