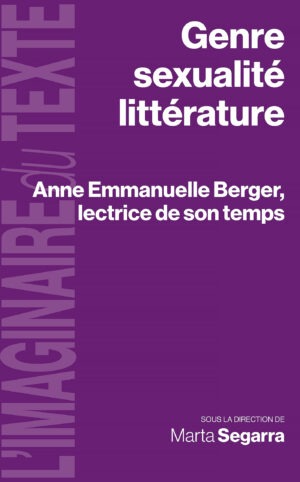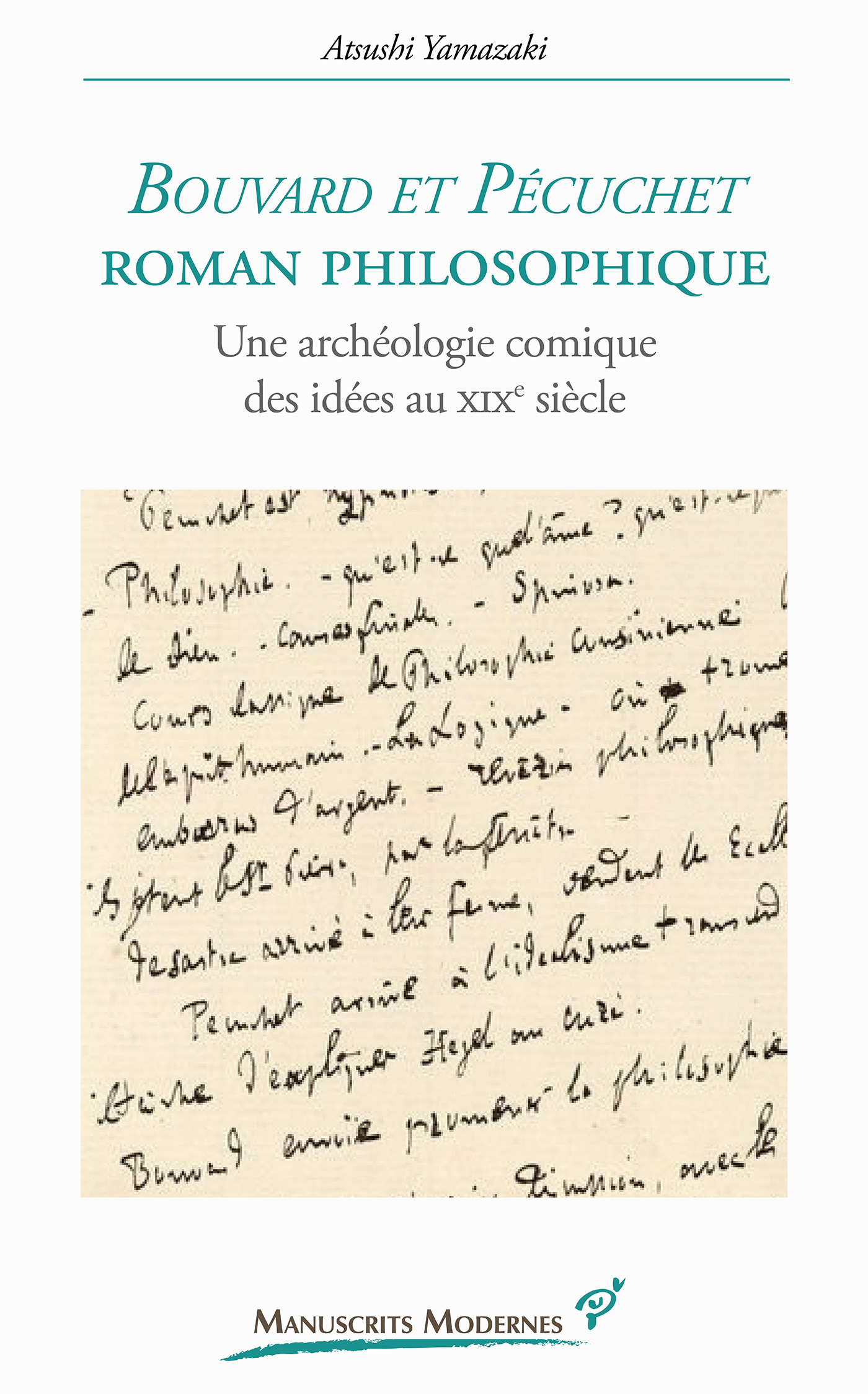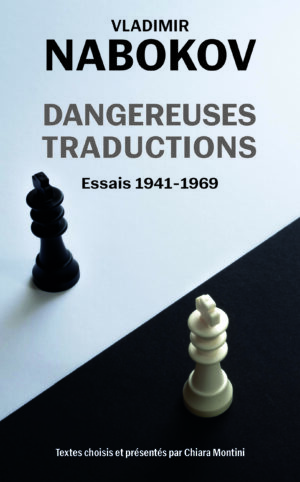Introduction
Une « encyclopédie critique en farce 1 » : autour de cette formule flaubertienne tournent, depuis des décennies, toutes les études sur Bouvard et Pécuchet. Chacune d’entre elles se définit par l’accent qu’elle met sur tel ou tel composant de la formule, « encyclopédie », « critique » ou « farce ». Si l’accent est mis sur l’« encyclopédie », le roman apparaîtra comme une « revue de toutes les idées modernes 2 ». Il importe donc de consulter les livres que Flaubert a lus et annotés pour préparer son roman encyclopédique ; de repérer les sources documentaires de chaque paragraphe, chaque phrase, et même chaque mot ; et de reconstituer deux bibliothèques à la fois, celle de Flaubert et celle du roman. Aussi faut-il être à la fois archiviste, philologue et historien des idées, comme Flaubert lui-même dans sa préparation de Bouvard et Pécuchet.
Mais déjà dans les dossiers documentaires, les savoirs ne sont pas pris dans leur cohérence, dans leur intégralité, dans leur véracité, mais dans leur incohérence, dans leur fragilité, dans leurs contradictions. Une encyclopédie, certes, mais une encyclopédie à rebours, la négation même de toute tentative encyclopédique : une encyclopédie « critique ». L’examen « critique » de toutes les idées modernes, tel était le dessein du romancier.
Ce dessein implique donc de donner une importance primordiale à la visée du roman, et d’abord à l’efficacité critique de son dispositif, si l’on considère celui-ci dans son ensemble : dix chapitres qui constituent le « premier volume » et les deux chapitres inachevés qui devaient constituer le « second volume », comprenant la Copie, Le Dictionnaire des idées reçues et quelques autres pièces. Sur ce point, nous suivons l’édition qu’ont réalisée Anne Herschberg Pierrot et Jacques Neefs pour le tome 5 des Œuvres complètes de Flaubert dans la Pléiade, qui, en publiant la totalité des dossiers préparés pour la Copie, Le Dictionnaire des idées reçues et les autres pièces dans leur continuité avec les dix premiers chapitres, fait apparaître, en particulier dans les notes, les multiples connexions tissées entre les deux volumes de l’œuvre, dans ses trois régimes : récit, catalogue « raisonné », dictionnaire 3.
On ne peut parler de dispositif critique sans considérer la cible. Quelle est en effet la cible d’un tel dispositif critique ? Sans doute s’agit-il d’une question piège, mais difficilement contournable. Personne n’est visé, dit Sartre, sinon Gustave lui-même (« Étrange ouvrage ! plus d’un millier d’articles et qui se sent visé ? Personne. Ou plutôt si : un homme. […] C’est l’auteur lui-même 4 »), mais il oublie une chose cruciale : l’« auteur » du Dictionnaire des idées reçues, à la limite, n’est pas Flaubert, mais Bouvard et Pécuchet, autant qu’on puisse en juger d’après certains scénarios de la Copie (« leur copie », dit l’un d’eux). C’est justement là que se manifeste l’ambiguïté de la formule : « C’est l’histoire de ces deux bonshommes qui copient, une espèce d’encyclopédie critique en farce 5. » Peut-on considérer l’histoire de deux bonshommes qui copient comme une encyclopédie critique en farce ? Ou est-ce une histoire où deux bonshommes copient l’« encyclopédie critique en farce » ? Une virgule change tout. La même ambiguïté frappe une autre formule non moins célèbre que la précédente : « Le sous-titre serait : “Du défaut de méthode dans les sciences 6”. » Le « défaut de méthode » est-il celui des sciences (en ce sens, c’est une « encyclopédie de la Bêtise moderne 7 ») ou celui des deux « cloportes » de Flaubert (version de Taine : « deux escargots qui s’efforcent de grimper au sommet du Mont-Blanc 8 », ce qui veut dire que les sciences restent indemnes) ? Ou celui des deux côtés à la fois ? Cette question se conjugue le plus souvent avec d’autres questions complémentaires : Bouvard et Pécuchet sont-ils bêtes ? Au moins deviennent-ils peu à peu intelligents au fil de leur périple ? Toute étude orientée vers la dimension « critique » du roman encyclopédique tourne autour de telles questions, que celles-ci soient explicitement formulées ou pas. Décidément, on est confronté à une « œuvre étrange » (Sartre a ironiquement joué sur cette expression), qui est « arrangée de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non 9 ».
L’encyclopédie flaubertienne ne se réduit cependant pas à sa visée critique. Son aspect farcesque n’échappe à personne, l’encyclopédie critique « en farce ». En effet, en ce qui concerne la conception du roman, dont l’évolution se dessine lentement dans la Correspondance et les plans et scénarios, on pourrait sans doute parler d’un tournant comique, sans pouvoir pour autant en préciser la date. Mais un comique plus qu’une farce, qu’une satire, qu’un burlesque, mais un comique singulier : un « comique d’idées 10 ». Cette approche, orientée vers l’aspect « comique » du roman, cherche à rendre compte non pas des idées comiques, mais justement du « comique d’idées ». Autrement dit, c’est le scénario épistémologique comique des « idées modernes », leur dramatisation comique qui attire notre attention.
Dès lors s’impose une évidence : les trois approches que nous venons de dégager dans les études sur Bouvard et Pécuchet ne sont jamais dissociables ni en droit ni en fait. Autour de la conception flaubertienne du « comique d’idées » s’articulent inséparablement les trois dimensions du roman, « encyclopédie », « critique », « farce ». Il importe donc au plus haut point d’en démonter la « mécanique » en examinant les dossiers documentaires ainsi que les brouillons du roman (on se souvient de ce que le romancier raconte à propos de Madame Bovary et de ses manuscrits : « Tu verras par quelle mécanique compliquée j’arrive à faire une phrase 11 »). Notre étude se propose de montrer comment la mécanique du comique des idées est en œuvre dans Bouvard et Pécuchet et comment sa « poétique insciente 12 » est formée dans l’espace intertextuel des manuscrits.
Or l’« encyclopédie critique en farce » est aussi un « roman philosophique 13 ». Toute lecture orientée vers la modernité de Bouvard et Pécuchet est placée sous le signe de Queneau, Borges, Barthes, Foucault, tous révélateurs de ce que Flaubert entendait désigner par la « portée philosophique 14 » de son roman. La puissance de ce « roman philosophique » ne tient pas à une quelconque thèse qui y est soutenue par l’auteur (le roman se réduirait alors à une « dissertation philosophique 15 »), ni à la leçon qu’on pourrait tirer de la mésaventure des deux copistes, mais au fait que les discours de savoir et leur mémoire se trouvent déformés étrangement mais intégrés subtilement, au plus près du déroulement narratif, dans les paroles et les gestes des personnages, dans les détails des choses. Une telle intégration narrative de discours crée un espace fictionnel singulier où les notions philosophiques apparaissent comme de véritables personnages au même titre que les deux héros : il s’agirait de personnages conceptuels. Les idées, écrit Maupassant, « deviennent vivantes en eux et, comme des êtres, se meuvent, se joignent, se combattent et se détruisent », d’où se dégagera un « comique tout particulier, un comique intense 16 ». Tel est l’enjeu de pensée chez Flaubert dans son entreprise du « roman philosophique ».
Notre étude s’organise en trois parties.
Dans la première partie, nous nous proposons de rendre compte de la manière dont Bouvard et Pécuchet abordent les savoirs face au défilé ininterrompu des discours. Plus précisément, on s’interroge sur la manière dont ils s’approprient les savoirs, notamment sur deux modalités propres à leur apprentissage : l’usage des signes et la classification. Le propos de cette partie consiste à dégager quelques traits distinctifs de leur manipulation des savoirs, de leur usage des signes, de leur pulsion classificatoire, qui caractérisent tout leur parcours intellectuel.
La deuxième partie est consacrée à l’analyse de l’épisode du magnétisme du chapitre VIII du roman. Cet épisode doit sa configuration globale ainsi que ses détails spécifiques à divers éléments constitutifs de l’immense corpus du magnétisme. Les énoncés, démarches et réflexions de nos deux magnétiseurs sont riches d’implications culturelles et épistémologiques dans la mesure où ils renvoient tous à l’un ou l’autre des moments de l’histoire du magnétisme. Le propos de cette partie est donc de restituer à la fiction flaubertienne son enjeu et sa portée épistémologiques.
La troisième partie est destinée, dans un premier temps, à analyser le scénario épistémologique (la dualité de l’âme et du corps ou l’opposition entre le matérialisme et le spiritualisme, ce que nous appellerons la gymnastique de l’esprit) qui articule étroitement le moment magnético-mystique et le moment philosophique du chapitre VIII et, dans un second temps, à explorer la bibliothèque philosophique du roman dans son ensemble. Dans cette bibliothèque se trouvent convoqués divers philosophes, entre autres, Descartes, Pascal, Voltaire, Cousin, Hegel, Spinoza, Schopenhauer, Montaigne. Comment le romancier a-t-il procédé à la fabulation narrative de ce qu’il appelle les « grandes questions » métaphysiques comme les causes finales, le libre arbitre, le critérium de vérité ? Telle est la question centrale qui se posera dans la troisième partie.
Cependant, un travail préalable s’impose dans l’analyse du chapitre VIII du roman : il faut transcrire intégralement les notes de lecture figurant dans deux « dossiers » préparatoires au roman : le dossier « Mysticisme-Magnétisme » et le dossier « Philosophie ». Il faut également en dresser la bibliographie, replacer les références rassemblées dans leur contexte historique, culturel et intellectuel et retracer respectivement l’histoire de chaque discipline telle qu’elle s’y dessine. Cette procédure génétique permettra, d’une part, de reconstituer le travail documentaire de Flaubert, et, de l’autre, de mettre en lumière cet immense chantier qu’est la Copie. Il ne s’agit pas seulement de repérer les sources documentaires de tel ou tel passage du roman, mais aussi et surtout d’interroger sa dimension épistémologique, d’analyser les transformations narratives que Flaubert a fait subir à chaque élément documentaire en fonction de la « poétique insciente ». La conception de la prose narrative, en effet, avance en parallèle de cette exploration érudite. En règle générale, le moment de la documentation, chez Flaubert, n’est pas un simple préalable à l’œuvre. Le romancier, explorant la multiplicité des livres, relève inlassablement phrases, notions, arguments, théories, et cela au plus près d’une forme à trouver, dans l’avancée vers cet inconnu que sont les deux volumes de Bouvard et Pécuchet.
Il s’agit bien d’une « encyclopédie critique en farce ». Mais on imagine mal une encyclopédie, quelque farcesque qu’elle soit, qui mette dans le même panier les tables tournantes et la philosophie. Une mauvaise volonté de la part de l’écrivain, qui désire rabaisser « la philosophie, la plus belle des sciences 17 » par cette contiguïté incongrue ? Assurément non. Nous en disons brièvement quelques mots dès cette introduction, car on tend à considérer cette articulation burlesque comme la manifestation des idées comiques, non comme celle du « comique d’idées ».
Le livre de mon ami Renan ne m’a pas enthousiasmé comme il a fait du public. […] C’est beaucoup et je regarde comme une grande victoire pour la philosophie que d’amener le public à s’occuper de pareilles questions.
Connaissez-vous La Vie de Jésus du docteur Strauss ? Voilà qui donne à penser et qui est substantiel ! […] Quant à Mademoiselle La Quintinie… franchement, l’Art ne doit servir de chaire à aucune doctrine sous peine de déchoir ! On fausse toujours la réalité quand on veut l’amener à une conclusion qui n’appartient qu’à Dieu seul. Et puis, est-ce avec des fictions qu’on peut parvenir à découvrir la vérité ? L’histoire, l’histoire et l’histoire naturelle ! Voilà les deux muses de l’âge moderne. C’est avec elles que l’on entrera dans des mondes nouveaux. Ne revenons pas au Moyen Âge. Observons, tout est là. […] La rage de vouloir conclure est une des manies les plus funestes et les plus stériles qui appartiennent à l’humanité. Chaque religion, et chaque philosophie, a prétendu avoir Dieu à elle, toiser l’infini et connaître la recette du bonheur. Quel orgueil et quel néant ! Je vois, au contraire, que les plus grands génies et les plus grandes œuvres n’ont jamais conclu. Homère, Shakespeare, Goethe, tous les fils aînés de Dieu (comme dit Michelet) se sont bien gardés de faire autre chose que représenter. […] La barbarie du Moyen Âge nous étreint encore par mille préjugés, mille coutumes. La meilleure société de Paris en est encore à « remuer le sac » qui s’appelle maintenant les tables tournantes. Parlez du progrès, après cela ! Et ajoutez à nos misères morales les massacres de la Pologne, la guerre d’Amérique, etc. 18
Si nous reproduisons un long passage de cette fameuse lettre, mille fois citée, ce n’est pas pour souligner les traits distinctifs de l’esthétique de Flaubert (l’art pour l’art, la poétique représentative), ni sa philosophie (une certaine forme de scepticisme qui refuse de conclure et qui ne prétend pas posséder la vérité), ni sa méthode empirique (la primauté donnée à l’observation) ; mais pour constater un fait qui peut paraître quelque peu surprenant : la plupart des matières abordées par Bouvard et Pécuchet se trouvent évoquées dans cet extrait : l’histoire naturelle, entendue au sens de sciences (chap. III), l’histoire (chap. IV), la littérature (chap. V), la politique, « les massacres de la Pologne, la guerre d’Amérique » (chap. VI), la philosophie (chap. VIII), la religion (chap. IX), sans oublier les tables tournantes, un des multiples avatars du magnétisme (chap. VIII). Il n’y a donc que deux maillons manquants : l’agriculture (chap. II), l’éducation (chap. X). Cette concordance n’a-t-elle pas de quoi étonner le lecteur du dernier roman de Flaubert ? Ce n’est pourtant pas tout. Les noms propres qui y sont inscrits viennent renforcer cette concordance. D’abord Homère et Shakespeare : Bouvard et Pécuchet lisent la critique formulée à leur égard. Il en est de même pour George Sand (c’est Bouvard qui la critique). Pour ce qui est de Renan et de Strauss, certes, leur nom n’apparaît pas dans le roman ; en revanche, on sait que Flaubert prendra des notes sur l’ouvrage de Renan cité dans cette lettre et que le nom de Strauss est annoté à plusieurs reprises dans les brouillons du chapitre IX. En ce sens, la référence à Mademoiselle La Quintinie est aussi significative, parce qu’il s’agit d’un roman épistolaire tout au long duquel George Sand développe le débat qui oppose constamment la philosophie à la religion.
La philosophie et la religion, dans l’esprit de Flaubert, sont jumelles dans leurs prétentions respectives à détenir un « Dieu à elle[s] ». Le même diagnostic réapparaîtra dans une lettre écrite au début du mois de mars 1879, à savoir au moment précis où le romancier se documente simultanément sur les trois derniers chapitres : « Ce qui m’indigne ce sont ceux qui ont le bon Dieu dans leur poche 19. » Ici comme ailleurs, la « rage de vouloir conclure » est à l’origine de l’illusion du « bon Dieu dans la poche », ce qui expliquerait l’enchaînement du chapitre de la philosophie et de celui de la religion dans l’encyclopédie flaubertienne. À moins que cet enchaînement, somme toute, ne soit fondé en termes épistémologiques, comme en témoignent indirectement, d’un côté, la manière dont Flaubert invoque deux « philosophes », Renan et Strauss (« une grande victoire pour la philosophie que d’amener le public à s’occuper de pareilles questions »), de l’autre, l’inlassable débat développé dans le roman de Sand (lequel, d’ailleurs, ne fait que reprendre le débat séculaire opposant les deux camps).
Et pourtant, à vrai dire, rien d’étonnant dans cette concordance qui semble s’établir entre la fiction et l’écrit épistolaire, puisque Flaubert avait déjà rédigé la première ébauche de l’histoire de ses deux « clo