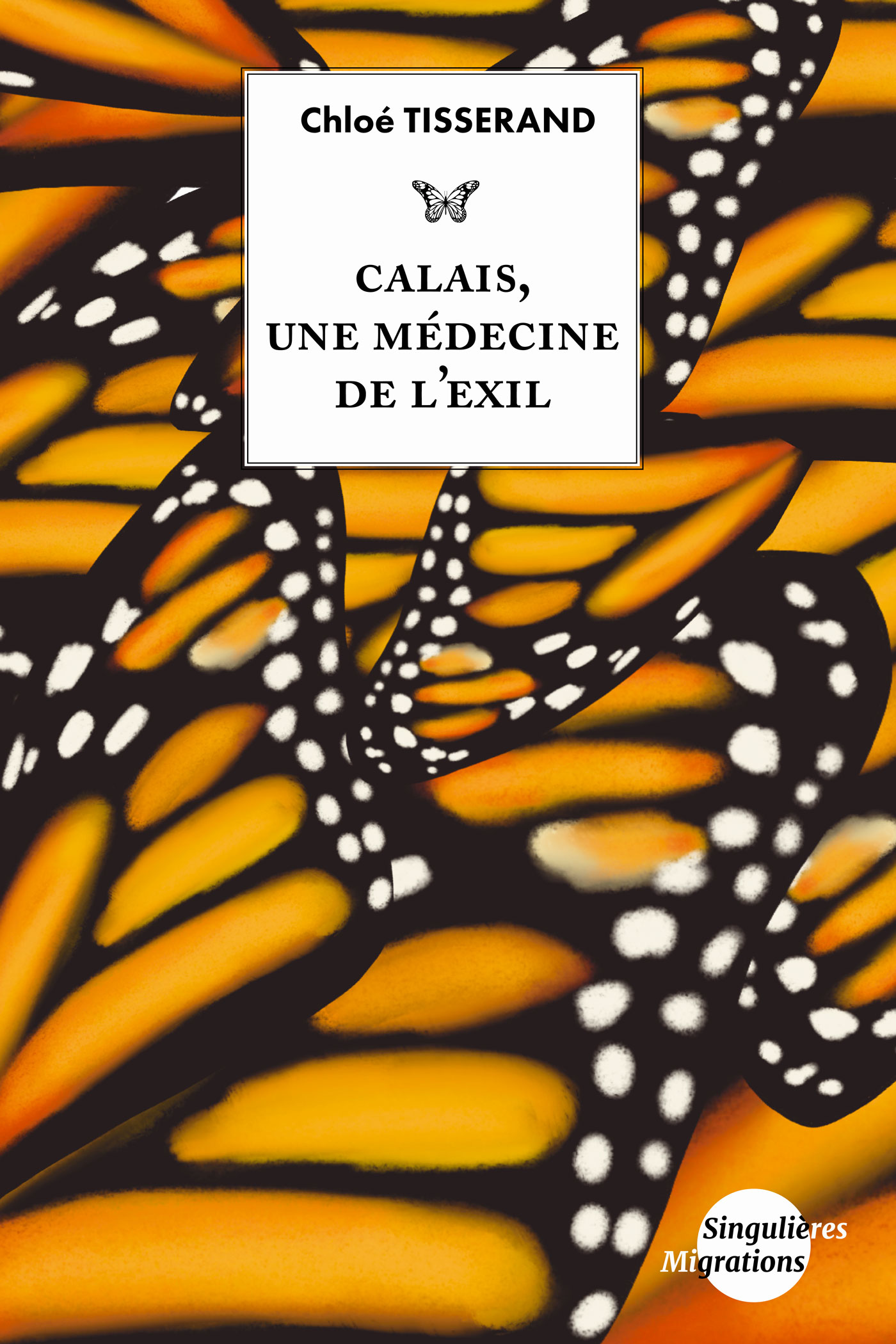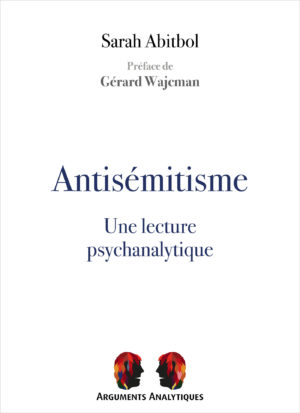Introduction
« Nous étions dans une situation où l’Europe faisait face à la crise des migrants et maintenant c’est l’inverse, ce sont les migrants qui font face à la crise de l’Europe car la crise des migrants a servi de révélateur, un profond révélateur de toutes nos divisions, les divisions de l’Europe, de nos propres divisions et des divisions qui traversent notre cerveau » (Héran, 2016). La crise de l’hospitalité se traduit par une multiplication des frontières artificielles dans le monde, on compte près d’une trentaine de murs d’interdiction (Quétel, 2012) générant ainsi des « lieux-frontières » (Cuttitta, 2015) qui proposent des décors bien tristes à leurs habitant·es et aux personnes qui les traversent, les « clandestins », « ceux qui ne sont pas les bienvenus » (Laacher, 2007).
Des grilles ont été posées par les autorités espagnoles à Melilla et Ceuta, enclaves situées au Maroc, tandis que la Grèce a érigé un mur avec la Turquie en 2012, imitée ensuite par la Bulgarie. En juillet 2015, la Hongrie a posé un rideau de barbelés à lames la séparant de la Serbie et de la Croatie, puis, en novembre 2016, la frontière franco-britannique a été renforcée par un mur de 30 km présenté comme anti-intrusion et antibruit. Melilla, Harmanli, Briançon, Calais, Vintimille sont autant de villes symboles qui illustrent ce phénomène de « refermeture des frontières » (Vallet, 2014) et dont les démarcations sont matérialisées par du béton, des clôtures, des rangées de forces de l’ordre. « Il semble donc que les murs contre l’immigration aient de l’avenir au sein même de l’Union européenne » (Quétel, 2012). En plus de ces obstacles et ronces artificiels, les exilé·es doivent surmonter les frontières naturelles (mer Méditerranée, massif alpin, etc.). Ces tracés physiques reconfigurent l’espace géographique, créent un jeu politique entre les acteurs·trices de terrain, génèrent de nouvelles représentations, obligent les exilé·es à placer leur corps au cœur de la dynamique de l’exil.
Les « corps traversés »
Les exilé·es sont défini·es dans cet ouvrage, issu d’un travail de doctorat, comme des individus confrontés à trois épreuves de vie : l’errance, l’incertitude migratoire et l’arrachement au pays. Leur corps sont « traversés ». Ce mot est utilisé comme métaphore pour évoquer la superposition des épreuves auxquelles sont confronté·es les exilé·es.
Le verbe « traverser » est polysémique : il possède d’abord un sens étymologique signifiant « parcourir un espace d’un bout à l’autre » (Ortolang, CNRTL). En quittant leur pays, les exilé·es s’inscrivent dans une mobilité contrainte. Elle suppose une double absence (Sayad, 1999) qui s’exprime à travers l’arrachement culturel et affectif au pays. Cette rupture radicale avec l’ancienne vie est jugée et évaluée par les sociétés d’accueil : la guerre serait une bonne raison pour obtenir le statut de réfugié·e, tandis que les difficultés économiques ne le justifieraient pas. Les autorités effectuent ainsi une politique du tri entre le « vrai et le faux » réfugié (Laacher, 2005), instaurent une « bipartition » selon une frontière morale entre « bons et mauvais migrants » (Streiff-Fenart, 2015), comme il y avait jadis des bon·nes et mauvais·es pauvres (Geremek, 1987).
Mais « traverser » signifie aussi « se frayer un chemin à travers » (étymologie du xvie siècle). Cette acception correspond à l’incertitude du voyage « comme étape de plus d’un voyage qui n’en finit pas ; où ils n’en finissent pas d’arriver » (Laacher, 2005). Les exilé·es, par « sauts de puce » d’un pays à l’autre, cherchent une vie meilleure, mais cette espérance est, bien souvent, plus un mirage qu’une réalité : les routes de l’exil sont des tracés hostiles où les conditions de vie sont misérables ; l’évolution dans ce « couloir des exilés » (Agier, 2011), se réalise en parallèle du monde des non-exilé·es. « Maintenu là, dans l’inachèvement d’un parcours de mobilité, il n’est ni immigré ni émigré mais suspendu en migration. » (Agier, 2014). Ces camps ne sont pas des espaces de projection mais des zones d’attente où la vie est mise entre parenthèses. Leur situation administrative les oblige à rester caché·es sous peine d’être expulsé·es.
Enfin, traverser c’est aussi « percer de part en part » (xe siècle, Ortolang CNRTL). Symboliquement les frontières traversent les corps. Elles sont des remparts contre lesquels les exilé·es se heurtent, se blessent, meurent. En mai 2018, United for intercultural action a publié une liste des décès aux frontières depuis 1993 : 34 361 décès ont été comptabilisés. Les artefacts sécuritaires participent à une « guerre aux migrants » : « la capture est d’abord un dispositif pratique qui combine des modalités de repérage et de détection, d’arrestation, d’enfermement et de traitement des capturés. Toute la gamme des techniques de la chasse, des plus ancestrales (affûts, pièges, battues, pisteurs…) aux plus post-modernes (haute-technologie militaire, bases de données, biométrie…) sont associées à ce dispositif » (Bernardot, 2012). L’exil est interprété tout au long de ce livre comme un mouvement contraint, à l’opposé d’une conception de l’exil partagée par Dany Laferrière (2020) comme « valant le voyage » et d’une migration vue non pas comme « une punition mais [comme] une récréation ».
C’est ainsi que les victimes aux frontières se présentent à la porte des hôpitaux. Le personnel soignant des sociétés dites d’accueil se retrouve en première ligne pour panser leurs plaies. L’hôpital est une institution d’État qui, dans sa forme ancestrale, protège les indigent·es ; il est porteur de valeurs fortes d’humanité. Ses professionnel·les de santé ont pour obligation de soigner tout le monde sans distinction. Les soins délivrés aux exilé·es semblent constituer aujourd’hui une pratique à contre-courant, qui tranche avec l’hostilité vécue par ces errant·es hors les murs de l’hôpital, qui reste un des rares lieux institutionnels d’accueil.
Dans ce contexte, cet ouvrage vise à comprendre comment la frontière a poussé cette institution à repenser sa prise en charge sanitaire pour soigner les patient·es exilé·es précaires. Formulant ainsi l’idée qu’une médecine spécifique s’invente sous nos yeux. Celle que nous nommerons « médecine de l’exil à la frontière », dont nous tenterons de définir les contours.
De la « maladie de Calais » au « syndrome calaisien »
Cette monographie est réalisée en grande partie à la permanence d’accès aux soins de santé de l’hôpital de Calais (PASS). Le choix de ce lieu m’est apparu évident puisque, outre le fait que je suis calaisienne, cette ville est une sorte de « laboratoire » de la migration, comme le rappelle cette frise chronologique (ci-contre).
Depuis les années 1990, l’histoire migratoire se répète : des exilé·es, dans le chaos de l’errance et de l’incertitude migratoire, traversent le territoire en espérant pouvoir atteindre la Grande-Bretagne. Leur présence suscite des tensions, de l’entraide, des débats, des mobilisations.
La « maladie de Calais » est une expression désignant le mal auquel était en proie Louis XIV lors de son passage dans la ville des Six Bourgeois et qui lui valut une perte importante de cheveux. Aujourd’hui, la « maladie de Calais » ou le « syndrome de Calais » est une expression utilisée chez les forces de l’ordre, qui craignent d’être mutées dans cette ville parce que le travail y est difficile, et chez les bénévoles qui ne sortent pas psychologiquement indemnes des logiques d’exclusion calaisiennes. Calais serait associée à la malédiction, une malédiction qui m’a gagnée. Dans ce travail, la patientèle – les exilé·es – on ne l’entend pas, et on ne la voit pas distinctement, et je conçois que cela puisse être frustrant. Ce n’est pas que leur point de vue ne m’intéresse pas, mais j’estime que ces exilé·es devraient faire l’objet d’un travail à part entière, exclusivement consacré à leur parole, avec un dispositif linguistique et une connaissance précise de leurs cultures. Je pense que ce choix de focaliser plutôt mon travail sur les soignant·es est motivé d’abord par le fait que je me sens, à mon corps défendant, dans une position dominante, un peu « colonialiste » et intrusive à l’égard des patient·es. Ne pas connaître précisément leur langue et leur culture me place dans une relation d’emblée déséquilibrée ; je reste une étrangère issue de sociétés qui ont un passé historique colonial. Comme le rappelle Edward Saïd (2005) :
Il doit être vrai aussi qu’un Européen ou un Américain qui étudie l’Orient […] se heurte à l’Orient en premier lieu en tant qu’Européen ou Américain, ensuite en tant qu’individu. […] cela signifiait et cela signifie encore que l’on a la conscience, même vague, […] d’appartenir à une partie de la terre qui a des rapports historiques avec l’Orient depuis pratiquement les temps homériques.
Rencontrer les exilé·es à Calais m’a fait passer par différents états émotionnels. En 2009, je me souviens m’être sentie comme une aventurière derrière « Moustache », surnom d’un bénévole qui arpentait les chemins sauvages de la « jungle » qu’il présentait aux journalistes tel un fixeur. J’ai photographié des bâches accrochées dans les arbres, des couvertures entassées et humides. J’ai ressenti de la peur aussi quand j’ai dû me rendre quai de la Moselle lors de la distribution des repas où des exilé·es se massaient en petits groupes ici et là. Je ne les avais jamais approché·es, je les avais vu·es, enfant seulement, marchant le long des routes, et j’en entendais parler de manière péjorative dans le bus scolaire sous le nom de « Kosovars ». J’ai eu peur de les approcher d’autant plus qu’avec d’autres journalistes, nous nous faisions copieusement traiter de « charognards » par un bénévole épuisé par la situation. J’ignorais les enjeux de la migration et je me sentais investie de la mission de montrer cette injustice. Le mythe du grand reporter devenait réalité. Quai de la Moselle, je me suis rapprochée d’un exilé (photo ci-dessous) fragilisé par une fracture à la cheville et entouré de compagnons de route. J’ai recueilli son témoignage pour un hebdomadaire et c’est grâce à lui que j’ai découvert la PASS (permanence d’accès aux soins de santé), puisqu’il avait été soigné là-bas.
Ensuite est venue une sorte d’addiction à retourner dans les camps, pour mieux comprendre : ainsi, vous découvrez que photographier les exilé·es peut représenter une menace pour elleux, que leur vie est une épreuve financière et administrative presque sans fin. Déjà cabossé·es, iels portent aussi les poids de la société française. Le « camp des Africain·es », le « squat des Égyptien·nes », les « jungles », les hangars, les bords d’autoroute, sous les ponts, j’ai vu. J’ai vu que rien ne change.
Calais est une ville frontalière, dont on entend parler à la radio pour ses mort·es, les tentatives de traversée, les camps d’infortune. La « new jungle » a marqué pour moi l’arrêt des visites dans les camps. Spectaculaire, hypermédiatisé, insalubre, ce nouvel espace à la marge a convoqué l’écœurement qui s’était accumulé pendant des années en moi. Je ne savais plus où poser mes yeux, je fuyais le regard des exilé·es, éprouvais le malaise calaisien. Le sentiment de honte, la culpabilité de ne rien pouvoir faire, la lassitude d’écouter sans cesse leurs souffrances, a suscité en moi une difficulté croissante à regarder cette condition. Cela m’a poussée à m’interroger sur ma position personnelle par rapport à ces personnes et, plus globalement, sur la société d’accueil à laquelle j’appartiens. J’ai alors souhaité entreprendre un travail sur les personnes qui réfléchissent à comment accueillir et s’adapter aux exilé·es. Parce que le monde médical est porteur de ces valeurs fortes, je me suis engagée dans ce travail d’observation avec les professionnel·les de santé.
Analyser le triptyque corps, frontière et soin,
à Calais
Les soignant·es sont des acteurs qui vivent les événements sanitaires migratoires, depuis leurs interventions dans le camp de la Croix-Rouge à Sangatte (1999-2002), des soins prodigués à l’arrière des coffres de voiture qui faisaient office de lits d’auscultation, dans des camionnettes exigües des associations où le « système débrouille » prévalait, jusqu’à la PASS de l’hôpital, créée en 2006 dans un bâtiment en dur. À cette époque, l’urgence humanitaire était telle que les ONG – Médecins du Monde et Médecins sans Frontières – ont sommé l’État de prendre ses responsabilités. Les réunions de concertation avec l’hôpital ont validé l’installation d’une PASS. Ainsi, l’hôpital a eu seul les commandes du pilotage de la prise en charge sanitaire des exilé·es et le dispositif, qui se cantonnait à un poste d’assistante sociale aux urgences, s’est déployé en une unité de soins.
La PASS a évolué et s’est métamorphosée au fil des débats en interne et des mobilisations associatives.
Les métamorphoses de la PASS :
la PASS Coubertin (2006-2012)
En 2006, le contexte d’urgence humanitaire engendre un engorgement des urgences ; sous la pression de Médecins du Monde (MDM) et Médecins sans Frontières (MSF), l’hôpital, en concertation avec les ONG, a décidé de se positionner sur la prise en charge des exilé·es. MSF s’est retiré et MDM a arrêté les soins pour se consacrer à l’accompagnement administratif des exilé·es. L’hôpital est devenu responsable de la santé de cette population. La PASS Coubertin était installée dans l’ancienne maison du concierge de l’EHPAD de l’hôpital, qui servait de chambres pour les internes et était située avenue Coubertin (voir photos ci-après). Elle dépendait alors du pôle gériatrie de l’hôpital.
« Dans ce lieu-là, il y avait une douche, un séjour qui est devenu une salle d’attente, une chambre qui est devenue une salle de soins et une autre chambre qui est devenue un bureau médical et ça a commencé comme ça », raconte une infirmière présente en 2006. La PASS était éloignée de l’hôpital qui se tenait dans un autre quartier du centre ville de Calais. L’espace était très petit, les gens s’y entassaient, les meubles pour le rangement aussi. L’équipe était composée d’une dizaine de médecins vacataires, d’une infirmière, d’un médiateur linguistique. Un médecin coordinateur chapeautait l’équipe.
La PASS-CH (Centre hospitalier)
En 2012, le nouvel hôpital a été installé en périphérie de la ville, dans la zone du Virval, près d’une sortie d’autoroute. Des bâtiments modulaires se trouvaient à proximité et ont servi dans un premier temps aux urgences pédiatriques pour être finalement dévolus à la PASS.
Actuellement on trouve aussi le centre périnatal, le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Le choix du modulaire a aussi tenu au fait que la PASS était censée être provisoire. Mais les migrations étant continues, la PASS a duré dans le temps. Avec la restructuration des pôles en 2013, la structure médicale dépend désormais des urgences.
Pour se repérer, des exilé·es la surnomment « le petit hôpital ». Même s’il existe des panneaux signalétiques, la localisation du modulaire n’est pas aisée. Les exilé·es s’y rendaient surtout à pied, soit vingt minutes de marche jusqu’en 2017. Mais depuis la « new jungle », des navettes associatives les y conduisent. Un papier collé sur la porte d’entrée indique « PASS ». Des traductions en arabe sont écrites à la main.
À l’intérieur, un long couloir jaune distribue les différentes pièces. Les murs des salles du modulaire sont peints de couleurs vives. À gauche, deux salles d’attente, l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants, sont pleines lorsque l’afflux de patient·es est important. Une salle est dédiée à la fois aux soins infirmiers et à la pharmacie où des patient·es reçoivent leurs médicaments dans des sachets marron comme l’on peut trouver chez le primeur ; une autre salle est réservée aux consultations dentaires les lundis et mardis matin. À droite, on a juste après la porte d’entrée le bureau des enregistrements aux armoires remplies de dossiers, un ordinateur, deux bureaux – le matériel y est sommaire ; puis la salle de consultation du médecin, qui vient un peu égayer l’aspect austère des lieux avec ses murs d’un ton bleu turquoise.
Contrairement aux services dits classiques, le lieu n’est pas aseptisé : on ne retrouve pas cette odeur si particulière de nettoyage ou de produits d’hygiène ou d’après pansements infirmiers, ni le blanc des murs et la lumière éblouissante, le dépouillement, les perfusions et toutes sortes d’appareils un peu effrayants. Dans la salle médicale, on trouve un bureau avec ordinateur, une grande armoire, un lit d’auscultation. À côté de cette pièce se tient le bureau de l’assistante sociale, les deux dernières salles correspondent aux douches et toilettes et espaces de rangement.
L’équipe de la PASS Coubertin et qui a été transférée à la PASS-CH a grossi dans le temps, notamment avec l’arrivée, en 2013, d’un psychologue, de deux dentistes vacataires et d’infirmièr·es supplémentaires. La PASS est la porte d’entrée en médecine générale du système de soins français pour les exilé·es.
La PASS Jules-Ferry 1
Le nombre d’exilé·es passe de 500 à 2 500 selon la préfecture en 2014. Entre-temps, la mairie de Calais cède le centre de loisirs Jules-Ferry – situé en périphérie de ville – à l’État afin qu’il prenne en charge les exilé·es. Cette décision est symbolique puisque ce centre Jules-Ferry n’est autre qu’un centre aéré que des générations de Calaisien·nes ont connu et affectionnent. Pour atténuer les reproches, la ville obtiendra une aide financière pour compenser ce qu’on nomme la « crise migratoire » et créer un centre aéré neuf. Les exilé·es sont autorisé·es à s’installer autour du site sans craindre une expulsion. Dans le même temps, les squats et camps en centre ville sont démantelés. La « new jungle », surnommée « la Lande » par l’État, se forme et comptabilise au moins 6 000 personnes, jusqu’à 10 000 selon les associations et environ 7 000 côté préfecture. Ce chiffre se répercute en termes d’afflux sur la PASS-CH, l’hôpital décide alors d’ouvrir de 11h à 14h15 en mars 2015 un centre de soins infirmiers au centre d’accueil (photo ci-dessous). Un infirmier délivre des soins aux hommes puis se rend à la maison des femmes et des enfants pour un temps de soin, d’orientation des patient·es et de prévention.
Le Défenseur des droits exprime son indignation face à la situation sanitaire et, considérant que la PASS-CH est sous-calibrée, réclame de l’État plus de moyens. L’État décide alors – en plein débat avec l’hôpital, plutôt opposé à une antenne aux abords de la « jungle » – d’ouvrir une annexe de la PASS au centre Jules-Ferry. Les soignant·es y accèdent grâce à des laissez-passer présentés à la police à l’entrée du Chemin des Dunes.
La PASS Jules-Ferry 1 est située dans un vieux bâtiment en béton : l’ancienne infirmerie du centre de loisirs.
On retrouve dans cette PASS le même inconfort que l’on pouvait connaître à la PASS Coubertin.Les soignant·es de l’hôpital sont épaulé·es par une équipe de l’établissement, celle de préparation et de réponses aux urgences sanitaires (ÉPRUS) pour organiser la prise en charge sanitaire dans le centre d’accueil. Deux consultations médicales sont ouvertes ; deux infirmiers, deux médecins y travaillent, de même qu’un psychologue et un kinésithérapeute, mais l’activité de ce dernier cesse vite. Au fil du temps, une coordination sanitaire est mise en place avec des acteurs associatifs comme MDM, MSF, Gynécologie sans Frontières (Rodriguez, Tisserand, 2017).
La PASS Jules-Ferry 2
Progressivement, des préfabriqués remplacent le vieux bâtiment en béton (voir plan ci-après) qui fait office de PASS délocalisée. Médecins sans Frontières, qui a ouvert une clinique, supplée le temps que les équipes hospitalières soient prêtes et étoffées.
Les différents métiers se répartissent selon une logique spatiale dans les différents préfabriqués (voir photos ci-après), détachés les uns des autres : une partie est dédiée au « centre de tri » (salle d’enregistrement) ; une autre aux salles de consultations médicales et psychologiques ; une troisième à la pharmacie, et une autre encore au service social hospitalier (SSH) avec ses lits d’accueil (voir plan ci-après).
Des renforts viennent grossir les rangs de l’équipe initiale de la PASS Jules-Ferry 1. La 2, plus moderne dans ses infrastructures, est en première ligne et prend en charge les patient·es atteint·es de maladies saisonnières tandis que la PASS-CH gère les malades chroniques. La vie de ce lieu aura été de courte durée puisqu’en octobre 2016, la « new jungle » est démantelée.
Focaliser mon regard sur ce lieu répond à une forme de travail que j’apprécie, en référence à celle qu’emploie le journaliste Jean Hatzfeld qui, toute sa vie, a observé la reconstruction du Rwanda et l’a traitée sous divers angles. Dans cette perspective, il a consacré un ouvrage aux témoignages des Tutsis, un autre aux Hutus, un autre encore à la façon dont les communautés réapprennent à vivre ensemble… S’attacher à un terrain, c’est aussi le suivre sur la durée, et cela m’a appris que des phénomènes se saisissent avec le temps et prennent aussi un sens différent dans la durée.
La structure médicale de la PASS est composée d’une petite équipe comprenant des infirmièr·es, une psychologue, une secrétaire, un médiateur linguistique, des médecins vacataires, une assistante sociale et une dentiste. Le fonctionnement de la permanence des soins est assez original puisque certain·es soignant·es, âgé·es de 23 à 68 ans, sont issu·es du monde libéral et d’autres, de l’hôpital ; les un·es sont engagé·es dans des missions humanitaires, les autres ne le sont pas ; certain·es, enfin, sont français·es, d’autres afghan·es, d’autres en situation de reclassement professionnel. La PASS est par conséquent un agrégat atypique de différentes identités professionnelles, et en même temps un lieu d’échanges où peuvent aussi circuler des savoirs.
Histoire des permanences d’accès au soin de santé (PASS)
La permanence d’accès au soin de santé (PASS) est un dispositif apparu dans les années 1990 et dédié à toute personne n’ayant pas de couverture maladie universelle (CMU) ou de mutuelle (Parizot, 2003). L’idée est proposée par le Dr Jacques Lebas, un « French doctor », ancien président de Médecins du Monde, à qui le secrétaire d’État à la Santé, Bernard Kouchner, et la ministre du Travail, Martine Aubry, ont commandé un rapport en vue d’améliorer l’état de santé des personnes souffrant de précarité. Au cours de ses observations, Jacques Lebas repère une difficulté des populations précaires à accéder aux soins et les place au cœur des inégalités de santé. Il propose donc une approche qui permette de remettre dans le droit commun les exclu·es du système de santé et souhaite que la relation aux patient·es ne soit plus strictement médicale et technique, ce qui suppose de mettre en place une équipe médicale adaptée aux besoins des précaires en associant les personnels du travail social à ceux du soin. « Ces dispositifs doivent être à plusieurs entrées, c’est-à-dire organisés au niveau des diverses consultations hospitalières. Selon les besoins, une consultation référente – assurant des consultations de médecine générale et située au niveau d’une polyclinique, d’une consultation de médecine polyvalente, voire des urgences – pourra effectuer la prise en charge de premier recours, en dehors des urgences avérées, afin d’assurer la prise en charge des malades et leur éventuel aiguillage dans les services hospitaliers spécialisés ou les consultations extrahospitalières adaptées » (Lebas, 1998).
Le nom même de PASS a été réfléchi comme un « mot de passe », « délivré par le travailleur social au moment même de la consultation médicale et en fonction de la situation concrète du malade, un accès sans délai au plateau commun de l’hôpital, sans attendre la récupération effective des droits ». Le dispositif PASS a été inscrit dans la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
La PASS donne à voir, de l’intérieur, ce qui se passe à l’extérieur. Le travail de soin pourrait aussi s’observer du côté des ONG, mais le choix de l’hôpital comme terrain de recherche m’a paru intéressant à plus d’un titre. D’abord, parce que c’est une institution, elle traduit la manière dont l’État prend en charge les patient·es précaires. De plus, clarifier le positionnement de l’hôpital dans un contexte extrêmement politisé m’intéresse puisqu’il s’agit d’une institution dont la neutralité est imposée à ses agent·es : c’est l’une des injonctions de la fonction publique. S’intéresser à une institution, c’est aussi s’intéresser à une référence – médicale en l’occurrence –, un univers normé, hiérarchisé. Or, je voulais savoir comment cette machine administrative et protocolaire imposante s’adapte à une population en mouvement. De plus, si la mise à mal du service public à l’hôpital a incité une majorité de professionnel·les à sortir de leur devoir de réserve, la parole soignante restait cependant discrète avant ces mobilisations et cela m’intéressait de sonder cette parole, d’autant plus que la PASS de Calais – lieu sensible – n’est pas ouverte aux médias facilement, de sorte qu’on en connaît peu le fonctionnement.
Une microsociologie du travail médical
J’ai réalisé ce travail sociologique durant six années. Une fois intégrée dans ce lieu, j’ai bénéficié d’une entière liberté. Je me suis retrouvée assez vite en salle de consultation. Je me tenais debout derrière une armoire basse dans les premiers temps, puis j’ai pu m’asseoir sur un tabouret dans un coin de la salle ; en salle de soins, je tournais autour des patient·es en suivant les mouvements des infirmièr·es. Je me suis retrouvée tout de suite dans l’intimité des patient·es et on me demandait de sortir ou je sortais volontairement dès que la personne devait se déshabiller, par respect pour elle comme pour moi. J’ai accompagné ces observations, démarrées en 2013, d’une trentaine d’entretiens semi-directifs enregistrés entre 2013 et 2019 avec des soignant·es de la PASS. Ces entretiens ont été complétés par un documentaire, Les soignants de l’exil, réalisé en 2019 (docsdunord.fr/films/soignants-de-lexil).
Interrogations éthiques autour de ma présence
Réaliser une enquête de terrain sur un lieu intime et auprès d’une population dont on suppose qu’elle subit un processus de domination symbolique est extrêmement incommode pour l’enquêtrice. Le sentiment de malaise qui naît de ma seule présence m’a amenée à me poser des questions éthiques. Devais-je me présenter auprès de chaque patient·e ? En principe, oui. Mais le rythme de travail intense ne le permettait pas toujours. Certain·es médecins vacataires demandaient aux patient·es leur accord, d’autres, non. Et les médecins qui le faisaient l’oubliaient au bout des cinq premières consultations. Il est vrai que je voyais des regards de patient·es interrogatifs pointés vers moi, alors j’essayais d’adopter un comportement, des poses et regards qui ne soient pas évaluateurs ou qui les rassuraient sur le fait que je n’étais pas là pour obtenir des informations contre elleux.
Devais-je me fondre dans l’équipe ? Je ne portais pas de blouse – on m’avait parlé de m’en donner une lors d’un entretien préalable mais je n’en ai pas reçu, et j’ai abandonné l’idée aussi parce que, sans blouse, les patient·es me posaient déjà des questions comme si j’étais une soignante, et que cet effet aurait été décuplé si j’avais porté ce vêtement de travail. Sous l’effet des regards méfiants des patient·es à mon égard, il est vrai que j’ai hésité à porter un badge présentant mon rôle. J’essayais à l’occasion de donner la raison de ma présence, en salle d’attente ou lors de conversations informelles. De manière générale, je parcourais les pièces avec un calepin pour créer des discussions.
J’avoue aussi que, sachant qu’une thèse préserve l’anonymat, j’avais moins de scrupules dans ce cadre que je n’en ai eu en réalisant un documentaire, Les soignants de l’exil : à ce moment-là, en effet, j’ai pris un maximum de précautions, car il s’agissait de figer en images des visages pour la télévision. Avec le recul, je pense que le dispositif utilisé pour la réalisation du documentaire, qui consistait à mettre des affiches traduites avec icônes pour prévenir de ma présence, aurait pu être utilisé pendant la thèse.
Les contours de la médecine à la frontière
Peu de travaux sociologiques existent autour de ce croisement entre une sociologie de la santé et une sociologie de l’exil (Laacher, 2005). Comme le rappelle Caroline Izambert (2018), les exilé·es ont été fondu·es dans une sociologie de la santé des précaires sans représenter une figure distincte. Certaines études les repèrent, bien sûr, mais sans forcément s’y arrêter : ainsi, dans les années 1980, Patrick Declerck (2001) identifie parmi les SDF non exilé·es la présence d’une population immigrée peu coutumière des centres d’accueil. Il s’en étonne d’ailleurs et n’hésite pas à noter un détournement des hébergements d’urgence par ces jeunes pauvres étrangèr·es attiré·es par le confort, qu’il décrit comme « migrant[·e]s des pays de l’Est » et qu’il distingue de ceux qu’il nomme les clochard·es. Il existe de nombreux termes pour dénommer les SDF (« clochard·es », exclu·es, nouveaux·elles pauvres, marginales·aux, mendiant·es) tout comme la diversité des termes s’applique aussi aux exilé·es que l’on nomme tantôt « migrant·es », « réfugié·es », « déplacé·es »… Les clochard·es non exilé·es formaient déjà aux yeux de Patrick Declerck un groupe d’exilé·es, en tant qu’iels étaient perçu·es comme étrangèr·es, du fait d’être à la marge de nos sociétés. « Qui sont-ils […] ces exilés qui nous côtoient, qui dérangent notre regard et suscitent nos fantasmes ? » (Declerck, 2001).
Des études ont été réalisées auprès de personnes sans domicile fixe (Gardella, Laporte, Le Méner, 2008), de bénéficiaires d’allocations, de détenu·es, de malades atteint·es du VIH (Rosman, 1999), de sans-papiers (Fassin, 1997). Au sein de cette sociologie de la médecine des précaires, des chercheur·es se sont penché·es sur les pathologies d’exclusion, d’autres sur les structures médico-sociales en marge de l’hôpital (Bruneteaux, Lanzarini, 1996), d’autres encore sur la place des exclu·es à l’hôpital (Ogien, 1986), sur les recours aux droits, sur la relation soignant·e-soigné·e dans les centres de soins gratuits (Parizot, Chauvin, 2005), sur l’inégalité d’accès aux soins (Fassin, 2000). La question de la frontière comme porte d’entrée pour comprendre la santé des exilé·es est plus rarement évoquée ou alors peu visible (même si elle tend à le devenir).
Il me semble donc nécessaire d’explorer cette articulation entre population précaire exilée, espaces géographiques frontaliers et espace médical institutionnel, et de comprendre ainsi comment les frontières amènent à repenser sous un nouvel angle la médecine des précaires. Quels sont les effets de la frontière sur une institution comme l’hôpital ? Sur les professionnel·les de santé et sur leurs pratiques ? Quels sont les dommages corporels sur les patient·es exilé·es ? Quels sont les freins aux soins ? Quels sont les leviers pour les dépasser ? Comment un « lieu-frontière » redéfinit un espace social institutionnel ?
Alors que dans les trois premiers chapitres j’établis une mise en perspective entre les épreuves de l’exil – telles l’incertitude migratoire et l’errance –, et la sociologie de la santé, dans le quatrième chapitre j’explore les liens entre santé et arrachement au pays. La rencontre médicale avec l’altérité donne lieu à des reconfigurations du soin. Celles-ci permettent de repenser la relation soignant·e-soigné·e au prisme de l’exil, compris comme déracinement social et culturel. La dimension culturelle imprègne les consultations et oblige le personnel soignant à adapter ses pratiques pour soigner les exilé·es précaires : il existe bien des écueils et le retour aux valeurs fondatrices et aux gestes de base de la médecine clinique permet de réduire l’écart culturel, rapprochant ainsi un peu les professionnel·les de leurs patient·es.
Documenter les répercussions de la frontière sur les corps des patient·es et montrer comment elles bouleversent les pratiques professionnelles est aussi l’objectif de ce livre. La frontière pose de nombreuses limites aux soignant·es, et la puissance de cette médecine réside dans le fait que malgré les multiples freins au soin, les professionnel·les usent de diverses tactiques pour les dépasser. Malheureusement, je montrerai aussi que l’absurdité de la frontière a eu raison de quelques bonnes volontés.