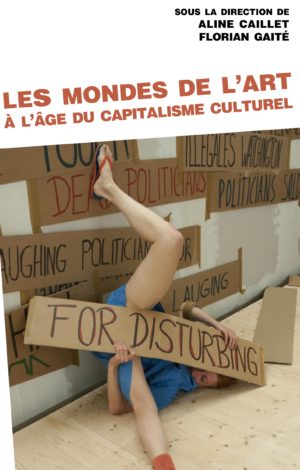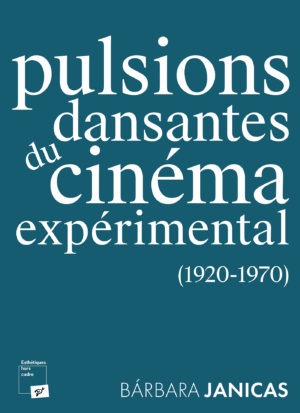À LA RECHERCHE D’UN « STYLE DUEL »
Qu’entendons-nous par « duo » ou « binôme » ? Certes, un seul film présente déjà un travail commun entre un réalisateur et compositeur. Pour autant, il nous semble important de prendre en compte une temporalité longue pour parler d’un véritable duo. Le choix renouvelé d’un même compositeur ne va pas forcément de soi : selon Bertrand Blier, « de film en film, il faut toujours changer de compositeur, surtout si la dernière expérience a été enthousiasmante. Car la suivante ne pourra jamais l’être autant ». Réengager un compositeur est non seulement le signe d’une bonne entente entre les deux créateurs, mais aussi celui d’une reconnaissance artistique. Ainsi, les duos qui font ici l’objet d’études sont des collaborations suivies qui prennent en compte au moins trois films, certains atteignant même des records (trente-six longs-métrages pour Claude Lelouch et Francis Lai, près d’une trentaine pour Steven Spielberg et John Williams).
« Collaboration au long cours », « duo », « binôme », « frères », « tandem », « couple »…, autant de manière de nommer le travail conjoint et prolongé d’un réalisateur et d’un compositeur. Co-auteur juridique du film, le compositeur joue un rôle essentiel dans la construction narrative et le vécu émotionnel de l’œuvre audiovisuelle. Les cas de collaboration unique sont très fréquents, soit que le réalisateur ait été déçu par le prédécesseur ou qu’il ait souhaité faire appel à un compositeur précis en rapport avec les besoins supposés de son film, soit qu’une production ou un studio ait tout simplement imposé un musicien.
Dès les débuts du cinéma sonore, des tandems privilégiés se sont pourtant mis en place : Max Steiner et Michaël Curtiz aux États-Unis, Jean Grémillon et Alexis Roland-Manuel en France, Serge Eisenstein et Serge Prokofiev en Russie. François Truffaut, pour lequel la musique ne constituait pas un enjeu majeur – ce qui ne veut pas dire qu’il ne la manipulait pas avec grand soin –, milite tout de même pour une collaboration poussée :
« J’ai des idées, mais je ne connais pas la musique. Souvent avec le musicien, le principal problème est celui du vocabulaire : quelquefois je dis à [Georges] Delerue : “Je vois ça joué en haut du clavier !” ou quelquefois je me sers d’exemples ou de comparaisons littéraires : c’est pourquoi on a intérêt à ne pas changer de musicien à chaque film. Comme on arrive à se comprendre de mieux en mieux, ce serait idiot d’avoir tout à recommencer avec quelqu’un d’autre. »
Si ce type de liens possède quelque chose de fascinant en ce qu’il semble mêler inextricablement sentiments amicaux et collaborations professionnelles, il faut se garder de toute valorisation excessive au sein de cette œuvre éminemment collaborative qu’est le film, d’autres binômes réalisateur/acteur (on parle parfois de « l’acteur fétiche » d’un réalisateur), réalisateur/chef-opérateur, réalisateur/scénariste ayant émergé tout au long de l’histoire du cinéma. Comme l’affirme Michel Chion, « l’œuvre de cinéma est plus que l’expression d’un moi ; elle est le résultat qui transcende les intentions affichées. Différente en cela de l’œuvre due à un auteur unique, elle peut créer ses auteurs ». Loin d’être incompatible, et c’est en cela qu’une étude filmique ou musico-filmique devient passionnante, ce propos n’empêche pas cette autre vérité, complémentaire, d’émerger : ce n’est sans doute pas un hasard si l’on retient le lien particulier qui se noue entre un réalisateur et un compositeur. On ne compte plus les duos qui ont contribué à singulariser un genre – comme le suspense (Alfred Hitchcock/Bernard Herrmann), le western (Sergio Leone/Ennio Morricone), l’épouvante (Terence Fisher/James Bernard), la fantaisie gothique (Tim Burton/Danny Elfman), le giallo italien (Dario Argento/Goblin) – ou une esthétique – comme le réalisme poétique (Jean Vigo/Maurice Jaubert), le néo-hollywoodisme (Steven Spielberg/John Williams) ou le symphonisme intimiste (François Ozon/Philippe Rombi). C’est cette question d’une auctorialité des duos réalisateur/compositeur que nous souhaitons analyser en profondeur. Tout duo prolongé aboutit-il nécessairement à une singularité musico-filmique ? Dans quelle mesure la musique participe-t-elle à définir le style d’un réalisateur ? Peut-on considérer certains duos comme un « auteur bicéphale » au sens de la « politique des auteurs » d’André Bazin ? Selon ce dernier, la politique des auteurs « consiste, en somme, à élire dans la création artistique le facteur personnel comme critère de référence, puis à postuler sa permanence et même son progrès d’une œuvre à la suivante. On reconnaît bien qu’il existe des films “importants” ou de “qualité” qui échappent à cette grille, mais justement on leur préfèrera systématiquement ceux, fussent-ils sur le pire scénario de circonstance, où l’on peut lire, en filigrane, le blason de l’auteur ». Selon cette conception, un duo entre réalisateur et compositeur poursuivrait, par-delà la diversité des films, la quête d’une esthétique musico-filmique singulière constituée de figures musicales et cinématographiques récurrentes qui, bien qu’elles puissent évoluer, demeureraient reconnaissables tout au long d’une œuvre. L’ensemble de ces figures constituerait alors la marque d’un style musico-filmique propre à un binôme, soit un véritable style duel. Il faut entendre ici l’adjectif « duel » au sens de « double », même si la polysémie de « duel » n’est pas complètement hors de propos ici : la collaboration peut parfois prendre l’aspect d’une cohabitation qui n’est pas toujours pacifique – l’histoire de la musique de film regorge à ce propos d’exemples de partitions refusées, comme celle de Bernard Herrmann pour Torn Curtain (Alfred Hitchcock, 1966), d’Alex North pour 2001 (Stanley Kubrick, 1968) ou de Gabriel Yared pour Troy (Wolfgang Petersen, 2004).
Le tandem formé par Hichcock et Herrmann a fait l’objet de plusieurs études approfondies, notamment celles de chercheurs américains comme Royal S. Brown et Bruce Graham qui ont pu établir l’existence d’une dialectique transversale forte focalisée sur la fonction psychologique des personnages. Cependant, même dans une entreprise artistique apparemment aussi concluante qu’entre Hitchcock et Herrmann, mieux vaut se garder de toute idéalisation. Michel Chion rappelle à ce propos que le « concept musical » de Frederico Fellini a survécu à Nino Rota (partitions de Luis Bacalov pour La Cité des femmes, 1981, de Gianfranco Plenizio pour Ginger et Fred, 1985, de Nicolas Piovani pour Intervista, 1987 et La Voce della Luna, 1990) ou que celui de David Lynch a précédé le recours à Angelo Badalamenti (Eraserhead, 1977). De même, ce que Royal S. Brown nomme à dessein l’« accord Hitchcock », résonnant notamment dans l’ostinato spirale de l’ouverture de Vertigo ou dans les accords amorçant le prélude de Psycho, apparait déjà dans les premières mesures du Concerto pour piano que Herrmann avait écrit pour Hangover Square (John Brahm, 1944) à des fins narratives quasi similaires. Il arrive aussi qu’un compositeur puisse constituer plusieurs tandems remarquables, c’est le cas, par exemple, d’Alexandre Desplat qui compose dans des styles différents selon qu’il travaille pour Jacques Audiard ou Wes Anderson, tout en mettant en valeur des esthétiques propres à chacun.
Si tous ces cas de figure existent, l’inverse peut également se produire, notamment lorsqu’un réalisateur et un compositeur, une fois sortis d’une collaboration au long cours, reforment ailleurs, chacun de son côté, d’autres duos. Hitchcock terminera sa carrière avec le jeune Williams pour un résultat mitigé (Family Plot, 1975), tandis que ce dernier commence l’une des collaborations les plus unanimement saluées du cinéma mondial aux côtés de Spielberg (Jaws, 1975). Alors même qu’il avait déjà trouvé son complément idéal en la personne de Delerue, Truffaut sollicitera Herrmann (peu de temps après la fin de sa collaboration avec Hitchcock) pour deux films (Fahrenheit 451, 1965 et La mariée était en noir, 1968). Malgré l’admiration que le réalisateur français nourrit pour le compositeur de Hitchcock, leur bref duo n’aura été qu’une réussite partielle, jalonnée par des incompréhensions de part et d’autre dont les films portent quelques traces (le second en particulier). On pourrait reconduire encore et encore ce genre d’observations.
Étonnamment, rares sont les duos – même ceux qui sont souvent cités ou appréhendés au détour d’un travail universitaire de première main, d’un article de revue ou d’un chapitre d’ouvrage – qui ont déjà fait l’objet d’études esthétiques et/ou analytiques détaillées d’un point de vue à la fois cinématographique et musicologique. À cet égard, le livre de Solenn Hellégouarch sur les duos formés par Normal McLaren et Maurice Blackburn d’un côté, et David Cronenberg et Howard Shore de l’autre, fait figure d’exception. Souvent, les approches sont d’ordre biographique, comme les ouvrages de Frédéric Gimello-Mesplomb sur Georges Delerue et celui de Vincent Perrot sur Vladimir Cosma. D’autres livres compilent des entretiens croisés entre réalisateurs et compositeurs, au sein desquels les questions de stylistique musicale ne sont finalement qu’effleurées, même s’ils restent bien sûr très intéressants dans les propos rapportés : ce sont les cas, par exemple, des ouvrages de Vincent Perrot, de Benoît Basirico ou de l’ouvrage coordonné par N. T. Binh, José Moure et Frédéric Sojcher. Signalons aussi les nombreux entretiens – parfois croisés – que l’on peut trouver dans les livrets de disques (par exemple la collection discographique « Écoutez le cinéma ! » d’Universal Music dirigée par Stéphane Lerouge) ou sur les sites internet comme Underscores ou Cinezik en France. Dans le présent volume, les différents auteurs, essentiellement des musicologues et des historiens du cinéma, ont été invités à privilégier une méthode analytique et esthétique sans pour autant délaisser toute une part de contextualisation et un travail de sources précis afin d’apporter une dimension historique nécessaire.
Dans son ouvrage précédemment cité, Solenn Hellégouarch a proposé quelques constantes qui marquent des relations privilégiées entre un réalisateur et un compositeur dans le cadre d’un duo : la sensibilité musicale du réalisateur, l’implication précoce du compositeur dans le projet, la grande liberté accordée au compositeur, la malléabilité ou la disponibilité du compositeur qui se donne pour objet de « capter l’univers du cinéaste », la volonté d’outrepasser les conventions musico-filmiques et d’explorer les rapports musique/images. Ces conditions suffisent, certes, pour constituer un binôme. Mais nous avançons ici l’hypothèse que cela n’aboutit pas forcément à l’émergence d’un « style duel ». C’est ce que prouvera notre première partie intitulée « Duos de choc. Au service de l’émotion collective ». En s’inscrivant dans le cadre du cinéma populaire ou, comme l’appelle plus justement Michel Chion, un « cinéma d’émotion collective », les réalisateurs travaillent sur des projets parfois très différents dont le seul dénominateur commun est un impératif de divertissement et de rentabilité. Lié au réalisateur pour des raisons à la fois humaines et artistiques, le compositeur n’a d’autres choix que de s’adapter à des œuvres très diverses, en tenant compte de l’horizon d’attente des spectateurs (et des producteurs !). Ennio Morricone a très bien résumé cette situation :
Quand j’ai collaboré à des films qui coûtaient vingt millions de lires et qui n’avaient pas la prétention, au dire de leurs auteurs, d’être commerciaux, combien je me suis senti plus libre ! Mais quand je fais un film avec Giancarlo Giannini, qui coûte assez cher, je dois me poser la question du public, le réalisateur doit aussi se la poser, s’il n’est pas inconscient. Sinon, la voie est celle du cinéma-vérité : faire des films qui coûtent très peu cher et ne pas se préoccuper des spectateurs. Je ne sais pas si c’est utile pour le cinéma commercial ; ce sera utile pour l’histoire du cinéma. Jusqu’à quel point suis-je prêt à faire une musique plus recherchée, moins facile ? Peu m’importe que la musique soit vendue en dehors du film, cela ne m’a jamais importé, et encore moins maintenant.
Dans un cadre commercial, la collaboration suivie entre un réalisateur et un même compositeur revêt finalement des aspects aussi variés que les films eux-mêmes, les compositeurs étant généralement guidés par des pistes temporaires. Il résulte de ces « duos de choc » des difficultés à parvenir au « style duel » défini plus haut – ce qui ne signifie pas pour autant que réalisateur et compositeur n’ont pas chacun un style propre –, en ce qu’il importe avant tout d’aboutir à un produit parfaitement calibré pour leur cible (ce dont s’assurent d’ailleurs un certain nombre de projections-tests). S’ils ne se caractérisent donc pas par l’émergence de singularités musico-filmiques, ces duos finissent tout de même, par la régularité des collaborations, par créer une forme d’unité à l’échelle d’une filmographie, ce que nous souhaitons montrer à travers les différentes études composant la première partie de notre ouvrage.
C’est le cas, par exemple, du duo formé par Francis Lai et Claude Lelouch. En faisant régulièrement appel aux talents de mélodiste du premier – il s’agit de l’une des collaborations les plus longues du cinéma mondial : plus de cinquante ans ! –, le second peut compter sur une bande originale populaire au sens où tout un chacun peut se l’approprier et en fredonner les principaux airs (le fameux Chabadabada…). Charge, par la suite, à l’arrangeur Christian Gaubert de déployer les chansons sous la forme de thèmes sur l’ensemble du film. Jérôme Rossi explore le fonctionnement de ces deux duos « enchâssés » entre le compositeur et le réalisateur d’une part, le compositeur et l’arrangeur d’autre part. Notons que, lorsqu’il travaille pour d’autres réalisateurs, Lai ne change ni son style ni sa conception de la musique de film, montrant que, s’il existe un « style Lai » (un goût pour l’électronique musical et une « patte mélodique » développée en partie au contact des films lelouchiens), ce dont on ne saurait douter, il ne paraît pas justifié de parler d’un style duel Lelouch/Lai.
Si, comme Lai, Cosma cultive l’évidence mélodique, sa solide formation musicale au Conservatoire national de Bucarest puis de Paris lui permet d’expérimenter à sa guise les couleurs les plus insolites. En lui confiant sa première partition de film (Alexandre le Bienheureux, 1967) et en encourageant sa démarche de recherche timbrique, Yves Robert fait éclore chez Cosma une verve créatrice prodigieuse qui va marquer quarante ans de cinéma populaire français. Dans ce volume, Sylvain Pfeffer s’intéresse aux intertextualités présentes dans la collaboration Cosma/Robert, ainsi qu’à la manière dont la musique est mise en scène. Là encore, il s’agit plus d’une belle collaboration que d’un style duel, Cosma creusant une veine personnelle qui change finalement assez peu selon qu’il travaille pour Gérard Oury, Claude Pinoteau, Pierre Richard, Francis Veber ou Claude Zidi.
Les liens d’amitié et de confiance qui liaient Robert et Cosma sont tout aussi profonds entre Spielberg et Williams, le premier allant jusqu’à modifier le montage de la scène finale d’E.T. the Extra-Terrestrial (1982) pour laisser plus de liberté d’expression à la musique. En se concentrant sur cette partition, Chloé Huvet insiste sur quelques traits caractéristiques de l’esthétique musico-filmique développée par Spielberg et Williams dans le genre du film de science-fiction : l’amitié, l’enchantement, la solitude et les fins mélancoliques. C’est l’occasion de remarquer que les deux créateurs ont abordé de nombreux genres (science-fiction, drame historique, aventure, comédie) dans lesquels ils ont laissé une empreinte durable moins par un style duel – le style féérique de Williams est le même pour le Hook de Spielberg (1991), pour Home Alone de Chris Columbus (1990), voire pour les trois premiers Harry Potter (