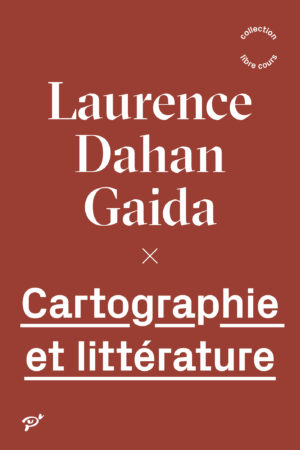Lire Derrida ?
« Que faut-il faire pour indisposer 1 ? »
« Un entretien avec Derrida ? Enfin, on va peut-être y comprendre quelque chose 2 ! » : c’est par ces mots, déjà rebattus au moment où ils furent rapportés en 1983, que Catherine David choisit de débuter son entretien avec Jacques Derrida pour Le Nouvel Observateur 3. Nul besoin d’attendre la mort du philosophe en 2004, et la nécrologie significative du New York Times intitulée « Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74 4 », ou encore celle de The Economist, qui consiste à déplorer la disparition d’un homme qui, s’il était « confus », était tout de même « sincère et érudit » 5, pour que Derrida soit accusé d’obscurité, ou d’obscurantisme 6. Depuis au moins le début des années 1980,
de John R. Searle au « Carnet Zilsel 7 », c’est aussi cela que nomme « Derrida » : un charabia obscur, une rhétorique volontairement absconse, bref : une prose sciemment illisible. Sans entrer dans un débat qui va au-delà de l’œuvre de Derrida elle-même, on peut noter que la célèbre obscurité derridienne a jusqu’alors été prise pour argent comptant par ses détracteurs comme par nombre de ses exégètes. Plutôt que de comprendre l’opacité du philosophe comme la conséquence, heureuse ou malheureuse, heuristique ou vaine, mais toujours accidentelle, d’un style philosophique, ce livre l’appréhende comme l’effet d’une rhétorique singulière. C’est penser que l’œuvre derridienne n’est pas absconse par hasard, mais qu’elle relève d’une rhétorique de l’illisible dont il revient au critique de rendre compte. Si, on l’a vu, toute l’œuvre, immense (plus de cent ouvrages), a une réputation d’obscurité, certains ouvrages se distinguent toutefois par une mise en page inhabituelle, propre à compliquer la lecture. C’est le cas des textes doubles comme Glas 8, « Tympan 9 », ou Le Calcul des langues, composés en deux colonnes, de Feu la cendre 10, qui distingue nettement le contenu des pages de gauche de celui des pages de droite, ou encore de « Survivre. Journal de bord 11 », dont la page est divisée horizontalement en deux textes distincts. Les dispositifs digraphiques mis en œuvre par ces textes participent à l’élaboration de ce que j’appelle une illisibilité montrée 12 : s’ils sont décodables, ces textes se caractérisent d’abord par l’exhibition d’un dispositif fait pour empêcher la lecture. L’opacité derridienne, étudiée dans la perspective des dispositifs digraphiques producteurs d’illisibilité, devient autre chose qu’un constat partagé, et peut être abordée comme l’effet construit d’une rhétorique.
Textes digraphiques
De 1969, année où fut distribuée aux participants d’une conférence du Groupe d’études théoriques, une feuille mettant en regard un extrait du Philèbe de Platon et « Mimique » de Stéphane Mallarmé, à 1991, année de la parution du livre à quatre mains de Derrida et Geoffrey Bennington – qui met le texte « Derridabase » de Bennington en regard du « Circonfession » de Derrida –, le philosophe publia plusieurs textes présentant une page divisée en deux : « LIVING ON. Border Lines », en 1979, publié dans un volume réunissant les figures de la Yale School et superposant un commentaire de Percy Bysshe Shelley et Maurice Blanchot à un « Journal de bord » dans le quart inférieur de la page ; « Tympan », qui figure en ouverture de Marges de la philosophie (1972), Feu la cendre (1987) et Glas (1974), ce dernier en constituant l’exemple le plus célèbre. Il travailla en outre, en 1972-1973, à un texte en deux colonnes sur Étienne Bonnot de Condillac, Le Calcul des langues, qui demeura inachevé et qui a fait l’objet d’une édition récente 13.
Si on ramène souvent la mise en page en deux colonnes de Glas au texte de Jean Genet, « Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés réguliers, et foutu aux chiottes 14 », il serait vain de réduire le dispositif digraphique à un intertexte unique. D’abord, Glas n’est pas le premier texte à présenter une mise en page double ou divisée, mais le troisième ; bien que « Tympan » comme « La double séance » soient postérieurs à la parution de « Ce qui est resté… » dans Tel Quel en 1967, rien ne permet d’affirmer que ce dernier a joué un rôle princeps dans leur production, Genet n’y faisant pas l’objet d’un commentaire comme dans Glas. De plus, le texte de Genet n’est pas unique en son genre : James Joyce déjà, dans le livre II de Finnegans Wake, jouait avec les possibilités de la typographie et de la mise en page en reproduisant les « Nightlessons » des enfants 15. Par ailleurs, Derrida n’est pas le seul de ses contemporains à diviser la page en deux ; entre 1960 et 1980, d’autres textes en deux colonnes brouillant les genres (littérature, philosophie, critique, psychanalyse, etc.) ont paru : deux textes en deux colonnes parurent dans la revue Tel Quel 16, trois en comptant celui de Genet ; « Partie » d’Hélène Cixous a paru en 1973 dans une revue de psychanalyse 17, tandis que le livre tiré de la conférence « Schizo-Culture » (1975) regorge d’exemples d’expérimentations de ce type 18. Quant à des exemples précédant 1960, Christine Buci-Glucksmann indique que les Cahiers philosophiques de Lénine recèlent des commentaires disposant la page en deux colonnes, avec des citations dans la colonne centrale et des annotations de Lénine dans la colonne de droite ; elle renvoie également aux « Essais sur le fascisme » de Bertolt Brecht, publiés dans Écrits sur la politique et la société 19, recueil de textes écrits entre 1933 et 1939 traduit en français en 1971 20. Les textes digraphiques de Derrida doivent donc quelque chose à l’avant-garde de l’époque, que ce soit celle de Tel Quel, celle des deleuziens de Semiotext(e), ou celle des marxistes : influence réciproque et diffuse, qui relève d’une conception étendue de l’intertextualité 21.
Les critiques s’accordent généralement à dater un changement dans le style de Derrida, au profit d’une certaine avant-garde poétique, de 1968-1969 : c’est la période de son engagement auprès du groupe Tel Quel, auquel il contribue en participant aux séances du « Groupe d’études théoriques » lancé à la rentrée 1968 22, par des articles publiés dans des ouvrages collectifs 23 ou des textes publiés dans la revue du groupe 24. Ainsi Benoît Peeters inscrit-il Glas dans un rapport téléologique à « La double séance » : « De ce nouveau mode de lecture, qu’il commence ici à mettre en acte, Glas offrira cinq ans plus tard l’application la plus radicale 25. » Rudy Steinmetz y voit quant à lui la « deuxième époque 26 » du style de Derrida, qu’il caractérise ainsi :
[…] à partir de l’exposé sur « La différance » [publié dans Théorie d’ensemble], s’ouvre par contre le champ d’une écriture qui s’enfonce, toujours plus profondément de texte en texte, dans l’épaisseur de ses signifiants sous la pression disséminante d’un concept qui, une fois formulé, exigeait que le langage, au sens le plus large du terme (texte et dispositif paratextuel), se soumette à ce qui travaillait à la libérer. Marqué du sceau de la phénoménologie husserlienne, le style neutre de la première époque bascule alors, notamment grâce au levier du texte mallarméen, vers une pratique où la vigilance du concept fait place à la jubilation et à la dissipation de l’écriture. Cette phase d’explosion de l’écriture correspond à ce que nous conviendrons d’appeler une Esthétique de la dispersion […], esthétique qui est le lieu où la différance « apparaît » dans tous les effets de prolifération dont elle est porteuse sur le plan graphique 27.
À l’écriture philosophique classique qui caractérisait les œuvres de Derrida depuis L’Origine de la géométrie 28, succéderait une période d’expérimentation poétique préoccupée du « langage, au sens le plus large du terme (texte et dispositif textuel) » plutôt que de « la vigilance du concept », une écriture du jeu (« jubilation » et « dissipation », « explosion » et « prolifération »), une « pratique » d’écriture tournée vers l’expérimentation y compris « sur le plan graphique ». Se rapportent à cette « esthétique de la dispersion », La Dissémination, « Tympan » dans Marges, Glas et La Vérité en peinture 29, en tant que ces textes « manifestent […] un certain rapport entre le discours philosophique et une certaine pratique avant-gardiste de la littérature 30 ». Les textes présentant une mise en page double, loin d’être inouïs dans l’œuvre de Derrida, participeraient donc d’une pratique textuelle plus large, englobant toutes les entorses au discours philosophique habituel, ou du moins à l’image que l’on s’en fait 31. Dans la même perspective, Peter Mahon met en garde contre la tentation de faire de Glas un texte à part ; pour lui, le dispositif digraphique ne représente qu’une forme d’hétérogénéité textuelle parmi d’autres, comme le « polylogue » utilisé dans « Restitutions 32 » et dans Feu la cendre 33 par exemple, mais aussi le dialogue fictif de « Le langage (Le Monde au téléphone) 34 » et du Monolinguisme de l’autre 35, ou encore les « fragments détachés [désencadrés] » de « Parergon 36 » et la bande autobiographique de « Circonfession 37 ». À l’édition bilingue anglais-français d’Éperons citée par Mahon 38, on pourrait ajouter la version quadrilingue du même texte parue chez Corbo e Fiore Editori en 1976 39, ainsi que celle de Signéponge 40 qui reproduit de même le texte français en regard de sa traduction anglaise, rappelant le dispositif en deux colonnes. Derrida lui-même embrasse hétérogénéité énonciative et hétérogénéité graphique lorsqu’il répond à une journaliste : « J’ai écrit des livres à plusieurs colonnes ou à plusieurs voix (le “Tympan” de Marges, La Double Séance, Glas, La Vérité en peinture, Pas, La Carte postale) 41. » Le corpus, on le voit, s’enfle indéfiniment, rendant toute délimitation de plus en plus arbitraire ; si le seul critère de l’hétérogénéité était retenu, tous les textes signés « Jacques Derrida » pourraient y figurer, tant ils répondent à la concession ouvrant La Carte postale et annotant la signature de l’auteur : « Tu as raison, nous sommes sans doute plusieurs, et je ne suis pas si seul que je le dis 42… »
Si cette étude entend rendre compte de manière privilégiée des textes digraphiques de Derrida, elle ne prétend pas s’y restreindre absolument, ni en faire un corpus au statut d’exception par rapport au reste de l’œuvre du philosophe. Au contraire : le passage par ces exemples limites que constituent les textes divisés en deux doit permettre de rendre visibles une conception du texte et de l’écriture, ainsi qu’une rhétorique philosophique largement identifiable dans toute l’œuvre de Derrida. Comme le texte digraphique présente deux textes à la fois et invite le lecteur à l’infinie reconstruction d’autres textes possibles, chaque texte de Derrida peut être considéré à son tour comme une colonne ou une bande susceptible d’être accolée, superposée à d’autres, signées « Derrida » ou non 43. On tentera cependant de se garder du vertige que manque rarement de provoquer une œuvre si vaste et si marquée par le double 44 : la conception même de l’œuvre comme hors livre invite à un renvoi intertextuel infini peu propice à l’analyse. La lecture d’un corpus défini, composé de « La double séance », de « Tympan », du Calcul des langues, de Glas, de « Survivre. Journal de bord » et de Feu la cendre, doit donc permettre d’analyser précisément comment s’élabore la rhétorique de l’illisible caractéristique du philosophe.
La préoccupation mallarméenne
Pour comprendre la rhétorique de l’illisible derridienne, il est nécessaire de l’inscrire dans une filiation à la fois trop évidente et souvent négligée : celle de Mallarmé. Toute l’œuvre de Derrida témoigne d’une préoccupation mallarméenne ; un seul coup d’œil à l’entrée « Mallarmé » du Derridex suffit pour s’assurer de son importance comme de sa constance : le nom apparaît dans plus de 28 ouvrages, de 1961 dans l’« Introduction » à L’Origine de la géométrie d’Edmund Husserl 45, à 2003 dans Genèses, généalogies, genres et le génie 46. Si « La double séance » constitue l’étude la plus approfondie que Derrida a jamais consacrée au poète, il faut également mentionner le chapitre « Mallarmé » rédigé pour le troisième volume du Tableau de la littérature française de Gallimard, en 1974 47. Outre « La double séance », texte entièrement consacré à « Mimique », figurent dans notre corpus des références explicites à Mallarmé : le « coup de donc » qui conclut « Tympan » et sert de coup d’envoi à Marges 48, ou encore l’analyse d’« Aumône » suivie de celle de la traduction de « The Bells » d’Edgar Poe, dans Glas 49. Mais on ne saurait réduire la présence de Mallarmé dans ces textes à quelques références ; parler de préoccupation plutôt que d’intertextualité permet justement d’aborder la question de l’influence de Mallarmé de manière plus subtile et plus large que ne l’autorise le simple relevé d’occurrences 50. La question des rapports entre les deux œuvres déborde la simple référence à trois égards au moins : elles se retrouvent autour d’une certaine conception du texte ; elles partagent une rhétorique de l’illisibilité ; elles exhibent un rapport comparable à la langue.
D’abord, ces textes radicalisent, dans leur mise en page mais aussi dans leur syntaxe, une conception du texte articulée sur la question du rythme, telle qu’elle s’élabore notamment dans la « Préface » à Un coup de dés :
L’avantage, si j’ai droit à le dire, littéraire, de cette distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, semble d’accélérer tantôt et de ralentir le mouvement, le scandant, l’intimant même selon une vision simultanée de la page : celle-ci prise pour unité comme l’est autrepart le Vers ou ligne parfaite 51.
Aussi nos textes forcent-ils leur lecteur à une « vision simultanée de la page » qui invite à réélaborer le rythme de la lecture, les blancs entre les mots devenant tout aussi significatifs que les mots eux-mêmes. On peut alors prendre au sérieux le programme annoncé dans « La double séance » : « […] déterminer la structure de l’espacement mallarméen, calculer ses effets et en tirer les conséquences critiques 52 », et sa reformulation dans Glas, au détour d’une analyse de Mallarmé : « […] (le propos serait, depuis La double séance, de repenser la valeur de rythme et de l’introduire à réélaborer le graphique de la mimesis. […] 53). » Les textes digraphiques résulteraient en partie de ce calcul des conséquences de Mallarmé sur le texte : toute la réflexion sur la machine par exemple – « machine d’écriture » dans « Tympan » 54, l’organon de Glas ou sa « machine à draguer » 55, jusqu’à la machine à reproduire qu’est le théâtre dans « La double séance » – peut être lue comme une réponse à l’injonction mallarméenne de « sortir [la Poësie] du Rêve et du Hasard 56 » ou, comme il l’exprimera plus tard, « de ne point produire (fût-ce des merveilles) au hasard 57 ». Quoi de mieux qu’une machine pour abolir le hasard ? Le fantasme d’une machine textuelle, omniprésent dans ces textes, constituerait une manière parmi d’autres de « repenser la valeur de rythme » après Mallarmé. De même, le dispositif de la page coupée en deux, « rééelabor[ant] le graphique de la mimesis », serait un moyen d’obliger le lecteur à élaborer d’autres rythmes de lecture, non linéaires, et pourrait ainsi être compris comme une machine à produire d’autres textes, au gré de chaque lecture.
Ensuite, les deux œuvres participent d’une rhétorique de l’illisibilité. Derrida et Mallarmé partagent les attaques d’une critique privilégiant la clarté : jugés obscurs, leurs textes créent un effet d’opacité souvent mal reçu des lecteurs, qui se scandalisent volontiers qu’on ne s’exprime apparemment pas pour être entendu. Mallarmé, comme Derrida, s’est défendu de provoquer volontairement une telle réception. Ainsi écrivait-il à Edmond Goose le 10 janvier 1893 :
[…] non, cher poëte, excepté par maladresse ou gaucherie, je ne suis pas obscur, du moment qu’on me lit pour y chercher ce que j’énonce plus haut, ou la manifestation d’un art qui se sert – mettons incidemment, j’en sais la cause profonde – du langage : et le deviens, bien sûr ! si l’on se trompe et croit ouvrir le journal 58.
Ou encore dans « Le Mystère dans les Lettres », réponse à un article de Marcel Proust intitulé « Contre l’obscurité », entièrement dédiée à cette question. À chaque fois, Mallarmé souligne la différence de nature entre ses poèmes, ses textes, et la presse :
Je préfère, devant l’agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire –
Sinon dans le journal […] 59.
Si Derrida ramène également cette accusation d’obscurité à une question d’attente, à un malentendu en somme sur ce que le lecteur est en droit d’attendre du poète ou du philosophe, il n’attribue pas ce malentendu à la paresse ou à l’incompétence du lectorat, bien au contraire :
Mais ne croyez-vous pas, ceux qui me font le procès que vous dites, qu’ils comprennent l’essentiel de ce qu’ils disent ne pas comprendre, à savoir qu’il s’agit d’abord de mettre en question une certaine scène de lecture et d’évaluation, avec ses conforts, ses intérêts, ses programmes de toute sorte ? On n’est pas en colère contre un mathématicien ou un physicien qu’on ne comprend pas du tout, ou contre quelqu’un qui parle une langue étrangère, mais contre quelqu’un qui touche à votre propre langue, à ce « rapport », justement, qui est le vôtre 60…
C’est parce que, contre toute attente, il ne s’exprime pas « dans cette “langue de tout le monde” dont on sait bien qu’elle n’existe pas 61 », parce qu’il touche à la langue maternelle, à celle de la communication ordinaire, parce qu’il met en œuvre « un art qui se sert […] du langage », que le poète ou le philosophe est mis en procès par le public 62.
Or, c’est bien ce rapport au français comme langue étrangère que partagent Mallarmé et Derrida. À travers la lecture et la traduction de Poe, puis l’apprentissage de l’anglais pour devenir professeur, Mallarmé se confronte à une langue étrangère, et cette confrontation bouleverse son rapport à sa propre langue 63, « car on ne voit presque jamais si sûrement un mot que de dehors, où nous sommes ; c’est-à-dire de l’étranger », écrit-il dans Les Mots anglais 64, assumant une position d’extériorité résolue par rapport à son objet. Dans cet ouvrage pédagogique étonnant, Mallarmé dresse un catalogue des mots anglais en fonction de leur formation et de leur étymologie (origine anglo-saxonne ou française) qui s’apparente à un traité de cratylisme 65. Cependant, la classification des mots selon leur origine ne doit pas masquer le « déplacement avantageux » qu’opère le traité : plutôt que d’inscrire fermement chaque terme, et en particulier les mots issus du français, à une place déterminée, il décrit les « lois de permutation » que subissent les phonèmes, les altérations et autres glissements qui rendent les termes inassignables 66. Ironiquement :
[…] même lorsque l’anglais semble s’efforcer de limiter les processus d’assimilation, lorsqu’il « va jusqu’à renoncer à ses us et à son génie ; et torture tout ce qu’il possède d’orthographes diverses, pour aboutir à ce point : conserver à nos mots leur physionomie étrangère » (1043), l’« intention pieuse » produit des « vocables qui semblent ne plus nous appartenir et n’avoir jamais appartenu à l’Anglais » (1044) 67.
L’intention « d’assigner aux éléments de l’Anglais un lieu, une origine, une propriété 68 » est ainsi mise en déroute alors que, parallèlement, Mallarmé forme des familles de mots aléatoires étymologiquement, réunies uniquement par vocables 69, sapant ainsi de l’intérieur le projet philologique qui semble pourtant être le sien. Ce travail sur la langue débute juste après une crise profonde que traverse Mallarmé durant l’année 1866-1867 70 ; en proie à l’impuissance, le poète souffre une « longue agonie 71 » dont il ressort transformé : « Je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu, – mais une aptitude qu’a l’Univers Spirituel à se voir et à se développer, à travers ce qui fut moi 72. » Le poète désormais radicalement étranger à lui-même reconstruit alors son rapport au langage en travaillant au manuel des Mots anglais, pour aboutir au « vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire 73 » : le français doit ainsi s’envisager comme langue seconde, depuis l’extérieur qu’est l’étranger, pour produire « cette surprise de n’avoir ouï jamais tel fragment ordinaire d’élocution, en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans une neuve atmosphère 74 » qu’est la Poësie.
Ce rapport d’étrangeté à la langue, Derrida semble à bien des égards le partager avec Mallarmé. Il s’agit chez lui de la conviction intime qu’« il n’y a pas de monolinguisme absolu 75 », dont découle le paradoxe qu’« On ne parle jamais qu’une seule langue » et que pourtant « On ne parle jamais une seule langue 76 ». Comme les mots anglais issus du français n’étaient plus tout à fait français ni jamais tout à fait anglais, la langue que forge Derrida semble toujours « au bord 77 ». Dans Glas, le parallèle avec la démarche mallarméenne est frappant : accumulant les morceaux d’étymologie, les entrées de dictionnaires, les extraits mentionnant « glas », Derrida produit une philologie parodique dont on ne peut ignorer la parenté avec Les Mots anglais. Non seulement le livre offre un florilège des « glas » de la littérature, en passant par un panorama de ses origines étymologiques, mais il explore les ramifications du mot à travers le phonème GL, du Klang dans l’Esthétique de Hegel à la « glu » de Genet. Travaux de reconstruction poétique de la langue en terre philosophique, les textes digraphiques participent donc d’une préoccupation mallarméenne qui s’étend d’un souci de modernité manifeste à une mise en œuvre poétique de l’écriture.
Problèmes
Les textes digraphiques ont en commun d’exhiber un redoublement qui ne cesse d’inquiéter la parole philosophique. L’opération digraphique, loin de se réduire à un « “mélange des genres” 78 », comme ont bien voulu l’appeler certains lecteurs, ou à une simple bravade typographique, n’est pas dénuée d’effets destructeurs ni de violence :
Par cette fellure [sic] de l’identité philosophique qui revient à s’adresser la vérité sous enveloppe, à s’entendre parler au-dedans sans ouvrir la bouche ou montrer les dents, le sanglant d’une écriture disséminée vient écarter les lèvres, viole l’embouchure de la philosophie, met sa langue en mouvement, la porte au contact enfin de quelque autre code, d’un tout autre type. Événement nécessairement unique, non reproductible, dès lors illisible en tant que tel et sur le coup, inaudible dans la conque, entre terre et mer, sans signature 79.
C’est le viol de la philosophie par l’écriture que raconte ainsi Derrida : une « écriture disséminée », l’autre blessée et blessante du discours philosophique, force la philosophie à s’ouvrir à son autre, c’est-à-dire à ce qui ne parle pas sa langue, « quelque autre code, d’un tout autre type », produisant un « événement […] illisible », du moins « sur le coup ». Si l’on peut être tenté de reconnaître dans cet « autre code » quelque chose comme la littérature ou la poésie 80, on ne peut l’y réduire. Comme le montre Nicholas Cotton-Lizotte, il s’agit moins chez Derrida de subversion – de l’un par l’autre, de la philosophie par la littérature, d’une voix par une autre – que de pervertibilité : conçue comme indiquant « un mouvement tournoyant de retournement et de renversement, de relance […] la notion sert moins à faire l’apologie de propriétés prétendument subversives de la littérature qu’à comprendre […] des gestes “pervers” de la pensée philosophique et des effets concrets d’écriture 81 ». L’auteur reconnaît des « dispositifs textuels pervers » à l’œuvre dans certains textes, sans que cela ne recoupe systématiquement la mise en présence de la littérature et de la philosophie ; c’est le cas d’« Envois » dans La Carte postale 82, mais aussi de Feu la cendre 83, de « Circonfession 84 » et de Glas 85, travaillés par Cotton-Lizotte, auxquels pourraient s’adjoindre les autres textes digraphiques.
Les textes digraphiques sont finalement caractérisés par une seule chose : l’exhibition d’un redoublement du texte, qui entraîne une perversion du contrat de lecture que le lecteur peut raisonnablement supposer avoir passé avec le texte (à travers le genre annoncé du livre, l’éditeur, le nom de l’auteur sur la couverture, bref : toutes les informations du paratexte qui construisent les attentes du lecteur). Le double semble indissociable d’une certaine duplicité : rendant la lecture linéaire impossible, les textes digraphiques semblent obéir à une stratégie de déception du lecteur (déçu dans ses attentes mais aussi trompé par le texte). Il y a une insolence dans ces textes, qu’on ne saurait trop prendre au sérieux. Ainsi Derrida parle-t-il, plutôt que du « dispositif » (mot des journalistes qui l’interrogent) en deux colonnes de Glas, de « l’indispositif », en raison de « ce qui en lui travaille sans cesse à indisposer 86 » ; et un peu plus loin : « L’indispositif dans le dispositif ou comme autre dispositif, comme ce qui fait faux-bond au dispositif, c’est peut-être plus intéressant, plus inévitable. S’il y a des effets de lecture recherchés, ils sont là : que faut-il faire pour indisposer 87 ? » « Indisposer » le lecteur, lui « faire faux-bond », tout faire en somme pour qu’il ne soit ni dispo ni bien disposé, mais qu’il s’indispose contre le texte : voilà ce qui rend les choses intéressantes, et « inévitable[s] », c’est-à-dire calculées, anticipées, soustraites au hasard. Quand on s’attendrait à ce que le texte soit conçu pour plaire, on s’aperçoit qu’il est stratégiquement agencé pour décevoir.
La double science : philosophie et rhétorique
Les critiques s’accordent uniment sur la difficulté qu’il y a à écrire sur Derrida. D’un ouvrage à l’autre, les mêmes protestations se font entendre, de ne pas y toucher, de ne pas froisser, de ne pas contredire le texte. Certes, les textes derridiens présentent des difficultés véritables au commentateur, ne serait-ce que par leur statut de textes seconds : comment commenter un commentaire ? En outre, la place privilégiée qu’occupe la question de l’écriture et de la rhétorique dans l’œuvre derridienne, et les longs commentaires que leur a consacrés le philosophe, semblent interdire l’adoption d’une approche qu’on dirait bêtement rhétorique. Derrida, philosophe de la déconstruction des origines et du logos, aurait dans son travail rendu caduque une approche se réclamant d’une rhétorique jugée prise dans un système qu’il s’attache précisément à déconstruire.
Rhétorique et philosophie procèdent à bien des égards d’une histoire commune. Dans le troisième livre du De oratore, Cicéron retrace les étapes de cette genèse mythique : au commencement, rien ne séparait « la science de bien dire de la science de bien faire, et le même maître enseignait l’un et l’autre ». Il n’y avait qu’une seule science, la sagesse, philosophia, et ses adeptes vivaient en paix, unis, les uns s’adonnant à la poésie, les autres à la géométrie et la musique. Thémistocle, Périclès, Théramène, ou encore Thrasymaque, Gorgias, Isocrate maîtrisèrent et exercèrent cette « double science ». Socrate survint, et voilà la guerre allumée : chef d’une secte déclarée « contre l’éloquence », « dans un temps où la connaissance et la pratique de tout ce qu’il y a de plus beau n’avaient qu’un seul nom, où les hommes qui traitaient des questions telles que celle qui nous occupe en ce moment, qui en faisaient l’objet de leurs discussions, de leur enseignement, étaient tous désignés sous le nom de philosophes », il « leur enleva ce titre qu’ils avaient possédé jusque-là ; et par son ingénieuse dialectique, parvint à séparer deux choses essentiellement unies, la sagesse de la pensée et l’élégance du langage ». Ce fut « un divorce entre la langue et le cœur », l’une méprisant l’autre, car bientôt « les philosophes dédaignèrent l’éloquence, et les orateurs, la philosophie » (XIX). Or, loin de former deux traditions bien séparées, rhétorique et philosophie poursuivirent leur cours en ne cessant de se prendre l’une pour l’autre, se disputant indéfiniment la prérogative du vrai et du bien : quoi qu’en dise la philosophie, la rhétorique ne se limita jamais à un ornement sans valeur, tandis que la philosophie employa toujours, quoi qu’elle en dise, les moyens de l’éloquence 88. Ainsi que l’écrit Michael Naas :
La persuasion, comme la ruse […], est digne de l’attention soutenue de la philosophie, mais [d’un autre côté] la philosophie n’est pas dénuée de persuasion. Non seulement la persuasion menace-t-elle la philosophie de l’extérieur, mais elle la divise aussi de l’intérieur, remettant en question la possibilité même d’une pure répétition, d’un retour à une identité unique 89.
Au xxe siècle, la supposée « mort » de la rhétorique du siècle précédent eut pour conséquence paradoxale sa renaissance dans, si ce n’est comme, la philosophie 90. Rappelons seulement la première phrase de La Métaphore vive : « Le paradoxe historique du problème de la métaphore est qu’il nous atteint à travers une discipline qui mourut vers le milieu du xixe siècle, lorsqu’elle cessa de figurer dans le cursus studiorum des collèges 91. » La rhétorique renaît donc de ses cendres dans la deuxième partie du xxe siècle, comme philosophie en tant que science du discours rationnel 92, dans la philosophie en tant que science des figures. Derrida lui-même exprime, dans « Le retrait de la métaphore », et non sans une certaine malice, son « étonnement devant le fait qu’un sujet apparemment si vieux [la métaphore], un personnage ou un acteur en apparence si fatigué, si usé, revienne aujourd’hui occuper la scène – et la scène occidentale de ce drame – avec autant de force et d’insistance depuis quelques années, de façon […] assez nouvelle 93 ». Lui-même, en 1971, dans « La Mythologie blanche », travaillait la question de la métaphore dans la langue philosophique en tentant à la fois de cerner ce que la métaphore tenait de la philosophie, et d’identifier « le terrain historico-problématique sur lequel on a pu demander systématiquement à la philosophie les titres métaphoriques de ses concepts 94 ». À l’occasion de ce texte, Derrida montrait combien philosophie et rhétorique ne peuvent se penser l’une sans l’autre, l’une étant toujours déjà traversée, divisée par l’autre. Jean-Luc Amalric le résume ainsi :
Non seulement la philosophie n’est pas capable de dominer la métaphore de l’intérieur, car elle est investie par le procès métaphorique au point d’en subir la loi ; mais en outre, il n’est pas davantage possible de dominer cette métaphorique philosophique de l’extérieur. En effet, ni une rhétorique de la philosophie ni une métaphilosophie (analogue à ce que Bachelard nomme méta-poésie dans son projet de psychanalyse de l’imagination matérielle) ne sont en mesure de revendiquer cette maîtrise car elles se serviraient nécessairement d’un concept de métaphore qui serait déjà en lui-même un produit philosophique 95.
On retrouve des considérations analogues dans un texte digraphique contemporain de « La Mythologie blanche », Le Calcul des langues, qui met en scène de manière dramatique la scission comme l’inséparabilité de la philosophie et de la rhétorique. Derrida commence ainsi par rappeler ce qu’il présente comme une évidence :
Je ne proposerai pas de longue introduction générale sur ce qui, l’une en l’autre, implique philosophie et rhétorique. En général ou en particulier dans le texte signé de Condillac. Comme art ou comme science du langage, une rhétorique ne peut pas ne pas impliquer tout un appareil philosophique, un concept de signe et une théorie du langage, soit tout un réseau de philosophèmes. L’implication peut aller d’une sorte d’inconscient philosophique à l’organisation thématique et systématique d’un discours métaphysique tenu par le rhétoricien lui-même. Qui peut à l’occasion être un philosophe lui-même. Inversement, même et surtout quand elle n’en fait pas un objet de réflexion, la philosophie abrite toujours en elle une rhétorique : une rhétorique à l’état pratique, d’abord, celle qui est nécessairement mise en œuvre dans le discours philosophique (dans la langue naturelle qui lui concède certains prêts et lui en demande intérêt), et une théorie de la rhétorique 96.
Pas d’introduction générale, donc. Mais un commentaire détaillé, suivi des problèmes rencontrés par Condillac pour donner la préséance à l’une ou l’autre, à la rhétorique ou à la philosophie. D’un côté, la philosophie, « science des principes 97 », domine le système, et précède la rhétorique ; mais de l’autre, la rhétorique, « science des effets 98 », vient au contraire en premier dans la démarche pédagogique de Condillac (il écrit pour l’éducation du prince de Parme), et ce en vertu d’un principe pratique : l’enfant sait déjà parler, il est déjà dans sa langue, et c’est à partir de sa connaissance de la langue que l’éducateur commence à lui apprendre à penser. En résulte une « ronde sémantique où philosophie et rhétorique se précèdent l’une l’autre 99 », la rhétorique dépendant de la philosophie comme « science des origines », n’en étant qu’un « soutènement », une colonne, et la philosophie dépendant de la rhétorique en tant qu’elle « est déjà inscrite dans l’espace d’une langue : dont l’histoire et les règles auront assigné son lieu au discours philosophique 100 ». Mais, Derrida le fait remarquer, cette ronde interminable divise aussi la rhétorique en deux :
Partie de la philosophie comme système, instance de la société ou de l’esprit comme histoire, la rhétorique restreinte ou art d’écrire se replierait dans les limites d’une région. Mais la rhétorique générale couvre tout le champ et envahit l’espace du tableau. Variant entre ses deux extensions, la rhétorique, quand elle est partie d’un ensemble, ne l’est que d’elle-même. Elle se couvre, se conçoit et s’engendre elle-même, tout et partie. Le tout, c’est de bien parler et donc de bien penser, de quoi la technique du style, des figures, des tropes est partie 101.
La rhétorique comme la philosophie ou la métaphysique est double, ou au moins plus d’une, jamais close ; sa structure divisée rappelle ce que Derrida écrit de la métaphysique dans « Le retrait de la métaphore », en réponse à Paul Ricœur :
Je n’ai jamais cru à l’existence ou à la consistance de quelque chose comme la métaphysique. […] S’il a pu m’arriver, compte tenu de telle ou telle phase démonstrative ou de telle contrainte contextuelle, de dire « la » métaphysique, ou « la » clôture de « la » métaphysique (expression qui fait la cible de la Métaphore vive), j’ai aussi très souvent, ailleurs mais aussi dans la Mythologie blanche, avancé la proposition selon laquelle il n’y aurait jamais « la » métaphysique, la « clôture » n’étant pas ici la limite circulaire bordant un champ homogène mais une structure plus retorse, je serais tenté de dire aujourd’hui selon une autre figure : « invaginée ». La représentation d’une clôture linéaire et circulaire entourant un espace homogène, c’est justement, tel est le thème de ma plus grande insistance, une auto-représentation de la philosophie dans sa logique onto-encyclopédique 102.
Il n’y aura donc pas la rhétorique, mais de la rhétorique tout de même. Car la réflexion présente dans « La Mythologie blanche » puis dans « Le Retrait de la métaphore » se retrouve, bien qu’à des degrés divers, dans tous les textes digraphiques. C’est particulièrement vif dans Glas, où la prose et la poésie genétiennes invitent volontiers à parler de métaphore. Derrida y cite même un extrait de « La Mythologie blanche » :
« Telle fleur porte toujours son double en elle-même, que ce soit la graine ou le type […] et en raison de la répétition où elle s’abîme sans fin, aucun langage ne peut reproduire en soi la stricture d’une anthologie. Ce supplément de code qui traverse son champ, en déplace sans cesse la clôture, brouille la ligne, ouvre le cercle, aucune ontologie n’aura pu la réduire. » (Offerte aux greffes, la mythologie blanche 103 (G 21b, judas)
Derrida décrit ainsi comment la structure même de la métaphore, sa structure double, sans origine qui ne soit pas déjà métaphorique, affecte la structure même de « son champ » : la rhétorique, la métaphysique, toutes deux pénétrées par la métaphore et déterminées par sa structure, ne peuvent prétendre à la clôture du cercle mais plutôt à une structure invaginée ; un bord externe se replie à l’intérieur pour y former une poche, brouillant la frontière entre le dedans et le dehors 104.
Partis des rapports entre philosophie et rhétorique, nous voici arrivés à la métaphore par différents procès de division : d’abord, la double science se divise en deux ; puis la rhétorique elle-même se scinde en deux, rhétorique générale et rhétorique restreinte ; et enfin, c’est la structure même de la métaphore qui apparaît comme double. Les textes digraphiques semblent alors mettre en scène cette prolifération des doubles qui caractérise l’histoire des rapports entre rhétorique et philosophie, et plus loin toute réflexion sur la rhétorique de la philosophie (concept ou métaphore). C’est donc dans la perspective des rapports entre rhétorique et philosophie que les textes digraphiques sont abordés dans ce livre.
Pour ce faire, je mobilise à la fois une rhétorique littéraire et l’analyse du discours. Je m’inscris dans la filiation de critiques se confrontant depuis la littérature au texte philosophique : c’est le cas de Bruno Clément qui, au fil des ouvrages, s’est attaché à interroger la manière des philosophes 105. Dans le présent travail, je complète cette perspective rhétorique par un travail d’analyse du discours philosophique, discipline qui prétend précisément « étudier la dimension spécifiquement discursive du philosophique 106 ». Interdisciplinaire dans la mesure où elle réunit des scientifiques issus de différentes disciplines (philosophes, sémioticiens, analystes du discours, stylisticiens, etc.), l’analyse du discours philosophique travaille, depuis plus de vingt ans, à forger les outils d’une lecture de la philosophie qui attacherait autant d’importance à ce que dit le texte qu’à la façon dont il le dit 107. L’analyse du discours philosophique, qui profite de sa proximité avec l’analyse du discours, et ainsi de ses affinités avec les sciences du langage, constitue un contrefort solide à une approche rhétorique ancrée dans une tradition critique littéraire. Ce sont donc aussi bien des outils issus de l’analyse du discours philosophique que de la rhétorique et de la poétique que nous mettrons à contribution pour lire nos textes.
Composition
Nous étudierons les ressorts de la rhétorique du commentaire derridienne en nous intéressant à trois aspects de son dispositif énonciatif – l’énonciateur, ses modalités génériques, le récepteur –, répondant à trois questions : qui parle ? comment ? à qui ? Le premier chapitre, « Double je ? », tente de répondre à la question « qui parle ? » dans des textes prompts à diviser et à redoubler le « je ». L’étude particulière de Glas permet de mettre en lumière une technique de couper-coller, caractérisée dans l’ouvrage comme spécifique au « Juif ». À travers une approche puisant à la fois dans les outils de l’analyse du discours (Maingueneau), de l’analyse du discours philosophique (Cossutta), et dans ceux de la poétique (Clément), il s’agit de détailler à la fois les modalités de constitution et les buts pragmatiques de la prise en charge d’un ethos « juif » par le philosophe. Le commentaire fidèle d’un texte violemment antijudaïque, L’Esprit du judaïsme de Hegel, permet en effet à Derrida d’isoler certains motifs (la pierre, Méduse) pour mieux les retravailler et les faire fonctionner à nouveaux frais dans un sens opposé à celui revêtu dans leur contexte d’origine : d’arguments antijudaïques, ils deviennent les éléments positifs d’une poétique « juive ».
Le deuxième chapitre, « Le rire de la femme : la parodie comme contre-chant de la philosophie », lie genres littéraires et genre social dans son analyse du comment de la pratique énarrative 108 à l’œuvre dans nos textes. Ceux-ci relèvent en effet explicitement d’une volonté de réélaborer le rapport du langage au réel, réélaboration exigeant un travail générique autant que stylistique. Afin de décrire les procédés critiques de la mimesis à l’œuvre dans nos textes, nous procéderons en deux temps, solidaires l’un de l’autre. Nous inscrirons d’abord « La double séance », « Tympan » et Glas dans une problématique générique en explorant leur dimension parodique, restreinte mais aussi générale 109, notamment à travers la mise en évidence de leurs affinités avec le genre ancien de la satire ménippée. Mais l’on ne saurait comprendre ces enjeux génériques et de registre sans examiner attentivement la fonction qu’y occupe « la femme » en tant qu’opérateur de style. Liée thématiquement à l’inconscient, au jeu de mots, à la poésie – via un commentaire de Sigmund Freud –, « la femme » désigne dans nos textes la possibilité d’un contre-chant irréductible au discours philosophique, d’un territoire où la distinction entre vrai et faux n’aurait pas cours.
Le troisième chapitre, enfin, examine la place du destinataire de ces textes : place réelle, à travers un court examen de la réception critique du corpus ; place intratextuelle, quand nous nous pencherons sur les différentes figures de lecteurs thématisées dans le corpus ; place idéale enfin, puisqu’il s’agira, en dernier lieu, de proposer « la mère » comme lieu de l’adresse encryptée dans nos textes. Informé par la psychanalyse autant que par les sound studies, ce dernier chapitre met l’écoute au centre, dans une volonté de faire un pas de côté par rapport au privilège du texte et de la vue, souvent commandé par le dispositif en deux colonnes de notre corpus. Il s’inscrit ainsi dans la continuité des écoutes du texte derridien proposées par Michel Lisse, Jean-Luc Nancy ou encore Hélène Cixous. La rhétorique du commentaire dont nous nous réclamons fonctionne ainsi à double sens : art d’écrire, elle permet de qualifier le discours philosophique du commentateur ; art de lire, elle se propose de répondre aux exigences de lecture inscrites dans le texte et de fournir les armes d’une lecture ni servile ni maîtrisante – inventive.
1. Jacques Derrida, « Ja, ou le faux-bond », dans Points de suspension. Entretiens, Paris, Galilée, 1992, p. 46.
2. Id., « Desceller (“la vieille langue neuve”) », ibid., p. 123.
3. J’emprunte, en guise de titre à cette introduction, le titre, lui-même si parlant, du livre dirigé par Dominique Maingueneau et Mathilde Vallespir, Lire Derrida ? Autour d’« Éperons. Les styles de Nietzsche », Limoges, Lambert-Lucas, 2015.
4. Jonathan Kandell, « Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74 », The New York Times, 10 octobre 2004.
5. Anabell Guerrero Mendez, « Jacques Derrida. Jacques Derrida, French Intellectual, Died on October 8th, Aged 74 », The Economist, 21 octobre 2004.
6. Searle raconte ainsi que Foucault aurait qualifié le style de Derrida d’« obscurantisme terroriste » (John R. Searle, « The Word Turned Upside Down », The New York Review of Books, 27 octobre 1983) ; comme l’écrit Benoît Peeters, l’expression « sera inlassablement reprise par John R. Searle dans ses attaques répétées contre Derrida » (Benoît Peeters, Derrida, Paris, Flammarion, 2010, p. 693).
7. Ce carnet de recherche, coordonné par deux sociologues, est particulièrement friand de canulars scientifiques qui visent, de manière privilégiée, les philosophes post-structuralistes à travers leurs épigones ; Aurélien Barrau, physicien titulaire d’un doctorat en philosophie dont la thèse portait notamment sur le travail de Derrida, ou encore Bernard Stiegler, ancien étudiant de Derrida et philosophe, ont fait l’objet de leur verve satirique.
8. Jacques Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1974.
9. Id., Marges de la philosophie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, p. I-XXV.
10. Id., Feu la cendre, Paris, Des Femmes, 1987.
11. Id., Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 117-218.
12. L’expression est modelée sur celle d’hétérogénéité montrée forgée par Jacqueline Authier-Revuz dans « Hétérogénéité(s) énonciative(s) », Langages, n° 73, 1984, p. 98-111.
13. Jacques Derrida, Le Calcul des langues, éd. Geoffrey Bennington et Katie Chenoweth, Paris, Seuil, 2020 (édition posthume).
14. Jean Genet, Œuvres complètes IV, Paris, Gallimard, 1968, p. 19-31.
15. James Joyce, Finnegans Wake, éd. Robbert-Jan Henkes, Erik Bindervoet et Finn Fordham, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 260-308. Les éditeurs résument le passage en ces termes : « La mise en page présente une colonne centrale où se déroule le récit des études des enfants ; les notes en marge de Shem (d’abord à gauche) et Shaun (d’abord à droite) s’échangent après la p. 292, tandis que les notes de bas de page sont d’Issy. La pièce maîtresse du chapitre est un exercice de géométrie qui commence à la p. 287, immédiatement interrompu, avant d’être repris à la p. 293 » (ibid., p. XXXVIII, je traduis). J’étends ici à l’intertexte genétien la mise en garde formulée par Peter Mahon contre la tentation de réduire Glas à l’intertexte joycien (Imagining Joyce and Derrida. Between Finnegans Wake and Glas, Toronto, University of Toronto Press, 2007).
16. Janine Aeply, « D’hier à aujourd’hui », Tel Quel, n° 2, 1960, p. 19-28 ; Julia Kristeva, « Héréthique de l’amour », Tel Quel, n° 74, hiver 1977, p. 30-49.
17. Hélène Cixous, « Partie », Nouvelle revue de psychanalyse, n° 7 : « Bisexualité et différence des sexes », 1973, p. 335-350.
18. Sylvère Lotringer et David Morris (dir.), Schizo-Culture, Cambridge, Londres, The MIT Press, 2013.
19. La première partie de l’essai intitulé « Le rétablissement de la vérité » oppose la « reproduction littérale » de propos tenus par de hauts responsables fascistes (Hermann Goering, puis Rudolf Hess) dans la colonne de gauche, et le « rétablissement de la vérité » dans la colonne de droite. Le dispositif en deux colonnes est mis au service d’une entreprise politique et éthique de rectification, que Brecht explique ainsi au début de l’essai : « Dans les époques exigeant la tromperie et favorisant l’erreur, le penseur s’efforce de rectifier ce qu’il lit et ce qu’il entend. Il répète doucement ce qu’il entend et ce qu’il lit, pour rectifier au fur et à mesure. Phrase après phrase, il substitue la vérité à la contre-vérité. Et il poursuit l’exercice jusqu’à ce qu’il ne puisse plus lire ni entendre autrement » (Bertolt Brecht, Écrits sur la politique et la société, trad. Paul Dehem et Philippe Ivernel, Paris, L’Arche, 1971, p. 139-203 ; p. 148 sq.).
20. Christine Buci-Glucksmann, « Déconstruction et critique marxiste de la philosophie », dans Catherine Clément (dir.), Jacques Derrida, Paris, Librairie Duponchelle, 1973, p. 20-32, p. 22.
21. Selon l’expression de Peter Mahon (Imagining Joyce and Derrida. Between Finnegans Wake and Glas, op. cit., p. 57).
22. Benoît Peeters, Derrida, op. cit., p. 259.
23. Tel Quel, Théorie d’ensemble, Paris, Seuil, 1968.
24. « La double séance » fut publié une première fois dans les numéros 41 et 42 de Tel Quel en 1970 (Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972, p. 214).
25. Benoît Peeters, Derrida, op. cit., p. 261.
26. Rudy Steinmetz, Les Styles de Derrida, Paris, De Boeck Université, 1994, p. 14.
27. Idem.
28. Jacques Derrida, « Introduction », dans Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, trad. Jacques Derrida, Paris, PUF, 2010, p. 3-179.
29. Id., La Vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978.
30. Rudy Steinmetz, Les Styles de Derrida, op. cit., p. 104.
31. La distinction entre un discours philosophique classique, caractérisé par l’exclusion de la subjectivité du philosophe et par l’absence de toute marque stylistique renvoyant au poétique – ce que Rudy Steinmetz nomme un « style neutre » –, et un discours philosophique qui ferait place à la subjectivité de l’énonciateur et utiliserait le style de la littérature, doit être relativisée et comprise comme le résultat de la coconstruction de deux traditions philosophiques occidentales ; je me permets de renvoyer à un article dans lequel j’ai tenté de mettre cette distinction en perspective : Charlotte Thevenet, « Les marges de l’analyse du discours philosophique en question : le cas Derrida », Argumentation et analyse du discours, n° 22, 2019.
32. Jacques Derrida, La Vérité en peinture, op. cit., p. 291-436.
33. Id., Feu la cendre, op. cit.
34. Id., Points de suspension, op. cit., p. 183-92.
35. Id., Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996.
36. Id., La Vérité en peinture, op. cit., p. 20.
37. Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris, Seuil, 1991.
38. Jacques Derrida, Spurs. Nietzsche’s Styles/Éperons. Les Styles de Nietzsche, éd. Stefano Agosti, trad. Barbara Harlow, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1979.
39. Sur les différentes versions d’Éperons, je renvoie à l’étude génétique d’Antonin Wiser : « L’espace du style, sur les trois versions d’Éperons (1973, 1976, 1978) de Jacques Derrida », Genesis. Manuscrits, recherche, invention, no 44, 2017, p. 147-156.
40. Jacques Derrida, Signéponge/Signsponge, trad. Richard Rand, New York, Columbia University Press, 1984.
41. Id., Parages, op. cit., p. 138-39.
42. Id., La Carte postale : de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, 1990, p. 12.
43. C’est ainsi qu’on peut interpréter cette remarque adressée à Henri Ronse lors d’un entretien, en 1967 : « On peut tenir De la grammatologie comme un long essai articulé en deux parties (dont la soudure est théorique, systématique et non empirique) au milieu duquel on pourra brocher L’Écriture et la Différence. La grammatologie y fait souvent appel. Dans ce cas, l’interprétation de Rousseau serait aussi la douzième table du recueil. Inversement, on peut insérer De la grammatologie au milieu de L’Écriture et la Différence, puisque six textes de cet ouvrage sont antérieurs, en fait et en droit, à la publication, il y a deux ans, dans Critique, des articles annonçant De la grammatologie ; les cinq derniers, à partir de Freud et la scène de l’écriture, étant engagés dans l’ouverture grammatologique » (Id., Positions, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 12-13).
44. Le « Derridex » élaboré par Pierre Delain (Idixa, 2005 : http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0506091008.html) permet de se rendre compte de cette dimension de l’œuvre : chaque terme drague avec lui une série d’autres termes, qui à leur tour s’inscrivent dans d’autres séries, etc. Ainsi l’œuvre semble-t-elle parfois plus faite pour la base de données et son fonctionnement par lien hypertexte que pour le livre et sa linéarité. De même, l’habitude qu’a Derrida de créer des renvois d’une de ses œuvres à l’autre produit un effet de maîtrise que le critique peut avoir du mal à surmonter, comme si le philosophe avait anticipé tout commentaire futur, avait déjà tout vu venir.
45. Jacques Derrida, « Introduction », dans Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, op. cit.
46. Id., Genèses, généalogies, genres et le génie. Les Secrets de l’archive, Paris, Galilée, 2003.
47. Id., « Mallarmé », dans Tableau de la littérature française. De Mme de Staël à Rimbaud, Paris, Gallimard, 1974, p. 368-79.
48. Id., Marges de la philosophie, op. cit., p. XXV.
49. Id., Glas, op. cit., p. 170b-180b.
50. À ma connaissance, une étude des rapports étendus entre l’œuvre mallarméenne et celle de Derrida reste à faire ; pour une première tentative, voir Rocío Rueda Ortiz, « Sobre las huellas de Mallarmé en la obra de Derrida », Educació i Cultura : revista mallorquina de Pedagogia, n° 16, 2003, p. 27-38. Rudy Steinmetz, s’il attribue au « levier du texte mallarméen » le changement de style de Derrida autour de l’année 1968 (Les Styles de Derrida, op. cit., p. 14), n’élabore pas les liens d’influence qu’a pu avoir Mallarmé sur l’œuvre derridienne. Je ne pourrai développer ici comme il se devrait les rapports profonds qu’entretiennent les deux œuvres, et me contenterai de mettre en évidence les points de convergence qui me semblent les plus pertinents pour mon propos.
51. Stéphane Mallarmé, Igitur. Divagations. Un coup de dés, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2003, p. 442.
52. Jacques Derrida, La Dissémination, op. cit., p. 289.
53. Id., Glas, op. cit., p. 174b.
54. Id., Marges de la philosophie, op. cit., p. II.
55. Id., Glas, op. cit., p. 250b, p. 229b.
56. Stéphane Mallarmé, Correspondance complète (1862-1871), suivi de Lettres sur la poésie (1872-1898), éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 1995, p. 366.
57. Ibid., p. 577.
58. Ibid., p. 614.
59. Id., Igitur. Divagations. Un coup de dés, op. cit., p. 287.
60. Jacques Derrida, Points de suspension, op. cit., p. 124.
61. Ibid., 125.
62. On pourrait encore présenter ces éléments de la filiation Mallarmé-Derrida dans une perspective médiatique ; en effet, Derrida fait jouer à son tour l’opposition entre l’écriture et « l’universel reportage » (Mallarmé), une tension qui n’apparaît qu’avec l’avènement de la presse vers 1800. Le détour par la langue étrangère constituerait alors une stratégie pour sortir de cette opposition. Sur le rapport entre théorie des médias (Medientheorie) et écriture, voir Friedrich A. Kittler, Discourse Networks 1800/1900, trad. Michael Metteer, Stanford, California, Stanford University Press, 1990, et, récemment traduit en français : Friedrich A. Kittler, Gramophone, film, typewriter, trad. Frédérique Vargoz, Paris, Les Presses du réel, 2018. Pour une approche historique des rapports entre Kittler et les post-structuralistes, voir Katia Schwerzmann, « “La lettre morte” – Friedrich Kittler en correspondance avec les poststructuralistes », Appareil, n° 19, 2017.
63. Jacques Michon, Mallarmé et Les Mots anglais, Montréal, Les Presses de l’université de Montréal, 1978.
64. Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes II, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2003, p. 1025.
65. Gérard Genette, Mimologiques. Voyage en Cratylie, Paris, Seuil, 1976.
66. Antonin Wiser, « D’un déplacement avantageux : Les Mots anglais de Mallarmé », Littérature, n° 157, 2010, p. 3-16 ; p. 9.
67. Ibid., p. 10. Les citations de Mallarmé renvoient à l’édition de la Pléiade des Œuvres complètes dirigée par Bertrand Marchal.
68. Antonin Wiser, « D’un déplacement avantageux », op. cit., p. 15.
69. Le chapitre du livre premier dédié aux éléments anglo-saxons réunit par exemple en une même famille les mots great, grass, groats, groat, green, to graze, tous ramenés à la racine to grow. L’entrée consacrée à la lettre G se poursuit ainsi : « G (tout en n’étant pas la lettre qui commande le plus grand nombre de mots) a son importance, signifiant d’abord une aspiration simple, vers un point où va l’esprit : que cette gutturale, toujours dure en tant que première lettre, soit suivie d’une voyelle ou d’une consonne. Ajoutez que le désir, comme satisfait par l, exprime avec ladite liquide, joie, lumière, etc., et que de l’idée de glissement, on passe aussi à celle d’un accroissement par la poussée végétale ou par tout autre mode ; avec r, enfin, il y aurait comme saisie de l’objet désiré avec l, ou besoin de l’écraser ou de le moudre » (Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes II, éd. Bertrand Marchal, op. cit., p. 986).
70. Dans la lettre à Henri Cazalis du 28 avril 1866, Mallarmé, « victime éternelle du Découragement », explicite cette crise : « Malheureusement, en creusant le vers à ce point, j’ai rencontré deux abîmes, qui me désespèrent. L’un est le Néant, auquel je suis arrivé sans connaître le Bouddhisme, et je me suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail, que cette pensée écrasante m’a fait abandonner. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, – mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami !, que je veux me donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d’elle, et, cependant, s’élançant forcenément dans le Rêve qu’elle sait n’être pas, chantant l’Âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges ! Tel est le plan de mon volume Lyrique, et tel sera peut-être son titre, La Gloire du Mensonge, ou le Glorieux Mensonge. Je chanterai en désespéré ! » (Id., Correspondance complète (1862-1871), op. cit., p 227-228.)
71. Ibid., p. 342.
72. Ibid., p. 343.
73. Id., Igitur. Divagations. Un coup de dés, op. cit., p. 260.
74. Ibid.
75. Abdelkébir Khatibi et al. (dir.), Du Bilinguisme. Journées de travail : 26-28 novembre 1981, Paris, Denoël, 1985, p. 10.
76. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, op. cit., p. 21.
77. Ibid., p. 14.
78. Id., Points de suspension, op. cit., p. 125.
79. Id., Marges de la philosophie, op. cit., p. XII.
80. Sur la fonction de la poésie chez Derrida, et particulièrement sur la poésie comme « indesconstructible », voir Guillaume Artous-Bouvet, Derrida, le poème. De la poésie comme indéconstructible, Paris, Hermann, 2022.
81. Nicholas Cotton-Lizotte, Penser la « pervertibilité » : incidences et réitérations du pervertible dans l’œuvre de Jacques Derrida, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2019, p. 26.
82. Jacques Derrida, La Carte postale, op. cit.
83. Id., Feu la cendre, op. cit.
84. Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, op. cit.
85. Jacques Derrida, Glas, op. cit.
86. Id., Points de suspension, op. cit., p. 45.
87. Ibid., p. 45-46.
88. Jacqueline Lichtenstein, La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, Paris, Flammarion, 1989.
89. Michael Naas, Turning : From Persuasion to Philosophy : a Reading of Homer’s Iliad, Atlantic Highlands (NJ), Humanities Press International, 1995, p. 13, je traduis.
90. Je m’appuie ici sur la synthèse de Jane Sutton, « The Death of rhetoric and its rebirth as philosophy », Rhetorica : A Journal of The History of Rhetoric, n° 3, vol. 4, 1986, p. 203-226.
91. Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 13. Cité par Jane Sutton, « The Death of rhetoric and its rebirth as philosophy », op. cit., p. 203-204.
92. Voir Ernesto Grassi, Rhetoric as Philosophy : The Humanist tradition, trad. John Michael et Azizeh Azodi, Carbondale, Edwardsville, Southern Illinois University Press, 2001.
93. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, p. 106. Outre l’ouvrage de Paul Ricœur déjà cité, on peut mentionner également Paul de Man, Allégories de la lecture, trad. Thomas Trezise, Paris, Galilée, 1989 ; Groupe Mu (µ), Rhétorique générale, Paris, Seuil, 1982.
94. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, op. cit., p. 256. Je renvoie également sur ce texte et plus largement sur le débat avec Paul Ricœur autour de la métaphore à Jean-Luc Amalric, Ricœur, Derrida : l’enjeu de la métaphore, Paris, PUF, 2006.
95. Jean-Luc Amalric, Ricœur, Derrida : l’enjeu de la métaphore, op. cit., p. 15.
96. Jacques Derrida, Le Calcul des langues, op. cit., p. 35a-36a.
97. Ibid., p. 51a.
98. Ibid.
99. Ibid.
100. Ibid., p. 52a.
101. Ibid., p. 52a-53a.
102. Id., Psyché. Inventions de l’autre, op. cit., p. 110-111.
103. La coupe entre crochets est de Jacques Derrida ; la parenthèse ouverte n’est pas refermée. Le passage cité se trouve à la fin de « La Mythologie blanche », Marges de la philosophie, op. cit., p. 324.
104. Derrida décrit avec précision la structure de l’invagination dans « Survivre » (Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 143 sq.).
105. Citons, entre autres, Henri Bergson, Prix Nobel de littérature, Lagrasse, Verdier, 2021 ; L’Invention du commentaire. Augustin, Jacques Derrida, Paris, PUF, 2000, et Rue Descartes, n° 50 : L’Écriture des philosophes, 2005.
106. Frédéric Cossutta, « Présentation », Langages, n° 119, 1995, p. 6.
107. Le GradPhi, Groupe de recherche sur l’analyse du discours philosophique, travaille, sous la direction de Frédéric Cossutta, depuis plus de vingt ans, à développer l’analyse discursive des textes philosophiques à travers un séminaire régulier, des journées d’étude, des ouvrages et des numéros de revue dont on trouvera la liste exhaustive sur le carnet du groupe [https://gradphi.hypotheses.org/37].
108. C’est ainsi que Bruno Clément nomme la pratique du commentaire en tant qu’elle mêle toujours de l’Autre et de soi (Le Lecteur et son modèle, Paris, PUF, 1999).
109. J’emploie l’expression « parodie restreinte » au sens où Genette parlait de « rhétorique restreinte » : au sens d’une « réduction tropologique » de la parodie, restriction de la parodie à une figure de style (Gérard Genette, « La rhétorique restreinte », Com