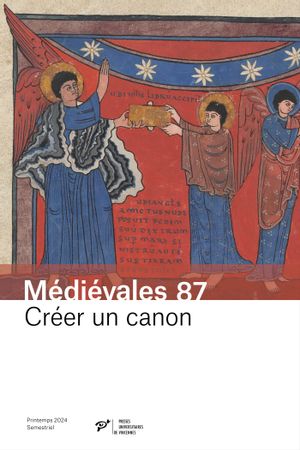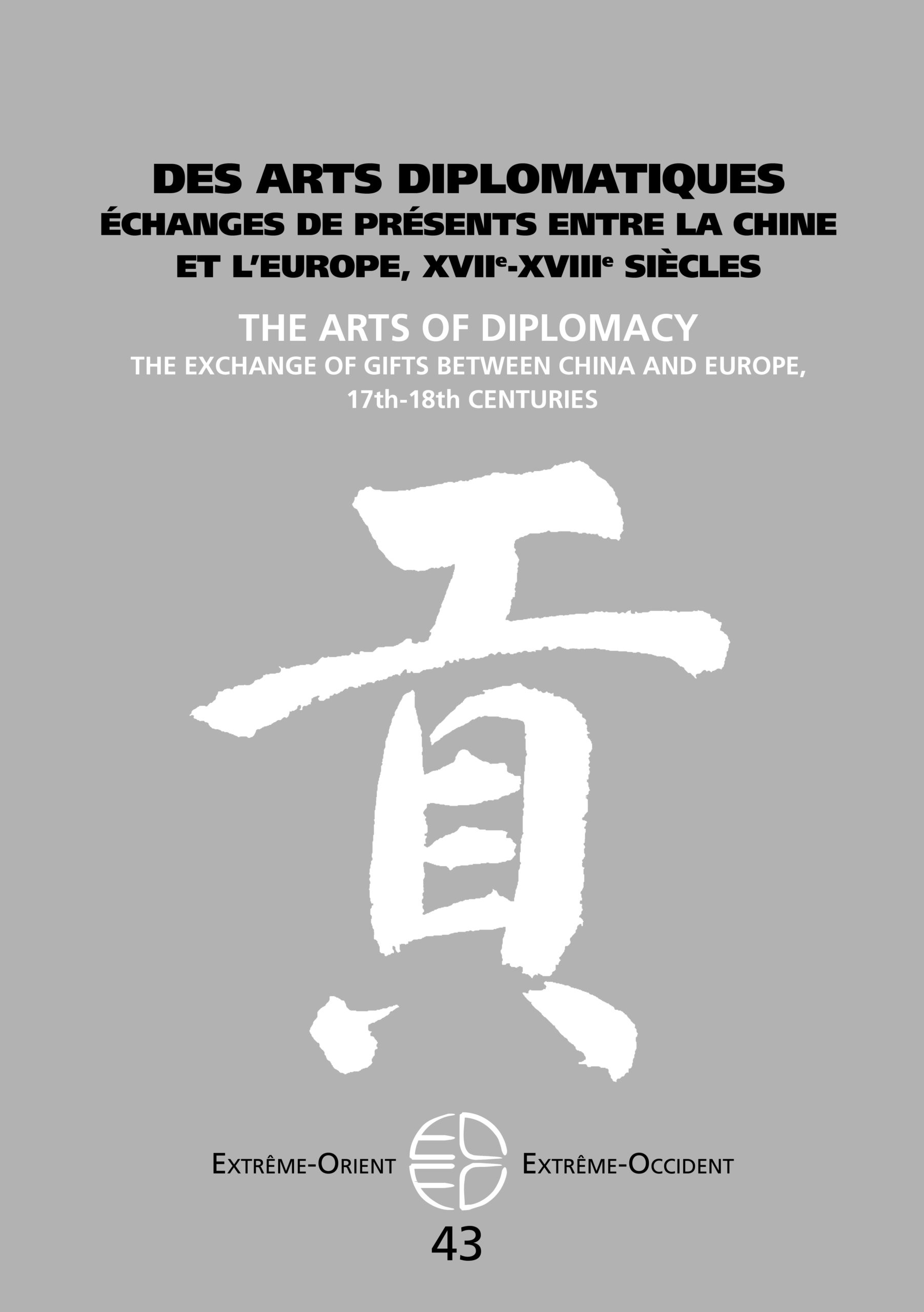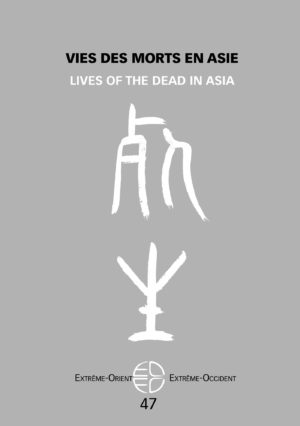Introduction :
Les cadeaux diplomatiques entre la Chine et l’Europe aux XVIIe-XVIIIe siècles. Pratiques et enjeux
Zhao Bing 趙冰 et Fabien Simon
À la date du 11 mars 1763, une entrée des registres de la manufacture royale de Beauvais mentionne la commande de six tapisseries sur des thèmes « chinois » à délivrer au ministre d’État Bertin, afin de servir de cadeaux à envoyer en Chine. Cette dite « seconde tenture chinoise », réalisée à partir d’esquisses de François Boucher, est en effet offerte à l’empereur Qianlong, pour sa plus grande satisfaction, d’après une lettre du jésuite Michel Benoist à Bertin du 10 novembre 1767. L’empereur ordonne, pour l’abriter, la construction d’un nouveau pavillon dans l’ensemble des « palais européens » du Yuanmingyuan.
Cet exemple fameux de cadeau diplomatique est réinterprété, sous divers angles, dans deux articles du présent dossier, sous la plume de John Finlay et de Marie-Laure de Rochebrune. Il permet d’envisager la diversité des acteurs impliqués dans ces relations diplomatiques à différentes échelles, depuis la production des objets jusqu’à leur réception, toujours active, et à l’adaptation de ces artefacts à leur nouveau contexte, ne serait-ce que dans la manière dont ils sont mis en scène, ou, au contraire, entassés dans quelques dépôts à l’abri des regards. Or la tapisserie faisait partie d’un ensemble de cadeaux incluant aussi de nombreuses porcelaines de Sèvres, démonstration de la maîtrise technique des artisans français.
Ce dossier d’articles est la première livraison d’un projet de recherche au long cours portant sur les techniques de l’émail et leur circulation entre l’Europe et l’Asie jusqu’au XIXe siècle. Né de la rencontre entre les recherches innovantes menées ces dernières années par des équipes françaises et un appel à collaboration lancé en 2014 par le musée du Palais de Pékin, le projet a été doté par l’INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) du CNRS du statut d’IRP pour les mobilités internationales (International Research Program 2017-2021, sous l’appellation de LIA-Laboratoire International Associé avant 2019) et soutenu par l’Iris « Études globales » (2017-2019) pour la construction de la base de données sur les archives 1. À l’encontre du lieu commun d’une Europe du XVIIIe siècle éprise de « chinoiseries » – d’objets, de culture ou de techniques chinois –, le projet propose de découvrir l’envers peu connu d’une histoire globale : l’engouement pour les arts décoratifs européens à la cour de l’empire du Milieu. Il porte précisément sur la circulation des objets en émail peint et de cette technique entre la France et la Chine (milieu XVIIe-fin XVIIIe siècle). L’émail (falang ou falan en chinois) est l’exemple type d’une technique méditerranéenne et européenne dont la pratique s’est déplacée d’ouest en est, au gré de la circulation des objets. La fascination pour les émaux peints européens en Chine est étroitement liée au prestige des instruments scientifiques et des montres et horloges européens, qui pouvaient être partiellement émaillés en surface. La première ambition du projet est donc d’explorer le rôle des objets et des techniques européens dans la constitution du patrimoine culturel et technique à la cour chinoise. La seconde est d’étudier, dans une perspective comparatiste, les rapports entre les pouvoirs impériaux et monarchiques et les patrimoines culturel et technique en Chine et en France. L’objectif scientifique vise à dépasser deux écueils : 1. une vision européocentrée de la diffusion des techniques depuis l’Europe, perçue à travers le prisme des écrits des missionnaires jésuites exclusivement, et une vision sinocentrée niant, au contraire, tout apport étranger ; 2. un parallélisme visuel qui prétend établir des liens techniques exclusivement à partir d’observations stylistiques. Il s’agit alors de proposer une triple mise en regard, inédite, entre : premièrement, objets et archives ; deuxièmement, données françaises et chinoises ; et troisièmement, sciences humaines et sociales et sciences exactes (analyse physico-chimique non destructive en particulier).
Le colloque inaugural de l’IRP TrEnamelFC « Les présents diplomatiques entre la Chine et l’Europe aux xviie-xviiie siècles », organisé à Paris les 4 et 5 mai 2017, constituait une porte d’entrée vers ces questionnements 2. En effet, d’après les premières enquêtes menées par les membres du programme TrEnamelFC dans les archives européennes et chinoises, une trentaine de types d’objets émaillés européens ont été introduits en Chine sous diverses formes, principalement par des biais « officiels », durant la phase initiale des Qing (1644-1911) 3.
Séduire et impressionner les Chinois grâce à des objets de luxe, des produits de bouche exceptionnels, ou des instruments de savoir, constituait une stratégie d’obtention de faveurs, pratiquée à différents niveaux sociaux, dès l’arrivée des premiers missionnaires en Chine. En 1601, Matteo Ricci (1552-1610), débarqué dix-neuf ans plus tôt, fut le premier à être reçu au Palais par l’empereur Wanli (r. 1574-1620), à qui il offrit une importante quantité de cadeaux 4. Les missionnaires figurèrent explicitement sous les Qing sur la liste des personnes habilitées à offrir des tributs à l’empereur 5. Comme d’autres groupes d’intermédiaires, tels que les marchands privés des différentes compagnies des Indes orientales, les missionnaires européens ne laissaient pas échapper une occasion d’offrir des présents à l’empereur, lors des diverses fêtes ponctuant l’année ou pour l’anniversaire du souverain. Plus intéressant encore, ils développèrent des manœuvres, fort efficaces, afin d’augmenter le nombre de leurs cadeaux : présenter au trône chaque missionnaire nouvellement arrivé à la capitale, créant ainsi les conditions d’un nouveau don de présents, en dehors des occasions habituelles ; ou encore, passer par les hauts fonctionnaires de province qui étaient habilités à envoyer des tributs à la cour à tout moment.
En fait, le statut de l’empereur ne lui permettait pas d’accepter tous les tributs qui lui étaient présentés et des stratégies de contournement du protocole furent alors mises en place pour étancher la soif d’acquisitions du souverain. Le cas le mieux étudié est celui de l’empereur Qianlong (r. 1736-1795) : lorsqu’il repérait des objets intéressants parmi les tributs présentés par un fonctionnaire chinois, il avait pour habitude d’user d’une sorte de droit de confiscation (chaojia) pour s’en emparer 6. Par ailleurs, la cour chinoise avait également l’habitude d’acquérir les marchandises étrangères qu’elle désirait sous forme d’« achat » par l’intermédiaire de l’administration des douanes maritimes, à qui elle confiait des listes. Celles-ci, vraisemblablement établies avec l’aide d’informateurs compétents, reflètent un certain degré de connaissance des pays européens.
Étudier la circulation des cadeaux diplomatiques entre la Chine et l’Europe est donc pour nous l’occasion d’observer, au-delà des appareils administratifs et leurs règlementations, des pratiques sociales diversifiées (depuis l’empereur, sommet de la société chinoise, jusqu’aux fonctionnaires de province), mises en place pour contourner le système tributaire, les périmètres d’action des acteurs et l’impact de ces circulations de présents apparaissant bien plus étendus que ce que les analyses avaient pu proposer jusque-là (fig. A1).
La Chine et le défi historiographique de l’histoire connectée multipolaire
Le présent dossier se veut ainsi une contribution au renouvellement historiographique, aux ramifications multiples (histoire postcoloniale, subaltern studies…), ayant pris place ces dernières décennies, et qui a permis de souligner les limites des prétentions à l’universalité de la tradition historiographique occidentale 7. Il s’est agi notamment de faire entendre d’autres sources, issues de terrains textuels différents et desquelles émanent d’autres idées, d’autres idéologies, d’autres représentations du monde 8. L’histoire connectée, telle que définie par Sanjay Subrahmanyam et Serge Gruzinski, ne considère ainsi pas un espace artificiellement homogène, tel qu’il peut transparaître parfois, depuis les années 1990, dans les global studies. Elle envisage, au contraire, les jeux d’échelles, du global au local, afin d’observer la circulation transformatrice des objets et des idées, les emprunts réciproques d’une culture à l’autre. Comprendre les sociétés non occidentales dans leurs dynamiques propres et leur hétérogénéité constitue alors une étape cruciale dans ce nouveau défi historiographique. Quelle place y occupe la Chine plus particulièrement ? Une conception « occidentaliste » de la Chine s’est forgée progressivement, depuis le xviiie siècle, rassemblant paradoxalement sinophiles et sinophobes autour du double binôme universalité/particularité, et idéalisation/préjugés ethnocentriques 9.
Depuis lors, la Chine a été le plus souvent conçue dans une opposition au modèle occidental. Et si les orientalistes contemporains continuent à revendiquer une Chine « particulière », ils proposent une lecture plus fine, insistant sur les dynamiques internes chinoises et sur le caractère complexe des évolutions. En Chine, on a pu assister récemment, d’un côté, à la montée du nationalisme qui développe la notion de « particularité chinoise » (zhongguo tese) ; de l’autre, à la création en 2004 du premier centre d’histoire globale, qui décloisonne l’histoire universelle (shijieshi) et l’histoire de la Chine (Zhongguoshi) elle-même. Des historiens chinois ont commencé à dénoncer les limites d’une vision sinocentrique pour proposer une histoire globale située, autrement dit une histoire mondiale de la Chine. Elle s’est traduite d’abord par des études de cas consacrées aux relations extérieures avec les pays voisins ; puis, depuis 2012, des investigations plus conséquentes ont été déployées sur la question des grandes routes commerciales terrestres et maritimes. Certains de ces travaux s’en tiennent parfois encore à brosser de grandes fresques, quelque peu héroïques et impérialistes, dans lesquelles la Chine est le principal, pour ne pas dire le seul, moteur. Néanmoins des chercheurs pionniers ont consacré d’importants travaux à examiner comment celle-ci était en connexion avec le monde extérieur et à comprendre comment les apports étrangers ont pu participer activement à son évolution interne 10.
L’apport de l’étranger dans la culture matérielle de la cour est resté, lui, presque un tabou jusqu’à il y a peu. L’étude des objets étrangers issus des anciennes collections impériales est extrêmement rare 11. A été récemment soulignée l’attitude ambivalente de la cour des Qing, partagée entre son engouement pour les objets européens et son rejet de toute idéologie occidentale 12. Au filtre idéologique s’ajoutent les compétences lacunaires du personnel scientifique, résultant de la fermeture de la Chine dans la seconde moitié du xxe siècle, et compliquant la reconnaissance des objets européens ou l’identification des composantes stylistiques européennes. Or, cette dernière est rendue d’autant plus difficile qu’afin de préserver le style impérial, les éléments non chinois furent souvent dissimulés volontairement (hormis pendant le règne de Qianlong). Nous souhaitons envisager en épaisseur, en réunissant dans ce numéro des chercheurs spécialistes de l’histoire occidentale et de l’histoire de la Chine, un épisode de « conquête » réciproque par la séduction, par l’agrément et le divertissement entre l’Europe et l’empire du Milieu, qui ne s’ignoraient pas autant que l’on pourrait le croire.
Selon Hans Bielenstein, il n’y avait pas, à l’époque qui nous intéresse, de relations diplomatiques entre la Chine et le reste du monde au sens moderne du terme. L’empereur étant considéré en Chine comme le fils du Ciel, cette universalité imposait d’emblée une asymétrie dans les relations avec les autres pays 13. Concrètement, aux yeux des Chinois, offrir des cadeaux à l’empereur signifiait admettre un rapport de subordination (chen). Dès la dynastie des Han (206 av. notre ère-220) furent instaurés des protocoles régissant les échanges avec l’étranger (cérémonies, procédures de réception et de gestion des présents, etc.). Ainsi les présents dits « diplomatiques » offerts par les Européens étaient traités comme des « tributs » (gong) ou, plus précisément, des « tributs locaux » (tugong) 14. Cela signifie qu’un cadeau changeait de statut une fois arrivé en Chine. Les termes chinois les plus couramment employés pour désigner l’acte d’offrir ont tous trait à la notion de gong (jingong, rugong, gongjin, etc.). Cet acte obéissait par ailleurs à des temporalités différentes suivant les protocoles. Les administrations frontalières habilitées à traiter des affaires de « tribut » devaient d’abord dresser une liste des objets offerts, puis la transmettre à l’administration centrale, qui examinait leur recevabilité. Une fois parvenus à la capitale, les « tributs » jugés acceptables étaient rarement remis en main propre à l’empereur. Quant aux cadeaux que la cour des Qing offrait en retour, tout en se référant aux règlementations, ils devaient être d’une valeur supérieure, afin de mieux marquer l’asymétrie de la relation.
Par ailleurs, il y a toujours eu dans la conception chinoise du « tribut » une connotation commerciale, soulignée par le terme shi. Depuis la mise en place progressive du système tributaire à partir des Han et plus particulièrement sous les Song (960-1279), la cour chinoise a toujours cherché à en tirer un profit économique. Ce commerce officiel ou « semi-officiel » était tant bien que mal contrôlé par les administrations centrales et provinciales ou par des marchands privés travaillant pour le compte de l’État 15. Puis les pays asiatiques se sont prêtés à ce jeu des échanges diplomatiques assimilés à du négoce dont ils tiraient de très lucratifs bénéfices. Toutefois, la cour des Qing eut à faire face aux demandes de plus en plus pressantes des Européens réclamant l’ouverture des ports chinois. Le but véritable des ambassades européennes fut clairement identifié en Chine comme « permettant de commercer grâce au tribut » (yigong deshi) 16. Dans ce contexte perçu comme menaçant, les sources chinoises ne cessent de stipuler, presque obsessionnellement, l’impérieuse nécessité de « suivre les usages » (anzhao guanli) en matière de protocole et de gestion des biens échangés dans les relations avec les pays européens 17.
Ce rappel historiographique du versant chinois des échanges a donc pour but, si ce n’est de remettre en cause, du moins de recontextualiser l’image d’une cour chinoise rigide, « brutale », et fermée sur elle. Cette image a été largement véhiculée – alors que les ambassades entre la cour des Qing et les cours européennes furent relativement peu nombreuses aux xviie et xviiie siècles – par quelques récits européens seulement. L’objectif est ici de proposer un regard critique renouvelé sur ces témoignages qui tenaient eux-mêmes largement à l’émergence concomitante en Europe de pratiques « modernes » dans les relations internationales, privilégiant les nouvelles références de la courtoisie et de la civilité 18 : comment étudier les rapports sino-européens de cette période en termes d’échanges plutôt que de conflit ou de querelle ? Comment dépasser le double écueil sino- et européo-centrique pour décrire à nouveaux frais la pratique sociale des cadeaux et l’impact de ces derniers, immédiat ou dans la durée ? Comment comprendre les comportements et enjeux sociaux, culturels et politiques au-delà des étiquettes formelles et en dehors des espaces officiels des échanges dans une optique locale ? Voilà le défi historiographique proposé et relevé par un ensemble d’auteurs venant d’horizons scientifiques et professionnels différents et aux compétences variées, chercheurs, universitaires et conservateurs de musée travaillant en Chine, en France et aux États-Unis.
Objets d’histoire : les présents comme « ambassadeurs muets »
Le cadre historiographique et méthodologique bordant ce dossier est, plus précisément, double. Tout d’abord, il repose sur une histoire de la culture matérielle, permettant d’envisager à partir des objets les « chaînes logiques qui s’imbriquent », puisque comme le soulignait Daniel Roche dans son Histoire des choses banales, « la force des usages est liée à la transformation des objets, entraînant habitudes sociales, capacités techniques des fabricants 19 ». Il insistait ainsi, aux deux bouts de la vie des objets (leur production et leur consommation/réception active), sur la « continuité du matériel et du symbolique », concluant : « Le monde ne peut être isolé sans risque dans sa contingence ni les idées dans leur pureté 20. » Avec cette volonté de dépasser la dichotomie matériel/immatériel, prônée déjà par André Leroi-Gourhan 21, l’objet était mis dès lors au centre des questionnements des sciences sociales, donnant lieu à une grande variété d’approches, à des définitions parfois contradictoires, parfois complémentaires, desdits objets 22. Parmi celles-ci, Bruno Latour propose, par exemple, de faire des objets des « actants », les non-humains agissant au même titre que les humains : « Les objets font quelque chose, et d’abord ils nous font 23. » Cette dernière approche est réinvestie notamment dans un champ de recherches, pluridisciplinaire – mais particulièrement actif dans une histoire de l’art renouvelée 24 –, focalisé sur les objets migrants 25, nomades 26 ou frontières 27 qui, plus que d’autres encore, bénéficient de cette lecture insistant sur les regards multiples portés sur eux, au cœur des zones de contact et des espaces d’interaction à l’intérieur desquels ils circulent. Ils se constituent ainsi en objets « transculturels », intrinsèquement « polyphoniques » 28. Leurs identités, leurs vies multiples 29, se complexifient au long de leurs parcours, elles se superposent, sédimentent.
Les circulations eurasiatiques sont particulièrement fécondes en production d’objets « enchevêtrés », « entremêlés », « entangled » 30, dont nous retrouverons plusieurs exemples détaillés dans le présent dossier ; parmi les plus fameux, celui de la porcelaine « globalisée », à propos de laquelle Robert Finlay et Anne Gerritsen ont respectivement forgé les concepts de Global Chinese porcelain et Global Jingdezhen 31. Une telle approche permet de dépasser les conceptions faisant de tout objet asiatique reçu en Europe une « chinoiserie » : il s’agit de démontrer, par exemple, comment la céramique de Delft, copie de porcelaines chinoises au départ, de leur matière, de leurs motifs, s’était constituée, après une réelle « domestication » de ces dernières, en objet à part entière, les blancs-bleus devenant progressivement, non plus des copies de Chine, mais des « porcelaines » proprement hollandaises et identifiées comme telles 32. Et ce mouvement d’adaptations européennes, liées aux arts du feu, se prolonge ensuite, avec le recours au kaolin cette fois, à Meissen au XVIIIe siècle 33. Parallèlement, les objets européens circulant en Chine ont pu être abordés, eux, comme des Chinese occidenteries, pour qualifier tant les « biens de l’océan » [ou « biens occidentaux », yanghuo], importés d’Europe, que les productions domestiques d’œuvres adaptant l’exotisme européen aux contextes chinois, lectures locales d’un global perçu depuis l’Orient 34. Si la correspondance du jésuite Florian Bahr témoigne, par exemple, en 1747, d’un goût prononcé à la cour des Qing pour les sphères en verre montées sur ivoire de Berchtesgade