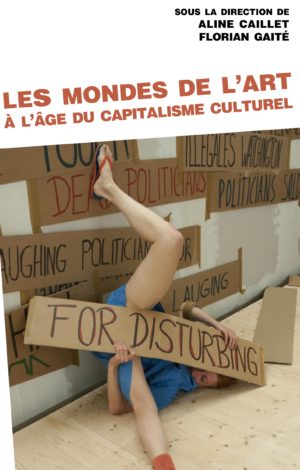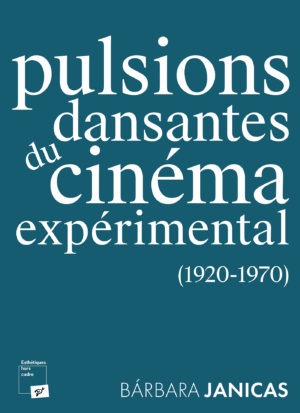Traces, Mouvements, Imbrications Nicolas Droin
Comment l’espace ne cesse pas d’être strié sous la contrainte de forces qui s’exercent en lui ; mais comment aussi il développe d’autres forces et dégorge de nouveaux espaces lisses à travers le striage. Même la ville la plus striée dégorge des espaces lisses : habiter la ville en nomade, ou en troglodyte.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux 1.
À la manière proustienne 2, le présent ouvrage propose de poser un « rapport » : de revenir sur les représentations de la ville au cinéma par le prisme de l’écriture. « Écrire la ville » dans un double mouvement qui est à la fois celui de la ville, dans ses métamorphoses, et celui de l’écriture, des écritures. Si la ville peut être pensée, c’est dans le mouvement même qui la constitue, dans ses transformations permanentes, dans la manière dont nos vies l’affectent et la traversent, comme dans la manière dont la ville nous affecte et nous traverse. Ville comme architecture mouvante, sans cesse sur le seuil, dans l’entre-deux constitutif du dedans dehors 3 (la chambre/la rue), dans le geste même que nos vies, et parfois les luttes et occupations, constituent comme reconfiguration de l’espace.
La ville, par ses transformations, ses fantasmagories, n’a cessé de se développer conjointement à l’art cinématographique, épousant toutes les formes du cinéma, du documentaire à la fiction en passant par les expériences visuelles et sonores de l’expérimental. De fait, la ville offre un terrain propice aux explorations cinématographiques, ce que rappelle Siegfried Kracauer en soulignant, par exemple, l’importance de la foule (comme organisation en mouvement permanent 4), et en expliquant combien « l’affinité du film pour les événements fortuits ressort on ne peut plus clairement de son hypersensibilité au monde de la rue – ce mot recouvrant non seulement la rue proprement dite, et en particulier la rue de la grand ville, mais également ses diverses annexes, telles que gares, dancings et salles de réunions publiques, bars, halls d’hôtels, aéroports, etc. 5 ».
La ville semble avoir été le lieu, multiple, mouvant, du renouvellement permanent des formes cinématographiques. Si la ville est mouvements, de fait le cinéma, art du mouvement, y trouve son territoire privilégié. Des avant-gardes à la Nouvelle Vague, en passant par le néoréalisme et le cinéma expérimental : la ville est lieu d’expérimentation formelle. Aussi, si comme le flâneur de Baudelaire, le regard que nous portons sur la ville est le « regard du dépaysé 6 », il nous faut réinterroger aujourd’hui ce dépaysement (ou plutôt ces dépaysements). Il s’agit ainsi de reprendre les figures propres à la ville, pour saisir à travers ses métamorphoses, les transformations du cinéma et du monde.
écrire
Poser la question de la représentation de la ville au cinéma par le prisme de l’écriture consiste à rapprocher deux mouvements qui peuvent sembler contradictoire, mais que Marguerite Duras avait proposé comme étant le socle de son cinéma : comment une écriture-flux ou écriture-parole rencontre et s’enlace avec une écriture-lieux, spatiale et visuelle. Comment, en s’entre-tissant, mots et lieux se transforment continuellement, sans que l’on ne sache plus qui est premier et qui déforme l’autre. Déjà le cinéma de Duras s’était intéressé aux ruines, lieux abandonnés, comme aux traces éphémères sur les murs, jusqu’aux « mains négatives ».
Nous souhaitons poser la question de l’écriture à la fois comme matrice et comme limite. Le film de Vivianne Perelmuter (Le Vertige des possibles, 2013), posant frontalement la question de l’écriture, du récit et de ses limites, au regard de la ville, de ses lueurs, traces, rencontres et solitudes, a constitué la matrice de nos interrogations. Vivianne Perelmuter parle ainsi des manières de restituer les signes de la ville, en invitant à les lire, mais à lire « comme un mouvement que nous ne pouvons pas achever qui garde la palpitation d’une énigme ou d’un rébus », où le Vertige tentait de « dresser un inventaire furieux et impossible d’un monde fugitif » 7. En cela le cinéma interroge notre présent, notre perception de la ville, et comment ce présent de la ville ne peut se penser sans un regard palimpseste, qui nous permet de voir dans le temps. Comment la ville, dans sa multiplicité, lieu des récits possibles, interroge l’écriture, la met en doute, en question ? Quels liens se tissent entre écriture et image, entre les mots et les lieux, et plus précisément dans la rencontre d’une écriture-trace et de la ville-mouvement ?
Écrire/décrire la ville, filmer la ville aujourd’hui, revient à en révéler les strates, à faire une archéologie ou passé, présent et futur coexistent et se répondent, continuant à évoluer chacun sur sa ligne propre. À la manière du cinéaste Sylvain George, enregistrer les signes, graffs, tags, mots, vite inscrits, vite effacés, sur les murs et sols de nos villes, c’est dresser une archéologie du présent, de l’éphémère, presque une archéologie du geste 8. Il nous semble dès lors impossible de dissocier l’écriture-voix proposée par de nombreux cinéastes dans la constitution d’une représentation de la ville et l’écriture-trace des écritures urbaines enregistrée par le cinéma (et la photographie) depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Dans les deux cas l’identité, la localisation, la temporalité sont remis en question, déplacés, dépaysés. Par la voix comme par les inscriptions sur les murs, les cinéastes interrogent le présent comme un palimpseste de vies dans la fragilité qu’évoque le geste ou l’élan : apparaissant pour ensuite disparaitre, laissant trace mais pouvant être effacé, remplacé, mouvement entre l’espace et le temps, entre le solide et le fluide, que détourait si bien Baudelaire dans son poème dédié « à une passante ». Parlant de cinéma « moderne », Gilles Deleuze proposait le terme d’« archéologie du présent » que nous voulons ici reprendre : « C’est comme si, la parole s’étant retirée de l’image pour devenir acte fondateur, l’image, de son côté, faisait monter les fondations de l’espace, les “assises”, ces puissances muettes d’avant ou d’après la parole, d’avant ou d’après les hommes. L’image visuelle devient archéologique, stratigraphique, tectonique. Non pas que nous soyons renvoyés à la préhistoire (il y a une archéologie du présent), mais aux couches désertes de notre temps qui enfouissent nos propres fantômes, aux couches lacunaires qui se juxtaposent suivant des orientations et des connexions variables 9. »
paradoxes
J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables […]. De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire : rien ne ressemblera plus à ce qui était, mes souvenirs me trahiront, l’oubli s’infiltrera dans ma mémoire […]. L’espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux informes : Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes 10.
À l’instar de Georges Perec, nous souhaitons poser l’espace comme « question », « doute », et l’écriture comme « trace », « signe », tentant de saisir des « bribes » du lieu et du temps qui sans cesse le troue et le recompose. Duras elle aussi expliquait combien :
Autour de nous, tout écrit, c’est ça qu’il faut arriver à percevoir, tout écrit, la mouche, elle, elle écrit, sur les murs, elle a beaucoup écrit dans la lumière de la grande salle […]. Elle pourrait tenir dans une page entière, l’écriture de la mouche. Alors elle serait une écriture. Du moment qu’elle pourrait l’être, elle est déjà une écriture. Un jour, peut-être, au cours des siècles à venir, on lirait cette écriture, elle serait déchiffrée elle aussi, et traduite. Et l’immensité d’un poème illisible se déploierait dans le ciel 11.
L’écriture pensée ici est constitutive d’un paradoxe : à la fois déchiffrable et illisible. Si la ville intéresse ontologiquement le cinéma c’est qu’elle est à la fois le lieu de tous les récits possibles et celui de la disparition possible de tous les récits : le lieu de l’origine des écritures et celui qui sous-tend l’impossibilité d’écrire. Ce sont ces limites que le cinéma explore en sondant les espaces de la ville et en se perdant dans ses marges et ses interstices. La ville, de fait, n’existe souvent que dans un double mouvement permanent de construction et de destruction, perpétuel chantier, traversée aussi par les luttes et les guerres. Elle peut alors être désert, grotte, forêt, mais laisse également transparaître combien la ruine semble être l’un de ses horizons constitutifs. Bien que moderne, flux de lumières et de communications, la ville se creuse sans cesse d’un passé non résolu. En ce sens elle ne peut être pensée de manière linéaire, mais elle pose le temps comme imbrication. Faire d’un coin de rue « un monde » en soit, pour citer Guy Gilles, c’est aussi, avec Vivianne Perelmuter, « creuser dans le présent toutes les temporalités qui le composent 12 ».
pour une écriture-mouvement
La ville s’écrit toujours : n’étant pas une chose fixe, figée, muséifiée et ordonnée, mais un chaos complexe, un tissage, un télescopage permanent de temporalités et d’espaces, et surtout de manières d’habiter cet espace, de la manifestation à la flânerie, de la voiture au skate, écrire la ville c’est la traverser, et en cela la rendre vivante, vibrante. Il s’agit de penser l’espace, et la ville en particulier, les lieux et le paysage non comme des objets finis, définissables, cartographiables, mais de voir à quel endroit ils ne sont plus une chose mais plusieurs choses. Penser l’espace par celles et ceux qui le recréent et l’occupent lors de luttes contemporaines (Nuit Debout, ZAD, etc.), c’est penser l’espace transformé, détourné, même pour les lieux dits « désaffectés », qui sont en réalité « affectés » par des émotions et des vies qui s’y superposent. Il nous faut inventer une réflexion autour de ce que l’on pourrait nommer une écriture-mouvement de la ville comme paradoxe entre le verbal et le non-verbal, entre ce qui peut s’écrire et ce que, justement, on écrit puisque ne pouvant pas s’écrire, on filme puisque infilmable, sur ce qui se passe entre les mots et entre les images, entre les lieux, entre nos vies, dans les zones blanches des cartes 13. Penser le paradoxe correspond au mouvement même du cinéma : art toujours ailleurs, hors temps, intempestif. Le paradoxe comme mouvement constitutif de la pensée : rapprocher les lointains, rentoiler, avec Proust, les fragments intermittents du paysage. Paradoxes que l’on retrouve dans les dedans/dehors du film/texte de Georges Perec (Un homme qui dort) : « Tu marches et tu ne marches pas. »
Il s’agit de penser l’écriture comme signe ou hiéroglyphe, mais aussi comme trace, trait, jet, coulure. Le signe ouvre le présent d’un doute, d’une faille, d’un geste. Filmer la ville, c’est filmer des traces qui vont disparaître, comme dans la flânerie, ou dans la rencontre amoureuse (thème éminemment urbain). Le cinéma propose de filmer ce qui va disparaître au moment, fragile, de son apparition.
Mouvement du monde, mouvements de la ville, mouvements du film, de la pensée et du cinéma. Pour Germaine Dulac : « L’art du mouvement, voilà ce qu’est le cinéma, et j’entends par mouvement le déroulement de la vie même avec les faits extérieurs qui se succèdent et le mouvement de l’esprit qui les cause 14. » Sous l’égide d’Henri Bergson, construisons une pensée qui n’arrête pas le mouvement, ne tente pas de définir des états, mais cherche à en comprendre les passages, les transformations, les métamorphoses.
un parcours, des écritures
Le présent ouvrage issu d’une journée d’étude et d’un colloque organisé.es en mai 2015 et juin 2016 propose différentes entrées dans ce maillage urbain et cinématographique qui sont autant de parcours possibles ou de variations. Chaque proposition peut recouper les autres dans un jeu d’imbrications et de déplacements des termes, des approches et des formes. Nous avons fait le choix d’inviter différents regards convoquant ainsi autour de notre objet de multiples approches et plusieurs écritures, venant d’artistes, de cinéastes, d’universitaires. Ces différences d’écriture nous semblent essentielles pour saisir ces formes multiples que la ville offre aux cinéastes. Tout d’abord dans le choix des films et des cinéastes étudiés en portant une attention à un regard féminin sur la ville là où très souvent le regard masculin domine. Ensuite en proposant, à travers les auteurs des articles, à des écritures singulières, parfois poétiques, de s’inscrire au côté d’écritures plus académiques.
Nos traversées urbaines au cinéma s’ouvrent aux « Seuils » entre écriture et cinéma, questionnés lors d’un entretien programmatique que nous a accordé la cinéaste Vivianne Perelmuter (Le Vertige des possibles).
Les « Traces » dans la ville sont ensuite convoquées dans une première partie à travers les rues parisiennes et prolétariennes se superposant aux grottes paléolithiques chez Marguerite Duras (par Suzanne Liandrat-Guigues), puis les ruines et strates des villes meurtries des cinéastes du Moyen Orient (Emna Mrabet), résonnant à distance avec les interstices politiques et urbains du cinéaste Sylvain George qui nous accorde un entretien inédit. Prosper Hillairet, cinéaste et historien du cinéma, clôture ce chapitre dans un texte elliptique et géométrique autour du Samouraï de Jean-Pierre Melville, entre lignes, minéralité et signes sur un plan de ville devenu abstrait.
Les « Mouvements » voient s’entremêler les écritures et lieux d’une ville devenue palimpseste des sentiments, des temps et des inspirations nocturnes (Guy Gilles par Mélanie Forret et Leos Carax par Julien Milly), pour nous emporter vers un urbain « transitionnel » chez Jane Campion (Ivan Hérard). Chaghig Arzoumanian, cinéaste et doctorante, termine ce deuxième mouvement par un retour personnel autour de son film réalisé dans le cadre du Master Réalisation à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis figurant une histoire amoureuse impossible entre les strates de destructions et reconstructions de la ville de Beyrouth.
Les « Imbrications » convoquent enfin des cinémas différents pour mettre en lumière une tension entre politique et habitations, imaginaires et réalités, villes modernes et géographies sensibles. Tout d’abord, des films méconnus du cinéma soviétique, les « films de chantier », nous amènent à focaliser sur la cinéaste Kira Mouratova et imbriquer ville en construction, terrains vagues, possibles cinématographiques et politiques (par Eugénie Zvonkine). La carte réelle d’une ville (Buenos Aires) se superpose ensuite avec celle imaginaire (Aquilea) d’Hugo Santiago dans Invasion (par Claire Allouche). La ville américaine et ses murales, puis ses brouillages modernes et flux-écrans sont enfin traversés avec les écarts séparant le Los Angeles d’Agnès Varda (par Véronique Buyer) dans Murs, murs, et la ville de Michael Mann dans Collateral et Miami Vice (par Damien Angelloz-Nicoud). Pour terminer ce dernier chapitre nous avons demandé à un artiste et ancien étudiant en cinéma de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de revenir sur l’expérience organique et personnelle de la réalisation de son film Le Piano, exploration physique et mentale d’une maison abandonnée.
1.Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 624-625.
2. Proust propose de penser par « montage » ou « télescopage » en posant comme nécessaire un rapport entre deux éléments : « On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans un lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport. » Marcel Proust, À la recherche du temps perdu VII. Le Temps retrouvé, Paris, Gallimard, p. 196.
3. Comme le propose Alain Mons : « Par la traversée de la ville nous faisons l’expérience de la dimension surfaciale des lieux se succédant spatialement […]. Cependant celle-ci nous renvoie à une profondeur, à des aspérités, à une épaisseur, à un volume, parfois à des abîmes. Le retournement se produit conséquemment dans les deux dimensions : du dedans vers le dehors, du dehors vers le dedans. Telle serait l’expérience du regard par rapport au lieu touchant. Les lieux urbains dans leur disparité nous invitent à ce basculement de la vision qui opère des surfaces scintillantes aux entrailles de la ville. » Alain Mons, L’Intervalle des lieux [en ligne : https://journals.openedition.org/leportique/578].
4. « Walter Benjamin note qu’à l’époque marquée par l’essor de la photographie, le spectacle quotidien de foules en mouvement requérait encore chez l’observateur une accommodation de l’œil et des nerfs. Le témoignage de contemporains à la sensibilité aiguisée semble corroborer cette pénétrante observation : les foules parisiennes omniprésentes dans les poèmes de Baudelaire fonctionnent comme des stimuli suscitant d’irritantes sensations kaléidoscopiques ; les passants qui, dans L’Homme des foules de Poe, se poussent et se bousculent sous les becs de gaz des rues de Londres, provoquent une série de chocs électriques. » Siegfried Kracauer, Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle, Paris, Flammarion, 2010, p. 93-94.
5.Ibid., p. 111.
6. « […] Le regard que l’allégoriste pose sur la ville est au contraire le regard du dépaysé. C’est le regard du flâneur, dont le mode de vie couvre encore d’un éclat apaisant la désolation à laquelle sera bientôt voué l’habitant des grandes villes. » Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2004, p. 58.
7.Entretien avec Vivianne Perelmuter, « Écrire la ville au cinéma », mené par Nicolas Droin.
8. Nous pensons notamment aux occupations récentes de places, aux ZAD et autres espaces éphémères qui se constituent dans le mouvement même de celles et ceux qui les créent, qui n’existent que dans le partage et la réinvention de l’espace, comme le souligne notamment le Comité Invisible parlant d’« habiter à nouveau l’espace urbain » : « Habiter, c’est s’écrire, se raconter à même la terre. » La commune « vient briser le quadrillage raisonné de l’espace, elle voue à l’échec toute velléité d’“aménagement du territoire” ». À nos amis, Comité Invisible, Paris, La Fabrique, 2018, p. 203-205.
9.Gilles Deleuze, <sp