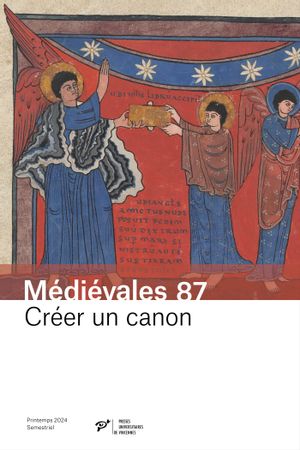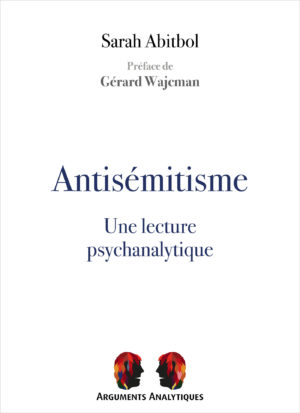Introduction
Pour une approche géographique des violences dans le couple
Mme C. quitte le domicile conjugal à la fin du mois d’aout 2020 avec ses deux enfants d’1 an et demi et 5 ans. Après deux nuits à l’hôtel, elle est accueillie en hébergement d’urgence par l’association Le Rialto 38 par l’intermédiaire de laquelle nous l’avons rencontrée. Elle vit le confinement de mars 2020 en cohabitation avec un mari violent, dans leur logement situé au sud de l’agglomération grenobloise. Dès l’annonce de la fermeture des écoles, elle tente de quitter le domicile et de partir en bus avec ses enfants chez sa mère à Nancy. Mais après une semaine de harcèlement et de chantage, il vient les rechercher en voiture. Pendant le confinement, elle reste donc 24/24 h avec cet homme rendu très nerveux du fait de la perte de son emploi ; elle passe ses journées à s’occuper de la maison et des enfants, à tenter de faire faire au plus grand d’entre eux les exercices transmis par son école, à faire les courses le plus rapidement possible pour que le père n’ait pas à les garder trop longtemps, à préparer à manger pour tout le monde. Chaque fois qu’elle s’assied ou s’allonge, son mari lui fait une remarque et la contraint à se relever. Un soir où il se montre agressif sous l’effet de l’alcool, elle tente de sortir avec les enfants, mais il lui prend ses clés, retient l’ainé, et l’enferme dehors avec le petit. Il est 20 h, les gens du quartier applaudissent les soignant·es en signe de soutien. Elle appelle la police qui ne se déplace pas car son conjoint la laisse finalement rentrer chez elle peu après. Un mois plus tard, elle se rend à l’hôtel de police de Grenoble, mais l’agent qui la reçoit refuse de prendre sa plainte parce qu’à la question « Pensez-vous que vous risquez de subir des violences physiques ? », elle répond : « Non. » Quand nous lui demandons pourquoi elle a répondu par la négative, alors qu’elle nous a fait part de coups portés sur elle et sur son fils ainé, elle explique que depuis 15 ans que dure sa relation avec son mari, elle a appris à éviter qu’il la frappe. Elle a aussi subi des rapports sexuels non consentis, mais qu’elle n’associe pas a priori à des violences physiques.
La crise sanitaire de la Covid-19 a été un bouleversement sans précédent 2. Elle a donné lieu à un grand nombre de politiques publiques qui, parce qu’elles étaient destinées à contenir l’expansion de la pandémie, ont eu pour dénominateur commun de viser les pratiques spatiales des populations pour les limiter. Le confinement et les mesures qui lui ont été associées ont renforcé la vulnérabilité des victimes 3 encore en couple à l’égard de la violence, parce qu’elles sont entrées en résonance avec la logique des agresseurs. En ce sens, la crise a tout changé et n’a rien changé. Elle a tout changé parce que, du jour au lendemain, elle a retiré aux victimes vivant sous le même toit que leur partenaire violent toute possibilité de lui échapper. Mais elle n’a rien changé aux dynamiques spatiales à l’œuvre dans les violences conjugales, notamment l’ingérence des agresseurs sur les pratiques spatiales des victimes dans et hors du domicile, et la réduction progressive des périmètres de vie des victimes qui en découle. La crise sanitaire a révélé au grand jour ce qu’Eva San Martin avait identifié dans son travail doctoral 4 : que les violences dans le couple comportent une dimension spatiale structurante, à la fois symptôme et instrument des violences. C’est ce qui a conduit la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à parler des violences conjugales comme d’un « confinement sans fin 5 ». On perçoit comment le contrôle spatial entre en jeu dans les violences conjugales lorsque le mari de Mme C. l’empêche de quitter son domicile pour autre chose que des courses rapides, ou la contraint à rester toujours active au sein du logement, la privant d’espace-temps à elle. On le voit aussi à l’œuvre lorsque les femmes tentent de mettre fin à la relation et que leurs partenaires les en empêchent par tous les moyens possibles, comme lorsque le mari de Mme C. vient la chercher chez sa mère où elle a trouvé refuge, à 500 km de leur domicile.
La dimension spatiale des violences dans le couple se déploie à différentes échelles. Mme C. fait la connaissance de son futur mari à 16 ans en 2005. Il vit alors dans un autre pays que la France, dont la famille de Mme C. est originaire. Elle le rencontre lors de vacances et retourne le voir à l’occasion des vacances scolaires estivales. Au fur et à mesure que la relation prend de l’importance, et précisément à partir du moment où elle va le voir chez ses parents à lui et non plus dans sa famille à elle, il devient plus possessif. Elle est étudiante en histoire de l’art, et lorsqu’elle est en France, il lui demande constamment de se connecter à Facebook ou Messenger et de laisser la caméra allumée pour qu’il voie où elle se trouve et puisse vérifier qu’elle n’a pas menti sur son emploi du temps. Peu à peu, elle doit effacer tous ses contacts sur ces deux réseaux sociaux car il ne supporte pas qu’elle parle à d’autres personnes que lui quand elle est connectée. Il devient agressif lorsqu’ils sont ensemble, et leurs premières relations sexuelles ne sont pas consenties. En 2013, après une courte séparation pendant laquelle elle se trouve rapidement sans soutiens, elle le rejoint dans son pays : il organise alors un mariage à son insu et prend un appartement avec elle. Très isolée, elle vit des violences qu’elle qualifie comme étant de plus en plus graves. Le mari de Mme C. utilise à son profit la distance géographique et les frontières internationales. Elle tente un temps de suivre des cours par correspondance, mais elle est vite contrainte d’arrêter ses études, parce que les violences l’empêchent de s’y consacrer sereinement, et qu’elle doit prendre un travail rémunéré, en l’occurrence dans un centre d’appels. Après la naissance de son premier enfant, elle revient en France et peut reprendre des études pour suivre une formation d’assistante maternelle. Mais là encore, les violences et l’importance du travail domestique font qu’elle ne peut valider son stage. Ce n’est qu’après sa séparation qu’elle peut s’engager à nouveau sereinement dans cette formation.
L’approche géographique offre des outils théoriques et méthodologiques utiles pour appréhender cette dimension spatiale des violences dans le couple jusqu’alors laissée de côté, c’est-à-dire pour étudier la manière dont l’espace est pratiqué, approprié, aménagé dans le cadre du contrôle coercitif 6. Elle est en particulier intéressante par sa capacité à envisager des phénomènes à différentes échelles : aux échelles les plus fréquemment mobilisées par l’analyse géographique (la ville, la région, le pays), le tournant culturel en géographie a ajouté celles de la subjectivité 7, et les géographies féministes celles du corps 8. Or, une des propriétés du raisonnement géographique est le fait d’être multiscalaire, c’est-à-dire d’analyser la manière dont les échelles s’articulent entre elles : comme l’illustre le récit de Mme C., l’intime ne se cantonne pas à l’espace privé mais se déploie à différentes échelles, y compris, dans ce cas, aux échelles plus vastes de l’international et de la mondialisation 9. L’entrée par une géographie féministe permet aussi de prolonger, de manière très concrète, la remise en cause de la distinction entre espaces public et privé, engagée par les militantes et chercheuses féministes.
Le rôle des violences
dans la reconduction des rapports
de domination de genre
Le récit de Mme C. le montre bien : les violences conjugales servent – intentionnellement ou non – au partenaire violent à assoir un rapport hiérarchique dont il tire des bénéfices : par exemple celui de s’assurer des ressources affectives et matérielles issues du travail domestique. Et en effet, comme l’a montré la philosophe Hannah Arendt dans son essai Sur la violence 10, la violence est d’abord une arme utilisée dans le cadre d’un rapport de domination, ce qui permet de distinguer le rapport de pouvoir au sens politique – qui n’a pas besoin de la violence voire peut être menacé par l’exercice de la violence – du rapport de domination. Les féministes matérialistes des années 1970 et 1980 11 ont montré le rôle que joue la violence dans l’établissement et la reconduction du rapport de domination patriarcal. Car la domination qu’exerce le mari de Mme C. ne concerne pas que leur couple. Lorsqu’elle est validée socialement par une absence de réponse de l’État, la violence conjugale sert un rapport de domination qui se déploie à l’échelle de la société tout entière : le rapport de domination patriarcal. La sociologue Jalna Hanmer 12 interprète ainsi la violence masculine comme le ressort d’un « contrôle social des femmes ». Elle montre que les violences commises envers les femmes parce qu’elles sont des femmes – au premier rang desquelles les violences à caractère sexuel – sont trop nombreuses pour être considérées comme des cas isolés commis par des auteurs déviants. Et parce que ces violences ont lieu en priorité au sein de la famille et qu’elles touchent les femmes dès leur enfance, Hanmer envisage le fait qu’elles participent à la socialisation des petites filles. En faisant cela, elle montre que les violences masculines faites aux femmes participent d’un rapport de domination qui n’est pas (exclusivement) interpersonnel mais (également) structurel.
Si les théories féministes matérialistes ont été élaborées à un moment différent en termes de prise de conscience des violences faites aux femmes et des réponses sociales et juridiques qui leur étaient apportées, elles sont toujours utiles pour comprendre comment les inégalités entre hommes et femmes résultent non de différences naturelles mais d’un rapport social de domination, et comment les violences jouent un rôle dans la préservation de ce rapport social. Les approches matérialistes qui se développent au sein des féminismes des années 1970 et 1980 s’inspirent des travaux de Marx en même temps qu’elles les remettent en cause. Celui-ci envisage en effet l’évolution historique de la société en termes de rapports conflictuels de classes aux intérêts matériels antagoniques, en particulier du point de vue du rapport de production : deux classes s’opposent, l’une, la classe possédante ou bourgeoise, qui possède les outils de production, l’autre, la classe laborieuse ou prolétaire, qui ne possède d’un point de vue productif que sa force de travail. Les féministes matérialistes réinterprètent cette proposition théorique pour formuler une lecture du patriarcat en tant qu’appropriation matérielle d’une classe de sexe par une autre, celle des femmes par celle des hommes 13. Au sein de la famille, les femmes fournissent un travail non rémunéré, le travail domestique et de care 14, qui est utile à la reproduction de la force du travail ; parfois, il arrive qu’elles fournissent dans le cadre d’une cellule de production familiale (comme dans le domaine de l’agriculture, du commerce ou de l’artisanat) un travail qui n’est pas non plus rémunéré. Certaines féministes matérialistes, comme Colette Guillaumin 15, considèrent que l’appropriation matérielle des femmes n’est pas seulement celle de leur temps et de leur force de travail mais aussi celle du corps et de ses produits (par exemple, l’obligation de relations sexuelles est toujours considérée comme inhérente au mariage, de même que le devoir de procréation pour les couples hétérosexuels cisgenres 16). La sociologue nomme ce « rapport d’appropriation » le « sexage ».
Colette Guillaumin 17 recense un certain nombre de moyens permettant cette appropriation, parmi lesquels figure « la démonstration de force (les coups) ». Celle-ci est « une sanction socialisée du droit que s’arrogent les hommes sur les femmes, tel homme sur telle femme, et également sur toutes les autres femmes qui “ne marchent pas droit” 18 ». Le recours à la violence est tantôt mesure d’intimidation, tantôt mesure de répression. Les travaux d’anthropologues féministes permettent de prolonger son argumentation et illustrent la manière dont le recours à la violence est constitutif des sociétés patriarcales. Paola Tabet 19 réfute ainsi l’idée que la division du travail entre les sexes serait de l’ordre de la complémentarité et « fondée sur les “limites” que la nature imposerait aux femmes 20 ». Elle démontre au contraire à partir d’une approche anthropo-historique que cette division du travail assoit un rapport de domination, et qu’elle se fait, à mesure de l’évolution technologique des sociétés, en réservant toujours les tâches qui nécessitent l’accès aux outils les plus complexes aux hommes. Ainsi, le monopole masculin de la chasse, de la guerre, ou du défrichage nécessaire à l’agriculture devient avant tout un monopole des armes. Aux femmes sont réservés les outils les plus sommaires, dont la production même dépend des hommes ; et lorsqu’elles participent à la chasse ou au défrichage, c’est à main nue et souvent pour des activités secondaires (rabattre le gibier, déblayer les branches abattues, etc.). Les travaux de l’anthropologue Yvonne Verdier confirment cela à partir d’une étude monographique du village de Minot en Bourgogne 21, lorsqu’elle observe par exemple que l’usage des couteaux et objets tranchants est réservé aux hommes, même lorsqu’il s’agit de servir la nourriture à table.
Les écrits féministes matérialistes sur le rôle des violences dans la reconduction du rapport de domination sont aussi utiles parce qu’ils remettent en cause l’idée que les dominées consentiraient à leur propre oppression, qu’elles participeraient à la reconduction du rapport de domination. Nicole-Claude Mathieu 22 introduit ainsi la distinction fondamentale entre céder et consentir. Contrairement à ce qu’ont pu avancer des anthropologues comme Maurice Godelier 23, les dominées ne coopèrent pas avec leurs agresseurs dans le rapport d’oppression, elles n’ont pas de responsabilité dans la violence qu’elles subissent. Car pour Nicole-Claude Mathieu aussi la violence joue bien un rôle central dans le rapport de domination patriarcal :
La violence physique et la contrainte matérielle et mentale sont un coin enfoncé dans la conscience. Une blessure de l’esprit. Après, si les coups ou les viols ne sont plus nécessaires à chaque instant, ce n’est pas que les femmes “consentent” – et il importe moins, et non pas plus que la violence et la contrainte physiques et mentales, que les femmes “partagent” ou non les représentations légitimantes du pouvoir masculin 24.
Mathieu montre également que la connaissance du rapport de domination est inégalement distribuée : le dominant connaît les moyens de la domination ; la dominée connaît, elle, le vécu de l’oppression 25.
On retiendra enfin des approches féministes matérialistes l’idée que le genre est une construction sociale qui a des bases matérielles et non biologiques. Cela signifie que les « caractères sexuels », c’est-à-dire les attributs anatomiques liés au système reproductif ne sont pas à l’origine du rapport de genre, mais chargés de sens a posteriori. Et que toutes les personnes socialement considérées comme relevant de la classe des femmes subissent l’oppression de genre, quel que soit le sexe qui leur a été assigné à la naissance, qu’il s’agisse donc de femmes cisgenres ou transgenres 26. Dans la suite de cet ouvrage, lorsque nous parlons de femmes, il faut entendre femmes cisgenres et transgenres, dans la mesure où toutes sont concernées par la violence patriarcale 27. À noter que plus précisément au cours de la recherche dont nous présentons les résultats ici, un faible nombre de personnes transgenres ont été interrogées dans le cadre de l’enquête de mobilité 28, et aucune dans le cadre des entretiens réalisés auprès des victimes de violences dans le couple.
Un continuum (spatial)
des violences faites aux femmes
Les violences de genre fonctionnent, en pratique, comme un levier de la reconduction du rapport de domination patriarcal parce qu’elles s’articulent les unes aux autres. C’est ce dont Liz Kelly 29 rend compte en formulant le concept de « continuum des violences à caractère sexuel » à partir d’une enquête menée auprès de soixante femmes dont la moitié avaient été la cible des violences qu’elles définissaient elles-mêmes comme viol, inceste ou violence domestique. Lorsqu’elle parle de violences « sexuelles » (sexual violence) elle englobe à la fois les violences à caractère sexuel et les violences faites en raison du sexe que l’on nommerait aujourd’hui violences de genre. Elle utilise le terme de « continuum » dans le sens d’une série d’éléments – ici d’évènements – qui possèdent un caractère fondamental commun. Elle démontre qu’il existe à la fois un continuum de fréquence, puisque toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale, font l’expérience au cours de leur vie de violences « sexuelles » ; et un continuum d’expérience : pour une même femme, toutes les expériences de violences « sexuelles » sont reliées les unes aux autres.
Les violences que subissent les femmes participent de leur socialisation de genre. Si l’« On ne naît pas femme, on le devient 30, « c’est notamment du fait de la violence subie dès l’enfance 31 et de la peur que l’on inculque aux filles dès toutes petites. Ces violences sont liées à la sexualité mais pas uniquement. Marylène Lieber 32 mobilise le concept de continuum des violences faites aux femmes pour tenter de comprendre le fonctionnement du harcèlement sexuel dans l’espace public. Elle s’appuie sur la lecture que fait Elizabeth Stanko des comportements des femmes dans l’espace public qui, « toutes origines sociales confondues, doivent toujours « jauger » (monitoring) le danger que peut représenter un homme ou un groupe d’hommes lorsqu’elles se promènent dans la rue, particulièrement le soir 33 », ce qu’elle désigne comme un « continuum d’insécurité » (continuum of unsafety) 34. Marylène Lieber montre, à la suite de Jill Radford et Diana E.H. Russel 35, que « parler de continuum permet d’analyser ces violences comme un moyen fondamental de contrôle social, essentiel au maintien d’un ordre social sexué 36 », ce qui la conduit à envisager les actes de harcèlement sexuel dans l’espace public comme un « rappel à l’ordre sexué 37 ».
Quel est le « caractère commun fondamental » au continuum des violences faites aux femmes, l’opérateur par lequel il se traduit en pratique dans la vie des femmes ? Pour Liz Kelly, dans la continuité des travaux d’Andrea Dworkin 38 et de Catherine MacKinnon 39, le continuum des violences sexuelles est sous-tendu par le cadre hétérosexuel, c’est-à-dire par le fait qu’une grande part des relations hétérosexuelles, et notamment dans le contexte conjugal, sont fondées sur la force, la contrainte et l’abus, ce qui revient à normaliser la violence et à l’invisibiliser. Pour Marylène Lieber, ce serait plutôt la peur qui jouerait le rôle d’opérateur du continuum et lierait entre elles les différentes formes de violence :
La peur joue un rôle non négligeable puisque des types de violences qui peuvent paraitre anodins de prime abord renvoient systématiquement à la potentialité de violences jugées plus graves par les personnes concernées 40.
En d’autres termes, en l’occurrence ceux de Coline Cardi et Geneviève Pruvost 41, « l’ordre social est avant tout fondé sur la distribution asymétrique des pouvoirs et des vulnérabilités supposées ». Le fait que
les hommes, en temps de paix comme en temps de guerre, n’aient pas à craindre dans l’espace public comme dans leurs foyers que les femmes les violent et les tuent constitue une donnée importante de l’ordre social et de sa prévisibilité. Inversement, que les femmes aient tout à fait incorporé qu’il fallait subordonner leur liberté de parole et de mouvement à la crainte d’être violées et tuées par des hommes (et non par des femmes), en temps de paix comme en temps de guerre, fait partie intégrante de ce même ordre 42.
Selon nous, il existe un troisième opérateur du continuum des violences faites aux femmes : la suspicion de consentement. Qu’il s’agisse de violences sexuelles, de violences conjugales ou même d’inceste, la victime est toujours soupçonnée d’avoir provoqué l’acte, de « l’avoir bien cherché ». Lorsqu’une personne subit des coups parce qu’une autre veut lui voler son téléphone portable et qu’elle la laisse finalement le prendre, personne ne lui demandera combien de fois elle avait dit non, et si c’était à haute et intelligible voix ; s’il s’agit d’un acte sexuel, si. Cela rejoint la suspicion de consentement des dominées à leur propre domination remise en cause par Nicole-Claude Mathieu sur le principe que « céder n’est pas consentir 43 ».
En rapprochant les violences faites aux femmes qui arrivent dans le foyer, sur le lieu de travail, dans la rue, à l’école, chez le médecin ou au poste de police, les intellectuelles féministes qui mobilisent le concept de continuum font apparaitre le lien qui unit ces différents espaces. Cela conduit à envisager la dimension spatiale fondamentale du continuum des violences faites aux femmes, et, ce faisant, à remettre en cause la division entre espace privé et espace public.
La division public-privé
et la responsabilité de l’État
dans les violences « domestiques »
La contestation de la division entres sphères publique et privée a été centrale dans le mouvement féministe, comme en témoigne le mot d’ordre « Le personnel est politique 44 ». Renvoyer les questions de violences sexuelles et conjugales à la sphère du privé est en effet une manière d’exclure ces questions du débat public et donc du politique. Il y a en outre un enjeu fort à montrer que la division entre privé et public n’est pas synonyme de division entre espaces personnel et impersonnel. Le fait qu’un espace soit privé est surtout une question de droits (notamment fonciers), mais il n’est pas du tout systématique qu’il coïncide avec l’espace personnel. Beaucoup de femmes en particulier n’ont pas d’espace à elles dans le foyer.
L’organisation de la famille dans l’espace domestique, indument appelé privé, répond en effet aux rapports de pouvoir. Un des effets de ces rapports, peu souligné jusqu’alors, est que les femmes y sont privées de privacité 45.
La privacité (de l’espagnol « privacidad » ou de l’anglais « privacy ») étant la sphère de l’intime y compris dans sa dimension spatiale. Et même si toutes les femmes ne sont pas à la même enseigne, cela variant notamment selon leurs revenus et leur capacité à « avoir une pièce à elles 46 », elles sont toutes, de manière générale, vulnérables aux violences dans l’espace privé. Selon l’enquête la plus récente sur les violences sexuelles, l’enquête VIRAGE 47, les violences les plus graves (viols et tentatives de viol) surviennent dans les espaces de la famille et du couple où elles sont près de quatre fois supérieures à celles déclarées dans l’espace public.
Les intellectuelles féministes se sont interrogées sur la responsabilité de l’État dans les violences elles aussi appelées « domestiques », les violences renvoyées à la sphère privée, qu’il s’agisse de violences sexuelles, conjugales et/ou intrafamiliales. La division public-privé est née avec l’État moderne, qui en est le garant 48. Lorsque la loi ignore, sur la base de cette division, les violences conjugales et intrafamiliales, ou lorsque les appareils d’État – à commencer par la police et la justice – ne condamnent pas les agresseurs et mettent en doute la parole des victimes, alors on peut penser, avec Birgit Sauer 49, que l’État partage son monopole de la violence physique légitime avec les maris et les pères de famille, c’est-à-dire à proprement parler les « patriarches ». Selon Max Weber, le compromis social repose sur le fait que tous et toutes cèdent leur capacité de violence à l’État qui, au moyen de la violence physique à laquelle il est le seul à avoir légitimité à recourir, assure la paix intérieure 50. Mais selon la lecture de Birgit Sauer, tant que l’État laisse le champ libre aux violences « domestiques » au motif qu’elles adviennent hors de la sphère publique (sans hésiter pour autant à légiférer sur l’avortement, la contraception, l’identité de genre et les pratiques sexuelles), alors il cède une part de son monopole de la violence physique légitime aux maris et aux pères 51. Mais l’État n’est pas nécessairement et définitivement patriarcal, il peut aussi être appréhendé comme un champ de bataille sur lequel des victoires peuvent être gagnées 52 – et sur lequel d’ailleurs des victoires ont été gagnées,
y compris récemment dans le domaine des violences conjugales.
Les politiques menées par l’État en France pendant la crise sanitaire illustrent bien ce double mouvement. Parce que les réponses gouvernementales à la menace pandémique se sont structurées autour de la division public-privé, elles témoignent du fait que l’espace privé était considéré de manière générale comme un espace de sécurité, où les sources d’insécurité (et en premier lieu desquelles les violences dans le couple) pouvaient être résolues par des mesures spécifiques sans que le cadre général de confinement aux espaces privés ne soit remis en cause. C’est ce qui fait l’intérêt d’une recherche portant conjointement sur les conséquences des politiques spatiales menées pendant la crise sanitaire et sur celles des mesures spécifiques de prévention des violences dans le couple.
Les politiques menées
en réponse à la crise sanitaire
La crise sanitaire de la Covid-19 a donné lieu à un grand nombre de politiques publiques, qui, comme nous l’avons vu plus haut, ont eu pour dénominateur commun de viser les pratiques spatiales des populations pour les limiter. Dans certains pays, comme la Suède, ces limitations se sont traduites par de simples recommandations à la population, tandis que dans d’autres, comme la France, elles ont pris la forme d’interdictions beaucoup plus strictes et sévèrement pénalisées.
Après la détection des premières infections par le SARS-COV-2 en Chine à l’automne 2019, et face à la diffusion rapide de l’épidémie, les premières fermetures d’établissements scolaires sont décidées au début du mois de mars dans les départements les plus touchés, et les visites aux personnes âgées hébergées en EHPAD sont interdites. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare l’épidémie de Covid-19 « pandémie mondiale ». Le gouvernement français décide conséquemment de prendre des mesures radicales de confinement : à compter du 14 mars à minuit, tous les lieux publics « non essentiels », y compris les établissements scolaires, sont fermés, et à compter du 17 mars les déplacements hors du domicile sont strictement restreints à certains motifs considérés comme essentiels. Ainsi, ne sont autorisés que les déplacements professionnels lorsqu’ils ne peuvent pas être différés ou remplacés par du télétravail, les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, les déplacements pour motifs de santé ou pour motifs familiaux impérieux (notamment dans le cadre de la garde des enfants), et les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, permettant l’exercice physique à condition qu’il soit individuel, ou de sortir les animaux de compagnie 53. Les personnes souhaitant bénéficier de ce qui est alors présenté comme des exceptions doivent se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement ; et tout manquement à la règle est puni d’une amende de 135 €. Ces dispositions sont reconduites tous les quinze jours jusqu’à leur levée le 11 mai 2020. La France fait partie des pays dont le degré de réponse gouvernementale à la Covid-19 a été le plus fort selon l’indice élaboré par l’université d’Oxford 54.
Au cours de l’été 2020, le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès diminue, mais il repart à la hausse à l’automne 2020, ce qui conduit le gouvernement à introduire un second (du 30 octobre au 15 décembre 2020) puis un troisième « confinement 55 » (du 3 avril au 3 mai 2021) qui, pour limiter l’impact sur le secteur économique, ont été beaucoup moins stricts que le premier : les établissements scolaires sont restés ouverts (mais pas les établissements d’enseignement supérieur), et la liste des lieux publics considérés comme « essentiels » a été largement étendue. La sortie du deuxième « confinement » s’est faite par phases jusqu’aux fêtes de fin d’année. Entre les deux « confinements » nationaux, des heures de couvre-feu ont été imposées pour limiter les déplacements non professionnels, d’abord à 20 h puis à 18 h au moment de la nouvelle hausse du nombre de cas à la mi-janvier 2021. Les activités sportives et périscolaires en intérieur étaient alors interdites. Des confinements locaux ont pu être imposés par les préfectures. La sortie du troisième « confinement » s’est également faite par étapes avec différentes heures de couvre-feu, jusqu’au 30 juin 2021, date de la levée de la quasi-totalité des restrictions de déplacement. Les jauges sont également levées pour les évènements de grande ampleur, alors que le pass sanitaire est introduit.
L’enquête
« Spatialité des violences conjugales & Covid-19 » : méthodes et études de cas
La recherche « Spatialité des violences conjugales & Covid-19 56 » dont nous présentons les résultats au sein de cet ouvrage s’est attelée à étudier les conséquences de ces politiques spatiales sur les violences conjugales pendant la période de mars 2020 à mars 2021. Elle repose sur trois types d’enquêtes : le recueil par entretien des récits des femmes vivant ou ayant vécu des situations de violence dans le couple 57, le recueil de l’expérience des professionnel·les les accompagnant – également par entretien 58 –, et la passation d’un questionnaire portant sur les conséquences de la crise sanitaire sur les mobilités des hommes et des femmes 59. Deux départements ont été choisis comme études de cas : la Haute-Garonne et l’Isère. Constitués de territoires variés mais comparables, avec une métropole centrale d’échelle nationale (Toulouse et Grenoble), des espaces périurbains conséquents, des espaces ruraux à la fois de plaine, de montagne et de piémont, ces deux départements sont tous les deux très dynamiques dans la prise en charge des violences conjugales, avec des histoires différentes cependant.
Nous avons commencé notre enquête en octobre 2020 en prenant contact auprès des acteurs 60 intervenant dans la prise en charge des violences conjugales, de façon à pouvoir solliciter, dans un deuxième temps et par leur intermédiaire, les victimes. Nous avons rencontré un total de 87 professionnel·les relevant de 56 associations ou institutions, parfois au cours d’entretiens collectifs. Les entretiens semi-directifs ont été réalisés suivant une grille qui portait sur les observations faites par les professionnel·les quant aux effets de la crise sanitaire sur les violences dans le couple en général, sur l’impact que la crise a eu sur l’exercice de leur profession (notamment en termes de changement de lieu de travail) et sur leur évaluation des politiques publiques mises en œuvre pendant la crise. Des entretiens ont parfois été réalisés auprès d’acteurs situés dans des territoires limitrophes des deux départements étudiés lorsque ceux-ci étaient susceptibles de recevoir des femmes de ces départements.
Dans un deuxième temps, nous avons effectué 25 entretiens auprès de femmes vivant ou ayant vécu des situations de violence conjugale (9 en Isère et 16 en Haute-Garonne). Ces entretiens ont eu lieu entre décembre 2020 et mars 2021. La plupart se sont déroulés en présentiel dans les locaux des associations. La grille d’entretien portait sur le vécu du confinement par les femmes vivant des situations de violence : les entretiens avaient pour objectif d’identifier l’impact de la violence sur les pratiques spatiales à l’intérieur et à l’extérieur du domicile, avant et pendant la crise sanitaire. En partant du contexte de la vie du couple en dehors de la crise sanitaire, les récits ont ensuite tracé l’évolution de la relation conjugale pendant la crise. Une grille spécifique permettait de recueillir le vécu des femmes séparées au moment du confinement.
Le troisième axe de la recherche a reposé sur une enquête quantitative visant à étudier l’impact du confinement sur la mobilité des femmes, en particulier de celles qui vivent une surveillance spatiale de la part de leur partenaire. Un peu plus de 3 000 personnes ont été interrogées par le bureau d’études Dynata, par Internet, selon un questionnaire construit par nous, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Pour pouvoir identifier des traits spécifiques de la mobilité des femmes, il nous fallait disposer d’une base de comparaison ; nous avons donc interrogé des hommes à hauteur de 35 %, pour 65 % de femmes donc. Après nettoyage de la base de données, le nombre d’individu·es s’élevait à 2 788.
*
Une des conclusions majeures de notre travail est que le bouleversement induit par la crise sanitaire n’a en fait pas modifié en nature les dynamiques à l’œuvre concernant la dimension spatiale des rapports de genre, des violences conjugales et de leur prise en charge. Mais il les a accentués, et en cela, il comporte une valeur heuristique – c’est-à-dire utile à la production de la connaissance – forte. L’étude des conséquences spatiales de la crise sanitaire et des mesures associées nous permet ainsi de mettre en évidence la dimension genrée des mobilités et la fragilité des tendances vers plus d’égalité dans ce domaine (chapitre 1). Elle met en évidence, en y faisant écho, les logiques spatiales des agresseurs relevant du contrôle spatial, mais aussi le fait que c’est leur mise à distance qui protège les victimes au moment de la séparation (chapitre 2). Elle a enfin révélé l’autonomie à double tranchant du travail social, avec des professionnel·les capables de maintenir un lien auprès des victimes malgré la mise à distance forcée, mais laissé·es très seul·es pour l’accompagnement des victimes une fois passée l’étape du signalement (chapitre 3).
1. Avec la complicité de Julie Bulteau, Pauline Delage et Eva San Martin. L’ensemble du texte de l’ouvrage a été relu par toutes et discuté collectivement. Esté R. Torres a été recruté·e au sein de l’équipe de recherche de janvier à août 2021 pour contribuer à l’étude statistique des mobilités.
2. Mariot et al. 2021.
3. L’usage du terme de victime pour désigner les personnes ayant vécu des situations de violence conjugale fait débat ; dans le monde anglophone on lui préfère par exemple le terme de survivant·e (survivor). Nous l’avons privilégié comme forme synthétique car nous l’avons pris dans son sens juridique de personne ayant subi un préjudice. Être victime ne signifie pas être passif·ve mais subir injustement les conséquences des agissements d’autrui. Dans la mesure où la très grande majorité des actes de violence conjugale sont commis par des hommes sur des femmes, et où cela concourt à la reconduction du rapport de domination patriarcal, nous parlerons par la suite des victimes au féminin et des auteurs de violence ou agresseurs au masculin.
Par « vulnérabilité », nous entendons la probabilité d’être touchée par un risque, ici celui des violences conjugales.
4. San Martin 2019.
5. Billon et al. 2020.
6. Stark 2007.
7. Claval 2015.
8. Blidon 2021.
9. Pain and Staeheli 2014 ; Schurr 2021.
10. Arendt 1972.
11. Ce qui correspond à la période où les violences conjugales commencent à être problématisées comme cause féministe et prises en charge par les militantes ; Delage 2017.
12. Hanmer 1977.
13. Delphy [1970] 1998 ; Wittig et al. 1970.
14. Le travail de care correspond au soin porté à ses proches : le fait d’être à leur écoute, de se préoccuper de leur bien-être, de penser aux choses ou aux dates qui sont importantes pour elles et eux, les aider à faire face à des difficultés, etc. Ce terme est utilisé pour indiquer qu’en plus des tâches généralement considérées comme du travail domestique (faire les courses, la cuisine, le ménage, etc.), un très grand nombre d’actes reviennent de manière disproportionnée aux femmes et renforcent leur charge mentale. Cf. également §1.1.2.
15. Guillaumin [1978] 2012.
16. Le chapitre du Code civil et la jurisprudence relatives aux « devoirs mutuels des époux » prévoient en effet que le divorce pour faute est possible en cas de refus répété d’avoir des relations sexuelles avec son époux·se, de refus de mettre en œuvre tous les moyens permettant la procréation et de refus de partager une résidence commune. En mars 2021, la justice française a en effet prononcé un divorce (entre une femme cisgenre et un homme cisgenre) pour faute aux torts exclusifs d’une femme de 66 ans victime de violences conjugales parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Cf. Turchi, Marine 2021. « Pour la justice, refuser des relations sexuelles à son mari est une faute », [en ligne] https://www.mediapart.fr/journal/france/170321/pour-la-justice-refuser-des-relations-sexuelles-son-mari-est-une-faute [consulté le 26 avril 2022].
17. Ibid. : 175-179.
18. Ibid. : 177.
19. Tabet [1979] 1998.
20. Ibid. : 11.
21. Verdier 1979.
22. Mathieu [1985] 2013.
23. Godelier 1978.
24. Mathieu [1985] 2013 : 197 ; souligné par l’autrice.
25. Ibid. : 136.
26. Clochec 2021.
27. Grunenwald 2021.
28. 23 personnes se sont déclarées femmes trans et 15 hommes trans (les quotas de sexe de l’enquête étaient déséquilibrés en faveur des femmes). Ce nombre s’est avéré trop faible au regard des 3 000 personnes interrogées pour donner lieu à un traitement statistique spécifique. Nous avons donc décidé d’inclure chacun·e dans le groupe revendiqué.
29. Kelly [1987] 2019.
30. Beauvoir 1970.
31. Dussy 2013.
32. Lieber 2008.
33. Ibid. 2008 : 60, à propos de Stanko 1987.
34. Stanko 1990.
35. Radford et Russel 1992
36. Lieber 2008 : 43.
37. Ibid. : 65.
38. Dworkin 1981.
39. MacKinnon 1982.
40. Lieber 2008 : 46.
41. Cardi et Pruvost 2012.
42. Ibid. : 57.
43. Mathieu [1985] 2013.
44. Hanisch 1970.
45. Collin 1994, traduite et citée par San Martin 2019 : 69.
46. Woolf [1929] 2001.
47. Debauche et al. 2017 : 32.
48. Bourdieu 2015.
49. Sauer [2002] 2020.
50. Weber 1959.
51. Sauer [2002] 2020.
52. Pour une synthèse, cf. Möser et Tillous (dir.) 2020.
53. Cf. Art. 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
54. Cet indice est calculé en fonction du nombre et de l’intensité des mesures de confinement et de restriction qui ont été mises en place par les différents gouvernements à travers la planète. Au 7 mai 2020, il était de 87,96 sur une échelle allant de 0 à 100, 100 étant le degré de réponse le plus strict. Pour plus d’informations concernant la construction de cet indice et le détail des mesures prises en compte par l’équipe de recherche, cf. [en ligne] https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker et Hale et al. 2021.
55. Nous parlerons dans la suite de ce texte de « confinement » seulement à propos du premier, considérant que l’emploi du terme par la suite par le gouvernement avait une fonction plus performative que descriptive.
56. Sélectionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre de l’appel à projets RA-COVID, il a été financé à titre principal par la Fondation de France (FdF).
57. Cf. détail méthodologique, grille d’entretien, liste et profil des personnes rencontrées dans les annexes 1 à 3.
58. Cf. détail méthodologique et liste des acteurs (au sens d’organismes) rencontrés dans les annexes 4 et 5.
59. Cf. détail méthodologique dans l’annexe 6.
60. Par « acteurs », nous entendons les organismes associatifs et institutionnels, raison pour laquelle nous l’écrivons et l’accordons seulement au masculin ; par « professionnel·les », nous voulons parler des personnes rencontrées, c’est pourquoi dans ce cas-là nous avons privilégié une formulation inclusive. »