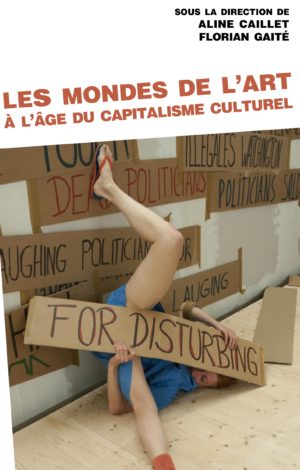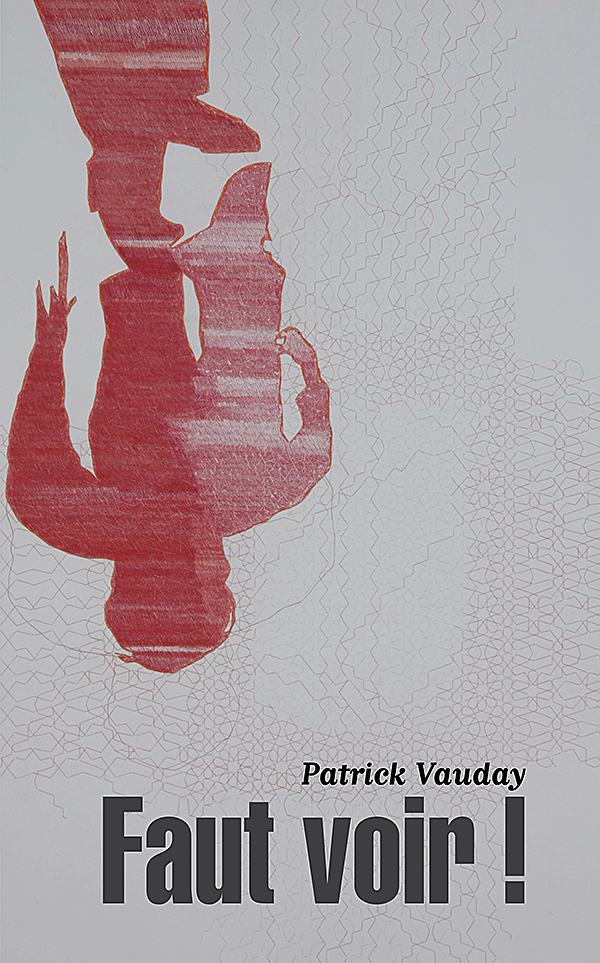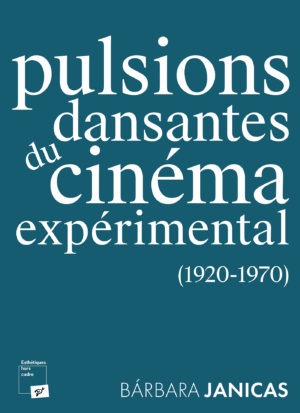Ce que les images montrent des images
Prologue
Bien des artistes et des œuvres ne se seraient jamais rencontrés sans la passion et la curiosité d’un collectionneur. La collection qui rassemble des œuvres au gré d’un goût singulier obéit peu ou prou à l’un ou l’autre de ces deux principes : la systématicité ou la disparité. Sous le premier principe, elle opère en fonction d’une règle explicite – artiste, école, style ou période – qui lui donne unité et identité. Sous le second principe, elle se constitue au cas par cas, non sans doute à l’aveugle mais sans fil directeur apparent, en quelque sorte par sauts et bifurcations, d’où un aspect plus disparate. Systématique, la collection pratique la variation sur un même thème en se fermant à tout ce qui déroge à son principe ; disparate, elle cultive la variété en s’ouvrant à l’avenant. Variété plutôt que variation ne veut pas dire pour autant arbitraire, seulement que l’unité se fait au fur et à mesure qu’elle se défait avec l’extension de la collection. À défaut de règle, son unité lui vient des affinités qui naissent du rassemblement même des œuvres et des circulations aléatoires qu’il favorise ; c’est qu’en effet les affinités ne sont pas de principe, par variation continue et réglée ou par dérivation, mais de rencontre, au coup par coup, sur le mode discret des résonances. Mais quel qu’en soit le principe, variation ou variété, la collection se traduit par une double opération dont la première consiste en sélection, puisqu’elle exclut, et la seconde en disposition où s’organise une circulation entre les œuvres retenues. D’où un changement de regard qui vient à s’exercer, en premier lieu, sur ces bords, à son envers en quelque sorte, en direction de ce qu’elle laisse hors de son champ mais qu’elle n’en éclaire pas moins autrement du seul fait de se constituer en point de vue, en second lieu, à son endroit, entre les œuvres qui d’être mises en vis-à-vis ou côte à côte se regardent et s’interrogent les unes les autres. Double regard de la collection qui fonctionne tantôt sur le principe du panorama, tantôt sur celui du diorama.
Si l’on veut bien admettre que ce qui vaut pour la collection puisse également valoir pour une esthétique soucieuse de penser avec les créations contemporaines, on aura un assez juste aperçu du mode de rassemblement des textes qui composent le présent recueil. Au lieu d’une série virtuellement close dans l’unité d’un concept, on y verra se former une constellation aux contours aussi mobiles qu’incertains ; chacune des œuvres qui la constituent y est mise sous tension d’un mot susceptible d’en éclairer l’opération selon le principe : une œuvre, un artiste, une notion. Autrement dit, une expérience sensible, la pointe d’un style et d’une pensée, des effets de sens, du suspens à sa prolifération.
Dans le désordre, on pourra lire des textes suscités par des œuvres aussi disparates quant au style et au médium que celles, parmi d’autres, de Sophie Ristelhueber, Claude Lévêque, Manoel de Oliveira, Tadashi Kawamata, Maria Bovo, Philippe Ramette, Claudio Parmeggiani, Michel Foucault et Jacques Tati, Abbas Kiarostami, Maurice Matieu, Ernesto Neto, Ange Leccia, et de quelques autres. De l’exploration des œuvres et des échos qu’elles se renvoient a progressivement émergé le concept le mieux à même de nommer la collection ouverte ainsi constituée, celui de contre-image.
Sous l’appellation générique de contre-image et à partir d’œuvres contemporaines (photographies, vidéos, installations, films, peintures), ce livre pluriel entend s’exposer à leurs puissances de contrariété pour en développer quelques avatars ; éloquence, ombre, trace, obscénité, spectre, projection, détail, déformation, exposition etc., en sont, entre autres, les noms d’usage et de circonstances. La prolifération des clichés faits pour rassurer et gratifier le regard au point d’en émousser la curiosité et la pointe critique suscitent des images contrariantes qui, à l’inverse, l’irritent, l’aiguisent ou le déplacent. Contrariété n’est pas exactement contradiction. Autant la seconde est franche et tranchante, en un mot frontale comme la négation, autant la première joue du détail qui cloche, de l’écart qui fausse la perspective, du trouble qui fausse la netteté. Force et forme d’opposition, la contradiction relève de la logique du langage et de l’idée tenant tête à une autre ; perturbation et insinuation, la contrariété est plutôt du registre de la psyché et le fait des images. Dans un cas, affrontement et rivalité entre thèses qui se nient, dans l’autre, destitution d’une prétention à la souveraineté dans l’aire du visible et du sensible, blow up, comme dans le film d’Antonioni, agrandissement et exagération du détail qui met l’image en abyme et en doute.
Une contre-image est encore une image. Freud le remarque dans L’Interprétation des rêves, les images n’en sont pas à une contradiction près puisqu’elles échappent, de nature, à cette logique élémentaire du langage, du moins du langage policé de la raison, qui exclut que deux propositions contraires puissent être vraies en même temps. Que l’image ne soit pas si regardante, Freud en veut pour preuve la fameuse École d’Athènes de Raphaël (1511) qui montre, réunies dans un même temps et dans le même espace monumental, les grandes figures dont l’humanisme renaissant se fait l’héritier, négligeant les différences d’époques et de lieux qui les séparent. À cette image transhistorique il y a d’autant moins à objecter qu’elle réussit l’admirable tour de force de rendre évidente à la vue et convaincante pour l’esprit l’invraisemblance même. Ignorant superbement le malaise archéologique qui, plus tard, saisira Freud devant les ruines de Rome, elle donne consistance visuelle à l’article de foi humaniste de la continuité d’une tradition intellectuelle. Inexacte, elle n’en est pas moins vraie. Rien à redire, rien à repeindre, le chef-d’œuvre se clôt sur lui-même non sans inclure dans un groupe situé à l’extrême droite de la fresque l’artiste lui-même prêtant ses traits à la figure d’Apelle et, détail qui a son importance, l’un des deux seuls personnages de cette illustre et nombreuse assemblée dont le regard s’échappe de la scène représentée pour aller à la rencontre du spectateur. La contre-image de cette scène magistrale où s’expose le programme intellectuel de la Renaissance n’existe sans doute pas mais il n’est pas impossible d’imaginer, sur le modèle des reprises d’œuvres anciennes par des artistes modernes, ce qu’elle pourrait être à partir de quelques détails susceptibles de la nourrir. Son contexte surtout, la Chambre de la Signature du Vatican où se tenait le tribunal du Saint-Siège avant de devenir le cabinet de travail et la bibliothèque du pape. L’annexion par la papauté de l’héritage grec ne va pas sans soulever quelques problèmes dont le moindre n’est pas la présence dans la fresque de Raphaël d’une figure discutée, celle du personnage vêtu d’une tunique blanche à gauche de Parménide, identifiée tantôt comme la philosophe néoplatonicienne et mathématicienne alexandrine Hypatie, lapidée à mort puis démembrée par des fanatiques chrétiens, tantôt comme Maria I della Rovere, duc d’Urbino, dont Raphaël a peint le portrait alors que le duc était âgé de 14 ans et présentait encore un visage quelque peu efféminé (Portrait du jeune homme à la pomme, 1504) contrastant avec le portrait beaucoup plus viril du condottiere en armure réalisé beaucoup tard par Titien (Francisco Maria della Rovere en armure, 1538). Une anecdote non prouvée veut que dans son esquisse du tableau Raphaël aurait d’abord représenté la figure d’Hypatie mais, après avoir été censurée par un cardinal parce que païenne et probablement aussi parce que martyrisée par l’Église, et par là même peu propice à la célébration des noces de la chrétienté et de l’humanisme, elle aurait été remplacée par la figure du condottiere qui en aurait gardé la trace dans ses traits efféminés. Or, comment ne pas être frappé du fait que cette figure troublante est celle qui, d’un même regard direct vers le spectateur, fait pendant à celle de Raphaël dans le rôle d’Apelle à droite de la fresque ? Si ces détails énigmatiques, comme absorbés ou effacés par la grandeur de la scène, ne contredisent pas à proprement parler le programme politique mûrement pensé et pesé que l’œuvre avait pour mission de rendre vraisemblable, ce sont néanmoins de petits accrocs dans la trame de la représentation par où s’instille le doute sur la consistance de la fable qu’elle figure, discrets témoins de ce qu’il faut oublier du christianisme pour croire à sa vocation humaniste. C’est, parmi d’autres, le genre de détail dont une contre-image trouve à s’animer.
Ce détour par quelques détails d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, loin de nous éloigner des œuvres contemporaines, nous y ramène au contraire et permet d’en préciser l’approche. Le choix des œuvres mises en constellation, plutôt qu’en série, dans les textes qui suivent s’explique en effet, en partie et pour partie d’entre elles, par leur mise en scène, explicite ou non, d’un détail singulier qui loin de contribuer à l’unité d’un récit ou d’une composition en fausse la perspective convenue ou attendue. Du détail soustrait à l’ensemble, d’une mise au point troublée ou d’une focalisation étrange naît une contrariété visible et/ou audible qui conduit à interroger ce que l’on voit et/ou entend. Aucune des œuvres présentées n’est équivalente à une autre, chacune est approchée dans son exemplarité et sous un angle particulier qui tente d’en enregistrer l’opération propre. Le nom commun et le titre associés à chacune d’entre elles n’entendent pas les définir et en finir avec elles, ils leur font écho et les prolongent. Il y a beaucoup moins d’images qu’on ne le dit généralement, mais du visuel sans aucun doute, si l’on veut bien admettre qu’une image est moins ce qui se voit et se reçoit passivement que ce qui fait voir au risque de décevoir. Une contre-image n’est rien d’autre finalement qu’une image qui pense.
Dans la circulation et l’entre-tissage permanents des images et des mots dont elle est partie prenante, la création artistique risque, au double sens du terme, une partition singulière qui consiste pour une part à faire trembler les lignes de partage de l’expérience sensible, les catégorisations paralysantes, l’articulation instituée des registres de l’affect, du percept et du concept, pour une autre part à faire voir et entendre d’autres accords et de nouveaux modes de composition. S’il est temps de faire le deuil de l’idée romantique d’une affectation, d’un rôle et d’une mission de l’art dans une perspective salvatrice, ce n’est pas que l’art soit mort et enterré et ne survivrait plus que dans les figures parodiques et spectrales du grand remake postmoderne, c’est tout au contraire qu’il trouve dans ce dés-assujettissement les circonstances et les risques de sa réinvention. C’est que sa ressource ne lui vient pas de ce qui est et de ce qu’il tient mais de ce qui est à venir imprévisiblement avec la nécessité de créer. Ici, comme toujours, la liberté épouse la nécessité : créer pour ne pas mourir, ne serait-ce que d’ennui, créer pour respirer. L’art ne naît que d’une impossibilité de vivre et qu’au risque d’un mourir. Il se tient sur la ligne de bord d’un effondrement et d’un vide créateur. Il tire sa force de sa faiblesse et de sa pauvreté en moyens d’inspiration. Dès qu’il ne s’agit plus de continuer mais d’interrompre une modalité d’existence exténuée, il ne sert à rien de faire avec ce qu’on a et il ne reste plus qu’à compter avec ce qu’on n’a pas et à occuper la place qui n’est pas la sienne, autrement dit à trouver autre chose et se déplacer.
Cette partition mobile de l’art, Kant a été le premier à la thématiser. Que dit-il en effet ? Que l’art ne nous réconcilie pas avec nous-mêmes et entre nous sans par ailleurs nous diviser. Le « chacun ses goûts et ses couleurs » n’a jamais dérangé personne puisqu’au contraire, c’est le principe de tout arrangement et de tout ordre qui met chacun à sa place dans un monde et une société bien ordonnés. Avoir des prétentions, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit avec le jugement esthétique kantien, prétention à juger librement et à la place de quiconque, sans titre ni qualité autres que celles d’un « sens commun » esthétique, n’est-ce pas d’emblée attenter à l’inégale égalité de tous les goûts qui veut que chacun ne juge bien qu’à sa place et dans sa sphère d’existence, le crapaud de sa crapaude, pour reprendre Voltaire, et le roi de sa reine ? Déranger l’ordre, sortir de sa sphère ou de sa condition, en jugeant publiquement de tout, loin d’arranger les choses produit au contraire le dissensus qui restait contenu par le « chacun chez soi ». La leçon de Kant est que l’égalité fait désordre dans la mesure où elle révèle qu’il n’y a pas d’autre critère de jugement en matière esthétique que l’exercice sans fin du jugement dans l’espace public ; à condition de rappeler que le public ne consiste pas dans le nombre mais dans l’égalité de toutes les voix et l’adresse au commun. Le jugement esthétique ne peut être que critique, au sens où il est toujours en discussion et en crise, et soumet le public à l’épreuve de sa propre division. Ce désordre qui déstabilise et brouille les places est révélateur et créateur : révélateur des hiérarchies discrètes qui fixent les frontières entre les genres, les pratiques et les normes socioculturelles, créateur de nouveaux modes de perception de l’espace, de nouveaux alliages sensibles et de nouvelles manières de penser le monde.
Avec la dimension spectaculaire qui est la sienne, le Festival de Cannes pousse jusqu’à la caricature cette partition de l’art en jouant régulièrement la scène du différend entre le public et la critique. Par sa fréquentation et ses modes de consommation privée (télévision, internet et DVD), le cinéma est de tous les arts indiscutablement le plus démocratique, et tout spectateur s’en prétend juge autant qu’un autre ou que le critique spécialisé. Cette division du sensible n’est pas un partage entre les « goûts et les couleurs » d’une masse ignorante et d’une élite éclairée, elle est à interpréter dans son effet qui est, à l’occasion d’un film-événement, de porter au cœur de l’espace public le dissensus qui le constitue. Les scandales de L’Avventura d’Antonioni ou de Sous le Soleil de Satan de Pialat n’auront fait que spectaculairement mettre au jour la séparation de la communauté d’avec elle-même.
Dans le milieu contemporain des images, la création artistique prend le caractère d’une intervention, au sens étymologique d’une venue ou survenue « entre », qui interrompt la continuité d’une séquence, d’une syntaxe apprise ou d’un phrasé solidifié par l’introduction d’un temps et d’un espace hétérogènes. Ce n’est pas une soudure ou une médiation réparatrice mais une coupure qui retourne une image ou un énoncé contre eux-mêmes, les détourne de leur signification et de leur fonction première ou les ajourne pour ouvrir un temps et un espace autres. La mise en abyme ironique du même par la répétition, le collage heurté des disparates, l’enrayement d’un processus habituel par l’intrusion d’un élément d’étrangeté, la distraction qui suspend le sens d’une scène, sont, parmi d’autres, autant de modalités de la coupure opérée par les arts. Sa valeur tient moins à sa nouveauté, toujours relative dans la mesure où elle prend son point de repère du passé, qu’à son déplacement sur un autre bord ouvrant à une expérience et à un point de vue différents. La différence joue moins par conséquent sur le versant temporel que spatial. Regarder d’ailleurs l’ici qui prescrit les formes de l’expérience et de la pensée revient à inclure l’ailleurs dans le champ d’attention qui l’excluait et en même temps à en reconfigurer la topographie et les limites. Si l’art n’a pas d’affectation, sauf d’époque et de circonstances, il n’est pas sans affect ; leur effet est de rendre sensible à l’insensible en dérangeant les formes et les arrangements convenus de la sensibilité. La division de la sensibilité par le sensible est l’opération propre de l’art.
Faut voir ! Ce n’est pas un commandement, pas davantage un impératif, c’est éventuellement une ironie moqueuse à l’encontre des trompe-l’œil, des fausses fenêtres et des pseudo-révélations, l’exercice salutaire d’une sagacité critique déjouant fausses prétentions et prises d’otage émotionnelle, mais c’est surtout à entendre comme un moment de suspens et une invite à douter, examiner, explorer ; bref, à aller y voir de plus près en s’exposant au travail et aux effets des œuvres.
Les textes qui suivent prennent le parti de ne montrer les images que par et dans les mots. Il ne s’agit pas, ce faisant, de traduction, moins encore de capture, mais d’une mise à l’épreuve du langage par les images qui l’impressionnent, le travaillent et le forcent hors de lui-même. L’écriture des images en vérifie en retour la fécondité.