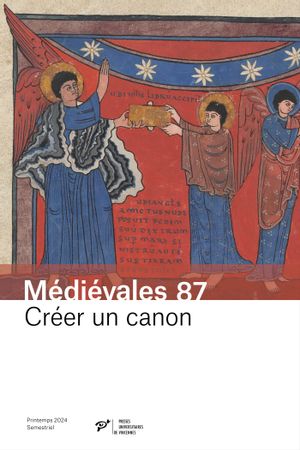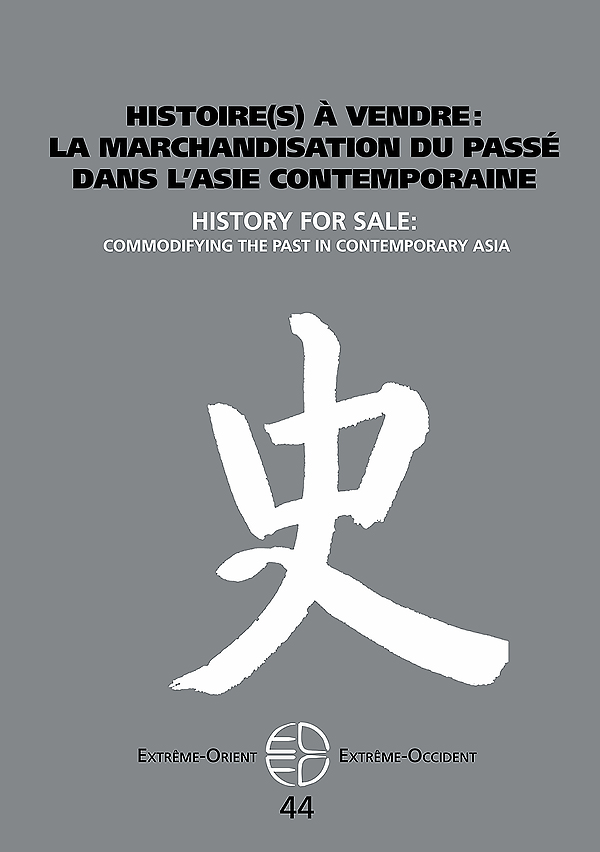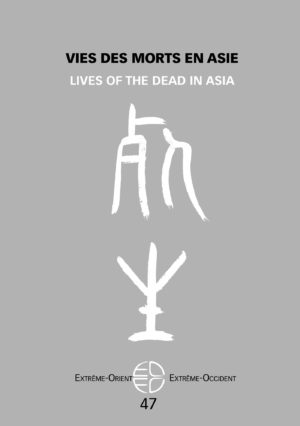Le passé à vendre : commercialiser l’histoire en Asie
Isabelle Charleux, Matthias Hayek et Pierre-Emmanuel Roux
Les exploitations commerciales de l’histoire et des patrimoines, souvent encouragées et promues par les États eux-mêmes, ont connu vers la fin du xxe siècle un essor remarquable en Asie de l’Est et en Asie intérieure. Elles touchent un grand nombre de domaines de l’économie qui sont souvent vitaux pour les pays concernés, tels le tourisme et les loisirs, et rejaillissent sur les musées et sites patrimoniaux, sans oublier l’architecture urbaine. Cette consumérisation du passé exploite la nostalgie, le sentiment de perte des repères et joue sur la fibre émotionnelle.
Les travaux récents sur la fabrique de l’histoire, les usages, mésusages et réappropriations du passé, en particulier par les nationalistes, ainsi que l’inflation de la patrimonialisation, sont pléthoriques pour ce qui concerne le monde occidental et les États post-soviétiques 1. Le passé est une ressource utilisable, une ressource politique d’abord, mais aussi potentiellement rentable dans le monde contemporain. De nombreux auteurs se sont penchés sur l’histoire comme objet de consommation et le marketing des musées, dénonçant fréquemment les « dérives » de la spectacularisation, la « disneylandisation » du patrimoine, les limites scientifiques, déontologiques et méthodologiques, ou encore les dangers des compromis 2. Mais peu de travaux ont encore porté sur ces questions en Asie à l’époque de l’hyperconsumérisme et de « l’économie de l’expérience 3 ». Ces dernières sont au croisement de plusieurs disciplines et thématiques à commencer par l’historiographie, la mémoire, le patrimoine, la muséologie, le tourisme et les loisirs, l’anthropologie, ainsi que l’économie et le marketing.
Malgré la grande diversité des pays d’Asie, on observe à la suite du monde occidental un fort développement de l’industrie des loisirs, conséquence de la globalisation, du libéralisme économique, de l’essor des classes moyennes et supérieures, et du développement du tourisme domestique. Alors même que le passé se fait de moins en moins visible dans les villes modernes, l’engouement pour sa redécouverte est une conséquence de « l’éclatement » de l’histoire, du phénomène mondial de patrimonialisation, de la médiatisation des découvertes archéologiques, ainsi que du nationalisme et de la recherche de ses racines. Les collusions entre l’économie et la culture, mais aussi le brouillage des frontières entre industrie culturelle et arts, ou encore entre musées et parcs d’attraction deviennent ainsi inévitables et invitent à explorer plusieurs lignes de réflexion. Quels sont le rôle et l’intérêt des États dans la promotion et la marchandisation de l’histoire ? Quels sont les acteurs et les médias de cette commercialisation ; qui vend l’histoire et qui en profite ? L’histoire est à vendre, l’histoire fait vendre, mais de quelle histoire parle-t-on ? Quelles sont les périodes de référence ? Les pays d’Asie orientale et intérieure se contentent-ils de suivre une tendance globale, ou ont-ils des modalités propres de commercialisation de l’histoire ?
Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles les contributeurs de ce numéro ont cherché à fournir des éléments de réponse. En guise d’introduction, nous aimerions proposer ici quelques formes de manipulation et de réécriture de l’histoire au xxe siècle, et rappeler les enjeux nationalistes de l’histoire et du patrimoine ayant suscité des débats passionnels et incité les États à les exploiter.
Histoire et constitution des États-nations aux xixe et xxe siècles
L’histoire est depuis deux millénaires un outil central de légitimation politique en Asie, comme en témoignent les nombreuses chroniques de facture gouvernementale et l’existence d’historiographes officiels. Mais les États sont loin d’avoir exercé un monopole sur l’histoire et l’exploitation du passé. Depuis de nombreux siècles, les tombes anciennes sont pillées à la recherche de trésors. Un marché des antiquités se développe également pour les collectionneurs et amateurs d’objets anciens, ainsi qu’un marché du faux 4. Dans le même temps, l’histoire ancienne écrite hors du cadre étatique offre différents usages. Elle sert notamment de paravent à une critique à peine voilée des élites régnantes, en permettant à des romanciers, dramaturges ou estampistes de mettre en scène des évènements du présent sous les oripeaux du passé.
L’histoire joue ensuite, à partir de la fin du xixe siècle, un rôle central dans la construction de l’État-nation, dont deux des symboles sont le musée et le monument historique : « Dès qu’elle prend conscience d’elle-même, une nation veut justifier son présent par son passé. Rien ne lui prouve mieux son existence que son histoire. En un sens, ce sont les historiens qui créent les nations 5 ». L’histoire permet de créer du « nous » pour s’opposer aux voisins, « eux ». Au Japon et en Chine, deux révolutions ont visé à moderniser le pays sur le modèle européen, éliminant la « culture traditionnelle » et réformant les religions : la restauration de Meiji (1868-1912) au Japon et l’établissement de la république en Chine (1912-1949). La « mise à distance du passé » s’est traduite par la promulgation de lois sur le patrimoine et la fondation de musées. Les premières lois de conservation du patrimoine, adoptées au Japon en 1911, évoluent vers la définition de « trésors nationaux » en 1929, et elles servent très rapidement de modèle en Chine et en Corée 6.
Mais les États-nations asiatiques du xxe siècle sont surtout passés maîtres dans la réécriture de l’histoire, voire dans sa manipulation pour les régimes autoritaires. L’histoire officielle doit coller à un schéma directeur de l’évolution sociale, impériale ou marxiste, et au principe de l’ethnogenèse. Il faut ainsi faire coïncider peuple et territoire, prouver que chaque peuple titulaire est présent sur son territoire actuel depuis des temps reculés voire mythiques. Étudier l’histoire sert les intérêts du présent, et l’archéologie contribue largement à la réécrire. Dans chaque État, l’archéologie doit en effet prouver l’origine de la nation, et les découvertes archéologiques participent à la démonstration de son ancienneté et finalement de sa grandeur 7.
La tout-patrimonialisation : protection et valorisation
De nouvelles lois de protection des biens culturels apparaissent en Asie de l’Est au milieu du xxe siècle, à commencer par le Japon dans les années 1950. Elles incluent des patrimoines matériels, tels que des objets, des livres anciens et autres documents folkloriques, et immatériels, comme des techniques de fabrication et de construction ou des modes de vie 8. Mais il faut attendre les années 1990-2000 pour que l’Asie connaisse plus généralement, comme l‘Occident, une « explosion du patrimoine » avec une « inflation et diversification à l’infini des types de patrimoine » 9. Cela se traduit notamment par la classification hiérarchisée du patrimoine matériel où les listes de villes et monuments célèbres ne cessent de s’allonger, l’émergence de nouveaux musées, la valorisation du patrimoine immatériel 10, tel que les « trésors vivants », et la course entre pays voisins pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de sites ou biens culturels.
Si la tout-patrimonialisation permet de faire ressortir la singularité et la richesse des cultures locales, elle ne va cependant pas sans critiques et difficultés, et l’alliance théoriquement vertueuse entre tourisme et patrimoine (suivant les recommandations de l’UNESCO) peut avoir des conséquences négatives. Des sites sont valorisés aux dépens de leur protection, et le patrimoine culturel est estimé non plus par rapport à son contenu mais à son potentiel économique 11. Le « discours sur le patrimoine » apparaît dans ce contexte comme un outil de gouvernance répondant à des contestations, des négociations et des appropriations locales 12. Le cadre législatif flou entourant l’inscription d’un monument sur une liste ou une autre ne garantit ni sa préservation ni sa transformation commerciale 13. Des voix s’élèvent ainsi contre la marchandisation du patrimoine matériel, notamment de la part des communautés locales, et le rôle des médias et des réseaux sociaux s’avère parfois crucial 14.
Soft power, tourisme et exportation de l’industrie culturelle
Depuis les trois dernières décennies du xxe siècle, et avec un décalage selon la situation économique et politique des différents États asiatiques, l’essor d’une classe moyenne et l’allongement des vacances permettent le développement spectaculaire du tourisme domestique, facilité par l’amélioration des voies de transport et l’accès à la voiture individuelle, ainsi que du tourisme à l’étranger 15. Les sites touristiques se multiplient, exploitant le tourisme historique, religieux, « ethnique » ou folklorique et naturel. Édifices anciens revalorisés, monuments et musées nouveaux à l’architecture évocatrice de l’identité locale deviennent des atouts majeurs du « province branding » ou « city branding ». Nombreuses sont également les collectivités territoriales et locales à mettre en avant un symbole ou une mascotte en lien plus ou moins étroit avec leur histoire.
Cette promotion de la culture et des traditions n’est pas exclusivement destinée aux consommateurs nationaux. Les industries culturelles cherchent à s’exporter et le patrimoine devient le moteur de la politique culturelle et économique. Il s’agit de donner une image de marque du pays (nation branding) qui séduise, et fasse rêver. Le nation branding et le city branding doivent, chacun à leur niveau, rendre un lieu plus identifiable et compétitif sur le marché mondial 16. La culture devient instrument de soft power aux quatre coins du globe avec des centres culturels et/ou des instituts de langue financés par l’argent public, des lois pour la promotion du tourisme ou encore des stratégies de développement économique tournées vers la culture et les arts. Cette diplomatie culturelle a des retombées considérables en termes d’exportation de produits de consommation et en nombre de touristes étrangers.
C’est donc avec un soutien étatique que, bien souvent, les industries culturelles et de loisir exploitent l’histoire comme une ressource. Produits hybrides du monde contemporain et des cultures locales, l’art, le cinéma et les séries télévisées, la littérature, la cuisine, la danse, la mode, la culture pop en général – mangas, jeux vidéo, musique (J-pop, K-pop, rock mongol), publicité, visuels d’emballage… – font référence à l’histoire et en proposent des lectures multiples. Des films et surtout des séries télévisées à thématique historique ou pseudo-historique sont exportés dans toute l’Asie voire au-delà. Des entreprises commerciales inventent une authenticité « marketable » en prenant les avantages du passé tout en conservant le confort de la période contemporaine. Les restaurants rétro sont à la mode, tels les bars de style « shōwa-retoro » au Japon, qui recréent de toutes pièces une ambiance puisant dans les codes culturels et alimentaires des années 1950-1970, ou encore les commerces et marques légendaires faisant revivre le Shanghai des années 1930. La marchandisation des « lieux saints », eux-mêmes en nombre croissant, est également de plus en plus visible. Si depuis longtemps les bâtiments latéraux des lieux de culte abritent des boutiques, aujourd’hui des boutiques d’antiquités se maquillent en temple sur les grands lieux de pèlerinages bouddhiques comme au Wutaishan (Chine). Le visiteur ne réalise où il se trouve que lorsqu’il voit des prix marqués sur les bouddhas qui trônent sur des autels. Le concept de « lieux saints » dépasse d’ailleurs le cadre religieux, puisqu’il s’applique aussi à des sites séculiers chargés d’histoire comme ceux de la révolution communiste en Chine ou de la résistance au Japon en Corée du Sud où les touristes abondent.
L’histoire se vend aussi dans les musées. Depuis les années 1990, le management muséal et les techniques marketing s’introduisent dans les musées les plus modernes d’Asie, qui suivent d’une dizaine d’années le tournant opéré en Occident 17. Par ailleurs, ces musées se « démocratisent » sous la forme de petits établissements, souvent privés, où la culture populaire s’introduit avec toutes sortes d’objets, d’histoires et de traditions locales 18. Les États préconisent l’utilisation de techniques modernes et poussent les musées à raisonner en termes d’attractivité, de rentabilité et de « museum branding 19 ». Les musées et leurs expositions tentent de séduire de nouveaux publics et deviennent interactifs et ludiques grâce à un équipement technologique multimédia de pointe (films, photographie, technologie digitale, cartes, dioramas, objets à toucher, effets spéciaux, hologrammes, etc.) et des reconstitutions totales ou partielles de bâtiments historiques. Le spectateur devient acteur, peut manipuler les objets, et des ateliers de fabrication d’objets sont organisés. Les matérialisations du passé font appel à tous les sens : la vue bien sûr, mais aussi l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher. Le temps accordé à la visite elle-même tend à se réduire par rapport à celui passé dans les espaces consacrés aux animations, mais aussi dans les boutiques vendant des produits dérivés et les cafétérias.
Si l’histoire se vend et fait vendre, c’est que sa mise en scène fait appel au registre de l’émotion, des affects, voire de la spiritualité et de la transformation de soi ; elle suscite la nostalgie pour un passé révolu, souvent fantasmé, et la quête d’authenticité. Des travaux récents ont enfin reconnu l’importance de l’affect et des émotions en tant qu’éléments constitutifs essentiels de la fabrique du patrimoine 20. On est passé, comme l’observait Daniel Fabre, d’un mode de l’avoir (le patrimoine, c’est à nous) à un mode de l’être (le patrimoine, c’est nous) 21. L’industrie des loisirs utilise « l’émotion patrimoniale » pour faire des profits, et les institutions culturelles à but non lucratif orientées vers l’éducation prennent de plus en plus en compte cette dimension émotionnelle : on visite pour ressentir, faire l’expérience, se sentir plus connecté à ses racines. La réalité augmentée, utilisée dans des jeux vidéo pour surimposer un cadre fictif à l’environnement réel, ainsi que les techniques immersives que l’on trouve dans certaines expositions ou des parcs à thème, exploitent toutes le concept postmoderne d’hyperréalité. Les consommateurs peuvent s’immerger dans une période historique spécifique, quoique bien souvent artificielle avec ses décors et ambiances reconstitués.
Quelle(s) période(s) de référence ?
Les périodes de référence de l’industrie des biens culturels varient pour des raisons multiples comme le rayonnement culturel ou politique d’anciennes dynasties, les effets de mode actuels, ainsi que le poids de l’archéologie et des médias. Les regards et partenariats extérieurs peuvent aussi influer sur les représentations du passé d’un pays 22. On observe tantôt la nostalgie pour un temps proche, connu, dont la mémoire est encore présente ou en passe de disparaître, tantôt la promotion d’un passé plus lointain, imaginé, fantasmé et malléable. Des périodes jadis mal-aimées voire haïes sont réhabilitées. C’est le cas, en Chine, de la dynastie mandchoue des Qing (1644-1911) et de l’époque des concessions étrangères – autrefois exemples humiliants d’impérialisme et aujourd’hui symboles de cosmopolitisme – à l’exemple du Shanghai des années 1930.
Mais quelle que soit la période de référence, l’histoire ne peut être vendue telle quelle. La philosophe Hannah Arendt soulignait déjà, au milieu du xxe siècle, que pour pouvoir être absorbée et recyclée par la société des loisirs, l’histoire devait être rendue facile à consommer 23. La culture passée nécessite un processus de décontextualisation et de recontextualisation : le spectateur s’identifie à un élément isolé et doté d’un nouveau cadre dans la société contemporaine 24. Au cours de ces différentes étapes, l’imaginaire d’une période est simplifié et idéalisé pour être rendu plus attractif et consensuel. On sélectionne les éléments susceptibles d’être marchandisés pour devenir des produits de consommation.
Même lorsque des historiens et archéologues conseillent voire travaillent pour des cinéastes afin de proposer des reconstitutions les plus proches possibles de la réalité, le résultat doit obéir à des objectifs économiques et, dans certains cas, politiques. Les inconnus, les lacunes et les incertitudes doivent être comblés. Les références historiques de différentes périodes et lieux peuvent être mélangées, jusqu’à un produit final truffé de contradictions et d’imprécisions. L’histoire telle qu’elle est médiatisée et commercialisée échappe finalement à l’historien.
Promenades aux marchés de l’histoire en Asie
Dans les pages qui suivent, les contributeurs de ce numéro d’Extrême-Orient, Extrême-Occident développent les différentes problématiques de la « mise en vente » de l’histoire à travers plusieurs approches illustrées d’exemples chinois, japonais et mongols.
Une première partie réunit trois articles qui explorent les usages commerciaux de la mémoire et du patrimoine en milieu urbain. Angel Pino et Isabelle Rabut se penchent tout d’abord sur le marché de la nostalgie en Chine contemporaine à travers deux types d’exemples : d’une part, la vogue de la mise en valeur de quartiers anciens à Pékin et Shanghai, d’autre part, celle des hôtels et restaurants à thème, notamment sur celui très sensible de la révolution culturelle. Cette balade historique s’accompagne de nombreuses références littéraires et nous rappelle chemin faisant que le passé chinois s’inscrit davantage dans les livres que dans les monuments sans cesse démolis.
Iwabuchi Reiji dresse ensuite l’historique d’une mode, apparue au Japon dès le début du xxe siècle, et qui occupe jusqu’à aujourd’hui une place essentielle dans les représentations médiatiques de l’histoire de l’archipel. Il s’agit de la (sur)valorisation de l’époque d’Edo (1603-1868), et en particulier de la ville éponyme, ancienne capitale shogunale, dont l’actuelle Tokyo conserve bien des traces. La simplification de cette période historique, qui tend à idéaliser certains aspects de la vie du peuple citadin, sert de support à la mise en place d’un « marketing national » depuis deux décennies. Iwabuchi souligne les aspects négatifs de la transformation du patrimoine culturel en ressource touristique et les contradictions et imprécisions du projet « Vision culturelle de Tokyo », mis en place pour les Jeux Olympiques initialement prévus en 2020. Il interroge ce faisant la position de l’historien face à la marchandisation de la culture promue par l’État.
Françoise Ged, après avoir dressé un historique des politiques patrimoniales urbaines en Chine, s’intéresse pour sa part aux stratégies de préservation ou de recréation du patrimoine par les collectivités locales chinoises, en lien avec le tourisme dans la région du Jiangnan (ou bas-Yangzi). Elle nous livre les résultats d’un partenariat de longue durée entre des institutions chinoises et françaises, au sein duquel elle a personnellement joué un rôle de première importance. Nous suivons avec elle l’élaboration des politiques en question, ponctuée d’interrogations des différents acteurs face à la marchandisation du patrimoine.
La seconde partie s’intéresse à la transition commerciale des usages de l’histoire dans les musées, et à l’utilisation de l’histoire pour construire une identité ethnique « consomma