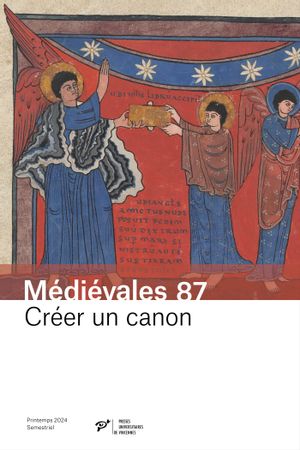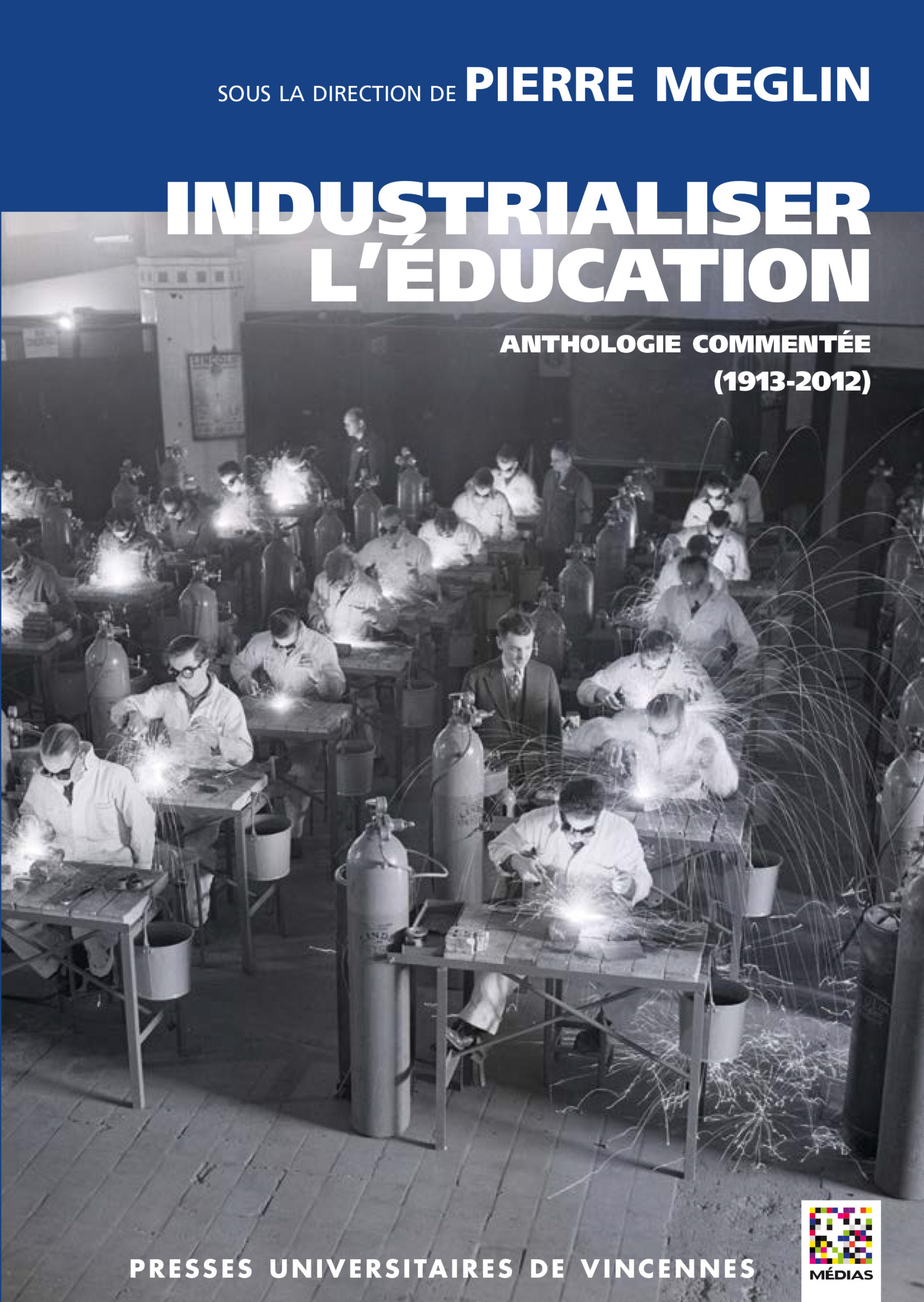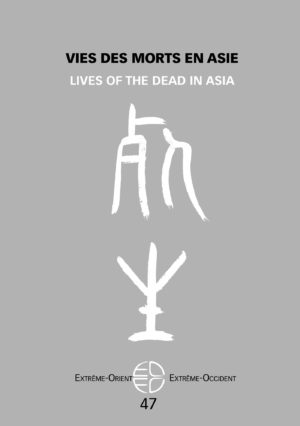introduction
La question de l’industrialisation
de l’éducation
Pierre Mœglin
À l’origine de cette anthologie, un constat : celui de l’ignorance de la question de l’industrialisation éducative par la plupart des spécialistes. Surprenante est en effet leur surprise lorsqu’ils découvrent que les termes « industrialisation » et « éducation » peuvent être accolés ! Plus surprenant encore serait leur étonnement de s’apercevoir que la formule « industrialisation de l’éducation » – qu’à tort ils tiennent pour un oxymore récent – se rencontre en fait, il y a plus de cent ans, sous la plume de penseurs comme J. F. Bobbitt* aux États-Unis et J. Wilbois* en France ! Qu’elle se retrouve également, à la même époque, chez un activiste comme H. S. Pritchett, président du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de 1900 à 1906 et, par ailleurs, président-fondateur de la National Society for the Promotion of Industrial Education, laquelle, à sa création à New York en 1906-1907, ouvre des bureaux dans trente-huit États de l’Union. Et que cette formule figure également dans un essai que publie en 1904 J. P. Monroe, chef d’entreprise, successeur de H. S. Pritchett à la tête de la National Society for the Promotion of Industrial Education et responsable de la Commission sur l’éducation de la Chambre de commerce de Boston. C’est d’ailleurs lui que l’historien R. E. Callahan qualifie d’« industrialist educator ». La formule n’est pas moins présente chez W. H. Allen, directeur du Bureau of Municipal Research de New York, dont un chapitre entier de son livre Efficient Democracy, paru en 1907, est consacré à la nécessité de recourir à des « educational engineers » pour réduire les coûts de fonctionnement des établissements d’enseignement et en calquer l’organisation sur celle des usines.
Ce n’est pas tout. Dès les dernières années du xixe siècle, la référence à l’industrialisation éducative fait également son apparition chez des sociologues tels que M. Weber en Allemagne et T. Veblen aux États-Unis. S’ils évoquent en effet le tournant industriel que connaît l’enseignement, c’est bien sûr parce qu’à l’université et dans les lycées sont mises à l’honneur des matières utiles à l’économie et à l’industrie. Mais c’est aussi et surtout parce que, pour reprendre une formule de T. Veblen, se fait jour « une certaine tendance à remplacer le prêtre par le capitaine d’industrie » à la tête des établissements et que, si partiel soit-il encore, commence à s’opérer le « remplacement de l’efficacité sacerdotale par l’efficacité pécuniaire ». De son côté, M. Weber observe que « pour le moment le travailleur de [sa] spécialité est encore dans une large mesure son propre maître à l’instar de l’artisan d’autrefois dans le cadre de son métier ». Mais, ajoute-t-il, « l’évolution se fait à grand pas », et l’université connaît une « évolution comme dans n’importe quelle entreprise ayant à la fois les caractères capitaliste et bureaucratique ».
Quel ne serait pas a fortiori l’étonnement des spécialistes s’ils venaient à apprendre que cette référence à l’industrialisation éducative est plus ancienne encore ! Et par exemple qu’en 1798, au début du Conflit des facultés, le philosophe E. Kant préconise déjà « de traiter l’ensemble tout entier du savoir (à proprement parler les cerveaux qui y contribuent) de façon pour ainsi dire industrielle [gleichsam fabrikenmäßig], par la division des travaux… ». Il s’agirait, selon Kant, de « recruter autant de maîtres publics, de professeurs qu’il y aurait de branches de la science […] et d’en faire les dépositaires de celle-ci, afin qu’ils forment collectivement quelque chose comme un État scientifique, appelé université (ou école supérieure) ».
Dans son commentaire de ce passage, le philosophe P. Macherey souligne que Kant propose en l’occurrence que l’enseignement « se consacre, avec un maximum d’efficacité, à la production et à la transmission des savoirs » ; il indique aussi que le « principe de la division rationnelle du travail dans l’industrie […] a en fait été théorisé quelques années auparavant par les philosophes écossais créateurs de l’économie politique ». Et ce, ajouterons-nous, quand bien même aucun de ces économistes, à commencer par A. Smith, n’envisage encore de soumettre l’éducation au principe de cette division rationnelle.
Maximum d’efficacité certes, mais aussi – et la précision est indispensable – maximum d’autonomie. Car le « savant corporatif » cher à Kant, censé n’obéir qu’à la Raison souveraine et être régi par ce que M. Freitag nomme « une normativité interne autonome », n’a de comptes à rendre à personne. P. Bourdieu explique d’ailleurs que la figure de ce savant autonome est « l’expression des intérêts sublimés de l’intelligentsia bourgeoise ». Le fait est qu’elle annonce le professeur de l’« Université inconditionnelle », tel que J. Derrida le pose en idéal, et qu’elle se situe donc aux antipodes de l’image de l’enseignant tout imprégné d’esprit d’entreprise que les industrialistes du début du xxe siècle appellent de leurs vœux.
Cette remarque importante ne permet pas seulement de relativiser l’industrialisme éducatif de Kant ; elle anticipe un point qui reviendra en leitmotiv tout au long de cet ouvrage : la référence à l’industrialisation désigne des réalités trop disparates et souvent trop contradictoires pour que l’on puisse se contenter d’en donner une définition unique. Autrement dit, pour que l’on puisse faire l’économie d’une analyse différenciée des acceptions qu’elle revêt en fonction des époques et selon les auteurs.
Commençons au préalable par écarter deux erreurs terminologiques courantes : la première, sur « université » ; la seconde, sur « industrie ».
Ce qui, après Kant, est nommé « université » correspond à un ensemble bien plus large que ce que lui-même désigne par ce vocable, à savoir les trois facultés supérieures de droit, de théologie et de médecine, ainsi que la faculté inférieure, qui regroupe les autres enseignements, dont celui de philosophie. De fait la définition de l’université qu’adopte le xixe siècle, telle qu’elle apparaît par exemple dans le décret de Napoléon de 1808 sur « l’organisation générale de l’université », recouvre l’ensemble de tous les ordres d’enseignement public (article 1), depuis les petites écoles jusqu’aux facultés (article 5). Il s’agit donc peu ou prou de ce qui est désigné dans les extraits ci-dessous, lesquels datent des xxe et xxie siècles, par des mots et expressions tels qu’« école », « enseignement », « appareil de formation », « éducation », « système éducatif ». Comme « université, ceux-ci désignent en fait la totalité des activités éducatives instituées.
Cette précision, indiquons-le dès maintenant, ne dispensera pas de marquer, chaque fois que nécessaire, les singularités propres au type et niveau d’enseignement du pays et de l’époque considérés. Comme cela se confirmera en effet plus bas, l’industrialisation dans laquelle l’université française s’engage aujourd’hui n’a pas grand chose à voir avec celle que connaît l’enseignement primaire et secondaire dans les années 1920 aux États-Unis. Et celle-ci n’a pas non plus grand chose à voir avec l’industiralisation de la formation professionnelle continue, telle qu’elle intervient avant et a fortiori après l’invention du e-learning, au cours des années 1990.
Quant au mot « industry », il s’agit d’un faux ami qui, en anglais, définit toute activité, industrielle ou non, de transformation de matières premières en produits finis. Ainsi par exemple quand, dans les extraits ci-dessous, P. H. Coombs* évoque l’éducation comme une « artisanal industry », ne veut-il aucunement associer deux termes incompatibles. Ce qu’il dit seulement, c’est que le système éducatif états-unien utilise, selon les termes qu’il emploie, des méthodes artisanales pour « transformer » de jeunes enfants en adultes. Quelques lignes plus bas, il exprime toutefois le vœu que ces méthodes artisanales cèdent la place à une industrie de l’enseignement. Cette fois, il parle d’« industry » au sens actuel d’industrie.
C’est ce sens qui fait son apparition en Allemagne et en France au milieu du xviiie siècle. Par exemple, c’est lui qui, chez Kant, qualifie les secteurs où prévalent les méthodes dites « industrielles ». Et c’est lui qui convient à l’organisation de l’éducation qui, plus tard, opèrera effectivement selon une certaine division scientifique du travail, une concentration des ressources et la production de prestations éducatives en série et à grande échelle. C’est également ce sens, élargi à toutes les formes d’industrialisation qui se rencontreront ci-dessous – archéo-taylorienne, taylorienne, néo-taylorienne, post-taylorienne, liée au « capitalisme financiarisé », « cognitif » ou « académique » –, qui sera attribué à l’expression « industrialisation éducative ».
Ces deux précisions terminologiques apportées, revenons au constat de départ : celui de l’oubli actuel des anciennes tendances industrielles en éducation, oubli lui-même assorti d’une surévaluation corrélative des tendances nouvelles. En découle a contrario l’objectif assigné à cette anthologie : penser la notion d’industrialisation éducative en vue d’en faire une catégorie de pensée. Autrement dit, examiner à quelles conditions et dans quelle mesure l’on peut conférer une valeur heuristique à cette notion, éventuellement l’ériger en un concept opératoire pour appréhender les évolutions et métamorphoses du système éducatif.
Pour ce faire, cette anthologie vise à identifier et étudier les temps forts de l’élaboration du paradigme industriel en éducation et de son déploiement en Amérique du Nord et en France plus particulièrement. Cinq d’entre eux retiendront notre attention : le temps des pionniers, favorables au taylorisme éducatif ; celui des critiques, pourfendeurs de l’industrialisme éducatif ; celui des ingénieurs, attachés à formuler des modalités industrielles adaptées aux spécificités éducatives ; celui des analyses, portant sur les enjeux de ce qu’il y a d’industriel dans les systèmes éducatifs ; enfin celui des renouvellements, quand ces systèmes se mettent à devenir des composantes de l’industrie du savoir et de la « Société de la connaissance ». Cependant, à travers la succession de ces temps forts – sur lesquels nous reviendrons plus bas –, il s’agira essentiellement de rendre sensible la dynamique de ce projet industriel éducatif sur le long terme, depuis ses premières formalisations, au début du xxe siècle, jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi voudrions-nous introduire le lecteur à une approche compréhensive et critique de ce que, dans de courts extraits choisis et commentés par nous, différents experts, penseurs et chercheurs ont écrit à différentes époques et dans différents contextes à propos des transformations ou tentatives de transformation industrielle du système éducatif. Par là, ce lecteur observera de quelle manière la référence à ce projet éducatif industriel se construit, circule et se renouvelle en permanence à la faveur de ce que l’on peut appeler une « histoire connectée » ou, mieux encore, une « genèse connectée », d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre.
Une entreprise si ambitieuse exigeait une démarche collective et interdisciplinaire. Le Séminaire Industrialisation de la Formation (Sif) s’y est prêté d’autant mieux que lui-même est le fruit et le vecteur d’une étroite collaboration entre des chercheurs qui se connaissent bien et depuis de nombreuses années, se réunissent régulièrement, appartiennent à des courants et à des disciplines différentes, mais ont l’habitude de travailler ensemble sur de mêmes objets et dans des perspectives convergentes. Cette anthologie vient d’ailleurs clore le cycle de travaux qu’ils ont ouvert au sein de ce Séminaire, il y a plus de vingt ans, et dont l’ouverture a été sanctionnée par la publication d’un ouvrage collectif. À ce premier ouvrage celui-ci fait donc en quelque sorte le pendant.
Celui de 1998 posait la question de l’utilité heuristique de la notion d’industrialisation appliquée à la formation. À l’époque, l’objectif était d’insister de manière extensive sur l’intérêt d’une notion à laquelle, dans leur immense majorité, chercheurs, experts et professionnels de l’éducation refusaient tout droit de cité. Aujourd’hui, la situation est, pour ainsi dire, inversée. De fait, l’importance de la notion est admise, du bout des lèvres et, plus souvent, avec un enthousiasme ou une aversion aussi excessifs l’un que l’autre. Le but de cette anthologie est donc d’écarter autant que possible généralisations abusives, approximations douteuses et acceptions erronées. Il s’agit par conséquent d’examiner de manière restrictive dans quelle mesure et à quelles conditions la référence industrielle peut être utile à la compréhension des mutations actuelles des régimes de savoir et de connaissance. Autrement dit, alors que, dans les années 1990, le propos était d’envisager tous les états de la notion d’industrialisation éducative et d’en identifier le plus grand nombre d’usages possibles, celui d’aujourd’hui est au contraire de cerner au plus près le périmètre de cette notion, de manière à en prévenir les utilisations inexactes ou simplement floues et métaphoriques.
Tel est le sens de la réflexion méthodologique et épistémologique qui s’engage ici et dont cette introduction s’attachera à retracer les prémisses. Divisée en deux volets, elle en présentera successivement principes et orientations. Pour ce faire, elle reconstituera rétrospectivement la cohérence d’une analyse dont, pour être conçues, élaborées et appliquées de manière efficace, les règles auront eu besoin du collectif formé par les vingt-deux chercheurs impliqués dans l’entreprise. Ainsi, espérons-le, cette introduction donnera-t-elle au lecteur les clés d’un projet dont, grâce à ce vade mecum, il pourra plus aisément suivre le déploiement de chapitre en chapitre.
Sous le titre « le poids des préjugés », le premier de ces deux volets passera en revue cinq idées faisant obstacle à une appréhension claire de la question de l’industrialisation éducative.
Ces idées couvrent le spectre qui se déploie à partir du postulat de l’incompatibilité a priori entre organisation industrielle et institution éducative, passe par la sous-évaluation systématique des réalités industrielles de l’éducation, inclut le refus de considérer ces réalités dans leur pluralité au nom de la représentation d’une industrialisation supposée s’imposer d’emblée sans rencontrer aucune résistance, avant d’aboutir au postulat (inverse du premier, mais tout aussi discutable) de l’inéluctabilité (souhaitée ou redoutée) d’une rupture industrielle radicale des manières d’enseigner, d’apprendre et d’organiser l’enseignement. Ainsi, depuis la croyance en l’impossibilité de toute industrialisation éducative jusqu’à la certitude de son omniprésence, cinq idées reçues – dont nous essaierons de montrer que ce sont cinq idées fausses – seront-elles successivement soumises au crible de la neutralité axiologique à laquelle les contributeurs de cette anthologie aspirent.
Consacré aux dispositions méthodologiques guidant la sélection et l’interprétation des vingt et un extraits retenus, le second volet de cette introduction (« les conditions d’une anthologie ») traitera du modus operandi.
Il y sera question de la grille de lecture à appliquer à ces extraits et des trois traits distinctifs (et interdépendants) du projet industriel éducatif sur lesquels ils mettent l’accent : technologisation, rationalisation, idéologisation. Évidemment, s’il fallait analyser les manifestations réelles de ce projet, ses applications in medias res et ne pas se contenter de ce que ces textes en disent, ces traits seraient probablement des marqueurs insuffisants ; il en faudrait d’autres, plus fins et opérationnels, rendant mieux compte des réalités industrielles et modalités pratiques propres à chaque situation. Cependant, l’analyse des faits réels n’est pas ici à l’ordre du jour. Pour prendre la mesure des points de vue en lice et de l’éventail qu’ils forment, les trois marqueurs mentionnés seront suffisants.
Éventail en effet, car il apparaîtra qu’aucun de ces extraits n’est à lui seul porteur de la totalité de la pensée industrielle de l’éducation : au mieux chacun en reflète-t-il un moment ou un mouvement. Pour autant, leur recueil ne vise ni la cohérence d’un corpus ni la linéarité – inévitablement artificielle – d’une histoire des idées sur la question des relations entre industrie et éducation. Il constitue encore moins un florilège de textes choisis pour leur qualité littéraire ou pour la réputation de leurs auteurs ; il ne propose pas davantage les résultats d’une enquête au sein de la communauté des penseurs, spécialistes et experts concernés, par exemple pour y suivre d’un point de vue sociologique la manière dont telle idée naît chez l’un, est reprise plus ou moins fidèlement par d’autres, et est finalement peu ou prou rejetée ou adoptée par tous.
Cet éventail déplié a un but différent : donner à voir la plus grande diversité possible des manières de penser l’industrialisation éducative. Plus exactement, la réunion de ces textes vise à sensibiliser le lecteur aux raisons pour lesquelles, en dépit des censures, anathèmes, exagérations et malentendus dont elle est victime de longue date, la référence industrielle refait régulièrement surface, chargée d’enjeux éducatifs et sociétaux renouvelés en permanence, mais conservant sur un siècle la même utilité pour aider à comprendre les mutations de la connaissance, de sa production et de sa transmission. Toute la difficulté est évidemment de savoir de quoi cette utilité est faite exactement.
Le poids des préjugés
L’ignorance des spécialistes n’est jamais plus flagrante que lorsqu’ils croient être les premiers à constater que l’éducation s’industrialise ou qu’elle est sur le point de le faire. N. Thrift, président et vice-chancelier de l’université britannique de Warwick, est de ceux-là lorsqu’il prédit que « quoi qu’il arrive, nous assisterons dans beaucoup de pays à une industrialisation de l’enseignement supérieur ». Il ajoute que « comme toute révolution industrielle, celle-ci aura ses bons et ses mauvais côtés, mais elle se produira. De cela je suis absolument sûr ».
Au moment où il écrit ces lignes, N. Thrift ignore très certainement qu’en 1963 – soit exactement cinquante ans avant lui – le président d’une autre université, plus prestigieuse encore, l’Université Berkeley en Californie, soutient déjà, en un ouvrage qui connaît un certain succès, que l’enseignement et la recherche relèvent de « l’industrie du savoir ». Et l’esprit industriel, ajoute le président C. Kerr, gagne si bien l’université que « celle-ci et certains secteurs de l’industrie se ressemblent de plus en plus. L’université se lie au monde du travail, et le professeur, au moins pour les sciences de la nature et quelques-unes des sciences sociales, prend le type de l’entrepreneur industriel ». Certes, la conjonction des deux univers ne va par de soi. De fait, comme le reconnaît C. Kerr : « l’industrie, avec les savants et techniciens qu’elle emploie, a dû s’initier laborieusement à la liberté universitaire » ; de son côté, l’université a dû « se mettre au service d’une croissance explosive des connaissances comme de sa population ». Mais l’industrialisation de l’enseignement est en route, conclut néanmoins C. Kerr.
L’amnésie d’aujourd’hui serait-elle due à la rareté et à l’inconsistance des tentatives du siècle précédent ? Et celles-ci seraient-elles trop anciennes pour que l’on s’en souvienne aujourd’hui ? Il faudrait pour cela que ces tentatives aient été négligeables et sans portée, ce dont font douter la profusion et la richesse des extraits ici réunis et celles des textes auxquels ces extraits renvoient et qui leur font cortège.
D’une part en effet, le renouvellement régulier, depuis un siècle, des travaux théoriques et jugements critiques sur ce projet industriel éducatif indique qu’il n’a rien perdu de son aptitude à susciter analyses, polémiques, controverses et débats. D’autre part, les pratiques et politiques éducatives actuelles, notamment celles marquées par le « pragmatisme social-libéral » de la Stratégie européenne de Lisbonne, en 2000, prolongent ces tentatives et, ce faisant, confirment a posteriori, s’il en est besoin, qu’elles n’ont pas été des coups pour rien. Quand bien même elles ne se sont pas toutes soldées par de francs succès.
Telle est donc, dans le monde des idées (et – insistons sur ce point – indépendamment du monde des faits), l’intention qui anime les auteurs de cet ouvrage : prendre au sérieux la question de l’industrialisation éducative, en suivre dans la durée l’élaboration à l’échelle internationale, les appropriations et formulations successives, en se gardant soigneusement de privilégier la dernière en date. Et, par là, démonter les préjugés qui en hypothèquent l’intelligibilité. Autrement dit, rompre avec l’enfermement amnésique dont, à l’instar de N. Thrift, nombre de spécialistes ignorants sont les victimes consentantes ou involontaires.
Incompatibilité ?
Le premier de ces préjugés est celui de l’incompatibilité des mondes respectifs de l’industrie et de l’école. L’économiste J. Gadrey* n’est pas le seul à se faire l’avocat de cette thèse de l’incompatibilité. Toutefois, l’opinion qu’il défend est l’une des plus radicales : l’éducation ne possèderait selon lui aucun des traits propres à un secteur industriel ou simplement industrialisable.
Les biens qu’elle produit (à supposer que l’on puisse parler de production) consisteraient en effet en des compétences acquises, des savoir-faire transmis, une culture partagée, une meilleure ouverture au monde. Mais ces biens ne sont ni tangibles ni, bien évidemment, produits en série. Par ailleurs, l’activité enseignante échappe aux principes de la division scientifique du travail, personne ne pouvant exiger des professeurs ou des élèves et étudiants une quelconque standardisation poussée des tâches, ni les astreindre à des contrôles menés par des « fonctionnels » spécialisés. Il ne serait pas davantage envisageable d’imposer aux établissements une logique de calcul et des critères de productivité afin d’augmenter la quantité en diminuant les coûts et en utilisant pour cela des systèmes automatisés permettant de remplacer les professeurs. Autant d’impossibilités conduisant P. Grevet – qui, plusieurs années durant, défend au sein du Sif des positions proches de celles de J. Gadrey* – à soutenir à son tour que de facto l’industrialisation de l’éducation est « impraticable ».
Sans anticiper la discussion des arguments de J. Gadrey* dans le chapitre qui lui sera consacré, l’on observera dès maintenant qu’en réalité, des modes de fonctionnement de type industriel sont d’ores et déjà, sinon appliqués, du moins proposés à (presque) tous les ordres d’enseignement. Et qu’à tout le moins, lois, textes réglementaires et consignes diverses poussent les universités, les lycées et, plus réc