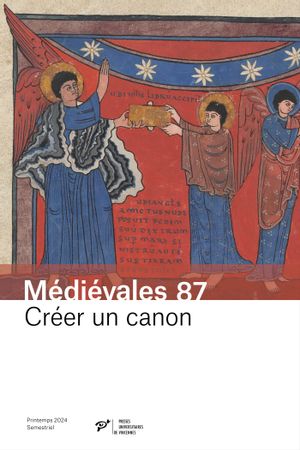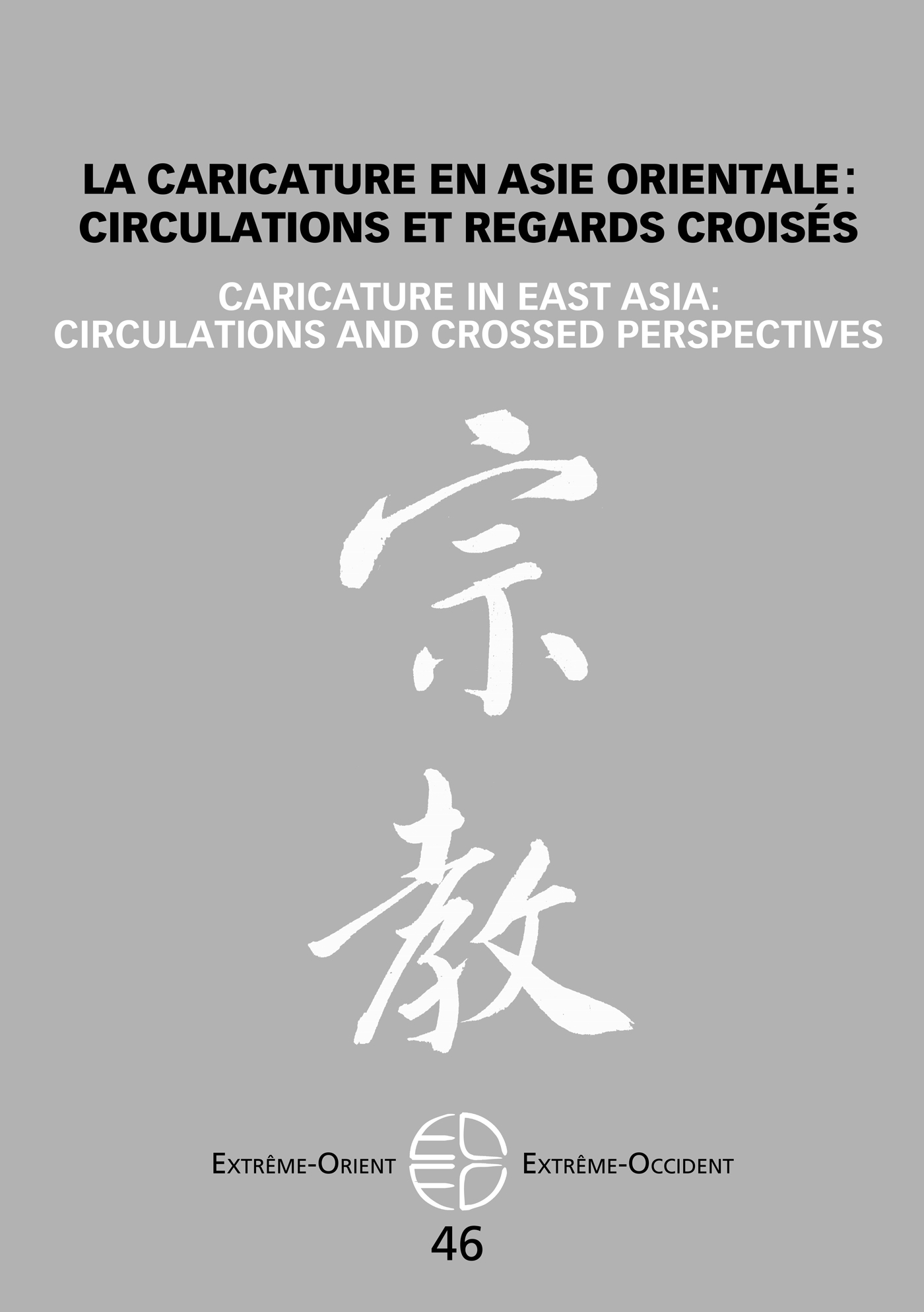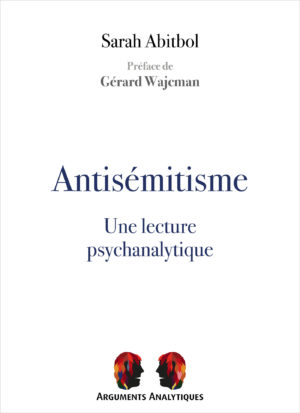Introduction
Identifier et interpréter la « caricature » en Asie de l’Est
Marie Laureillard et Laurent Baridon
Quiconque s’intéresse à l’histoire de la caricature affronte d’emblée des problèmes de définition. Il est particulièrement ardu de s’entendre sur ce mot, pourtant fort usité, mais la difficulté de l’entreprise s’accroît encore lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des territoires où il n’a été employé que récemment, l’Asie en l’occurrence. Pourtant, le mot « caricature » s’est défini au gré de sa diffusion, circulant en Europe, puis au-delà de ce continent, rencontrant et parfois fusionnant avec d’autres formes d’expression graphique. S’il est encore communément employé aujourd’hui, il ne correspond plus seulement à ce qu’il désignait lors de son apparition, en Italie, au début du xviie siècle. Une évocation de quelques aspects de cette histoire peut servir d’introduction à un propos sur la caricature en Asie de l’Est et aux problèmes définitionnels que pose une telle entreprise[1].
Le mot caricature apparaît dans l’entourage des frères Carrache à Bologne pour désigner un aspect spécifique de leur pratique : la recherche d’une perfetta difformità au moyen de ritrattini carichi (petits portraits chargés). Il s’agit de charges graphiques caractérisées par une déformation expressive du corps et notamment du visage. À l’origine, ce procédé graphique est pratiqué par des artistes comme un activité marginale ou un divertissement destiné aux initiés. Les feuilles des Carrache ou du Bernin en témoignent. Il faut signaler qu’il s’agit de dessins sur des feuilles volantes qui ne font pas à l’époque l’objet d’un grand intérêt de la part des publics et des amateurs. En 1665, le sculpteur et architecte italien Gian Lorenzo Bernini (dit Le Bernin) étonne les Français en leur faisant découvrir ce genre lors de son voyage en France, mais il est peu imité. Ces dessins ne sont d’ailleurs pas destinés à être diffusés au moyen d’une reproduction par la gravure. Ce n’est plus le cas au xviiie siècle. Les dessins de Pier Leone Ghezzi, qui s’est fait une spécialité de la caricature des artistes et des voyageurs, sont très recherchés. En Angleterre, William Hogarth reprend le mot « caricaturas » dans une gravure de 1743 qui montre une accumulation de visages chargés et quelques reprises de caricatures italiennes. Désormais gravés, les portraits chargés rencontrent alors une autre tradition, plus ancienne : celle de l’image satirique de propagande qui avait connu un fort développement dans le contexte de la Réforme et des guerres de religion au xvie siècle et une forte diffusion au moyen de la gravure. Portraits chargés et images satiriques fusionnent pour brocarder la société, les mœurs, les faits et les hommes de pouvoir. Une économie de la gravure à l’eau forte se met en place, avec d’étroites collaborations entre éditeurs et dessinateurs. L’estampe satirique et caricaturale conquiert un large public au-delà même des Îles britanniques[2]. Les codes visuels inventés en Angleterre par Hogarth, James Gillray ou Thomas Rowlandson sont repris par des dessinateurs continentaux et l’on en trouve la trace chez Jean-Jacques (J. J.) Grandville ou Honoré Daumier qui comptent parmi les premiers à fournir des compositions pour une nouvelle forme de diffusion : la presse illustrée. Le mot « caricature », qui sert de titre au journal satirique illustré le plus important du xixe siècle[3], s’impose dès lors durablement dans toute l’Europe, pour englober bientôt toutes les formes d’estampe satirique.
Les mots « caricature » et « caricaturiste » sont très employés en France jusqu’au début du xxiesiècle, mais ils tendent aujourd’hui à être remplacés par d’autres. Après les attentats contre Charlie Hebdo puis l’assassinat de Samuel Paty, la décision de créer une « Maison européenne (ou internationale) du dessin de presse et du dessin satirique » traduit par son intitulé le problème généré par le mot « caricature », alors que dans les années 2000 les « caricatures de Mahomet » étaient connues dans le monde entier sous ce terme. Les dessinateurs de presse étaient alors couramment nommés des caricaturistes. L’expression « dessinateurs de presse » devient elle-même caduque de nos jours, tant les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont diversifié les médias et les formes d’expression. Il faudrait en réalité parler d’« editorial cartoon », car il s’agit avant tout de dessins de presse, caricaturaux ou non. Cette appellation très générique, quoique moins fautive que celle de caricature, reste imprécise. Il faudrait sans doute utiliser des cadres encore plus larges pour espérer saisir l’ensemble du phénomène : satire graphique, ou même satire visuelle, pour prendre en compte toutes les pratiques qui se déploient sur internet. Le Prix Pulitzer a d’ailleurs créé une nouvelle catégorie, Illustrated Reporting and Commentary, distincte de celle qui existe depuis 1922 pour Editorial Cartooning.
En passant les limites de l’Europe, le risque est grand d’identifier les formes visuelles satiriques en plaquant les critères définitionnels de la caricature, de l’image satirique ou du dessin de presse[4]. Reconnaître l’existence même de la satire dans une image nécessite une grande culture de l’époque de création, une fine connaissance de son contexte, des formes de diffusion, des conditions de réception, des multiples niveaux de lecture, des contraintes de la censure, etc. Il ne suffit pas de comparer le trait et d’inférer d’une ressemblance formelle entre deux dessins produits en Europe et en Asie, un même processus de création, une même intentionnalité et une même agentivité. De surcroît, il existe dans les lexiques des langues d’Asie des termes qui posent des problèmes définitionnels comparables à ceux qui viennent d’être évoqués pour l’Europe, avec les mêmes caractéristiques de passage d’une langue à l’autre, d’une culture à une autre. C’est notamment le cas du terme japonais manga que l’on retrouve en chinois (manhua), en coréen (manhwa) et en vietnamien (biếm hoạ), tout en présentant des spécificités propres à chaque langue. Enfin, ultime difficulté, les études théoriques anciennes sont moins nombreuses qu’en Europe, ce qui rend difficile à ce stade l’écriture d’une historiographie sur le temps long.
Aperçu terminologique de la caricature en Asie de l’Est
Ce n’est que depuis un siècle et demi que les pays asiatiques ont pleinement pris conscience, sous l’influence occidentale, de la notion de caricature. Auparavant, en Chine, au Japon ou en Corée et au Vietnam, on peut repérer une forme de production qui pourrait s’apparenter de diverses manières à cette catégorie. On sait que la satire graphique repose sur certaines références culturelles ancrées dans un espace et une époque donnés. Ce qui paraît évident à certains peut échapper ou être mal interprété par d’autres faute d’en connaître les codes. Comment se caractérise-t-elle en Asie orientale ? Devons-nous retenir le critère d’une déformation expressive ? Ou plutôt celui d’une intention satirique ? En Chine, les histoires de la caricaturesemblent plutôt s’attacher à la seconde en l’identifiant dans des temps reculés, par exemple à l’époque des Han dans certains bas-reliefs funéraires du iie siècle où sont représentés des rois de l’Antiquité d’un point de vue manifestement critique. L’exagération du trait ne semble pas pouvoir constituer un critère pertinent à elle seule dans la mesure où la mimèsis ou souci de ressemblance n’a guère préoccupé les artistes chinois. On peut repérer plusieurs exemples à travers les siècles, notamment celui, dans une veine grotesque, d’une curieuse figure tricéphale sous les Ming (1368-1644) intitulée Yituan heqi (Unité et concorde, 1465), qui exprime l’espoir de l’auteur, l’empereur Xuanzong, de parvenir à l’harmonie et à la paix après la tyrannie de son père. Sous la dynastie mandchoue des Qing (1644-1911), la satire politique par le biais d’allusions ou de symboles se développe, comme avec les paons du peintre Zhu Da (1625-1705), critique voilée de la conduite immorale des fonctionnaires (dont la coiffe s’ornait de plumes de paon), ou encore les fantômes de Luo Liangfeng (1733-1799), qui singent le comportement peu recommandable des fonctionnaires avec une ironie que semble autoriser leur appartenance à l’au-delà[5].
Les animaux permettent aisément de parodier les attitudes humaines, comme on le voit sur une série d’estampes polychromes produites à Wuqiang (Hebei) à la fin du xixe siècle : des singes habillés en fonctionnaires brandissent des textes de lois qu’ils ne respectent pas eux-mêmes. Sur l’une d’elles, un singe habillé en haut fonctionnaire de la dynastie des Qing, pourvu d’une coiffe et d’un collier imposants, agitant un éventail, est transporté sur une perche de bambou en guise de chaise à porteur. Un singe lui ouvre la voie en jouant du gong et en tenant un étendard où on peut lire l’inscription « Interdit de fumer ». Un peu plus loin, dans la procession, on découvre un singe tenant une pipe à opium d’un air innocent et un autre un baldaquin évoquant un lit de fumeur d’opium : l’image moque ainsi le comportement laxiste et corrompu de l’administration mandchoue qui ne se soucie aucunement des règles qu’elle édicte en matière de consommation d’opium Ces bruyantes campagnes anti-opium des Qing ne sont rien d’autre qu’un spectacle de singes : la satire, audacieuse, vive et directe, peut être considérée comme une proto-caricature (fig. 1 et 2).
À partir de 1875 se développe le dessin de presse sous l’influence occidentale, avec la publication de journaux bénéficiant des nouvelles techniques d’impression lithographique. Si les caricatures ressemblent alors de plus en plus à leurs modèles européens, certaines d’entre elles revêtent un caractère local marqué, en particulier lorsque la figure est constituée de caractères chinois d’une manière qui pourrait évoquer les « images en écriture » (moji-e) japonais[6] (fig. 3), comme par exemple Protection et partage du pays par Ma Xingchi, caricature parue dans le Shenzhou ribao(1908). À gauche, on reconnaît un étranger, constitué des caractères 保護乎 (baohu hu,« protection »). À droite : un Chinois coiffé d’une calotte de fonctionnaire, avec les caractères 瓜分乎 (guafen hu, « partage du pays »). Il s’agit d’une dénonciation du discours hypocrite des puissances étrangères, qui, sous prétexte de protéger la Chine, cherchent à assurer leurs intérêts en divisant le territoire en diverses zones d’influence, que l’on ne peut comprendre que si on parvient à déchiffrer le message écrit et si l’on connaît le contexte géopolitique de l’époque.
La notion de caricature semble alors se préciser avec l’apparition d’une multiplicité de termes pour la désigner : fengci hua (image satirique), yuyi hua (image allégorique), fengyu hua (image allusive), shihua (image d’actualité), xiehua (image facétieuse), xiaohua (image pour rire) ou encore huaji hua (image burlesque). Mais c’est surtout le terme manhua qui est employé couramment à partir de 1925, en premier lieu à propos des dessins de Feng Zikai (1898-1975). Il se caractérise bientôt par une polysémie qui excède la seule notion de caricature en s’étendant à l’esquisse, au dessin de presse, et inclura plus tard celle de bande dessinée[7]. En Chine, le terme manhua serait apparu dès l’époque des Song (960-1279) sous la plume de Hong Mai (1123-1202) dans un sens bien différent, puisqu’il désigne alors un oiseau, la spatule blanche. Sous les Qing, ce mot ne renvoie pas encore à une catégorie de peinture, mais plutôt à une attitude à l’égard de celle-ci : il signifie en effet « peinture faite à sa guise » ou « peinture d’humeur » (on parlera aujourd’hui plutôt de suiyi hua). C’est notamment le cas sous le pinceau de Jin Nong (1687-1764) dont la peinture comporte une dimension satirique[8].Le terme manhua dans son sens actuel serait apparu dès 1904 dans l’expression « manhua d’actualité » (shishi manhua) pour désigner une rubrique de journal. Pourtant, du fait de la rareté de ce genre de dessins, cette appellation serait passée inaperçue et ne se serait répandue qu’avec les débuts de Feng Zikai : le trait minimaliste de ce dernier est parfois au service d’une intentionnalité satirique, même si la plupart de ses manhua en sont dépourvus et transmettent plutôt un état d’esprit ou une philosophie de vie. Dans le cas de ses créations plus orientées vers une critique sociale, il sera aisé d’interpréter la représentation d’un professeur dont la tête a été remplacée par un phonographe comme une pique contre le caractère répétitif de son enseignement. Un enfant encastré de force dans un moule suggèrera la contrainte et l’uniformité d’un enseignement de tradition confucéenne étouffant[9].
Dans son acception moderne, ce serait un néologisme emprunté au japonais au début du xxesiècle (les mêmes caractères se prononçant manga) : « L’appellation manhua est apparue pour la première fois au Japon. Elle a tout d’abord été utilisée à l’époque des Tokugawa (correspondant au début de la dynastie des Qing en Chine) par les huit grands maîtres de mangas, à commencer par Hokusai, qui lui auraient donné le sens de “peinture faite à sa guise”. Depuis lors, l’usage de ce mot s’est perpétué au Japon. On peut affirmer que son emploi s’est répandu en Chine sous l’influence japonaise », explique l’historien chinois Bi Keguan[10].
La question des premiers emplois du mot « manga » au Japon, et du sens qu’a progressivement pris ce terme pour en arriver à sa signification actuelle de « cartoon » ou de « bande-dessinée » est pourtant loin d’être simple. La combinaison des caractères « man (incontrôlé, insouciant etc.)» et « kaku/ga (écrit ou dessin)» se voit en effet employé à partir de la fin du xviiie siècle dans des contextes distincts. Suzuki Kankei (1713-1776) utilise ce composé dans la préface de son essai au fil du pinceau paru en 1771, Rōgai ichitoku (Un trésor sauvé des flots), mais il fait référence à un « oiseau qui parcourt les flots en attrapant inlassablement des petits poissons pour s’en nourrir »[11]. On y reconnaît la spatule blanche de Hong Mai, employée ici comme métaphore du savant insatiable, sans lien donc avec les images. À l’inverse, l’écrivain Santō Kyōden (1761-1816), dans son Jiji no yukikai (Croisements des quatre saisons) en 1798, fait usage du même composé pour parler des portraits des passants esquissés par un personnage installé dans boutique devant un carrefour. C’est ce même sens d’ « esquisse », de « dessin libre », voire de « caricature », qui se trouve appliqué comme titre d’un manuel de modèles de dessin de Hokusai à l’usage des apprentis peintres en 1814. La veine satirique du « manga » ne sera ceci dit pleinement exploitée qu’à partir de la fin du xixe siècle, avec l’apparition de la caricature et du dessin de presse en une page, notamment dans le journal Jijishinpō. Quant au manga comme bande-dessinée narrative, ce n’est finalement qu’à l’orée de la seconde guerre mondiale qu’il commencera à émerger, avant de s’imposer comme genre après la guerre.
On peut se demander si la solennité et la retenue confucéennes n’auraient pas freiné l’expression humoristique des arts graphiques en Chine, en Corée et au Vietnam, contrairement au Japon où elle semble s’être épanouie beaucoup plus librement, comme en témoigne le catalogue de l’exposition Warai : l’humour dans l’art japonais[12]. Il apparaît même que la déformation expressive a suscité un intérêt particulier au Japon. Ainsi, les auteurs des ouvrages Ukiyo-e Caricatures et Ōtsu-e : Imagerie populaire du Japon n’hésitent pas à qualifier les images populaires japonaises de « caricatures », dans la mesure où leur immédiateté et leur efficacité ne le cèdent en rien à celles de leurs homologues modernes [13]. Il est d’usage au Japon de faire remonter l’origine du genre au moins au fameux Rouleau des oiseaux et animaux (Chōjū giga) de Toba Sōjō (1053-1140), sur lequel sont figurés grenouilles, lapins, singes et renards dans ce qui apparaît comme une audacieuse description de la vie dissolue des religieux. Si les représentations animalières occupent une place importante au Japon, celles des êtres surnaturels et des figures religieuses permettent également de renverser les hiérarchies, de remettre en cause les conventions et de dénoncer le ridicule des comportements humains en contournant la censure. Parmi ses modèles japonais, Feng Zikai, bien informé de la situation artistique à l’étranger, cite notamment Sengai Gibon (1750-1837), séduit par les œuvres vives et dynamiques, le trait souple et spontané, la liberté créative de ce peintre à l’esprit facétieux qui prétendait ne suivre aucune règle. À travers l’excès et l’exubérance, Sengai cherchait en réalité à diffuser l’anticonformisme du zen : la combinaison d’un trait d’une concision presque désinvolte et du rire malicieux qu’il suscite font de cette peinture une caricature avant la lettre. La fascination de Feng Zikai pour les modèles japonais n’est guère étonnante lorsque l’on considère la profusion, la dérision et la virtuosité extraordinaire qui les caractérisent, dont un Kawanabe Kyōsai (1831-1889) est emblématique par son goût pour le carnavalesque et le grotesque[14]. Feng Zikai est également intrigué par les mangas composites (dits kakushi-e ou « double image ») d’Utagawa Kuniyoshi (v. 1797-1861), où les visages sont formés de plusieurs corps humains enchevêtrés à la Arcimboldo. Sa perspicacité le conduit même à s’intéresser à l’Ōtsu–e, estampe au dessin sommaire pourvue de couleurs simples à l’humour naïf qui connut une immense faveur au xixesiècle. Notons que les termes japonais désignant la caricature semblent pour quelques-uns d’entre eux plus anciens que celui de manga, ce qui est révélateur de la valeur qu’on accorde à cette notion au Japon : giga (« image drolatique », terme employé par exemple au sujet du Rouleau des oiseaux et des animaux), Toba-e (« image à la Toba [Sōjō]»), illustration comique comportant souvent des animaux anthropomorphisés), fūshi-ga (« image satirique », terme désignant généralement les estampes produites durant la deuxième moitié du xixe siècle), ou encore kyōga 狂画 (image fantasque).
La caricature à l’occidentale se répand en Asie de l’Est à partir de la fin du xixe siècle, notamment grâce aux avatars asiatiques de la revue britannique Punch. Loin de se réduire à une simple traduction, ces derniers, qui virent le jour vers 1860 et dont l’existence fut intrinsèquement liée à l’âge du colonialisme et de l’impérialisme, procèdent à une recontextualisation fondamentale de la forme graphique qu’elles empruntent à leur modèle européen. La satire met en lumière certaines asymétries, comme celle qui caractérise les relations entre colons et populations colonisées ou semi-colonisées. Ces versions asiatiques de Punch savent aussi bien railler la prétention des premiers que la veulerie des secondes, révélant le mélange de fascination et de répulsion que suscite en elles la culture des puissances dominantes. La satire offre également un espace d’expression face aux injustices ou aux aberrations qui affectent la société. C’est ainsi que tous ces périodiques intègrent les lecteurs d’un pays donné à une communauté internationale dont l’imaginaire est façonné par des codes journalistiques et des messages visuels homogènes d’un bout à l’autre de la planète. La culture de l’imprimé crée dès lors les conditions d’une « communauté imaginée », au sens où l’entend Benedict Anderson, ainsi que d’un imaginaire global, permettant un « cosmopolitanisme virtuel » et une « libre circulation des idées » entre centre et périphérie tout en transcendant les différences locales et régionales[15]. Pour prendre l’exemple de la Chine, le China Punch, publié en anglais à Hong Kong dès 1867, se voit complété à partir de 1918 par le Shanghai Puck à Shanghai, première revue satirique de langue chinoise. Si ce dernier connaît une existence éphémère et s’inspire en fait davantage de Punch que de la revue Puck, il contribue néanmoins à diffuser un vocabulaire visuel international tout en exprimant la frustration de la Chine et son rêve de revanche sur le plan géopolitique[16].
Toujours dans le contexte chinois, deux célèbres revues de caricatures des années 1930, Shanghai Sketch et Modern Sketch, témoignent d’une certaine évolution ou appropriation locale de la notion de caricature, désormais couramment désignée par le terme manhua, qui inclut ici satire sociale et politique. Les manhuas qui se déploient au fil des pages témoignent d’une étonnante créativité, empruntant leur vocabulaire visuel à des sources diverses, tout en recourant à une pluralité de médias : dessin, montage photographique, papier découpé, sculpture, combinaison de dessins et de photos, etc. Déformation graphique et satire apparaissent çà et là sans qu’il soit bien aisé de déterminer les frontières exactes de ce que nous nommerions « caricature » d’un point de vue occidental. Avec des procédés variés tels que l’exagération, le symbolisme, le comique de situation, au moyen d’une esthétique parfois inspirée du décadentisme européen, du cubisme, de l’Art déco et très marquée par l’influence de la presse anglo-saxonne, toutes ces caricatures tendent un miroir légèrement déformant à la classe moyenne urbaine, qui constitue le lectorat de ces revues. Épinglant un mode de vie tourné vers le plaisir et l’argent, elles brossent un portrait sans complaisance de la « modern girl », cette nouvelle jeune femme émancipée et séductrice qui apparaît comme une métaphore de la métropole, et du « modern boy », dandy lancé dans une quête éperdue d’amusements et de distractions. Non dépourvues d’humour, toutes ces caricatures moquent les habitudes nouvelles des Shanghaiens. Notons que cette caricature de mœurs connaît des équivalents en Corée, au Japon et au Vietnam à l’époque moderne et contemporaine[17].
Pendant la guerre sino-japonaise (1937-1945), les caricaturistes chinois fustigent pour la plupart l’ennemi à travers une caricature désormais politisée témoignant d’une pleine maîtrise des codes occidentaux[18]. Mais à partir de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, l’espace de liberté conquis à l’époque républicaine laisse la place à une expression beaucoup plus contrainte.
Le présent numéro cherche à prolonger ces quelques lignes de réflexion en offrant des clés de lecture indispensables à la compréhension d’images satiriques nées dans des contextes et des époques spécifiques. À partir d’un ensemble de sept articles sur la Chine, la Corée, le Japon et le Viet Nam, et abordant tant les périodes classique que moderne, il met en lumière les échanges qui ont pu avoir lieu au sein de l’Asie de l’Est ou à travers le monde, devenus de plus en plus évidents à partir du xixe siècle. Nous avons articulé l’ensemble en trois grands thématiques que sont l’iconographie satirique dans la peinture classique, puis le graphisme dans la mondialisation à l’œuvre depuis le xxe siècle, et enfin les modalités satiriques dans la culture de l’imprimé.
Interpréter l’iconographie satirique dans la peinture classique
Les représentations des aveugles produites en Chine pendant la dynastie des Qing, étudiées par Alice Bianchi, posent des problèmes d’identification du contenu satirique. Ces scènes de genre (fengsu hua) sont en principe rarement satiriques. Elles procurent d’ailleurs un évident plaisir esthétique lié à l’habileté de l’artiste à représenter visuellement la cécité par le traitement des yeux des personnages certes, mais surtout par les situations et les attitudes. Les aveugles sont traditionnellement considérés comme doués de facultés de perception supérieure. Les représenter dans des activités qui leur sont en principe interdites pourrait relever d’un discours valorisant. Mais la lecture satirique semble devoir être privilégiée : ces aveugles sont des métonymies visuelles parce qu’ils servent à moquer des personnes voyantes qui croient voir et savoir, mais qui n’en ont pas les capacités. La critique morale et sociale est corroborée par des références à des dictons, des jeux de mots ou des expressions transmises par des textes. Même si la clientèle de ce genre d’images n’est pas précisément connue, il est probable qu’elle appartenait à plusieurs catégories qui devaient trouver des interprétations différentes en fonction de leurs références culturelles et de leur culture visuelle.
L’étude du motif Tigre et pie dans la Corée de l’époque Chosŏn (1392-1897) par Okyang Chae-Duporge vérifie la difficulté de caractériser le contenu satirique, par nature instable et synthétique
[19]I. Elle permet également de saisir la complexité des transferts culturels, puisque ce motif trouve son origine en Chine, mais acquiert des significations complexes en Corée où il rencontre un grand succès au xviiie et xixe siècles. Culture savante et populaire se mêlent en effet dans la représentation du tigre, un des sujets de la peinture lettrée provenant de la Chine des Ming. Dans les représentations populaires coréennes, il se charge de vertus apotropaïques qui tiennent précisément au danger que cet animal représentait dans les campagnes. Mais associé à la pie, que le grand fauve n’est pas en mesure d’attraper, il acquiert une nouvelle signification, plus sociale. Le tigre devient probablement une représentation ironique de la classe dominante, impuissante et oisive, alors que la pie, oiseau inoffensif mais rusé, incarne les dominés. Comme dans la représentation des aveugles d’Alice Bianchi, les références littéraires sont nécessaires pour exhumer les significations attachées à ces animaux. En Corée, ce sont les contes qui évoquent un tigre, certes terrifiant intrinsèquement, mais rendu crédule et vaguement ridicule. L’aspect humoristique introduit vers la fin du Chosŏn a contribué à populariser ce thème au point de faire du tigre, domestiqué par la satire, un animal emblématique de la Corée.
Graphisme dans la mondialisation
À partir de l’incident diplomatique créé par des caricatures du Canard enchaîné sur l’attribution des Jeux olympiques au Japon, Tino Bruno met en évidence la récurrence du traitement du thème du nucléaire dans les grands quotidiens japonais depuis les années 1950. Contrairement à ce que les réactions aux dessins français pourraient laisser supposer, le sujet du nucléaire n’a pas été moins présent dans la presse au Japon qu’en France. Le traitement est également comparable, les événements servant de métaphores pour véhiculer des propos satiriques de nature politique. Le ton et la forme diffèrent cependant, ce qui est dû à la structuration particulière de la presse quotidienne japonaise et aux modes d’expression graphiques. Entre également en jeu une culture de l’humour qui porte moins atteinte au corps que dans la presse satirique européenne, ce qui est probablement dû, pour partie, au traumatisme des malformations génétiques liées à l’atome. Si la forme et le trait du dessin de presse sont comparables de manière générale, des différences culturelles se font ainsi sentir dans le traitement du sujet, qui devient dès lors un enjeu diplomatique.
En étudiant les personnages créés par Huang Yao et Yancong à un demi-siècle de distance, au milieu du xxe siècle et au début du xxie, Norbert Danysz interroge quant à lui un mode de figuration épuré, réduit à un cercle et quelques éléments au trait. Là encore, le rapport à la narration est essentiel, mais il s’inscrit cette fois davantage dans un processus de sémantisation du trait dû à la bande dessinée qu’à une relation aux sinogrammes. Le lien à la culture littéraire ancienne chinoise reste néanmoins prégnant chez Huang Yao dans les années 1930, même si le graphisme est renouvelé par l’apport d’une forme d’abstraction savante venue d’Europe, tout autant que par les comics américains. Produits culturels hybrides, les personnages simplifiés de Huang Yao et Yancong témoignent, avec des références différentes et de plus en plus mondialisées, de la complexité des circulations des références comme de leur capacité à ouvrir la voie à des formes satiriques et humoristiques novatrices et originales.
La production d’images de propagande au Viêt Nam relève d’autres circulations. Entre 1945 et la fin des années 1950, des affiches réalisées par les artistes de « l’Association Culturelle pour le Salut National » recourent à un mode caricatural pour représenter l’ennemi français. Les techniques graphiques et d’impression rappellent des traditions vernaculaires, mais le traitement caricatural renvoie lui à la presse satirique illustrée qui s’était développée dans l’entre-deux-guerres. Moqués et ridiculisés dans un premier temps, puis rendus diaboliques par leur monstruosité physique et morale, les colonisateurs voient ainsi retournée contre eux la caricature qu’ils avaient introduite. Elle disparaît peu à peu au profit d’une iconographie héroïque sous l’influence du réalisme socialiste, tant soviétique que chinois, à la fin des années 1950 dans le contexte de la guerre du Viêt Nam, reflétant la globalisation du conflit dans le contexte de la Guerre froide.
Modalités satiriques dans la culture de l’imprimé
Marianne Simon-Oikawa étudie deux albums illustrés parus en 1809 et 1878. Il s’agit de parodies d’une pièce de théâtre célèbre – Kanadehon Chūshingura (Le Trésor des vassaux fidèles) – dont le sujet est basé sur des faits réels remontant au début du xviiie siècle. La pièce, qui acquiert sa forme canonique dans les décennies suivantes, connaît rapidement un grand succès et est adaptée de nombreuses fois pour le kabuki et le théâtre de marionnettes. Mais elle fait également l’objet d’un grand nombre de parodies destinées à être jouées lors de banquets, par des comédiens ou par les convives eux-mêmes. En 1809, Santō Kyōden fait paraître un livre comique destiné à ces divertissements privés, avec des illustrations de Utagawa Toyokuni. La déformation des attitudes et l’outrance des expressions se conjuguent à des procédés destinés à animaliser les personnages au moyen d’accessoires ou par des jeux de mots visuels. Le traitement caricatural soutient l’esprit du texte, dont les images sont indissociables. Quand Kawanabe Kyōsai reprend ce sujet en 1869, sur un texte de Shinoda Senka, c’est pour réaliser des peintures puis un album comique très librement inspirés de celui de 1809. Mais surtout, il produit une œuvre qui atteste sa connaissance de la caricature occidentale avec laquelle il cherche visiblement à rivaliser au sein même de la tradition de la parodie et de la saynète humoristique jouée dans les banquets.
La représentation des enfants jouant, étudiée par Doreen Müller, est une autre tradition japonaise liée à l’estampe nishiki-e (« image de brocart »), c’est-à-dire la gravure polychrome faisant son apparition au milieu du xviiie siècle. Ce type de sujet devient un genre à part entière et jouit d’un grand succès populaire, par son caractère plaisant et attendrissant. Mais en 1868, la dernière année du shogunat des Tokugawa, ce type de scènes résonne de la situation politique à Edo (l’actuelle Tokyo) par un jeu de transposition et de remodelage (mitate). Même si la censure s’exerce alors avec moins de dureté, il faut de toute évidence beaucoup de patience et de sagacité pour identifier les personnages et les clans politiques au travers de la représentation des enfants, malgré certains indices de nature symbolique comme les motifs de kimono ou les jouets. Cela tient au fait que la physionomie des personnages politiques n’était pas connue des habitants, ce qui montre bien tout ce qui sépare la caricature politique occidentale de ce moment de la satire à Edo. Mais cela tient aussi au fait que ces estampes véhiculent une forme de proclamation d’une culture propre à Edo, attachée à des valeurs de paix et de prospérité inhérentes à ce type de scène. La connaissance de la caricature occidentale et sa diffusion par le Japan Punch notamment, a probablement imposé un type de satire qui nous est plus familier.
*
Pour clore ce volume, le « regard extérieur » de Philippe Kaenel ouvre un horizon de comparaison en montrant comment la caricature asiatique peut facilement désorienter le chercheur occidental. Il invite à réfléchir aux transferts ayant pu s’opérer depuis deux siècles entre nos deux mondes et aux dialogues qu’il serait fructueux de poursuivre afin de ne pas conclure, de manière caricaturale, à un simple modèle de la satire occidentale en Chine, en Corée, au Japon et au Viêt Nam.
Bibliographie
Baridon Laurent, Frédérique Desbuissons & Dominic Hardy (2019). L’Image railleuse : La satire visuelle du xviiie siècle à nos jours. Paris, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art.
Baridon Laurent & Martial Guédron (2021), L’art et l’histoire de la caricature. Paris, Éditions Citadelles & Mazenod.
Bevan Paul (2016). A Modern Miscellany: Shanghai Cartoon Artists, Shao Xunmei’s Circle and the Travels of Jack Chen, 1926–1938. Leiden, Brill.
Bi Keguan 畢克官(1982). Zhongguo manhua shihua 中國漫畫史話 (Récits historiques sur le manhua en Chine). Jinan, Shandong renmin chubanshe.
Bi Keguan 畢克官 & Huang, Yuanlin 黃遠林 (1986). Zhongguo manhua shi 中國漫畫史 (Histoire du manhua en Chine). Pékin, Wenhua yishu chubanshe.
Brandl Noriko & Sepp Linhart (2013). Ukiyo–e Caricatures. Leiden, Brill.
Crespi John A. (2020). Manhua Modernity: Chinese Culture and the Pictorial Turn. Berkeley, University of California Press.
Davis Jessica Milner & Jocelyn Chey (dir.) (2013), Humour in Chinese Life and Culture: Resistance and Control in Modern Times. Hong Kong, Hong Kong University Press.
Eco, Umberto & Bouzaher, Myriem (2016). Construire l’ennemi et autres écrits occasionnels. Paris, le Livre de poche.
Expressions of Humor in Chinese Painting and Calligraphy 書畫家的幽默感 (2017). Exposition au Musée national du Palais de Taiwan du 1er janvier au 25 mars 2017. URL : https://theme.npm.edu.tw/exh106/ExpressionsOfHumor/en/index.html (consulté le 7/07/2022)
Gan Xianfeng (2008). Zhongguo manhua shi中国漫画史 (Histoire du manhua en Chine). Jinan, Shandong huabao chubanshe.
Harder Hans & Barbara Mittler (2013). Asian Punches: A Transcultural Affair. Heidelberg & New York, Springer.
Laureillard Marie (2017). Feng Zikai, un caricaturiste lyrique : dialogue du mot et du trait. Paris, L’Harmattan.
Le Men Ségolène (dir.) (2011), L’Art de la caricature, Presses universitaires de Paris Nanterre.
Lent John A. (2015). Asian Comics. Jackson, University Press of Mississippi.
Lent John A. & Xu Ying (2017). Comics Art in China. Jackson, University Press of Mississippi.
Li Chan 李闡 (1978). Zhongguo manhua shi 中國漫畫史 (Histoire du manhua en Chine). Taipei: Shixi chubanshe.
Liu-Lengyel Hongying (1993). « Chinese Cartoons as Mass Communication: the History of Cartoon Development in China ». Thèse de Ph. D., Temple University.
Marquet Christophe & Kusunose Nichinen (2015), Ōtsu-e : imagerie populaire du Japon. Arles, Éditions Philippe Picquier.
Melot Michel (1975). L’œil qui rit. Le pouvoir comique des images. Fribourg, Office du Livre.
Oikawa Shigeru (2021). Le bestiaire extraordinaire de Kyōsai. Arles, Éditions Philippe Picquier.
Porterfield Todd (dir.) (2016). The Efflorescence of Caricature, 1759–1838. Londres, Routledge.
Renner Bernd (2006). “Difficile est saturam non scribere”. L’Herméneutique de la satire rabelaisienne, Genève, Librairie Droz (« Études rabelaisiennes », 45), p. 13-15.
Schaal Sandra (2020). « Amorce d’une anatomie d’une satire morale : la garçonne japonaise dans les caricatures de mœurs des années 1920 et 1930 », dans Loxias-Colloques, 16. Représentations littéraires et artistiques de la femme japonaise depuis le milieu du xixe siècle, 21 avril, URL : http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1549 (consulté le 7/07/2022).
Simon-Oikawa, Marianne (2007), « Écrire pour peindre : les moji-e de Hokusai et Hiroshige », dans Textuel : La lettre et l’image. Nouvelles approches, Anne-Marie Christin, Atsushi Miura (dir.), 54, p. 75-96.
Shimizu Isao 清水勲 (1991), Manga No Rekishi 漫画の歴史 (Histoire des mangas). Tokyo, Iwanami Shoten.
Tillier Bertrand (2021). Dérégler l’art moderne – de la caricature au caricatural, Paris, Éditions Hazan.
Yamashita Yūji, Yajima Arata & François Lachaud (2012). Warai : L’humour dans l’art japonais, de la préhistoire au xixe siècle. Paris : Maison de la culture du Japon.
Glossaire
Chōjū giga 鳥獣戯画
Chosŏn 朝鮮
Edo 江戸
Feng Zikai 豐子愷n
fengci hua 諷刺畫
fengsu hua 風俗畫
fengyu hua 諷喻畫
fūshi-ga 諷刺画
giga 戯画
Han 漢
Hong Mai 洪邁
huaji hua 滑稽畫
Huang Yao 黃堯
Jin Nong 金農
Jiji no yukikai 四時交加
Jiji shinpō 時事新報
Katsushika Hokusai 葛飾北斎
Kawanabe Kyōsai 河鍋暁斎
kyōga 狂画
Luo Liangfeng 羅兩峰
Ma Xingchi 馬星馳
manga 漫画
Mankaku zuihitsu 漫画隨筆
manhua 漫畫
Ming 明
Mitate 見立
Moji-e 文字絵
nishiki-e 錦絵
Qing 清
Rōgai ichitoku 撈海一得
Santō Kyōden 山東京伝
Sengai Gibon 仙厓義梵
shihua 時畫
shishi manhua 時事漫畫
Song 宋
suiyi hua 隨意畫
Suzuki Kankei 鈴木煥鄉
toba-e 鳥羽絵
Toba Sōjō 鳥羽僧正
Utagawa Toyokuni 歌川豊国
Wuqiang 武強
xiaohua 笑畫
xiehua 諧畫
Xuanzong 宣宗
Yancong 煙囪
Yituan heqi 一團和氣
yuyi hua 寓意畫
Zhu Da 朱耷
[1] Pour une approche générale de l’histoire de la caricature, voir Baridon & Guédron 2021.
[2] Porterfield 2016.
[3] La Caricature morale, religieuse, littéraire et scénique, entre 1830 et septembre 1832, devient La Caricature politique, morale, littéraire et scénique à partir du 4 octobre 1832.
[4] Voir le « Regard extérieur » de Philippe Kaenel à la fin de ce numéro.
[5] Bi & Huang 1986 : 1-7.
[6] Simon-Oikawa 2007 : 75-96.
[7] Sur le concept moderne de manhua, voir Crespi 2020.
[8] Liu-Lengyel 1993 : 56-58.
[9] Laureillard 2017 : 318-319.
[10] Bi 1982 : 44.
[11] Cette expression a finalement été utilisée comme titre de l’ouvrage dans des rééditions ultérieures, et c’est sous le titre Mankaku zuihitsu (Notes insatiables au fil du pinceau) qu’il est aujourd’hui plus connu.
[12] Yamashita et al. 2012. Voir aussi Expressions of Humor in Chinese Painting and Calligraphy2017.
[13] Brandl & Linhart 2013 et Marquet 2015.
[14] Oikawa 2021.
[15] Harder & Mittler 2013 : 424.
[16] Yamashita et al. 2012 : 381-382.
[17] Schaal 2020.
[18] Celle-là même que remarque un certain A.L. Bader en 1941, mentionné par Philippe Kaenel dans son « Regard extérieur ».
[19] Renner 2006 : 13-15.