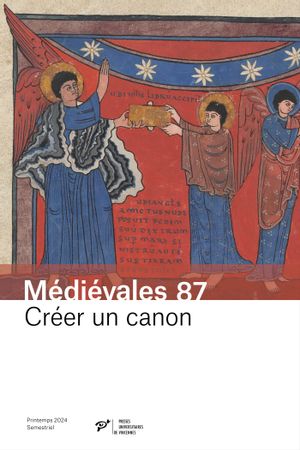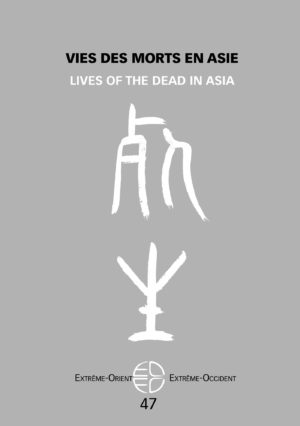L’« indiscipline » d’Arif Dirlik
David Bartel
Les textes présentés ici ont été sélectionnés avec leur auteur, Arif Dirlik, historien des idées devenu critique social. Le choix des textes retenus cherche à montrer la cohérence d’un parcours sinologique entamé dans les années 1970 sous la forme d’une archéologie des idéologies radicales qui, de l’anarchisme au marxisme sinisé, expose les logiques propres et les tensions paradoxales qui sous-tendent le développement intellectuel de la Chine au xxe siècle. En s’attachant de près aux fondements de l’historiographie chinoise contemporaine et à ses liens intimes avec la construction politique moderne, le sinologue américain d’origine turque laisse apparaître les spécificités de l’émergence en Chine d’un mouvement révolutionnaire dont l’orthodoxie idéologique et ses fluctuations ont été – et demeurent – un marqueur indélébile.
La fin de l’épisode révolutionnaire, que l’on peut faire correspondre à la mort de Mao Zedong, le 9 septembre 1976, marque une inflexion majeure de l’idéologie d’un Parti communiste chinois (PCC) qui doit réinventer sa propre grammaire intellectuelle pour que, comme l’écrit le regretté Roland Lew, « rien ne change », et surtout pas la mainmise du Parti sur le pouvoir et sur toute la structure institutionnelle de l’État. Avec une intelligence fine et parfois cynique, une capacité d’adaptation dynamique rare pour un appareil politico-bureaucratique d’une telle dimension et la menace toujours présente d’un usage brutal de la force, le Parti a su « coopter » les outillages intellectuels nouveaux à son avantage en détournant tout un ensemble de richesses théoriques et conceptuelles (hégémonie, identité, pouvoir, impérialisme) de leur définition originale, en les retournant vers l’usage unique d’un renouveau du discours nationaliste rendu nécessaire par l’abandon de la téléologie de la révolution.
Cette évolution du discours politico-idéologique s’est faite dans le contexte global d’une mondialisation des problématiques socioéconomiques (croissance des inégalités, crise environnementale et revendications légitimes des anciennes populations « subalternes » sur l’épistémologie et les « manières de savoir » autour d’une critique tous azimuts des Lumières européennes) et d’une normalisation générale du vocabulaire pour exprimer celles-ci. Elle est surtout alimentée par la tension normative de la mondialisation entre une ouverture économique et culturelle, et une fermeture paradoxale et parfois inquiétante sur un « roman national » nécessaire pour canaliser les énergies libérées par la disparition des idéologies révolutionnaires. En proposant une analyse extrêmement précise de ce tournant idéologique et intellectuel, Arif Dirlik nous offre des clefs indispensables pour entendre comment ces discours, articulés entre culpabilité coloniale occidentale et avidité des anciens pays du « Sud » à partager les bénéfices du développement, sans toutefois avoir à s’alourdir des pesanteurs démocratiques de la légitimité populaire, redéfinissent les contours des notions de progrès et de développement.
Ces considérations sur la reconfiguration d’une « modernité globale », au-delà de la rupture que représente l’année 1989 (répression de Tiananmen, fin du monde du « socialisme réel » et essor hégémonique conséquent du capitalisme global), permettent enfin de questionner à nouveau frais les vocables que les discours contemporains, et surtout la nouvelle doxa du management globalisé, tendent à faire passer pour apolitiques et non idéologiques. Au contraire, Arif Dirlik nous oblige à réentendre le « modèle » chinois, le « consensus » de Pékin, le renouveau confucéen ou l’essor de la « classe moyenne » dans les pays « émergents » comme autant de piliers idéologiques d’un discours dominant articulé : le développementalisme. Il ouvre ses analyses sur l’essor de ce discours au-delà de la république populaire de Chine (RPC), dans un vaste ensemble asiatique qui, mal défini, centré sur les succès économiques de la RPC, ne sait proposer rien d’autre qu’un développement dans le capitalisme où les méfaits – sociaux et écologiques – connus du développement ne seront soulagés que par davantage de développement. Comme s’il fallait, nous dit Dirlik, « boire du poison pour étancher sa soif ».
Ce parcours dans les idéologies, attaché à la réalité chinoise d’aujourd’hui, nous offre une forme d’anthropologie du contemporain qui permet de comprendre le glissement effectué par Arif Dirlik, historien des idées devenu critique social. Le constat de la grave situation en RPC et dans le monde, les promesses trahies – de la révolution d’abord, du développement ensuite – obligent à lire les textes les plus récents de l’auteur en partant du principe que désormais, ce qui arrive en RPC est une alarme qui nous concerne tous. Ce faisant, Arif Dirlik mondialise la problématique chinoise et invalide avec une force rare tant les discours sur l’« altérité » supposée des Chinois que ceux sur les « spécificités culturelles » du développement.
Avec une écriture serrée, théoriquement riche, et une argumentation qui trouve sa pertinence dans l’histoire, Arif Dirlik nous oblige à sortir de notre zone de confort en démontant les logiques idéologiques qui infusent les discours contemporains sur l’« essor » de la Chine. En sortant la RPC de la boîte sinologique où on l’y enferme parfois si complaisamment, il explose le cadre d’une réflexion habituellement enfermée sur la « chose chinoise » pour pointer les complicités du néolibéralisme mondialisé avec les catastrophes, sociales et écologiques, qui désormais touchent l’ensemble du monde tel que nous le connaissons. Dirlik dérange, mais permet d’être mieux armé pour répondre aux défis posés par la mondialisation de l’économie et des savoirs.
Une biographie politique
Né à Mersin en Turquie en 1940, Arif Dirlik grandit à Istanbul où il s’engage très tôt dans le syndicalisme étudiant. Au lycée, il organise des discussions sur Kemal Atatürk (1881-1938), la figure centrale de la modernité turque. Il publie des articles polémiques sur le sujet dans un pays, dit-il, où il est impossible – encore aujourd’hui – d’exprimer une perspective critique sur cette figure historique. Il quitte la Turquie en 1964, diplômé en ingénierie, avec une étiquette de « communiste » qu’il considère déjà être une preuve du primitivisme politique de son pays. S’il se considère « de gauche », il avoue n’avoir jamais eu de patience pour la pratique politicienne. Il n’a jamais été affilié à aucun parti ni à aucune organisation. Et même s’il cherche à relativiser son statut d’« exilé », d’« insoumis », ses rares contacts avec la Turquie restent problématiques. Produit et défenseur de la laïcité, il regrette le tournant droitier et la résurgence de la religion dans le domaine politique. Il critique aussi vertement l’incapacité du gouvernement turc et de la majorité de la population à admettre des épisodes peu glorieux du passé qui pourtant font intégralement partie de l’émergence de la Turquie moderne. Il reste persuadé que le courage d’affronter ces moments permettrait à la nation de s’ouvrir un avenir plus intelligent, plus démocratique et plus humain. Une analyse et une exigence qui à l’évidence résonnent pour d’autres pays.
Il arrive aux États-Unis en 1964 avec une bourse Fulbright. Après deux mois pourtant, il abandonne les études de sciences auxquelles il se destinait pour se tourner vers l’histoire de la Chine. L’université Rochester de New York ne possède pas encore à l’époque de département de chinois. Il y apprend l’histoire du Japon et de la Russie. Deux ans plus tard, il intègre la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Là, sous la houlette de l’historien Karl Wittfogel (1896-1986), il étudie le chinois avant de passer deux années à l’université de Taiwan au tournant des années 1970. Arif Dirlik se dit appartenir à la génération des années 1960. La guerre du Vietnam est à son apogée. Le mouvement pacifiste bouleverse les campus américains et chevauche le mouvement des droits civiques. Dans le même temps, les mouvements de libération nationale, partout dans le monde, font émerger la question du tiers-monde sur l’échiquier intellectuel international. Il obtient son doctorat en 1973. Sa thèse porte sur l’histoire de l’historiographie marxiste en Chine. Elle sera publiée en 1978 1. Il commence rapidement à enseigner à l’université de Duke où la violence des affrontements entre des factions politiques opposées lui fait comprendre l’inanité et le danger du dogmatisme idéologique.
En 1975, il participe à la création de la revue Modern China, dont le but est de donner la voix à une jeune génération de chercheurs qui ne peut plus se satisfaire de paradigmes sinologiques dont l’eurocentrisme marque l’obsolescence. Les travaux de Joseph Levenson (1920-1969), qui ont longuement imprégné les études chinoises modernes, sont leur première cible 2. Arif Dirlik voit dans la Révolution chinoise qui semble être en train de se dérouler une grande proximité – de situation et de problématique – avec d’autres pays du tiers-monde. Il se rend en république populaire de Chine pour la première fois en 1983, presque vingt ans après avoir entamé ses études chinoises, et cinq années après la publication de son ouvrage Revolution and History. C’est un moment, se souvient-il, où la Chine a encore un fort goût de socialisme. Les conférences qu’il donne alors sur le marxisme à l’université de Nankin sont critiquées comme « hétérodoxes » ou « révisionnistes ». Pourtant, il touche aussi des étudiants surpris et intéressés par ces perspectives nouvelles sur le marxisme.
Près de dix années plus tard, en 1993, c’est avec le politologue Yu Keping (俞可平 né en 1959) qu’il introduit le concept de globalisation (全球化 quanqiuhua) – déjà utilisé à Taiwan – à un auditoire continental 3. Il introduit aussi les concepts de « postsocialisme » et de « postrévolution », utiles aux historiens de la Chine dans leurs tentatives d’historiciser le présent chinois. Arif Dirlik est considéré comme un pionnier de l’arrivée dans les universités chinoises des discours postcoloniaux et du développement de ce que l’on nomme aujourd’hui les « postologies » (後學 houxue) 4. Son retour systématique à l’histoire et au présent de la Chine l’éloigne pourtant d’autres penseurs critiques en ce que son travail intellectuel tient fondamentalement à s’ancrer dans la réalité. « Je suis avant tout un sinologue (China scholar) » aime-t-il rappeler.
Avec le recul, on comprend qu’Arif Dirlik fait le choix de la Chine à un moment où se déploient dans le tiers-monde des questions d’impérialisme, de classes, d’inégalité, de développement, de patrimoine culturel et où se met en place plus généralement une réflexion sur la possibilité de créer une alternative au développement capitaliste, visage renouvelé d’une hégémonie culturelle qu’il qualifie d’« euromoderne ». En accordant une importance centrale aux circonstances spatiales et temporelles de production et de réception de nouvelles manières de penser, il est frappé par la similarité des problèmes qui touchent des pays très différents, mais pareillement positionnés dans la distribution globale du pouvoir. La question de la réception et de la domestication de corpus d’idées d’origines étrangères est centrale dans sa réflexion. La traduction de bagages conceptuels dans des contextes historiques et sociaux différents, en même temps que les défis qu’imposent les revendications alternatives au grand récit eurocentré de la modernité, courent en effet tout le xxe siècle. Pour lui, comprendre la Chine, c’est un moyen et un outil pour mieux saisir des questions théoriques d’importance universelle comme le nationalisme, les évolutions culturelles, la révolution et la démocratie, dans l’urgence déjà de remettre en cause la persistance d’un binarisme Chine/Occident qui – s’il ne dit rien en réalité – demeure stratégiquement encouragé comme instrument politique complaisant de légitimation polie des ignorances réciproques.
Mondialiser la Chine
Quand il quitte la Turquie pour rejoindre l’université américaine, la passion théorique d’Arif Dirlik est déjà posée. En passant des sciences naturelles à l’histoire intellectuelle son choix correspond, « par le plus grand des hasards » dit-il, au moment où se joue dans le monde universitaire une révision de l’histoire, fondée désormais sur la centralité de l’interprétation et sur l’exploration des concepts constitutifs de l’analyse historique, moment où l’histoire comme discipline, étude du passé, commence à sciemment interroger les modes de représentation et de compréhension du présent. Le passé, invariablement traduit pour répondre aux besoins et aux perceptions du présent devient alors, en soi, un sujet de recherche. Si Arif Dirlik est attentif aux fondements disciplinaires, il se méfie de l’enfermement qu’impose le compartimentage universitaire. Il se méfie encore plus des fourre-tout à la mode – transdisciplinaires ou pluridisciplinaires – et sans substance. Pour saisir les concepts qui fondent une discipline, il s’agit de les comprendre historiquement, en termes d’origines, de transformations et de conséquences, spatiales et temporelles. Pourtant, en tant que spécialiste des idéologies, son travail traverse par essence diverses disciplines : histoire intellectuelle et conceptuelle bien sûr, mais aussi sociologie, anthropologie, science politique, voire littérature.
Arif Dirlik a ainsi su inventer un style propre, une forme originale d’anthropologie contemporaine du monde dans laquelle les étiquettes politiques et méthodologiques restrictives qui lui sont parfois accolées passent à côté d’une œuvre qui supporte mal les stratégies académiques de confinement. C’est dans la perspective de cette « indiscipline » qu’il faut envisager la lecture d’Arif Dirlik et des textes réunis ici. En réaffirmant la réalité des liens existants entre réalité contemporaine et histoire moderne, il formalise à nouveau un espace politique essentiel enterré trop tôt par une globalisation capitaliste clamant l’apolitisme des « lois » de l’économie, défendu par le laïus convenu de la neutralité du marketing et de la consommation globalisée. Il (re) politise ainsi le contemporain en réinscrivant le présent dans son passé. En prenant la politique chinoise au mot, en la replaçant dans son histoire, il écoute – et prend au sérieux – la parole de ceux qu’il confronte et critique et qui sont trop souvent encore reçus avec une forme mal dissimulée de condescendance qui nuit à l’analyse. Ses travaux sur l’histoire du radicalisme en Chine ont été indispensables pour le guider dans l’exploration d’interrogations très contemporaines et lui ont permis de proposer une nouvelle interprétation – transnationale – de l’histoire et de la politique chinoise.
En effet, ses travaux sur l’introduction des idéologies radicales ont bouleversé le champ de l’histoire de la Chine moderne en montrant comment l’anarchisme avait précédé – et inspiré – le marxisme chez les radicaux chinois du début du xxe siècle 5. Ses travaux lui ont dans le même temps ouvert une fenêtre adaptée pour travailler théoriquement la signification des mouvements alternatifs radicaux visibles dès les années 1960, puis, avec la globalisation, depuis les années 1990. C’est là que se fonde aujourd’hui son intérêt pour les politiques locales de développement, alternatives concertées – et de plus en plus nombreuses – à la globalisation capitaliste.
Ainsi, dès le départ, « mondialiser la Chine » c’est briser les frontières culturelles et conceptuelles pour congédier l’exceptionnalisme chinois, précondition indispensable à toute tentative sérieuse pour historiciser la Chine, plutôt que de l’emballer du doux cocon des spécificités culturelles. Cet apport de la perspective historique de l’expérience chinoise prend un sens renouvelé à l’heure de l’abandon des promesses sociales portées par la révolution. Première puissance économique mondiale depuis peu, la République populaire nous oblige à envisager à nouveaux frais le sérieux et l’importance des défis lancés par d’autres systèmes de connaissance à l’organisation des savoirs qu’impose une euromodernité symbolisée par des Lumières désormais envisagées comme savoir hégémonique louant un universel univoque, imposé, conquérant et au final assez peu scrupuleux. La visibilité nouvelle qu’autorise à la Chine ce nouveau statut économique offre en passant une autorité renouvelée à des systèmes de savoir jusque-là bannis comme aberrants ou arriérés, et le retour de Confucius sur le devant de la scène intellectuelle chinoise est un événement majeur – et ambivalent – d’une modernité chinoise désormais autochtone dont la redéfinition du sens implique cependant une révision historique générale de l’histoire chinoise du xxe siècle. Un effort conceptuel et sémantique difficile qui égratigne nécessairement une orthodoxie historienne encore très susceptible. La révolution avait « rangé Confucius au musée », où il n’existait plus que comme « attachement sentimental », disait Karl Marx. Son retour en grâce est un préjudice majeur à l’historiographie officielle de la révolution victorieuse et ne va pas sans poser d’insolubles casse-têtes jusque dans les plus hautes sphères dirigeantes. En même temps, l’importance de la formulation de ces défis à l’eurocentrisme – dont le retour du passé est un trait distinctif – est pour Arif Dirlik une marque évidente et constitutive de notre temps. C’est un phénomène central et partagé de ce qu’il définit comme la « modernité globale ».
Histoire, discours, globalité
Les textes réunis ici racontent cette histoire, celle du triomphe du moderne en Chine, sous la forme de l’importation du socialisme et de l’idée de révolution sociale. L’immense changement, et les immenses espoirs que les idéologies radicales ont suscités dans le pays au début du xxe siècle, leur adaptation à des réalités complexes et changeantes forment la première partie de l’ouvrage. Les textes réunis ici dessinent le cadre de la réflexion, ils détaillent le parcours de ces idées radicales en Chine – leur origine, leur victoire, leur détournement – jusqu’à nos jours. Les succès politiques du marxisme sont en partie dus à l’introduction d’une révolution historiographique sans précédent. En introduisant une histoire sociale, une histoire du peuple, l’historiographie marxiste réinvente l’histoire de Chine et modifie le cours des événements en inversant les polarités d’un « régime d’historicité » jusque-là fondé sur un âge d’or révolu 6. L’historiographie marxiste joue un rôle clef dans l’invention d’un premier « roman national », réponse à la crise de la Révolution républicaine de 1911 et à l’échec manifeste des tentatives de transition politique de l’Empire à la République. Un échec que figure politiquement l’abandon du pays à la soldatesque des « seigneurs de la guerre » après 1917, et intellectuellement par le premier sursaut nationaliste articulé et conscient du 4 mai 1919, point d’orgue du Mouvement pour la nouvelle culture et du phénomène culturel plus large des Lumières chinoises 7. Pour Arif Dirlik, le marxisme est une réponse à cette faillite de la Révolution de 1911 à renouveler la grammaire du politique et une réponse à l’immense crise de représentation que les Chinois se font à partir de là de leur propre culture.
On peut penser la Révolution chinoise comme une multiplicité de révolutions – sociale, culturelle, politique, intellectuelle, générationnelle, féministe, paysanne, subalterne – subsumées par la définition unique qu’en donne le parti communiste, après l’échec du parti nationaliste (Guomindang). Le détournement de l’effort sincère pour reconstruire la Chine selon les indications du marxisme, et la mise en place par le Parti communiste d’une orthodoxie restreignant la théorie en étouffant la vie intellectuelle, racontent le fourvoiement des promesses sociales de la révolution, jusqu’au retournement ironique contemporain qui progressivement a réinventé une tradition – le confucianisme – pour en faire désormais le moteur d’une « renaissance » chinoise dont les termes restent à discuter. L’abandon de la téléologie de la révolution et l’adoption subséquente d’un discours développementaliste résolu ont eu un impact majeur, tant sur l’image que la Chine a d’elle-même, que sur les représentations historiques que s’en font les historiens de la Chine.
Là se trouve le fil directeur de cet ensemble d’essais. L’intensification du trafic intellectuel entre la Chine et le monde permet en effet l’intégration progressive des intellectuels chinois sur un échiquier mondial de la pensée où désormais les différends se formulent dans un champ discursif commun. L’histoire de l’arrivée à maturité en Chine des discours théoriques qui ont accompagné le retournement unique de la relation de la Chine à son passé et au monde met en lumière la façon dont les délicatesses des discours du postmodernisme (théorique, esthétique, littéraire…) – et de son rameau postcolonial – ont réussi à se faire adopter par le discours officiel pour ranimer une litanie nationaliste officielle grégaire et assez peu stimulante, instaurée en dernier rempart de l’idéologie. Un sursaut nationaliste qui se distingue du nationalisme communiste des années révolutionnaires en ce qu’il est désormais débarrassé des préoccupations sociales. Cette intégration théorique semble cependant être bien incapable de restituer les possibilités de résistances nouvelles qu’offrent les méthodes de déconstruction des discours du pouvoir pour être utilisée dans le but unique de s’opposer à un « Occident » perçu toujours comme hégémonique. En permettant de dépasser le simple appel à l’émotion populiste du discours patriotique, le vocabulaire postcolonial profite ainsi à la rhétorique officielle. Un glissement sémantique qui avalise le mélange du politique et du culturel par l’utilisation de concepts postcoloniaux dans un sens contraire à leur usage.
Une évolution discursive fondamentale pour comprendre comment s’est brisé l’unanimisme des Lumières chinois