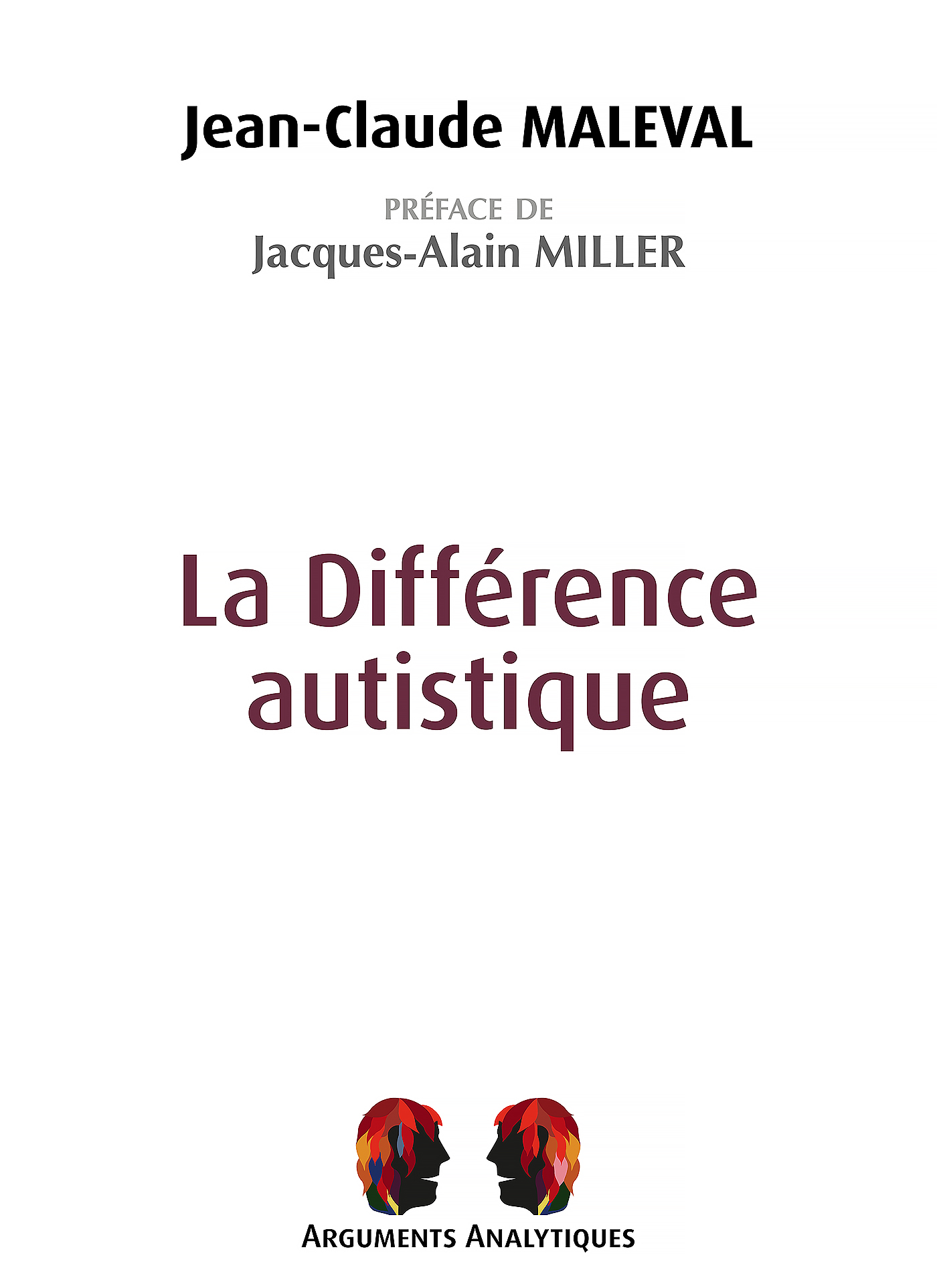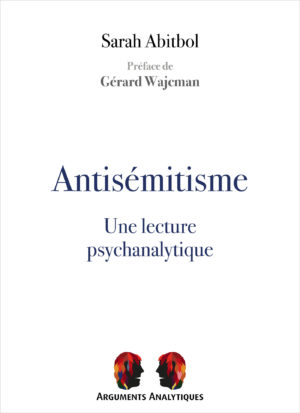Introduction
La différence autistique s’affirme et s’accroît au xxie siècle : ceux qui la vivent veulent faire reconnaître que l’autisme n’est ni une maladie, ni une folie, ni même un handicap. La cause de l’autisme n’est pas connue, mais un constat s’impose : les autistes fonctionnent de manière différente, tantôt avec plus de difficultés que les non autistes, tantôt avec plus d’atouts. En quoi réside cette différence ? Le mouvement de la neurodiversité affirme qu’elle repose sur une autre intelligence déterminée par un fonctionnement cérébral original. Il a pris naissance dans les années 1980 à l’initiative d’autistes qui voulaient que l’on cesse de les considérer de manière négative. Ils revendiquent le droit à la diversité humaine et considèrent que la société devrait accueillir leurs particularités afin qu’ils puissent y vivre dignement. Ils cherchent à lutter contre les processus de stigmatisation et d’exclusion dont ils sont l’objet. Ils célèbrent une « culture autistique » mettant l’accent sur ses aspects positifs et créateurs. Certains vont jusqu’à considérer l’autisme comme un mode de fonctionnement cognitif alternatif qui ne demande aucun traitement.
Les premières autobiographies parues dans les années 1980 et 1990, constate Brigitte Chamak, en particulier celles de Temple Grandin (1986) et de Donna Williams (1992), ont largement participé à la construction d’une politique identitaire autour de l’autisme. N’étant plus limitée aux enfants sans langage, cette étiquette, si stigmatisante jusque-là, devenait un étendard pour des personnes fières de revendiquer le qualificatif d’autisme et décidées à en changer les représentations, refusant la vision négative et pessimiste et les descriptions perçues comme insultantes que les professionnels, les médias ou les parents faisaient de l’autisme 1.
En 2015 est paru, sous la plume d’un journaliste américain, un véritable plaidoyer en faveur de la « neurodiversité » : NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity (Tribus neurologiques. L’héritage de l’autisme et l’avenir de la neurodiversité). Cet ouvrage contribue grandement à la diffusion de cette notion par l’entremise de son succès médiatique. Steve Silberman, son auteur, considère que la neurodiversité inaugure une ère lors de laquelle l’humanité pourrait commencer à « penser plus intelligemment aux gens qui pensent différemment 2 ». Dans cette perspective, il promeut une conception de l’autisme comme un variant de l’humain et non comme une maladie à soigner. Un des aspects les plus intéressants de sa réflexion réside dans l’interrogation de la pertinence de la frontière tracée entre normalité et anormalité.
Le mouvement pour les droits des personnes autistes est à l’origine de la création et de la diffusion de nouveaux mots et concepts. Les autistes Asperger se désignent comme « Aspies » et promeuvent le terme d’« Autie » pour référer à un autisme plus sévère. L’innovation la plus lourde de conséquences tient au concept de neurodiversité qui partage l’humanité entre autistes et « neurotypiques ». Il présuppose que les neurosciences détiennent une vérité ultime sur l’humain et sur l’autisme. Pourquoi la diversité des individus devrait-elle se concevoir en référence aux neurosciences ? L’histoire et la culture n’y contribuent-elles pas pour le moins autant ?
Il est de plus en plus fréquent que les autistes se considèrent comme « neuroatypiques ». Or, comme le souligne Jean-Marie Vidal,
ce n’est qu’une nouvelle manière de catégoriser les gens selon leur anormalité, au regard de la norme statistiquement majoritaire dans la population. Mais c’est aussi une nouvelle manière d’insister sur l’origine neurologique du trouble, même si elle reste bien souvent indétectable. Cette insistance aboutit alors à un étonnant paradoxe : alors que l’autisme est régulièrement invoqué pour souligner la part neurologique du fonctionnement psychique, il ne peut être identifié que par une approche clinique des modes d’expressions des personnes atteintes de ce trouble. Avant que l’on puisse détecter un fonctionnement neuronal atypique des personnes autistes, ce sont leurs conduites humaines qui se montrent atypiques. Leur neuroatypie se manifeste d’abord comme une psycho-atypie qu’il y a lieu d’analyser 3.
À l’instar de Temple Grandin, beaucoup d’autistes voient le monde à partir du prisme de leur cerveau. « Elle n’a pas un cerveau, constate Ehrenberg, comme la plupart des gens, elle est son cerveau. » Pour elle, la neuroanatomie est une psychologie, « et peut-être plus encore, une ontologie » 4. Pour les tenants de la neurodiversité, la vérité de l’homme reposerait sur la singularité de son cerveau. Il s’agit d’une approche réductionniste qui néglige des niveaux autonomes de la réalité humaine, en particulier sa dimension symbolique et ses déterminants sociaux, tandis qu’elle minimise la vie affective et ce qu’elle doit à l’impact du pulsionnel. Cette théorie promeut une identification de l’homme à une machine à traiter les informations. Or, il faut constater que cette image est aujourd’hui agréable au grand public.
Croire que ce que je suis, c’est « un » cerveau, souligne Clotilde Leguil, c’est se définir à partir de l’anonymat d’un fonctionnement qui m’est étranger. […] Peut-être chacun préfère-t-il se savoir asservi à ses neurones, plutôt que d’éprouver une quelconque responsabilité quant à son destin. Et si le grand public aime les neurosciences, c’est qu’elles lui présentent une version de l’existence plus reposante, dans laquelle il n’a plus qu’à se laisser vivre et à obéir au programme qui est celui de son cerveau 5.
Cette réduction, qui gomme ce que l’homme doit au social, est en phase avec la montée contemporaine de l’individualisme.
Si la neuro-imagerie saisit bien des éléments de la géographie du cerveau, leur dynamique cependant lui échappe. Le psychisme est infiniment plus complexe qu’un double du cerveau : tout laisse supposer qu’une situation identique génère des états cérébraux différents d’un sujet à l’autre, voire chez un même sujet à des moments différents de sa vie. Le discours des neurosciences promeut une approche réductrice du sujet en ne prenant en compte qu’une cognition censée gouverner l’affectif.
Le sujet du cognitivisme, constatent Marie-Jean Sauret et Christiane Alberti, n’a pas de sexualité, donc pas ce bout de jouissance qui infecte sa pensée ; le sujet du cognitivisme n’a pas de corps mais est identifié au système nerveux central évalué en termes de performances mesurables ; le sujet du cognitivisme n’a pas d’histoires, celle que le signifiant jalonne et permet d’évoquer, mais la mémoire d’un ordinateur dont la capacité est précisément jaugée, le sujet du cognitivisme n’a que faire d’une éthique puisque la science est censée révéler les lois de la nature, le programme génétique, qui règle ses comportements également inventoriés et calibrés 6.
La norme cérébrale étant la diversité, le neurotypique est impossible à saisir. Les forces évolutives à l’œuvre dans l’évolution de l’espèce humaine produisent des comportements d’une grande variabilité selon les cultures et les histoires individuelles, modelant ainsi des cerveaux singuliers et hétérogènes. Il n’existe pas de consensus sur ce qui permettrait de déterminer en quoi le cerveau d’un autiste, ou celui d’un psychotique, sont spécifiques.
Si la neurodiversité, c’est donc, minimalement, l’idée que l’autisme est d’origine cérébrale, écrit Denis Forest, cette origine est, pour l’instant, un objet de recherche et non un substrat qui serait identifié au moyen d’un ensemble de connaissances robustes. Lorsqu’on parle de neurodiversité, la référence au cerveau est donc une référence faite à des mécanismes hypothétiques auxquels les différences psychologiques avérées doivent correspondre en principe. Or, il n’y a à ce jour ni intégration de ces mécanismes et de ces différences au moyen d’une théorie qui ferait consensus, ni distinction bien nette entre ce qui dans le cerveau marcherait mal et ce qui en lui marcherait autrement et apporterait à la diversité le fondement objectif désiré 7.
Faute d’une cause connue, l’appréhension de l’autisme reste aujourd’hui essentiellement clinique, ce dont témoignent les variations de sa définition ; et c’est aussi la clinique qui nous oriente quant aux modes de prises en charge des autistes les plus sévères. Une clinique bien plus large que celle qui est contrainte dans les protocoles de l’evidence-based medicine, une clinique qui prend en compte les études de cas, les évolutions spontanées et l’hypertrophie compensatoire des autistes soulignée par Asperger.
Notre revendication de la différence autistique, comme fonctionnement psychique original, ne s’accompagne pas d’une adhésion à la notion de neurodiversité qui lui est en général associée. L’approche psychanalytique propose une saisie tout autre de la différence autistique, à partir du fonctionnement subjectif et de la manière de se protéger du désir de l’Autre. La différence ne passe alors pas entre autiste et neurotypique, mais entre autiste, névrosé ou psychotique, sachant que tout sujet participe de l’une de ces structures subjectives. Il est cependant regrettable que ces trois fonctionnements soient nommés, pour des raisons historiques, par des termes psychiatriques : ils désignent les trois manières dont dispose l’humain pour composer avec sa jouissance. Ils sont chacun compatibles avec les mal-êtres les plus graves et avec les réussites sociales les plus hautes. Il existe des autistes, des névrosés et même des psychotiques heureux. Dès lors, revendiquer la différence autistique, ce n’est pas reconnaître implicitement l’existence d’un groupe dominant, qui serait la référence de cette différence. Chacun des modes de fonctionnement subjectif est différent des deux autres et aucun ne doit être considéré comme un étalon. Quant au « neurotypique » définit comme « toute personne sans différence neurologique », il ne relève d’aucune de ces structures subjectives : ce n’est qu’une fiction statistique introuvable.
Selon certains, proches du mouvement de la neurodiversité, plutôt que de s’évertuer à guérir l’autisme, mieux vaudrait chercher à changer une société « handicapante ». Notre approche de la différence autistique ne conduit pas à l’exalter en la considérant comme « révolutionnaire 8 ». Il arrive certes qu’elle « bouscule l’ordre établi », mais l’hystérie ou la psychose ne s’avèrent ni plus ni moins performantes à y parvenir. En revanche, ceux qui revendiquent la différence autistique, que ce soit en la fondant dans le cerveau, ou en la discernant à partir d’un fonctionnement subjectif, ceux-là convergent pour poser des questions qui dérangent : « Pourquoi vouloir empêcher un enfant autiste de faire du flapping 9 ? Ou pourquoi lui apprendre absolument à regarder dans les yeux 10 ? » Prendre en compte la différence autistique, quelle que soit la manière de la concevoir, implique rupture avec les discours normatifs véhiculés par les protocoles et les bonnes pratiques.
L’objection la plus fréquente à l’appréhension de l’autisme comme une différence, et non comme une maladie ou un handicap, consiste à souligner qu’il s’agit d’un mouvement généré par des autistes sans déficience intellectuelle, lesquels ne prendrait pas suffisamment en compte les formes les plus sévères. Nul doute cependant que ces dernières recèlent, au moins chez certains, des potentialités permettant de passer d’un extrême à l’autre du spectre de l’autisme. « Quand j’étais toute petite, souligne Temple Grandin, j’étais autiste sévère ; ce n’est que plus tard que je suis devenue autiste de haut niveau 11 ». À l’encontre de ce que soutient le mouvement de la neurodiversité, nous ne considérons pas que la différence autistique implique pour tous absence de soins et d’éducation spécialisée, cela n’est vrai que pour quelques sujets, situés dans le haut du spectre. Quand il s’agit d’améliorer le mal-être de l’autiste, le traitement du social ne saurait en toutes circonstances se substituer aux soins. Les réponses à apporter aux troubles et aux difficultés doivent grandement varier suivant les régions du spectre. Que l’autisme se réduise à un problème de société, qui n’accepte pas la différence, n’est soutenable qu’en référence aux autistes indépendants ; pour les autres, qu’ils soient peu autonomes ou totalement dépendants, la question de la prise en charge et du traitement ne peut être évacuée.
Selon l’approche cognitiviste, la spécificité de l’autisme réside en une autre intelligence, cela semble bien établi. Cependant, selon nous, cette cognition originale repose sur un autre fonctionnement affectif et libidinal. Il s’agit d’une hypothèse psychanalytique, or, pour la plupart, ni les autistes, ni leurs parents, et moins encore les autorités sanitaires, ne sont prêts à s’y intéresser. Les neurosciences cognitives qui régissent l’abord contemporain de l’humain font obstacle épistémologique à la prise en compte de la dynamique inconsciente discernée par Freud. Les autistes eux-mêmes, à la différence des névrosés, n’éprouvent guère le sentiment d’être parfois débordés par une force vécue comme plus puissante que leur volonté. Quant à leurs parents, ils sont souvent arc-boutés sur des dénonciations de la psychanalyse, accusée de les avoir rendus responsables des troubles de leurs enfants. Pourquoi, malgré tout, tenter de faire entendre une approche psychanalytique de l’autisme ? Parce qu’elle nous paraît aujourd’hui en mesure de rendre compte de la spécificité de la différence autistique avec plus de précision que les théories cognitives. La reconnaissance de la médiocrité des résultats des méthodes cognitivo-comportementales pour traiter le mal-être autistique commence à s’imposer ; viendra bientôt le temps d’une diffusion des méthodes psychodynamiques spontanément utilisées par certains autistes – quand ils ne sont pas entravés dans leurs efforts. C’est ce que prône l’approche psychanalytique, non pas en cherchant une causalité dans l’histoire du sujet autiste, mais en s’appuyant sur ce qu’Asperger nommait son « hypertrophie compensatoire ».
Les débats qui semblent opposer de manière irréductible les pratiques comportementales et les méthodes psychodynamiques masquent une tendance à une atténuation des antagonismes qui s’opère lentement sur le terrain. Qui plus est, l’inclusion de l’autisme dans les psychoses est apparue de plus en plus contestable. Les Lefort ont fait œuvre de pionniers à cet égard en tentant dès la fin du siècle dernier de dégager les caractéristiques d’une structure autistique, faisant ainsi de l’autisme une différence et non une maladie 12. Beaucoup de psychanalystes freudiens et lacaniens s’inscrivent aujourd’hui en cette perspective et s’efforcent de distinguer le fonctionnement autistique du fonctionnement psychotique. Nous précisons plus loin pourquoi l’autisme doit être différencié de la psychose, en soulignant notamment l’absence d’hallucinations verbales et de délires, l’évolution de l’autisme vers l’autisme, la spécificité des écrits, l’absence de déclenchement, et la volonté d’immuabilité.
La France souffre de ne pas disposer d’un mouvement d’auto-défense des autistes, tel qu’il existe aux États-Unis, pour dénoncer les violences inhérentes à la méthode ABA, et pour souligner la médiocrité des résultats obtenus par les méthodes encore recommandées par la Haute Autorité de Santé. Le porte-parole le plus reconnu de la communauté autiste en France, Josef Schovanec tient parfois un discours contradictoire. Il souligne l’importance de s’appuyer sur les intérêts spécifiques pour développer les capacités de l’enfant autiste, tout en n’hésitant pas à apporter sa caution médiatique à des méthodes qui prônent de les réfréner, au mieux de les utiliser comme carotte. Daniel Tammet, un anglais résidant en France, se montre quant à lui beaucoup plus clair. Quand on l’interroge sur comment faire avec tel ou tel enfant autiste, il n’hésite pas à répondre qu’il convient d’inventer une méthode pour chacun.
En Europe, la parole critique des autistes ne s’est pas encore faite beaucoup entendre. La revendication d’une approche plus humaniste de leurs difficultés n’est pas portée par des associations de parents, constituées au siècle dernier, qui, en France, considèrent que le combat majeur est de dénoncer la psychanalyse au nom d’une science dont les résultats sont complaisamment interprétés. Pourtant le mal français n’est pas la psychanalyse, mais le manque de moyens, l’absence de dialogue et une administration de la santé kafkaïenne 13.
Les temps changent. Les évaluations des méthodes recommandées s’avèrent de plus en plus décevantes 14 ; tandis que se multiplient les relations de thérapies par affinités efficientes, pourtant fondées sur des principes opposés aux précédentes. Des parents se lèvent pour prôner une approche humaniste de l’autisme 15. Les psychanalystes partagent la même éthique que celle dont se revendiquent leurs associations : celle qui met le sujet et sa singularité au premier plan. Celle qui prône pour chaque autiste une méthode spécifique.
Même en adaptant la cure psychanalytique à l’autiste, c’est-à-dire en ne l’orientant pas vers la révélation d’un sens caché, mais en la fondant sur un traitement par le bord, objet qui mobilise les investissements libidinaux de l’autiste, et qui connaît trois incarnations (l’objet autistique, le double et l’intérêt spécifique), même dans ces conditions, nous ne la considérons pas comme le traitement privilégié du mal-être de l’autiste ; beaucoup d’autres méthodes psychodynamiques, parfois spontanément inventées par le sujet lui-même, parviennent à des résultats significatifs. Aucune réserve à faire par exemple à la thérapie rogérienne par le jeu conduite par Virginia Axline avec Dibs 16. L’Affinity Therapy ou le SCERTS 17 ouvrent de même des voies nouvelles intéressantes qui prennent en compte le savoir et les passions de l’enfant. En outre, il est en général bienvenu que d’autres prises en charge soient associées (pédagogie, orthophonie, psychomotricité, etc.) Cependant, seule la psychanalyse fournit un cadre théorique pour aborder les angoisses et la spécificité du fonctionnement affectif de l’autiste. En cela, elle reste indispensable. Sa remarquable persistance tient à sa capacité heuristique incomparable pour comprendre les phénomènes humains qui dépassent la volonté – ceux qui témoignent d’un savoir agissant à notre insu. Cette persistance est d’autant plus digne d’être soulignée que la psychanalyse se heurte aujourd’hui à des représentations collectives contraires qui exaltent l’individualisme et qui font de la propriét&eac