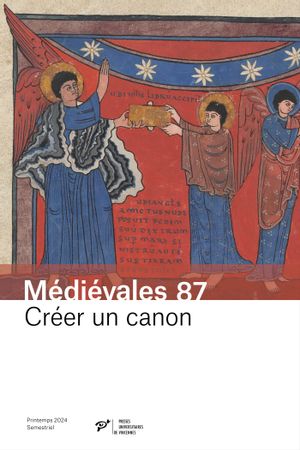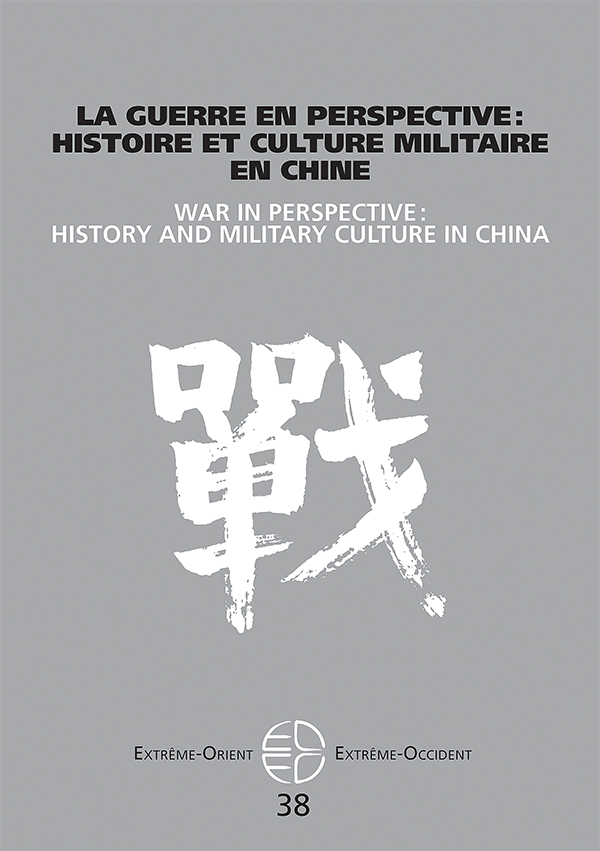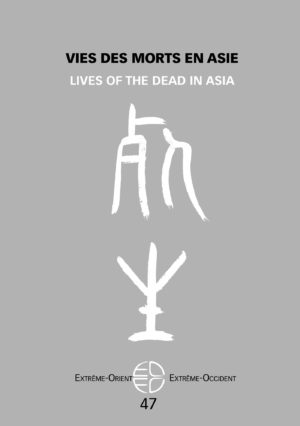Extrême-Orient, Extrême-Occident, 38 – 2014
Polémiques polémologiques
Albert Galvany et Romain Graziani
Les nouvelles conquêtes de l’histoire militaire au xxe siècle
Il paraît aujourd’hui légitime, voire justifié, d’entreprendre une enquête historique sur les déplacements massifs de populations civiles consécutifs à un conflit armé, d’analyser la participation des femmes aux préparatifs et à la conduite d’opérations militaires, de traiter de l’impact d’une action belliqueuse sur le fonctionnement des institutions ou de tout autre sujet touchant aux dimensions sociale, symbolique, culturelle, économique ou encore psychologique de la guerre. De telles orientations de l’esprit de connaissance sont pourtant le résultat d’une transformation récente, quoique profonde, dans notre manière de concevoir et d’écrire l’histoire. En Occident, les études consacrées à la guerre sont longtemps restées tributaires d’un intérêt prépondérant pour un nombre restreint de thèmes tels que la tactique, la logistique, la technologie ou encore l’armement utilisé au cours des campagnes militaires. Parallèlement à ces analyses, avaient le vent en poupe les biographies des grands généraux et stratèges dont l’histoire a fait des protagonistes de premier choix, liés de façon inextricable au destin de la nation1.
Au cours de la première moitié du xxe siècle, ce type d’histoire traditionnelle se maintenait encore, certes comme une survivance obsolète – sinon suspecte – à la marge des grands courants de pensée qui étaient en train de renouveler en profondeur l’historiographie, au premier chef l’école marxiste et celle des Annales. L’intérêt pour les batailles et les guerres commençait alors à être perçu, et cela de manière croissante et irrémédiable, comme le signe d’une mentalité antiquaire, pour être finalement relégué au rang de divertissement pour amateurs enthousiastes dépourvus de la plus élémentaire formation scientifique2.
À la base de grands récits descriptifs, que maints historiens modernes imputent soit à la ferveur nationaliste soit à une inspiration exclusivement belliciste tout en en dénonçant le caractère répétitif et vide de sens, cette approche traditionnelle de la guerre exerça son influence jusqu’à la fin des années 1960. Encore au début des années 1970, l’historien Gordon A. Craig déplorait l’absence de recherches fiables et rigoureuses sur la guerre dans l’historiographie contemporaine3, et cela en dépit d’une amorce de changement dès cette époque. C’est à ce moment en effet qu’apparaissent les premiers indices d’une attitude qui, en quelques années, finira par opérer une révision radicale de l’historiographie traditionnelle et le rejet total des préjugés qui entachaient jusque-là les historiens de profession. Ici et là se détectent les signes précurseurs d’un renouveau des études sur la guerre et d’un élargissement des perspectives adoptées. Citons parmi d’autres l’exemple du livre de Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines, publié en 1973, ou le cours que Michel Foucault dispense au Collège de France en 1975-1976, qui propose une analyse critique du rôle joué par la guerre et la pensée militaire dans la formation des États modernes, ou encore les deux volumes que, cette même année, Raymond Aron consacre à l’œuvre de Clausewitz4. À partir de 1980, l’ostracisme académique dont étaient victimes les études sur la guerre cesse progressivement de s’exercer sous l’effet de perspectives, de méthodologies et d’enjeux inédits pour ouvrir la voie à ce que le monde anglo-saxon baptise la Nouvelle histoire militaire (New Military History)5. Précisant la portée de ce nouveau regard sur la guerre à l’occasion d’un discours devant la Society of Military History, le 23 mars 1991, Peter Paret en mentionne l’un des traits distinctifs : l’expansion de l’objet même de ce type d’histoire. Après s’être occupée des caractéristiques propres à l’organisation et à l’action militaires, cette discipline rénovée en est venue, en effet, à élargir son champ de vision pour traiter des implications sociales et culturelles des conflits armés 6. Force est donc de constater que ce n’est qu’au cours des dernières décennies du xxe siècle que la science historique en Occident a cessé d’aborder la guerre exclusivement à partir des modèles traditionnels, ceux que désignent encore aujourd’hui les termes dépréciatifs de « tambours et clairons » (drums and trumpets). L’intégration de ce champ de recherches aux sciences historiques et l’adoption d’une multitude de perspectives sur le phénomène de la guerre sont, comme on le voit, une conquête des plus récentes. L’une des conséquences les plus sensibles de cette rupture épistémologique dans l’approche de la guerre, construite comme objet culturel, phénomène économique ou encore enjeu symbolique, fut de revitaliser l’histoire militaire en lui proposant de nouvelles pistes de questionnement, en diversifiant ses méthodes et en modernisant son appareillage optique si l’on peut dire. Or, une telle rupture s’est produite, étrangement, au moment même où la guerre, comprise comme conflit armé, public et inscrit dans un cadre juridique, semble dépérir, voire même entièrement disparaître7.
D’un préjugé tenace sur la civilisation chinoise
Bien que longtemps repliée sur des paradigmes datés et des méthodes anciennes, la sinologie s’est assez vite acclimatée à ces nouveaux courants historiographiques : signalons dès 1974 l’une des premières tentatives d’approche de la question de la guerre dans une perspective historique large avec la publication d’un volume collectif dirigé par Frank Kierman et John Fairbank, Des Voies de la guerre en Chine (China’s ways in warfare)8. Les sinologues avaient devant eux un large chantier, étant donné la riche tradition de traités militaires et de réflexions tactiques et stratégiques, inaugurée dès l’aube du ve siècle avant notre ère et dont la vitalité spéculative s’était maintenue depuis lors sans interruption9. Le renouvellement du champ d’investigation que résume le nom de « guerre» fut pourtant ralenti, dans le cas présent, par un préjugé tenace, qui tient à l’image que la Chine s’est forgée de sa propre culture et de ses institutions, tout au moins à partir de la dynastie Song (960-1279).
Selon l’interprétation avancée par Alastair Iain Johnston, il faudrait en effet distinguer, à partir du second millénaire, deux attitudes fondamentales face à la guerre et à la culture militaire : d’un côté, ce que l’historien canadien appelle le paradigme « confuciano-mencien », c’est-à-dire hérité directement de la pensée de Confucius puis de l’oeuvre écrite de son sectateur Mencius (380-289 av. J.-C) ; de l’autre, ce qu’il baptise le paradigme parabellum. Selon le premier, toute forme de violence ou de coercition doit être rejetée au profit d’une attitude morale de la part du gouvernement, supposément suffisante pour déjouer les menaces contre la sécurité intérieure, tout en ayant recours, s’agissant de sécurité extérieure, aux manœuvres diplomatiques, aux alliances, aux tributs et aux relations commerciales. Le paradigme parabellum, au contraire, intègre l’affrontement armé comme élément constant des rapports entre États et, par conséquent, accepte le principe de la violence légale comme moyen le plus efficace de gérer les conflits. Selon ce second paradigme, la sécurité intérieure, reposerait, autant que la sécurité extérieure, sur la force militaire, seule susceptible d’assurer la défaite, voire l’anéantissement, de toute ennemi10. Pour Johnston, comme pour d’autres auteurs11, l’opinion prévalant tant en Chine qu’en Occident12 tient la civilisation chinoise pour réfractaire à toute forme de militarisme et adhérant pleinement aux valeurs essentielles du confucianisme. Nimbé par l’aura de la figure tutélaire de Confucius, modelé sur la conduite du sage opposé à l’usage de la violence, travaillé par la doctrine impériale d’un Etat se voulant lui-même confucéen et prônant sans relâche l’étude des textes classiques contribuant à l’édification morale de chacun, le pacifisme l’aurait emporté sur toute forme de culture martiale dans l’histoire chinoise, et ce de manière croissante depuis le début du second millénaire. C’est ainsi que la sphère civile serait parvenue à s’imposer au domaine militaire pendant une grande partie de l’histoire impériale chinoise13. Cette image pérenne se retrouve dans les textes et discours officiels des dirigeants chinois d’aujourd’hui – militaires ou non – où se rappelle constamment la prégnance de cette tradition pacifiste plongeant ses racines dans le terreau du confucianisme antique. Les exemples sont légion, mentionnons parmi tant d’autres Li Jijun, lieutenant-général de l’Académie des sciences militaires (Junshi kexueyuan), qui considère que la culture militaire chinoise est fondamentalement de caractère défensif. Ou encore l’ancien Premier ministre Wen Jiabao, lequel soulignait au cours d’une conférence donnée en 2003 à l’université Harvard le penchant de la nation chinoise pour la paix et le caractère défensif de sa politique internationale depuis des siècles14.
Confucius bellicosus ?
La fréquentation familière des textes anciens et leur recoupement critique permet toutefois de mesurer combien ce paradigme pacifiste confuciano-mencien proposé par l’historien Alastair Iain Johnston relève en vérité d’un mélange indécidable d’ignorance et de mauvaise foi. La conduite et la carrière de Confucius, si elles n’en font pas un stratège ou un partisan de la force armée, montrent néanmoins de façon indiscutable le caractère martial de ses décisions et la préférence nette qu’il pouvait accorder aux châtiments punitifs au détriment de l’éducation correctrice en certaines occasions.
Observons d’emblée que l’image répandue d’un Confucius explicitement opposé à toute forme d’agression ou de violence n’est fondée la plupart du temps que sur l’interprétation d’un nombre très modique de fragments provenant presque invariablement des Entretiens15. Dans de nombreux textes qui s’étendent de la période pré-impériale jusqu’aux Han, le portrait de Confucius et son rapport à la violence d’Etat s’avèrent beaucoup plus ambigus. On trouve par exemple dans le compendium des rites intitulé Da Dai Liji un passage qui traite de l’émergence de la violence et de l’invention des armes dans lequel Confucius justifie leur usage : « Le Duc demanda : “L’usage des armes procède-t-il de l’infortune ?” À quoi le Maître répondit : “Comment pourrait-il procéder de l’infortune ? Les sages ont utilisé les armes pour proscrire la cruauté et mettre fin à l’oppression dans le monde entier 16”. » Dans un autre passage appartenant aux Propos de l’école de Confucius (Kongzi jiayu), un disciple de Confucius, Ran You (connu également sous le nom de Ziyou) s’apprête à offrir ses services au puissant lignage Ji dans le pays de Lu face à la menace imminente d’une agression, et démontrer ainsi son expertise en matière de stratégie militaire. Son supérieur, Jisun, étonné de voir qu’un disciple direct de Confucius ait pu cultiver de telles compétences lui demande comment, se réclamant du maître, il a bien pu étudier la stratégie militaire. À quoi Ran You répond : « Précisément, j’ai appris cela de Confucius. Confucius est un grand sage et, comme tel, rien n’est hors de la portée de son discernement17. »
Parmi les disciples les plus proches, on trouve également Zilu, un ancien guerrier de carrière à la nature belliqueuse et qui aimait à ferrailler ; son caractère hautain et intransigeant le prédisposait à des saillies de violence que son Maître avait bien de la peine à contenir ou modérer. Sa male mort scella ce destin guerrier : Le Mémoire sur les rites (Liji) rapporte en effet par la bouche d’un messager s’adressant à Confucius : « Avec sa chair ils ont fait du pâté au vinaigre18 ». Citons encore cet autre disciple du nom de Gongliang Ru, connu aussi sous celui de Zizheng, qui selon l’historien des Han Sima Qian disposait de cinq chars de guerre et alliait une extrême bravoure à une grande vigueur physique, qui lui servit à combattre, en compagnie du Maître, les gens de Pu au moment d’une révolte19. Confucius n’hésite pas pour sa part à faire l’éloge de personnages guerriers et de leurs faits militaires, comme lorsqu’il loue Meng Zhifan dans un passage des Entretiens (Lunyu VI.13). D’autres sources20rapportent qu’il mena lui-même des opérations militaires, notamment lorsque les habitants de Bi attaquèrent la capitale de Lu en 497 avant notre ère.
La considération de ces passages comme de tant d’autres relatant des moments de la vie de Confucius laisse penser que ce dernier était loin d’être étranger au paradigme que Johnston baptise parabellum. Le pacifisme du Maître est en effet comme inquiété par d’autres épisodes de sa vie politique, qui montrent qu’il se rangeait sans réserve du côté de la méthode forte, aux antipodes du portrait du saint construit par l’idéologie impériale, opposé à la violence, prêchant la bonté et la justice. Mentionnons pour preuve, ce n’est pas le lieu ici de commenter en longueur ces épisodes, la fameuse entrevue diplomatique de Jiagu entre le duc de Lu, que servait Confucius, et le puissant duc de Qi. Après s’être senti menacé par une troupe de danseurs martiaux dans les gestes desquels il flairait un attentat possible et qu’il écarta en invoquant la correction rituelle, Confucius fit dépecer une troupe de nains21, danseuses et bouffons au motif qu’il était contraire aux rites de les faire parader sur scène. C’était là un fin coup de diplomate et de stratège pour faire plier le duc de Qi et obtenir des avantages matériels en se récriminant haut et fort sur l’entorse de ce dernier au protocole d’entrevue. Autant pour la bonté et la droiture légendaire du maître, ici éclipsées au profit d’une superbe leçon de cynisme politique. L’ascendant moral de Confucius allié à la mâle énergie qu’il manifeste et qui lui permet de faire déférer un puissant duc au nom des convenances, confirme la citation de son disciple Ran You reproduite plus haut : en lui convergent les valeurs martiales et militaires, le pinceau et le fouet, la natte et le char. Un second épisode achève le trait de ce portrait martial. Nommé aux fonctions de ministre dans l’Etat de Lu, sa première décision fut de faire exécuter un dissident, du nom de Shao Zhengmao, au motif que ce dernier abusait de la crédulité du peuple par ses raisonnements spécieux et ne cessait de gagner en popularité22.
De tels événements, que corroborent les sources historiques et que les auteurs anciens mettent à l’honneur de Confucius, ne manquent pas d’invalider l’idée si répandue à propos de la Chine d’une tradition pacifiste, gouvernée par la doctrine confucéenne et imprégnée par l’esprit des lettres. Sous l’impulsion des confucéens tout autant que des légistes, et peu importent ici les désignations d’école, les méthodes martiales conçues dans le contexte d’une guerre intestine ou inter-étatique se sont introduites dans l’administration du corps politique sans solution de continuité et ont permis de renforcer l’arsenal déjà sophistiqué des règles et prohibitions qui gouvernaient les relations hiérarchiques. Au demeurant, Confucius et ses sectateurs, en dépit de quelques déclarations tirées des Entretiens hâtivement brandies pour « sauver » le pédagogue humaniste et prouver que leur seul recours était l’exemple moral, ne se sont en réalité jamais dans leurs actes ni leur carrière opposés aux châtiments qui établissent une continuité entre discipline martiale et éthique sociale.
Confucius bellicus ou Confucius bellicosus ? C’est en tout cas le Confucius historique lui-même que dans sa posture de chef martial viennent louer ses héritiers puis les historiens de l’ère impériale. Le premier des maîtres semble avoir fait sien ce précepte que devait énoncer haut et fort le penseur de l’autoritarisme politique Han Fei quelques trois siècles plus tard : « Entre un souverain et ses sujets, ce sont cent batailles par jour à livrer ». La politique est la gestion des guerres quotidiennes qui sévissent dans la société, contre les envieux, les vicieux et les séditieux, que l’on se situe sur le champ de bataille ou dans l’arène du politique
En finir avec le mythe d’un « Art de la guerre »
essentiellement chinois
Ce volume s’attaque de manière frontale et massive à un autre préjugé qui a longtemps abusé les esprits à propos de la Chine. De nombreux sinologues ont bâti leurs succès de librairie, en Europe comme aux États-Unis, sur un brillant exposé des grandes différences qui opposent la civilisation occidentale à la Chine, en tirant de quelques idées fausses dès le départ un schéma général d’interprétation de leur développement. Alors que les Grecs de l’antiquité – dont nous sommes forcément les héritiers en ligne directe – auraient opté pour un combat frontal en bataille rangée, les Chinois auraient choisi la ruse, l’approche indirecte et le travail de sape de l’adversaire en amont de tout combat. La quintessence de quelques pages du livre de Sunzi, L’Art de la guerre – écrit au ive siècle avant notre ère – recèlerait ainsi les clefs de la « mentalité chinoise ». Au risque d’occulter l’immense littérature stratégique et militaire contemporaine ou postérieure au Sunzi. Au risque aussi de confondre « guerre sur papier » (zhi shang tan bing) et histoire réelle des pratiques militaires en Chine. Or, la chronique des batailles, guerres et invasions qui ont marqué de façon si constante l’empire chinois pendant plus de deux millénaires, dément lourdement cette merveilleuse efficacité de la « stratégie indirecte » des Chinois.
La polarité Chine-Occident, construite à partir de deux attitudes stratégiques opposées dès l’antiquité, a parfois servi de modèle global pour caractériser deux façons typiques et opposées de penser et de s’exprimer : en Occident de façon argumentée, directe, chaque parole étant comme un brave hoplite bataillant contre la légion des arguments du camp adverse ; en Chine, de façon allusive, détournée – donc bien plus efficace – à la manière d’un général prenant l’ennemi à revers, ou en embuscade, sans se montrer, en évitant le corps-à-corps. Dans leurs travaux minutieux d’historiens des pratiques guerrières en Occident, Beatrice Heuser et Patrick Porter23 suggèrent que cette dualité de fond entre la civilisation chinoise et la civilisation occidentale reprend des thèses très anciennes, non dénuées de racisme, qui opposaient un Occident loyal, franc, honnête dans ses façons de combattre, à un Orient recourant à des expédients et des ruses moralement condamnables. L’extension de ce paradigme de la « stratégie à la chinoise » à la « pensée asiatique » en général se veut aujourd’hui, dans ses formes les plus sophistiquées, indemne bien sûr de ce préjugé raciste et neutre sur le plan des valeurs. Il n’en demeure pas moins qu’il conforte à son corps défendant le préjugé d’une mentalité chinoise encline à se montrer fourbe et sournoise. Le public mal informé des réalités de l’histoire chinoise en tire facilement la conclusion que les lettrés en Chine, qui étaient aussi les serviteurs du pouvoir impérial, ont toujours évité la polémique, le débat d’idées, la courageuse remontrance au souverain au risque de sa propre vie, au profit de formules ambiguës, savamment construites de manières à « passer » tout en suggérant de loin, et sans en avoir l’air, une critique ou un blâme. De même que le public, sous l’emprise de ce séduisant face-à-face entre la Chine et l’Occident qu’il s’imagine enfin déchiffrer, en vient à croire que les meilleurs généraux chinois ont su, contrairement à leurs homologues occidentaux, éviter le choc frontal et destructeur d’armées en campagne au profit de victoires obtenues sans avoir à livrer le combat. Ces lubies, tirées d’un texte antique aussi fascinant qu’idéaliste, et qui a longtemps servi de paravent occultant la vision lucide de ce que fut la guerre au quotidien dans l’empire chinois, – ces lubies ont joué un rôle prépondérant dans l’image contemporaine de la Chine, comme dans celle que, par différence, nous sommes amenés à construire de nous-mêmes. Si parmi les objectifs de ce numéro il s’agit de terrasser le préjugé d’une Chine confucéenne condamnant ou escamotant la violence militaire, les différents auteurs sont également unis par la volonté de creuser une sape pour faire s’écrouler la construction de cette grande fresque binaire retraçant d’un côté l’épopée de la civilisation occidentale, marquée par les guerres héroïques et les batailles décisives, de l’autre une Chine astucieuse et rusée qui machine et manigance pour gagner le combat en appliquant la méthode du non-agir.
Cette entreprise, dont il s’avère dès lors redondant de souligner le caractère engagé, est inaugurée par un article de Peter Lorge, intitulé « Discovering War in Chinese History », qui développe pour partie les idées que nous venons d’introduire. Son texte se propose d’offrir au lecteur une réflexion de nature critique sur le rôle que la guerre et l’étude historique de cette dernière auraient joué en Chine selon la sinologie occidentale. Selon Lorge, les sinologues auraient accordé une attention bien plus grande à la pensée militaire qu’à l’histoire militaire. Dans le droit fil de cette argumentation, il retrace la genèse de ce qui semble avoir constitué un obstacle majeur à la juste compréhension du rôle joué par la guerre dans l’histoire chinoise : l’idée, étrangère à tout sens historique, selon laquelle il y aurait une manière essentiellement chinoise de conduire la guerre et les affaires militaire. En fonction de cette perspective essentialiste, l’attitude des intellectuels chinois a été rangée aux antipodes du bellicisme, tandis que, en parfait accord avec cette opinion, les stratèges et plus largement les penseurs en Chine qui se sont intéressés à la guerre auraient avant tout conçu et formulé une série de stratagèmes et de moyens contournés pour emporter la victoire. Lorge montre dans quelles conditions historiques et idéologiques le texte militaire traditionnellement attribué à Sunzi est devenu le paradigme de la pensée stratégique, et cela grâce sans doute à une lecture arbitraire qui a marginalisé la très riche et diverse tradition de commentaires de L’Art de la guerre, une mise à l’écart qui ne fit que se durcir sous l’effet d’une tendance prononcée à établir des comparaisons – dont on ne dira jamais assez le caractère biaisé – avec l’œuvre de Clausewitz. Incapables qu’elles sont de discerner correctement la dimension rhétorique des écrits militaires, Lorge considère que la plupart de ces interprétations influentes postulent de manière consciente ou non une parfaite continuité entre la littérature militaire et les pratiques guerrières, de sorte que les traités théoriques sur la guerre ne seraient que le parfait reflet de ces dernières, ce qui, comme on le pressent, constitue une hypothèse des plus problématiques. L’étude de Lorge montre à cet égard que l’instauration d’une distance critique par rapport à cette attitude essentialiste, comme par rapport aux notions qu’elle met en jeu, permettrait non seulement de revitaliser un champ d’études de première importance pour comprendre la Chine à travers l’histoire, mais aussi de reconsidérer l’intégralité de l’histoire militaire en Occident.
La contribution de David A. Graff, « Brain over Brawn : Shared Beliefs and Presumptions in Chinese and Western Strategemata », reprend et prolonge en quelque sorte les thèses avancées par Peter Lorge, en se proposant notamment d’invalider, à partir d’un exercice comparatif, un certain nombre d’idées reçues sur l’histoire militaire de la Chine. Comme on vient de le signaler, L’Art de la Guerre de Sunzi sert le plus souvent à caractériser la tradition militaire chinoise, dominée qu’elle serait par les manœuvres indirectes et l’emploi de la ruse, en contraste avec la manière occidentale de faire la guerre, incarnée dans l’œuvre de Clausewitz et définie par des attaques directes et frontales. Afin de saper les fondements de cette croyance aussi répandue que tenace, l’article de Graff prend pour objet d’étude les précis classiques de Frontin, Onasandre et Polyen (ier et iie siècles de notre ère) ainsi que quelques traités militaires byz