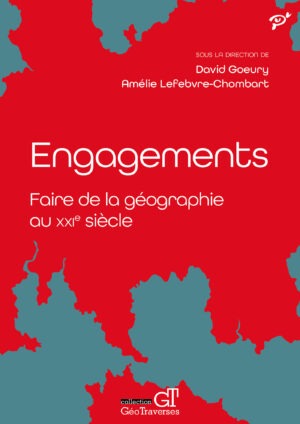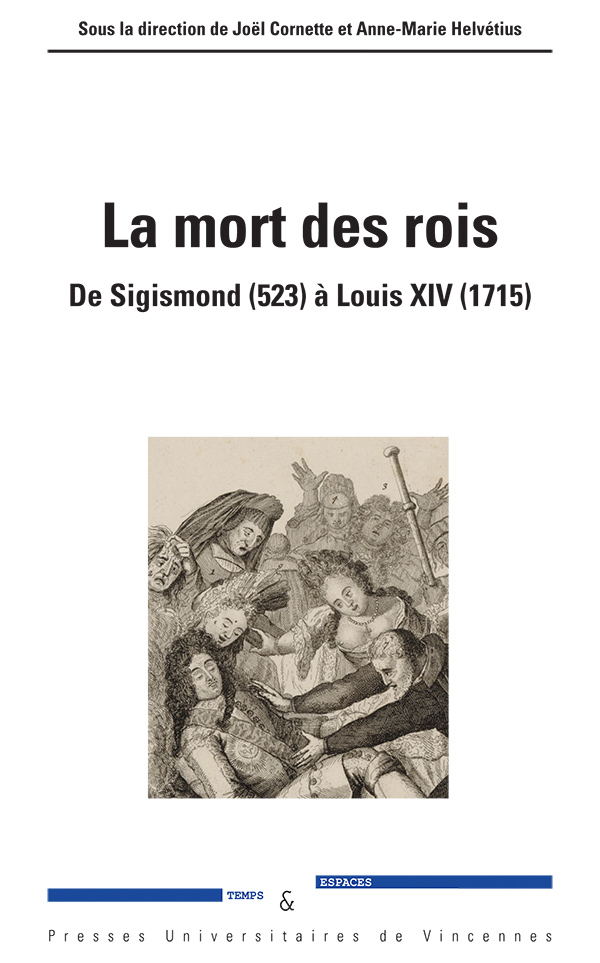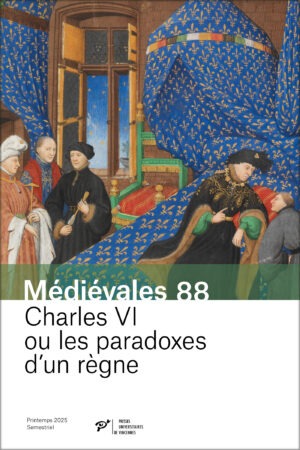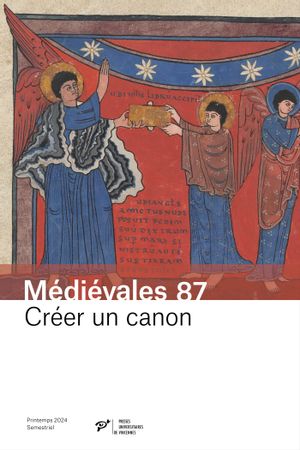Introduction
Joël Cornette et Anne-Marie Helvétius
Depuis les années 1970, avec les travaux de Philippe Ariès, de François Lebrun, de Pierre Chaunu, de Jacques Chiffoleau et de Michel Vovelle, les études sur la mort se sont largement développées, tout en acquérant une dimension comparative et pluridisciplinaire. L’histoire dite des mentalités et des sensibilités, des attitudes et des comportements collectifs, qui triomphait ces années-là, a permis d’aborder frontalement et sans tabous le thème de la mort, au même titre que d’autres sujets voisins tels que l’histoire de la famille ou de la sexualité. Depuis lors, les études portant sur la mort au Moyen Âge se sont multipliées : tandis que ses dimensions spirituelles et sociales retenaient l’attention de Jean-Claude Schmitt ou de Patrick Geary, d’autres chercheurs, comme Cécile Treffort ou Michel Lauwers, se sont concentrés sur la question des rites funéraires et de l’organisation matérielle des cimetières. Parallèlement à ces recherches de portée générale, la mort des souverains et leurs lieux de sépulture ont spécialement retenu l’attention des médiévistes. Les travaux pionniers de Karl Heinrich Krüger et d’Alain Erlande-Brandenburg ont ainsi marqué des générations d’historiens, tout en les incitant à prendre en considération les aspects matériels de la mort des rois.
Mort des rois, mort des princes, mort des grands : ces questions continuent à passionner les médiévistes, comme en témoignent de nombreux colloques et ouvrages récents. Cependant, paradoxalement, dans cette redécouverte du trépas comme objet et sujet d’histoire à part entière, la mort des rois a longtemps semblé marginale, voire délaissée par les historiens modernistes : ainsi, la grande étude de Michel Vovelle s’attache plus aux mentalités collectives qu’à la disparition des souverains, singulièrement absente de son analyse. Des exceptions pourtant : durant ces années fécondes en inventions thématiques, quelques historiens ont exploré la mort des princes, tel Ralph Giesey (1923-2011), disciple d’Ernst Kantorowicz (1895-1963). Il fut son étudiant à Berkeley, devint son assistant à Princeton en 1953 et orienta ses recherches sur les funérailles royales dans le cadre d’une thèse soutenue en 1954 à l’Université de Californie, publiée en 1960 et traduite en français sous le titre : Le Roi ne meurt jamais (Paris, Flammarion, 1987).
Dans cette étude fondatrice à plus d’un titre, centrée sur les obsèques royales dans le royaume de France, Ralph Giesey, dont les travaux s’intègrent à ceux de l’« école cérémonialiste américaine » publiés au même moment, montre que les « deux corps du roi », chers à son maître Kantorowicz, apparaissent clairement au moment des funérailles du corps mortel du souverain qui vient de décéder, dans la mesure où une effigie (corpus mysticum) du roi est présente de 1422 (funérailles de Charles VI) à 1610. En effet, jusqu’aux funérailles d’Henri IV, dès que le roi meurt, un mannequin est fabriqué, doté d’une tête en cire, les yeux ouverts comme s’il était vivant, de la façon la plus réaliste possible, et tout un rituel est organisé autour de lui (les repas, par exemple, servis avec cérémonie aux heures habituelles). Au xviie siècle, alors que triomphait la Réforme catholique, ce simulacre du roi vivant apparut comme la manifestation déplacée d’un culte païen.
Giesey a soutenu que cette effigie, revêtue des habits royaux – ceux que le roi portait lors de son sacre –, représentait l’immortalité du souverain décédé, la partie immortelle du prince, en quelque sorte (à l’image du chancelier, homme de la justice, qui ne revêt pas de vêtements de deuil). Ainsi, par exemple, confectionné par François Clouet, le mannequin de François Ier, exposé dans la salle d’honneur à Saint-Cloud du 24 avril au 5 mai 1547, a été conçu avec deux paires de mains amovibles : l’une des paires figure des mains jointes, et l’autre des mains dans une position capable de saisir un objet ; la mécanique prévoit la superposition du symbole chrétien de l’immortalité du roi en prière et celui de l’immortalité de la monarchie, par l’attribut du sceptre, tenu par le souverain. « Le roi est mort », crie le héraut d’arme dans la crypte de la basilique Saint-Denis, en abaissant la bannière royale sur le cercueil descendu dans le caveau, avant de la relever au cri de « Vive le roi » : ce second cri triomphal s’adresse au roi vivant comme principe monarchique, comme incarnation d’une monarchie qui ne meurt jamais.
En partie contestée, l’étude de Ralf Giesey a eu le mérite de susciter des recherches et des analyses neuves, de multiplier des monographies centrées sur le trépas des souverains. D’autant que, sur la mort des détenteurs du pouvoir, nous disposons de sources variées et abondantes : elles ont inspiré de nombreuses études et synthèses récentes. Ainsi, trois colloques internationaux, organisés par le Centre de recherche du château de Versailles (à Cracovie en 2007, à Madrid et à l’Escorial en 2008, à Versailles en 2009), ont proposé une lecture tout à la fois neuve et comparatiste des rituels funéraires à l’échelle de l’Europe : il s’agissait d’identifier des modèles et d’étudier leur circulation, afin de tenir compte des spécificités institutionnelles, politiques et confessionnelles. Quant au tricentenaire de la mort de Louis XIV, il a suscité une floraison d’études originales centrées sur l’agonie et les funérailles du Grand Roi : ce fut une forme d’opéra funèbre, une œuvre d’art total qui se déploya durant presque deux mois, de l’instant même du trépas, le 1er septembre 1715, jusqu’à la grandiose cérémonie terminale à l’abbaye de Saint-Denis le 23 octobre, quand la dépouille du Grand Roi, embaumée dans son double cercueil de bois et de plomb, rejoignit ses ancêtres dans la sombre crypte du lieu de mémoire de la monarchie.
*
En 1996, un numéro de la revue Médiévales publiée par les Presses Universitaires de Vincennes en hommage à Jean Devisse avait été consacré à « La mort des grands ». Dans une perspective quelque peu différente, justifiée par l’inscription de l’Université Paris 8 sur le territoire de l’abbatiale de Saint-Denis, le sanctuaire et le panthéon du sang royal, là où reposaient presque tous les souverains des quatre lignées de la monarchie – Mérovingiens, Capétiens, Valois, Bourbons –, et les restes de l’apôtre des Gaules, premier évêque de Paris et saint protecteur du royaume, il nous a paru opportun de rassembler à nouveau des chercheurs, médiévistes et modernistes, avec la volonté de croiser des problématiques aussi variées que fécondes, afin de rendre compte des résultats de leurs travaux et des recherches en cours sur la mort des détenteurs du pouvoir, envisagée à l’aide de perspectives ouvertes et plurielles. En effet, s’attacher aujourd’hui à comprendre ce qui entoure la mort des rois, c’est aussi une manière de réfléchir sur de nombreuses problématiques d’une histoire politique et culturelle renouvelée et repensée : le corps du prince dans sa double dimension de « simple corps » et de corps souverain ; les apports de l’archéologie et de la culture matérielle ; le cérémonial complexe des funérailles et les apparats éphémères qui les accompagnent, rituel souvent spectaculaire dès qu’il s’agit d’un prince ; la « médiatisation » de la mort du souverain à travers la circulation de l’information (orale, écrite, graphique) révélée par la diffusion de la nouvelle et la publicité des obsèques ; la commémoration du souverain après sa mort ; sans oublier la mort des rois par l’image et la caricature et les bouleversements politiques multiples provoqués par la disparition du souverain.
Car nous sommes en un temps où l’État est encore pleinement identifié à la personne physique du prince : même si Louis XIV n’a jamais prononcé l’apocryphe « L’État c’est moi », cette phrase résume assez bien la personnalisation extrême d’une « royauté d’incarnation » que le Roi Soleil a pleinement assumée tout au long de son règne, et jusqu’à sa mort publique. « J’ai vécu parmi les gens de ma cour ; je veux mourir parmi eux. Ils ont suivi tout le cours de ma vie ; il est juste qu’ils me voient finir. » Cette identification de la personne du roi à la constitution même de l’État permet de mesurer à quel point sa disparition est presque toujours synonyme de traumatisme, souvent violent : voyez les oppositions et les malcontentements lors des périodes de minorité (guerres de Religion après le trépas brutal de Henri II en 1559, révoltes aristocratiques au temps de la Régence de Marie de Médicis au lendemain de l’assassinat d’Henri IV, « guerres domestiques » de la Fronde au temps de Louis XIV enfant) ; voyez encore le refus de bien des communautés rurales de payer la taille à l’annonce de la disparition du roi, comme ce fut le cas dans plusieurs provinces en 1643 à l’annonce de la mort de Louis XIII, car beaucoup pensaient que l’impôt était lié aux besoins personnels du souverain. Le prince, en tant que prince, écrit Bossuet dans sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, n’est pas regardé comme un homme particulier, « c’est un personnage public, tout l’État est en lui ; la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne » (Livre V, art. 4, 1re proposition). Tant il est vrai que la notion abstraite de souveraineté, indépendante de celui qui en est tout à la fois la figure et l’incarnation, ne concerne encore que des milieux limités, officiers royaux, magistrats et juristes nourris de droit romain. On peut ainsi comprendre l’importance toute particulière de cet « espace-temps » particulier provoqué par la mort du prince : vacance et transmission du pouvoir, mais aussi concurrence et enjeux de souveraineté. Les funérailles du roi défunt et l’intronisation de son successeur constituent de ce fait un ensemble rituel et cérémoniel de la plus haute importance : au-delà de la disparition du simple corps du souverain, son enjeu est la survie et la pérennité du pouvoir.
C’est donc une temporalité événementielle exceptionnelle qu’aborde ce livre : « l’entre-deux » de deux règnes, une histoire lestée de multiples implications et enjeux, une histoire pleinement politique aussi, puisque c’est l’essence et le fonctionnement mêmes du pouvoir qui se jouent et se nouent au moment de la mort parfois tragique (Sigismond, Henri II, Henri III, Henri IV) de celui qui incarne et exerce la souveraineté.
*
Les différents chapitres de ce volume sont organisés en trois parties. La première, intitulée « Aux origines », nous rappelle que l’histoire de la royauté ne peut s’écrire que sur un temps long. Cette institution qui, en France, a survécu durant quatorze siècles, trouve en effet ses fondements dans le très haut Moyen Âge, une période pour laquelle les sources posent de délicats problèmes d’interprétation. L’exemple des funérailles du roi Raedwald d’Est-Anglie, inhumé au début du viie siècle à Sutton-Hoo, illustre la manière dont les découvertes archéologiques peuvent suppléer l’absence de textes, tandis qu’une série de récits contradictoires viennent documenter le cas de Sigismond de Burgondie, assassiné en 523 et aussitôt vénéré en tant que martyr. Dans des perspectives très différentes, ces deux premiers chapitres révèlent le caractère exceptionnel que revêtait déjà la mort des rois aux premiers siècles du Moyen Âge. En insistant sur le lien indissociable que la royauté entretient avec le sacré, ils permettent d’introduire une série de thématiques que nous retrouverons dans la suite du volume : dès l’origine, la mort d’un roi, violente ou non, représentait un événement hors norme, qui s’accompagnait de rites spécifiques et entraînait dans son sillage la question de la succession, assortie de rumeurs et de soupçons portés contre la reine ou contre l’entourage du défunt.
La deuxième partie, intitulée « Questionnements », vise à éclairer différents aspects particuliers de la mort des rois à partir de cinq études de cas regroupées en trois thèmes : le roi assassiné, les pratiques funéraires, la régence. Dans le prolongement du cas de Sigismond, deux chapitres sont tout d’abord consacrés aux rois assassinés dans des contextes très troublés : entre pamphlets polémiques et déplorations, comment les contemporains ont-ils réagi à la nouvelle de la mort tragique d’Henri III ? comment l’annonce de l’assassinat d’Henri IV a-t-elle été soigneusement contrôlée afin d’assurer la stabilité politique du royaume ? Consacrés à des morts plus sereines, les deux chapitres suivants analysent la question des pratiques funéraires, depuis la « belle mort » soigneusement anticipée de Charles V à l’embaumement de Catherine de Médicis et aux transferts successifs de son corps. Enfin, le dernier chapitre de cette partie montre comment l’organisation de la régence a pris une ampleur exceptionnelle à la mort de Louis XIII, au point même d’éclipser l’événement des funérailles royales.
Dans la troisième partie, « Le modèle Louis XIV », de nouvelles perspectives éclairent différents aspects de la disparition du Roi Soleil : une mort spectacle, assumée comme telle par le souverain lui-même, des funérailles grandioses, les dernières de l’Ancien Régime, préparées notamment par l’institution méconnue des Écuries royales, une mort anticipée aussi, par des pamphlets et des images fabriquées par les puissances étrangères, déconstruction méthodique du roi de gloire.