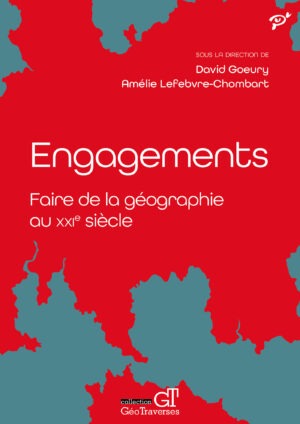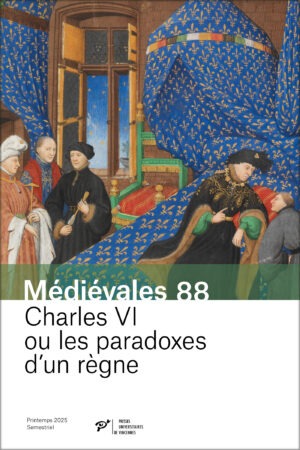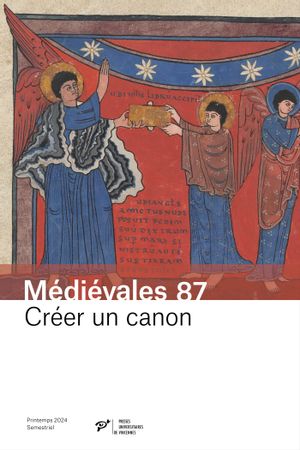Introduction
Des gares modernes, « lieux et réseaux », aux gares écologiques et métaboliques de demain
En France, depuis la thèse monumentale de René Clozier sur la gare du Nord (1941), les géographes ont fait de ces bâtiments singuliers un objet de recherche privilégié, parce qu’ils concentrent et cumulent deux propriétés spatiales particulières : le lieu et le réseau.
Étudier les gares : quels champs disciplinaires ?
Les géographes français ont fait des gares des « lieux-réseaux »
Entrez dans une gare un matin, alors qu’elle grouille de monde, ou à midi, quand elle semble sommeiller. Les qualités essentielles du lieu (place en anglais) ne vous échapperont pas. D’abord parce que la gare occupe toujours une situation géographique particulière. Elle n’est jamais exactement au centre d’une ville. On l’a construite à une position de marge que la croissance urbaine du xxe siècle a quelque peu – mais pas complètement – effacée. Ensuite, parce que la gare est toujours hautement accessible, et en même temps d’un accès parfois malaisé (stationnements compliqués, congestion automobile, trafic important de bus). Signalée de loin par des panneaux directionnels, elle fonctionne parfois comme une sorte de deuxième centre-ville qui n’en aurait pas toutes les fonctions, ou qui en aurait d’autres (cafés et brasseries, hôtels, parkings… et sex-shops). Cette gare-lieu résonne particulièrement avec d’autres lieux dans la ville (la gare routière, l’aéroport, la brasserie, le local syndical). Ainsi les géographes ont-ils eu très tôt l’intuition de la capacité germinative de ce lieu qui devient « milieu », parce qu’il « fait pousser » toute une série de bâtiments et de fonctions alentour, cités cheminotes ou tours de bureau selon les époques, si l’on veut du concret, et beaucoup de rêves aussi, si l’on se tourne vers l’art et la littérature.
À la topographie du lieu-gare s’adjoint la topologie. Dans le dernier tiers du xxe siècle, les « nouveaux géographes » ont pensé leur discipline comme une science des réseaux. Le dense maillage des chemins de fer a fourni un support idéal pour construire des outils d’analyse et de classification des formes réticulaires (corridors, lignes radiales, tangentielles, etc.) et pour réfléchir, à toutes les échelles, aux relations de constitution (ou de destruction) réciproques entre réseaux et territoire (effets tunnels et contractions de l’espace-temps, effets de barrière des réseaux). Toute une littérature d’économie et de géographie régionales suit la transformation de la technologie ferroviaire (l’école française, à ce titre, bénéficie de l’antériorité de la grande vitesse), car la gare, par sa position liminale entre les mondes urbain et ferroviaire, permet de superposer les effets de réseaux ferrés et de systèmes métropolitains. Construire une gare, et parfois une nouvelle ligne ferrée, suppose de calculer à l’avance ou a posteriori des effets (l’impact de la grande vitesse sur le tissu entrepreneurial, par exemple) et de prendre en compte les anticipations et les représentations, parfois excessivement optimistes, des réseaux d’acteurs institutionnels qui attendent un effet d’entraînement (la gare « booster »).
Les sociologues français et les gares lieux-mouvements
Nous arrivons ici aux limites entre l’étude géographique des gares et l’approche que portent sur elles les sciences humaines et sociales. Les gares sont intensément étudiées depuis l’histoire (urbaine, industrielle, des techniques, de l’architecture). Ne sont-elles pas un espace clos, ou enclavé, en tout cas en forte discontinuité avec ce qui l’entoure, et qui génère des différences de comportements, des écarts à la norme ou la fabrique de nouvelles normes, mais aussi, de nouvelles libertés ? C’est la définition même d’une hétérotopie pour Michel Foucault. Par-delà la french theory avide de réseaux et de rhizomes, la sociologie pragmatiste, dont le chef de file fut Isaac Joseph, a collaboré dès les années 1980 avec le service de prospective de la RATP pour observer ce qui se jouait dans les gares des grandes villes. Il en est ressorti une théorie des « lieux-mouvements » mettant en avant le flux, l’usager, les ambiances. Anthropologues et sociologues sont bien placés pour envisager la gare comme un lieu de passage et de brassage, un territoire de frôlements et de frottements entre inclus et exclus. Vue comme une ruche dont les voyageurs seraient les abeilles, la gare affirme depuis lors sa logique circulatoire. Miracle et mystère, elle accueille la course apparemment aléatoire des individus au milieu d’un chaos machinique qui peut parfois apparaître comme une chorégraphie parfaitement réglée. Comme pour les géographes, la description analytique par les sociologues n’est jamais éloignée d’une perspective politique ou d’un effort critique. Alors que des anthropologues pointent l’anomie et la banalisation des gares, les sociologues soulignent le rôle du transport métropolitain dans la (re)production des inégalités et son rôle de support dans l’avènement d’une société de surveillance.
Et du côté des sciences politiques ? La gare offrirait un levier de gouvernance, comme une image métaphorique non pas de la politique, mais du politique. Une gare et une chambre parlementaire se ressemblent de plus en plus : même foule à la fois pressée et sous pression, même spectacle thermodynamique (agitation et effervescence, échauffement et sentiment d’impuissance), mêmes investissements discursifs et financiers de l’État au service d’une société liquide. À quoi tient cette analogie ? La gare comme le politique offrent encore tous deux l’illusion que notre monde va quelque part. Il y a des destinations et des horaires sur le grand tableau, comme il y a des promesses sur des programmes électoraux. Et pourtant, le politique et la mobilité vivent (ou meurent) d’une implacable accélération et d’une incertitude fondamentales. D’un côté, les gares fonctionnent plus que jamais en flux tendus ; de l’autre, nos législateurs alimentent la chaudière normative sans jamais épuiser le sentiment d’urgence à agir, avec le changement climatique comme épée de Damoclès. Le citoyen achète un billet de train comme il choisit son bulletin électoral : un peu confiant, un peu dans le doute…
Les ingénieurs français et les gares
Une troisième source de connaissances constituée sur les gares réside dans les corpus construits initialement par les ingénieurs des Ponts et Chaussées selon deux grands domaines, la conception et l’exploitation. D’un côté, une culture technique fondée sur l’architecture, le génie civil, l’urbanisme et le design. Avec l’émergence d’une agence spécialisée interne à la SNCF, AREP (Architecture, Recherche, Engagement post-carbone), une vision des gares « à la française » a pris corps, des concepts typiquement hexagonaux comme « pôle d’échanges » ont été forgés et des pratiques théorisées (créer un « urbanisme d’intérieur », dessiner des « lieux capables », par exemple). Plus récemment, la même agence embrasse le pari de la décarbonation, de la sobriété énergétique et matérielle, de la biodiversité, un pari que nous testons sous un aspect scientifique dans cet ouvrage.
De l’autre côté, c’est-à-dire dans les métiers de l’exploitation des gares, de grands bouleversements s’opèrent aussi. Gérer une gare est depuis toujours une science de la fluidité, fondée sur l’agencement spatiotemporel de circulations hétérogènes (trains, piétons) qui entraînent une jonglerie d’horaires et de sillons, de dessertes et de cadencements. L’ingénierie qui lui correspond s’inscrit dans un effort permanent d’optimisation, car la thrombose ou la vacance des réseaux sont coûteuses. Ces métiers partagent une valeur cardinale, la sécurité ferroviaire. À cela s’adjoignent toutes les activités et actions qui anticipent les attentes ou besoins du « client-usager-
voyageur ». Cependant, tout se complique depuis l’ouverture à la concurrence et la transformation de compagnies historiques en sociétés anonymes. L’activité ferroviaire bascule (incomplètement, et avec des effets de balanciers) d’une industrie à une économie de service. Le métier de gestionnaire de gare se rapproche de celui de facility manager. Les compétences juridico-financières, marketing et managériales se superposent, se concurrencent, et transforment les cultures techniques préexistantes.
La gare est aussi l’affaire des architectes qui, depuis les premiers embarcadères, se sont employés à théoriser et caractériser l’urbanité spécifique de cette portion d’espace bâti dans une perspective de design urbain. Oscillant entre recherche sur l’architecture (objet d’étude) et recherche en architecture (par le projet), les concepteurs s’accordent ainsi pour attribuer aux gares une forme d’agentivité, pour partie performative, reposant sur des considérations d’ordres symbolique, esthétique, fonctionnel ou onirique. Ce bâtiment si spécifique dans la ville se voit attribuer une série de fonctions particulières :
- signifier (symboliser la présence du chemin de fer, ainsi que la puissance politique et financière des compagnies et des décideurs publics),
- servir de repère (participer ainsi de l’ordonnancement spatial de la ville, dans une approche à la fois esthétique et d’ingénierie viaire),
- faire lieu (apporter de l’animation économique et sociale, et prévenir ainsi le dépérissement d’un quartier, par exemple),
- jouer un rôle particulier dans un système de gares, selon un réseau (axial, corridor, étoile).
Analysée dans ses dimensions fonctionnelle et morphologique, l’inté-gration urbaine ou l’intégration ferroviaire des gares n’est pourtant pas acquise. Elle relève davantage d’un processus de négociation, sans cesse renouvelé.
On retient de ce premier tour d’horizon très simplifié une première boussole qui pourrait avoir quatre branches. Sur une ligne horizontale, la tension entre la gare-point, lieu et milieu (réel ou virtuel) et la gare-mouvement (flux matériels et immatériels). Sur une ligne verticale, deux perspectives scientifiques opposées : en bas, observation, description, taxonomie des gares, bref, un mode de production de la connaissance fondamentale fondé sur le paradigme des sciences naturelles, dont est justement née la géographie ; en haut, l’ingénierie entendue comme production de connaissances appliquées tournée vers l’action (optimiser ou réformer le fonctionnement des gares). Ce schéma dessine quatre quadrants avec lesquels les chercheurs peuvent choisir de construire des perspectives analytiques ou prescriptives, utopiques ou critiques.
Chocs environnementaux et contrechocs épistémiques
La vulnérabilité environnementale des infrastructures ferroviaires
Les dérèglements climatiques globaux induisent une série de risques que les acteurs ferroviaires connaissent depuis longtemps, mais qui croissent en intensité et en brutalité, et qui se cumulent. Ainsi, les gares et les lignes ferrées sont fortement exposées : risque de submersion marine et d’inondation fluviale, fragilisation des composantes électriques et métalliques aux vagues de chaleur, méga-feux incontrôlables, ouragans, etc. Ces risques (qui ne sont que très partiellement « naturels ») créent des menaces d’un nouvel ordre, des risques en cascade qui articulent de manière complexe l’environnement, le digital et l’énergie. Enfin, ces risques retentissent dans différents champs de la sécurité ferroviaire (le domaine technique) et de la sûreté (la partie qui s’occupe de l’intégrité et de la tranquillité des personnes).
Approfondir le concept de résilience environnementale des gares
Les opérateurs et gestionnaires de gare promettent de construire des stratégies de résilience. Ils se convertissent de grands consommateurs d’électricité en futurs producteurs. Les gares passent du statut de fardeau (elles consomment entre le quart et le tiers des besoins électriques de la SNCF) à gisement. Avec leurs surfaces de dépôts, de hangars et de parkings, elles offrent des superficies aptes à produire de l’énergie renouvelable, tandis que l’éolien intéresse d’autres gestionnaires qui valorisent les emprises foncières des gares. Dans cet ouvrage, nous observons comment les savoirs de conception ou d’adaptation des gares intègrent progressivement des compétences d’énergéticien. Nous étudions la montée en puissance des questions de rareté, de cherté relative des ressources énergétiques, ainsi que les programmes expérimentaux d’innovation industrielle. Ces derniers redéfinissent à la fois la gare et les manières de façonner cet objet qui est en même temps lieu et réseau dans l’optique d’une planification écologique.
Les cadres théoriques et les modes d’expression associés aux transformations éco-énergétiques des gares peuvent varier considérablement : à l’une des extrémités du positionnement, des start-up rêvent de la gare zéro-
carbone ; à l’autre, des ingénieurs de réseau considèrent combien l’infrastructure ferroviaire a créé la catastrophe anthropocène et tendent à réparer une sorte de dette morale en imaginant des gares « low energy low tech ». Ces mutations montrent que les savoirs, les imaginaires et les affects n’évoluent pas dans des champs totalement distincts, d’où l’importance d’un regard des sciences humaines et sociales. Mais, pour ce faire, on aurait tort de se débarrasser du sujet en taxant trop rapidement l’écologisation des gares de stratégie de greenwashing destinée à convaincre que le train est un transport décarboné (l’affirmation est en effet discutable), en vue de donner bonne conscience aux opérateurs qui s’engagent dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cette dimension « marketing » n’est toutefois pas inexistante et nous en parlons aussi dans ces pages, mais elle s’accompagne d’autres mouvements, moins visibles peut-être, et que cet ouvrage tente de mettre à jour. En parlant désormais de sobriété, d’optimisation ou de mitigation des impacts environnementaux, les ingénieurs ferroviaires tentent aussi de percer sur les marchés internationaux, fort concurrentiels, et prennent très au sérieux ce chantier (qui est donc tout autant scientifique qu’économique et moral) d’une nouvelle « railway ecology » (écologie du chemin de fer).
Les potentialités de la railway (station) ecology
Parler de tournant écologique des gares ou, plus ambitieusement, affirmer la possibilité et la nécessité d’une écologie ferroviaire qui comprendrait en son sein une partie dédiée aux gares est une perspective que nous proposons d’explorer du point de vue de ses cadres épistémologiques et idéologiques, de son outillage conceptuel, de ses méthodes d’expérimentation et de ses stratégies d’application. Un tel champ de savoirs et de savoir-faire s’appuierait sur deux orientations : l’une est (éco)sytémique, l’autre métabolique.
L’approche éco-systémique considère que la gare est un système de moins en moins clos et monofonctionnel, et de plus en plus connecté à d’autres systèmes (énergétiques, écologiques, économiques). Ainsi, à l’instar de tout ensemble bâti et non bâti de quelque ampleur, une gare peut être envisagée comme un milieu (oikos), c’est-à-dire une entité incluant espèces et communautés ainsi que leur environnement biotique et abiotique. Selon ces différentes approches en géographie, dans les sciences sociales, en architecture et en ingénierie, une gare ne constitue pas une série d’habitats écologiques par défaut, pour quelques pigeons, rats ou grillons. Et elle n’est pas naturelle au sens où des états de nature précéderaient sa construction ou lui succéderaient. Non, ce que nous affirmons, c’est qu’une gare, qu’elle soit rurale ou urbaine, fonctionnelle ou abandonnée, représente un assemblage vivant et qu’elle fonctionne comme un éco-système. Elle peut donc être analysée avec les outils classiques de l’écologie : chaînes trophiques, trames vertes et bleues, etc. Cet ouvrage propose quelques points d’entrée dans ce sens. En outre, il valorise la plasticité du terme « système », car nous sommes convaincus qu’une écologie ferroviaire ne se constituera pas sans prendre en compte la réalité socio-technique déjà constituée des gares, en tant que systèmes technologiques et systèmes d’acteurs.
L’inscription des questions énergétiques dans la réflexion sur les gares résilientes permet également une approche métabolique. Habitués à se penser comme des gendarmes des flux piétons ou des circulations de trains, les métiers techniques des gares considèrent désormais ces bâtiments comme abritant d’autres flux (impulsions électriques, masses de données, courants d’air caniculaires, migrations d’espèces naturelles, etc.). Cela crée de vraies ruptures cognitives. Précédemment, ces acteurs voyaient la gare comme un circuit fermé dont ils dominaient tous les mouvements : flux piétons, graphiques d’occupation des voies à partir des centres opérationnels et des tours d’aiguillage. Désormais, la gare est traversée de part en part, les flux entrent et repartent au-dehors… ou pas.
L’approche métabolique résulte de la montée en puissance des approches calculatoires et des normes d’émission (carbone, gaz à effet de serre). L’ambition d’une gare sobre du point de vue de la consommation de ressources (extractives, constructives) émane d’une perspective semblable d’identification et d’évaluation quantitative et qualitative des entrées et sorties d’un système gare. L’idée est de réutiliser, restituer ou compenser ce qui est pris à la « nature ». Cette approche ouvre grandement les échelles d’analyse et complique les calculs : du bâtiment gare au quartier, du quartier à l’îlot (construit, ou à l’îlot de chaleur urbain) et, de proche en proche, jusqu’à la bio-région. Dans ce contexte, la pensée circulatoire emboîte les échelles sans fin, puisque la thermodynamique étend ses boucles de circulation et de rétroaction jusqu’à la planète. Une écologie des gares nécessite donc des ruptures épistémiques et méthodologiques dont cet ouvrage cherche à pointer les défis, les difficultés, mais aussi les potentialités. Nous ne doutons pas qu’en manipulant de nouveaux équipements techniques (la conception BIM) et de nouvelles notions (sobriété, compensation carbone, compensation écologique, prévention des événements climatiques exceptionnels), l’idée de gare va être réinventée, dans sa morphologie – en l’associant plus fortement avec des systèmes en réseau : habitats naturels, systèmes sociaux localisés – comme dans ses fonctions – rôle climatique, services éco-systémiques. Il pourra en ressortir de nouveaux services – accueil des usagers, informations, sécurité, confort, offre intermodale, bref, les promesses que l’on doit à l’« usager-client-voyageur » – et d’autres réalités normatives – les promesses que l’on doit au client-opérateur de train : alimentation énergétique, services informatiques, base de vie des personnels navigants, etc.
Enfin, la railway station ecology n’émerge pas aujourd’hui par hasard ou par erreur. Elle est un effet de la poussée de la planification écologique dans les politiques publiques du transport (au même moment, on prétend décarboner la route et on diffuse des conceptions plus vertueuses des aéroports). Mais nous défendons l’intérêt d’une réflexion spécifique sur les gares, quitte à revenir dans un deuxième temps vers d’autres lieux du transport.
Il y a deux raisons à cela. D’abord, il n’y a pas de rails dans le ciel. L’industrie aérienne a besoin de « nœuds » au sol, mais ses réseaux n’ont pas besoin de la même « infrastructuration » que l’industrie ferroviaire, ce qui modifie totalement les questions éco-systémiques et métaboliques. Ensuite, les aéroports ont en moyenne cinquante ans d’existence, tandis que les gares sont souvent de vieilles dames à l’âge respectable de 150 ans. Le monde ferroviaire fonctionne sur des cycles d’immobilisation financiers beaucoup plus longs que l’aérien, et il se connecte avec des circuits capitalistiques assez distincts, car les pouvoirs urbains financent fortement la renaissance des gares comme levier de quartiers entiers. Ainsi, il est capital de cerner comment le mouvement d’écologisation des gares coïncide avec un moment historique de réinvestissement dans l’infrastructure physique du rail : l’écologisation se combine avec un besoin de « régénération des gares », expression elle-même plurisémique. Pour un architecte du ferroviaire, elle s’entend à la fois dans le sens de la modernisation infrastructurelle (remplacer voies et ballasts) et dans celui de la rénovation bâtimentaire, porteuse d’une meilleure adéquation de l’édifice aux besoins et aux usages. Pour les économistes du ferroviaire, elle représente des sommes considérables qui doivent être aujourd’hui orientées vers la recapitalisation de réseaux ferrés obsolètes, parfois abandonnés, quelquefois rouverts au prix de coûteux investissements régionaux ou locaux. Deux chapitres de l’ouvrage travaillent la question qui consiste à penser le ferroviaire hérité au futur : l’un en expliquant en quoi les gares représentent un facteur essentiel de stabilisation des anticipations de création de valeur aux yeux des grands investisseurs publics et privés qui prennent aussi ce tournant écologique par la titrisation verte ; l’autre en montrant les opportunités offertes par la perspective de renaissance d’une gare du point de vue d’acteurs politiques d’une moyenne montagne en déprise.
Les gares présentent donc l’avantage de nous donner à penser le concept de cyclicité infrastructurelle à la fois depuis l’économie ferroviaire et depuis l’écologie ferroviaire. Un vocable permet de tenter cette approche conjointe, c’est le terme « rafraîchissement ». Une approche plus écologique des gares permettra de les utiliser dans des conditions climatiques que nous ne connaissons pas encore très bien, mais que nous percevons déjà lors des grosses vagues de chaleur par exemple (un chapitre de l’ouvrage y est consacré). Autre acception du terme « rafraîchissement » : l’écologisation des gares accompagne leur réaménagement. Il s’agit du rafraîchissement porté par les métiers du bâtiment à travers une rénovation sans transformation de la structure bâtie. Car il est certain que la planification écologique fera avec les bâtiments déjà là bien davantage qu’avec des prototypes architecturaux (un autre chapitre ouvre cette discussion). Enfin, au sens commun, le rafraîchissement d’une page internet signifie sa mise à jour. Dans cet ordre d’idées, une gare rafraîchie est une gare remise en phase, reconnectée avec les flux de connaissances, de compétences, et avec les contextes juridico-techniques du moment.
Ambitions intra et transdisciplinaires de l’ouvrage
Cet ouvrage trouve sa place dans la collection « GéoTraverses » parce qu’il veut montrer comment, partant d’un objet que la communauté géographique couvre bien et depuis longtemps, un dialogue avec des domaines d’expertise connexes peut ouvrir de nouvelles pistes d’exploration fécondes.
Ces pistes existent au sein de la géographie. Notre approche des gares reflète la spécificité du positionnement de la géographie à l’articulation des sciences naturelles et sociales. Bien au-delà de la géographie des transports stricto sensu, cet ouvrage s’adresse aux chercheurs en géographie climatique, en biogéographie, et nous voudrions qu’il renforce donc des liens intradisciplinaires. Aux géomaticiens, il montre des avancées et peut-être des innovations, tant conceptuelles que méthodologiques, en matière de modélisation (voir le chapitre sur le green transit oriented development). Aux géographes du fait social et aux spécialistes des études urbaines et territoriales, il montre combien des recherches sur les infrastructures peuvent embrasser des considérations cliniques et critiques sur l’expérience subjective ou la corporéité.
Cet ouvrage porte aussi une ambition interdisciplinaire et appelle à relier la géographie à d’autres champs (architecture, urbanisme, aménagement, économie) ainsi qu’à des sciences des réseaux d’ingénierie ferroviaire et digitale. C’est la raison pour laquelle, par-delà l’utilisation assez classique de l’emboîtement des échelles d’analyse avec laquelle les géographes sont familiers, nous avons choisi de valoriser des travaux qui mobilisent deux domaines de la théorie.
Le premier domaine est l’analyse et la cartographie de l’acteur réseau et de son organisation en systèmes multiniveaux. Cette entrée offre des outils de conceptualisation et de représentation des interactions entre les multiples « choses » vivantes et non vivantes qui sont et qui font les gares, et qui permettent de passer de la gare nœud de réseau à la gare réseau de réseaux.
Le deuxième domaine renvoie à l’approche socio-technique des infrastructures, un champ dans lequel le ferroviaire occupe déjà une place éminente et ancienne. Cet ouvrage participe au virage de ce domaine vers une approche éco-socio-technique, c’est-à-dire vers une pensée qui intègre les différentes formes de transition (énergétique, urbaine, etc.) et les questionnements autour du sens de ces transformations. Le terme « sens » est évidemment à prendre dans sa dualité (signification et direction). La transition est pensée comme un chemin, ce qui permet de situer le rôle des gares au sein d’une réflexion sur les sentiers adaptatifs. La transformation énergétique des gares peut être étudiée depuis l’idée de niches qui diffusent – ou pas – des expérimentations au sein de régimes d’innovation. Cette perspective positionne les gares désormais « verdies » à l’articulation de transformations réglementaires, de processus organisationnels, de dynamiques territoriales et de bien d’autres facteurs où les questions de connaissance et de pouvoir sont centrales. Il nous paraît essentiel que les géographes apportent leur voix à cette écologie politique de l’innovation et investissent les cercles où ces débats mobilisent leurs savoirs sur les héritages infrastructurels (l’histoire et la spatialité des réseaux ferrés), sur leur état contemporain (dégradation, obsolescence, diversification formelle et fonctionnelle), et sur leur avenir.
Structure de l’ouvrage
La première partie explore les interactions entre les gares et la biosphère. Elle propose des textes qui considèrent les échanges entre des réalités vivantes extérieures à la gare (par exemple des habitats naturels, avec Alexandre Auvray et al.). Les recherches soulignent les relations à la fois positives et négatives pour la qualité de l’environnement ou la fonctionnalité de la gare : par exemple, les gares et réseaux ferrés sont des barrières bien identifiées pour les migrations d’espèces, mais les corridors ferroviaires peuvent servir dans certains cas à la mobilité d’autres animaux (Auvray et al.). Certains travaux montrent que la production de réseau a façonné, sur le temps long, certains sites que nous voyons comme naturels (les forêts ferroviaires du Japon par exemple, avec Corinne Tiry-Ono). Cette partie intègre la question de la perception sociale et culturelle des marqueurs d’artificialité ou de naturalité des gares.
À travers des contributions consacrées au réemploi des pierres de taille ou à la valorisation des roches excavées lors du creusement de gares souterraines (Salwa Cherkaoui El Baraka), la deuxième partie souligne l’intérêt renouvelé de l’ingénierie pour une utilisation plus sobre des ressources naturelles. Nous avons encore une fois pris soin de souligner combien ce type de pratiques est à la fois inscrit dans un héritage ferroviaire (Pauline Detavernier et Alexandrina Striffling-Marcu) et, en même temps, combien il implique un saut radical dans les manières de concevoir et de modéliser les gares (Nils Le Bot). Ce saut qualitatif ne se réalise pas partout avec les mêmes formes d’inscription dans les stratégies économiques ou territoriales des compagnies. Les facteurs normatifs et les pratiques professionnelles existantes offrent selon les cas des résistances, des verrouillages ou des appuis à l’incorporation des innovations dans les logiques de production conventionnelles des gares. Une bonne partie du travail à réaliser se trouve dans les domaines de la socialisation et de l’institutionnalisation des innovations et de l’apprentissage collectif.
La troisième partie envisage l’environnement des gares depuis des travaux sur la revégétalisation, l’insertion paysagère et la mise en avant des qualités sensorielles des gares. Nous avons pris soin de décaler la focale par rapport à des sujets peut-être davantage attendus comme l’insertion paysagère des gares dans des sites naturels protégés ou le fleurissement et l’ornementation végétale des bâtiments voyageurs. Nous avons aussi opéré deux choix. L’un consiste à privilégier des travaux qui défient la toute-puissance de la visualité, ce qui ouvre à une approche plus éco-phénoménologique (ambiances, atmosphères). C’est ainsi que l’on trouvera une réflexion sur les paysages sonores des gares et leurs effets en matière d’inclusion ou de discrimination sociale (Thibaut Carcano). Le deuxième choix est de valoriser la dimension subjective du terme « paysage » et de s’intéresser à la conversion des gares en valeurs futures, ce qui ouvre à d’autres connexions entre écologie, design et forces de marché (Étienne Riot). On propose à ce sujet un texte sur la financiarisation des gares, un autre sur le transit oriented development et le verdissement de gares en série (dans le cadre d’un corridor métropolitain), et encore un texte sur la traduction des objets matériels présents/absents en gare, sous la forme de traces, dans un éco-système numérique (Arina Rezanova).
La quatrième partie n’oublie pas que l’humain, singulier et collectif, se tient au centre de la nouvelle nature des gares : l’usager affairé et mécontent, et aussi le sans-abri constamment rejeté de la gare (Noélia Voiseux) ; l’ingénieur-concepteur dans son laboratoire, nourri de belles intentions, et le cheminot, tout en bas de l’échelle, pris parfois dans les contradictions du management ; l’autorité politique, qui défend un territoire fragile et qui rêve de relever une gare abandonnée (Maddalena Ferretti et al.), ou bien l’artiste, fasciné par la gare en ruine et ensauvagée, et par son potentiel esthétique (Christelle El Hage). Nous avons réuni toutes ces voix dans cette partie afin de montrer qu’une écologie des gares ferait bouger bien plus que des technologies (Halina Veloso e Zarate et Manuella Triggianese). Elle impliquerait d’engager des chercheurs et des décideurs à travailler ensemble sur le long terme, sans quoi il n’y a pas de fondement durable à notre vie de citadins mobiles.