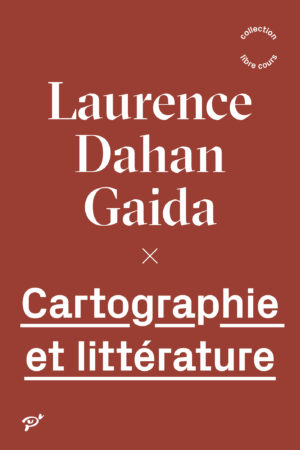L’instinct du constructeur
Avant-propos
Lire, fidèlement, un texte de Michon, ce serait entrer dans la logique de cette épaisseur [d’écriture], y retrouver les gestes, ou chemins d’une grande chorégraphie signifiante.
Jean-Pierre Richard
« Il y a quelque chose qui n’est pas humain ou qui est trop humain et qui me porte quand j’écris », déclarait Pierre Michon en 1999. Et il ajoutait : « Vous savez ce qui est merveilleux avec toutes les mythologies antiques et romantiques de l’inspiration ? Elles vous permettent de n’être pas vraiment concerné par ce que vous avez écrit. » À la limite, l’œuvre se donne pour Michon comme un fait accompli presque à son insu, au terme d’une « opération d’écriture […] à la fois surdocumentée et complètement traitée dans le noir ». Sinon, précise-t-il, « j’aurais l’impression que ça ne me tombe pas du ciel. Or il faut que j’aie l’impression que ça me tombe du ciel ».
Ce dispositif spécial, cette prodigieuse « machinerie » michonienne d’où naissent « plaisir d’écrire » et « fantasme de créateur hors du temps » ne pouvait manquer de susciter un désir infini de commentaire. Mise au défi d’en explorer les arcanes, encore relancée par la publication d’entretiens qui ont révélé « d’un seul coup les grottes et les gisements sur lesquels cette œuvre s’est bâtie » puis par le succès des Onze, l’exégèse – autre machinerie – tourne désormais à plein régime, multipliant les angles d’étude au gré de nombreux colloques et ouvrages collectifs. C’est que la matière « érudite et carnavalesque » du mince corpus michonien « convoque […] à [son] écoute toutes les formes d’approche critique », comme le rappellent les organisateurs du colloque de Cerisy, pour qui « ce sont toutes les grandes questions de la littérature d’aujourd’hui que cette œuvre remet en perspective ». Approches et questions si nombreuses en vérité qu’il est impossible de les détailler ici. Qu’il me suffise de mentionner l’exploration du matériel génétique, de la « variété générique », de l’intertextualité, l’étude du rapport au biographique, à la littérature ancienne ou contemporaine, à l’archive, à l’érudition, à l’histoire, à la langue, à la rhétorique, à la théorie (littéraire ou picturale), à la psychanalyse, à la sociologie, à l’anthropologie, à la théologie, à toutes sortes de savoirs.
Or il me semble que si une telle diversité de démarches est indispensable, l’espèce de diffraction qu’elle engendre pourrait distraire de ce qui, justement, dans l’œuvre dense et chatoyante de Michon, fait œuvre. Les études de Jean-Pierre Richard sur Rimbaud le fils et Vie de Joseph Roulin évoquent une « logique en devenir », une « grande chorégraphie signifiante ». C’est sur ce terrain que je tente de me situer en interrogeant la « profonde nécessité non dite » qui habite les livres de Michon, cette « monotonie » très particulière qui unifie étroitement les éléments constitutifs de son inspiration tout en les colorant chaque fois diversement. Entreprise semée d’embûches mais à laquelle la longue « crise » tardivement dénouée des Onze donne une chance d’aboutir parce qu’elle oblige à considérer dans sa logique interne un parcours, il est vrai, plein de contradictions et de surprenants « rebondissements ».
Dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Proust évoque à propos de Bergotte ce profond « instinct du constructeur » de l’écrivain, capable de reconnaître la « vérité » d’une page à la « joie » qu’elle lui procure – et qui en est, dit-il, la « preuve ». Joie ou sentiment d’évidence nés de l’adéquation mystérieuse entre la chair de l’œuvre (motifs, images, rythmes propres, « mots-fantasmes », personnages, couleur) et son architecture, son dessin (son disegno), c’est-à-dire une dimension plus intellectuelle, préméditée et donc a priori moins « instinctive ». Chez un grand écrivain, la construction est toujours et partout au travail, effet d’une nécessité créatrice, indivisiblement substance et structure et dont la puissance est telle que son serviteur ne peut que se laisser mener par elle, en somnambule, vers sa propre vérité.
C’est pourquoi le labyrinthe où Michon nous fait cheminer avec lui paraît en quelque sorte hors du temps, comme si un secret principe organisateur (appelons-le l’Œuvre) en gouvernait à l’avance – quoique de manière imprévisible – tous les détours. Dans ces « blocs de prose » qui ne se laissent guère périodiser, l’exégète ne peut d’ailleurs s’appuyer sur aucune chronologie fiable pour repérer les éléments d’une hypothétique « évolution ». Même les dates de parution ne signifient pas grand-chose. Avec Les Onze, le cas peut-être le plus flagrant du décalage entre dates d’écriture et de publication est L’Origine du monde, commande de Jacques Réda pour La Nouvelle Revue française. Le livre ne parut qu’en 1996, sous le titre La Grande Beune, alors qu’« à l’insu » de son auteur, il était achevé depuis 1988. Et quand, la même année, Vie de Joseph Roulin sort en volume chez Verdier, le cycle que semble inaugurer ce livre est en fait largement entamé : deux des textes de Maîtres et serviteurs ont été publiés en revue deux ans plus tôt. Quant au Roi du bois (Verdier, 1996), dernier récit de la série, c’est en 1992 qu’il a d’abord paru – et encore n’est-ce qu’une date d’édition. Et ce ne sont pas les seuls exemples.
Ces particularités resteraient anecdotiques si l’on n’en retirait pas l’impression troublante que les écrits de Michon, y compris ceux non encore parus, sont tous « contemporains » les uns des autres, pans détachés, selon une maturation inégale, du monument encore invisible de l’Œuvre : tout entière déjà là et à venir ; remise en chantier permanente, dans le doute et l’inquiétude, de questions toujours en suspens jusqu’au moment où, selon l’expression de Michon, ça marche. Chez lui tout se tient, peut-être parce que tout est mené de front, ce que l’écrivain, quand on lui demande d’évoquer son « parcours », formule ainsi : « je suis toujours le même, je n’ai pas la chance de pouvoir changer de main, comme Pessoa ».
*
L’histoire accidentée des Onze, dont j’ai eu la chance de suivre la reprise et l’achèvement pendant l’année qui a précédé sa publication, lève un peu le voile sur le mécanisme qui vient d’être évoqué. Les crises sont toujours éclairantes et celle-ci fut de taille. En 1996 et 1997, peu de temps après la parution de La Grande Beune, Michon avait publié dans des revues assez confidentielles les premiers chapitres, rédigés des années plus tôt, de son « roman » sur la Terreur. Le troisième, plus accessible que les deux autres car mis en ligne par Verdier, laissait le lecteur sur la vision saisissante du tableau éponyme, où s’alignent, encadrant Robespierre, les membres du Comité de salut public. Mur de peinture définitive, infranchissable, devant lequel, terme cher à Michon, on ne peut que rester « baba », le tableau de 1794 se dressait donc devant le lecteur médusé à la fin du troisième chapitre. Puis plus rien, comme si, piégé par cette perfection, l’auteur n’avait pu que s’effacer, nous laissant déchiffrer la « tartine » biographique, placée là comme un leurre ou un défi, à l’usage des visiteurs du musée. Nulle « vulgate » (c’est le mot utilisé dans Rimbaud le fils) ne pouvait être invoquée ou prise à rebours à propos de Corentin, son auteur : il avait fallu en forger une de toutes pièces pour nous faire croire « imparablement » au chef-d’œuvre de ce peintre imaginaire, exception à la règle jusque-là observée du point de départ réel.
De temps en temps, quand on l’interrogeait sur Les Onze, Michon mentionnait des « coups d’essai » catastrophiques : sur David d’abord puis sur « un épisode de la Révolution dans la Creuse ». En 1994, il est question d’un nouveau départ pour ce texte dont Michon se dit « amoureux », avant que le projet (« un peu téléfilm » et qui « plaisait » pour de mauvaises raisons), ne soit enterré : « ce livre, commencé en 1993, ne sera jamais fini ».
Pendant que restait en panne, obsédante sans doute, l’histoire du tableau de François-Élie Corentin, paraissaient des textes dans lesquels se perçoivent des échos assourdis de l’échec provisoire des Onze. Il y a dans Le Roi du bois, par exemple, quelque chose comme un règlement de compte avec la peinture, d’autant plus que le récit de Desiderii, disciple raté de Claude Lorrain, est à la première personne et non dépourvu de la tonalité fortement autobiographique propre à Vies minuscules et à La Grande Beune. D’autres indices annoncent ce qui se dénouera et permettra l’achèvement des Onze, comme le motif récurrent des reliques ou, dans le texte de Corps du roi consacré à Flaubert, celui de l’Œuvre tueuse.
Les Onze, donc, ne se laissait pas mettre de côté ; de fait, le livre « insista » si bien que son auteur se remit au travail. Je l’ignorais quand, séduite par le chapitre trois, je commençai à prendre des notes pour un article, sans trop savoir où me mènerait l’idée bizarre d’écrire sur un texte non seulement inachevé mais renié avec véhémence par son auteur. Michon apprit mon projet par hasard (je lui avais demandé une préface pour mon livre La Figure du monde) et il m’engagea à le poursuivre et même à lui soumettre sans délai ce que j’avais fait : « Expliquez-moi ce texte ! »
Étrange requête mais qui, je crois, rend bien compte de ce dont je parlais en commençant. En publiant les premiers chapitres (j’avais entre-temps lu les deux autres malgré son véto), Michon les avait éloignés de lui. Dans quel but ? S’en débarrasser ? Je crois plutôt que c’était une façon de les mettre en jeu, exposés et cachés à la fois, peut-être pour que quelque curieux allât y voir, sans se laisser intimider par le déni officiel. Mais qu’est-ce qu’un lecteur arrêté au chapitre 3 pouvait bien percevoir d’utile ? Sans doute l’ignorance de ce qui avait été voulu, prémédité, intéressa-t-elle Michon à ce stade, d’où sa demande d’une réaction instinctive, « à chaud ».
Ce qui me frappa d’emblée ne se réduisait pas à la nouveauté d’un peintre fictif, difficile à ranger aux côtés des Goya, Van Gogh, Watteau, Lorenzino ou Desiderii, dont l’histoire était ordonnée à la question « qu’est-ce qu’un grand peintre ? ». Outre l’étrangeté d’une interpellation du lecteur au présent – présent d’une expérience commune en train de se construire –, la surprise venait de la place prise par le tableau, aux dépens de ce qui semblait jusque-là primordial dans l’œuvre de Michon : la « vie », le destin de l’artiste. Comme l’annonçait déjà le titre, on pressentait que loin d’être l’objet du récit, la biographie de François-Élie Corentin, sa généalogie hybride, serait subordonnée au chef-d’œuvre, chargée de l’éclairer. D’ailleurs, là où habituellement se joue l’essentiel : le moment du basculement, de l’élection, le récit présentait un « inexplicable trou ». Les Onze s’étant arrêté à ce point bien avant que Michon en eût fini avec les questionnements qui avaient mené à Vies minuscules, il n’était pas interdit de supposer que l’irruption avant l’heure du « fétiche à onze têtes » avait engendré le « cadenassage » de l’entreprise, si longtemps crue « damnée » par son auteur.
Il fallut encore six mois à Michon pour accepter le sacrifice des « vies » aux « exigences égoïstes » de l’œuvre. En tant qu’« exégète autorisée, prématurée et nécessaire de cet ouvrage fantôme », je pouvais me « rassurer » : le chapitre suivant serait un retour sur les circonstances de la commande, nous n’en saurions guère plus sur le Limousin au double prénom, « le « trou demeure[rait] ». Ce choix me plut même si je ne pouvais alors en mesurer la portée.
Je reproduis sans y rien changer ma petite étude de 2008, d’abord parce que la circonstance de l’exégèse prématurée est tout de même curieuse ; et aussi parce que s’y trouvent des intuitions que l’article écrit l’année suivante sur l’œuvre achevée ne pouvait reprendre telles quelles. La lecture des Onze, enfin publié au printemps 2009, confirmait que Corentin n’était pas le « sixième peintre de Pierre Michon », contrairement à ce qu’indiquait mon sous-titre ; du coup, l’analyse proposée dans un chapitre de mon livre paru en 2008 devait être modifiée. Non sur l’essentiel (la cohérence d’un ensemble de peintres liés par un réseau serré d’interrelations), mais parce que la clôture de la série avec Le Roi du bois (le cinquième peintre) dégageait d’autres lignes de force. Avec le recul, l’ensemble ne m’apparaissait plus seulement comme un « polyptyque » – que pourraient compléter à l’infini d’autres « vies de peintres » – mais comme un système aussi refermé sur lui-même que Vies minuscules : un triptyque dédié à Van Gogh (« saint Vincent »), figure maîtresse, la première émergée du cycle, autour de laquelle se disposent les quatre autres selon une rigoureuse symétrie. Le remaniement du chapitre qu’on lira plus loin doit donc beaucoup, comme le reste, à l’éclairage apporté par Les Onze, qui révèle une construction jusque-là invisible au lecteur et sans doute à l’auteur lui-même.
Les Onze est au cœur de cet essai parce que s’y retrouvent en outre, imperceptiblement décalés par un changement de perspective ou d’éclairage, la plupart des thèmes et motifs de prédilection de Michon, eux-mêmes comme « travaillés » en secret par le livre à venir pendant les longues années de sa gestation. Les Onze est une histoire de peintre, comme les récits parus entre 1988 et 1996 : Vie de Joseph Roulin, Maîtres et serviteurs et Le Roi du bois. Par bien des traits (l’âge, l’origine limousine, etc.), la biographie et même l’autobiographie n’en sont pas absentes. De l’aveu même de l’auteur, Corentin lui ressemble bien davantage que les Van Gogh, Goya, Watteau, Lorentino, Desiderii dont la réinvention avait répondu à un double besoin : se voir soi-même autrement, de biais mais aussi, en traitant à égalité le raté et le génie, interroger le mystère de l’élection. « Il a fallu que j’en passe par la peinture, a expliqué Michon. C’est étrange. » Mais dans Les Onze, le destin de l’artiste ne se donne plus qu’en creux.
Le chapitre intitulé « Devant le tableau » s’attache à montrer l’apport de ce livre : au bout de toutes ces années, la foi en l’Œuvre pouvait enfin s’avouer sans réserves. Non qu’elle eût jamais vraiment fait défaut à Michon, étant le moteur déjà, quoique en partie inconscient et « à éclipses », de Vies minuscules. « C’est la galère. Mais la mer est belle », répondait-il en conclusion à un entretien en 1992. Dans le texte de Trois Auteurs consacré à Balzac, « que la Grâce a tenu par la peau du cou pendant quinze ans », cette confiance est réaffirmée en dépit des obstacles et des désillusions : « Qu’importe qu’ils soient vides, les appartements ? Reste le chemin plein d’espérance et de foi qui vous mène à leur porte. »
En cela, Les Onze – c’est encore une dimension précieuse de ce livre – s’inscrit en faux contre le terrible constat d’Anatole France qui, un siècle plus tôt, dans Les Dieux ont soif, vouait sans recours à l’échec non seulement Gamelin, son « citoyen-peintre » contemporain de Corentin mais toute peinture, son pessimisme ne pouvant admettre la possibilité d’aucun miracle. Pour Michon, au contraire, « le texte (l’art) gagne toujours ». La confrontation des deux peintres fictifs montre bien, sans minimiser l’importance du cadre historique choisi, à quel point l’invention de Corentin répond bien à une nécessité interne de l’œuvre entière.
Les Onze se place donc à l’horizon de mes analyses mais cela ne signifie pas que les livres antérieurs n’ont été abordés que dans l’après-coup d’un point de vue rétrospectif. Les études consacrées à Vies minuscules, mais aussi à Rimbaud le fils et aux autres écrits de Michon, tentent de rendre compte au plus près de ce qui tient à l’époque de leur rédaction. C’est au fil des livres que tout s’éclaire et se met en place, que les résistances cèdent. Mais un instinct sûr a préparé