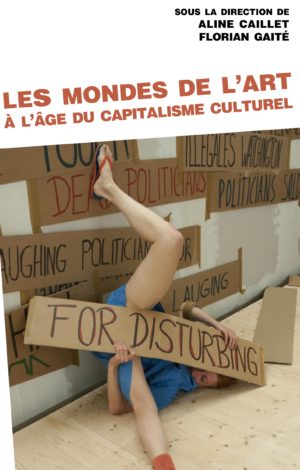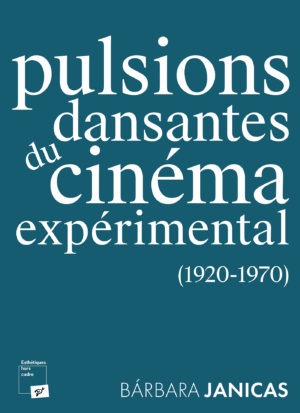Introduction
Thomas Horeau
Cet ouvrage propose d’appréhender l’esthétique du jazz au prisme de la théâtralité, c’est-à-dire de décrire le fonctionnement, les modalités de production et de réception de ses œuvres, leurs finalités et leurs fonctions au moyen des instruments de l’analyse théâtrale. Aussi le jazz ne sera-t-il pas considéré dans sa seule dimension musicale mais, plus largement, comme un phénomène culturel dont la performance musicale et scénique est à la fois le produit, le principal ferment et la manifestation exemplaire. Notre démarche s’inscrit dans le sillage des travaux qui explorent les porosités entre ces deux arts, soit en les faisant concrètement dialoguer, soit en analysant l’un à la lumière de l’autre. Bien que cet intérêt soit, en France du moins, un fait relativement récent, la référence au jazz occupe désormais une place significative dans le monde du théâtre. Depuis leur publication à la fin des années 1980, les écrits pionniers d’Enzo Cormann et de Koffi Kwahulé ont instillé l’idée que les ressources expressives et les protocoles de création du jazz sont susceptibles de fournir un modèle pour repenser la pratique théâtrale.
À toutes les époques, les artistes se sont référés à des modèles plus ou moins détaillés et plus ou moins contraignants, comprenant des formes et des préceptes ordonnés par des principes politiques, éthiques ou religieux. Le pluralisme typique de la situation postmoderne et la déhiérarchisation des pratiques qui en découle n’ont pas fait disparaître les modèles, ils les ont rendus plus diffus et ils ont, par-dessus tout, annihilé leur prétention à valoir de manière universelle. Le modèle d’aujourd’hui tend à devenir une construction singulière liée au parcours de l’individu créateur et aux finalités qu’il assigne à son art. Certes, il existe des thèmes et des formats récurrents, mais ceux-ci s’imposent insensiblement, à la manière d’une mode, sans prétendre faire autorité. La norme, en somme, enjoint chacun à se forger ses propres normes, et l’idée de filiation revendiquée s’est substituée à celle de canon imposé. Le monde du théâtre ne fait pas exception. Pour l’auteur ou le metteur en scène, il s’agit moins de s’inscrire dans un courant donné que de développer un rapport personnel à tel ou tel corpus d’œuvres et d’en extraire un propos original. La pratique de l’interdisciplinarité procède de la même dynamique, à cette différence près que l’artiste s’aventure en dehors de son champ propre, ce qui peut le conduire à redéfinir la nature et la vocation de son art. Notre époque jouit ainsi du luxe ambigu de pouvoir associer un modèle esthétique à chacune de ses œuvres.
Pourtant, au sein de ce monde de l’art où la subjectivité semble régner en maître, l’apparition d’une référence commune mérite d’être observée avec attention, qui plus est lorsque cette référence concerne un paradigme culturel et non seulement une technologie, un médium ou une démarche singulière. L’intérêt porté au jazz par le milieu théâtral n’est pas, loin s’en faut, un phénomène massif, et les raisons qui le motivent sont multiples, mais cet attachement commun à une esthétique, à l’histoire et aux valeurs qu’elle charrie pose question. Quelles conceptions du jeu le jazz véhicule-t-il ? Quelles sont ses potentialités théâtrales ? En quoi peut-il répondre à des préoccupations de la scène contemporaine ?
Dans la plupart des études consacrées à ces questions, la méthode consiste à analyser le travail d’un ou plusieurs artistes du théâtre se réclamant du jazz, en décrivant la manière dont ce dernier est utilisé et en théorisant les analogies entrevues dans la pratique. Cette approche est féconde dans la mesure où elle met précisément en exergue ce que le jazz « peut faire au théâtre » et, par extension, ce qu’il peut lui apporter. Les potentialités théâtrales comprises dans l’esthétique du jazz se révèlent à travers l’analyse des processus d’appropriation et des œuvres qu’ils engendrent. Le modèle jazzistique est donc en quelque sorte déduit de l’objet théâtral, il apparaît en négatif, à travers les usages qui en sont faits. À l’inverse, notre projet consiste à examiner les œuvres de jazz au prisme de la théâtralité. Non pas pour proposer un modèle global et monolithique, mais pour tenter de mettre au jour certaines virtualités encore non explorées. Si l’on prend au sérieux l’idée que le jazz peut constituer un modèle – « modèle » étant entendu ici dans le sens que lui donne Paul Ricœur soit comme un « instrument de re-description » permettant, via l’introduction d’un langage nouveau, de forger de nouvelles interprétations d’un fait –, il apparaît nécessaire de bien connaître ce langage, et d’identifier, au-delà des appropriations singulières, ce que le jazz en lui-même comprend de théâtral. Et ce d’autant plus que la distinction entre les deux disciplines n’a pas toujours eu la netteté qu’on lui reconnaît aujourd’hui. Plusieurs raisons nous incitent à privilégier cette approche. D’abord, tout simplement, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une recherche de fond. L’influence du jazz sur l’art du théâtre a donné lieu à des travaux d’importance, mais la dimension théâtrale de l’art du jazz demeure à ce jour peu étudiée. Il y a là deux perspectives complémentaires qui doivent pouvoir dialoguer.
Ensuite, depuis qu’il a suscité l’intérêt des milieux littéraires et scientifiques, c’est-à-dire dès les années 1920, le jazz a souvent été décrit comme un phénomène spectaculaire s’adressant à la fois à l’écoute et au regard. Si l’on en croit les connaisseurs, en jazz, l’expression « voir un concert » n’est pas un abus de langage, mais un oxymore qui désigne justement la nature synesthésique de l’expérience faite par les auditeurs-spectateurs. « Entendre de tous ses yeux et voir de toutes ses oreilles, propose Jean Jamin, tel serait le guide du savoir-vivre de l’amateur de jazz. Mais tel serait aussi ce qui structure la dynamique de l’exécution musicale en jazz où le geste se fait entendre, où le son se donne à voir. » Il faut peut-être avoir vu de ses yeux un artiste de jazz s’engager à corps perdu dans le jeu pour saisir le sens de ces assertions surprenantes. Car, dans les faits, ce principe de correspondance n’a rien de nébuleux. Il désigne simplement la tangibilité de l’effort fourni par le musicien et son audibilité dans le discours musical. La performance de Georges Shearing croquée par Jack Kerouac dans Sur la route donne une idée de la nature de ce travail :
Neal et moi, on est allés le voir au Birdland, au milieu de ce long week-end de folie. Dix heures du soir, l’endroit était désert, on était les premiers clients. Shearing est arrivé, comme il était aveugle on l’a conduit jusqu’à son clavier. […] Et voilà Shearing qui commence à se balancer ; son visage extatique se fend d’un sourire ; il se balance sur son tabouret ; il se décroche la tête, son pied gauche bat tous les temps, son front s’en va toucher le clavier, il renvoie ses cheveux en arrière, sa coiffure se délite, il commence à suer. La musique monte en puissance. Le contrebassiste est recroquevillé sur son instrument, et il le cogne de plus en plus vite. On dirait que tout s’accélère. Shearing se met à plaquer ses accords. Ils jaillissent du piano en cataractes, on croit qu’il va pas avoir le temps de les aligner. Ils déferlent en vagues successives, océaniques. Les gens lui crient : « Vas-y ». Neal est en nage, la sueur dégouline sur son col de chemise.
Transpiration, ravissement et frénésie des artistes, euphorie et participation de l’assistance, rien ne manque au tableau. Si l’atmosphère fiévreuse qui se dégage de cette scène doit beaucoup à l’écriture de Kerouac, la description n’a pourtant rien d’outrancier : en jazz, expression musicale et gestuelle font corps dans l’énonciation, et l’observation du travail d’enfantement du son constitue l’un des attraits de la performance. Ce texte est celui d’un connaisseur dont l’expérience esthétique du concert passe aussi par le regard. La musique n’est pas ici conçue comme un pur produit de l’esprit, le « jaillissement » des accords correspond à un engagement physique lisible dans la sueur qui perle sur les visages. Et dans ce rapport de symbiose entre le discours et sa gestation, l’auditeur-spectateur comprend le non-sonore comme une composante essentielle de l’œuvre.
Cette dimension spectaculaire ne procède pas d’une dynamique interdisciplinaire mais de la survivance d’un paradigme étranger à la classification des beaux-arts. Bien qu’il voie le jour sur le sol américain, dans un contexte moderne, le jazz prend sa source dans la conception symbiotique ouest-africaine de l’art qui a survécu au traumatisme de la déportation, au déracinement et aux siècles d’oppression. Dans cette conception, la distinction entre la musique, l’expression verbale et l’expression du corps n’a pas lieu d’être. À ses débuts, la « musique syncopée » des Noirs est liée aux danses vernaculaires, aux minstrel shows et au vaudeville américain. Ce que l’on commence à nommer « jazz » dans les années 1910 ne désigne pas seulement le genre musical en train de naître, mais la performance dans son ensemble. Les cabarets harlémites où les nouveaux rythmes s’inventent dans les joutes entre percussionnistes et danseurs de claquettes, où les sonorités rugueuses des soufflants soulignent la tension dramatique d’une pantomime, sont des lieux de spectacle. Certes, le jazz actuel n’est pas celui des grandes revues new-yorkaises que le public européen percevait comme un « spectacle total », ainsi que le rappelle Yannick Séité. L’histoire de cet art est notamment celle d’une spécialisation en tant que genre musical, la longue marche d’une pratique plurilangagière vers sa sédimentation dans la forme concert. Pourtant, on le voit dans le texte de Kerouac, même lorsque le musicien se contente apparemment de jouer de la musique, sa performance garde quelque chose de cette symbiose originaire. Ainsi, considéré dans sa dimension spectaculaire, le phénomène semble se prêter à l’analyse théâtrale.
Enfin, et c’est là le dernier motif qui préside à cette étude, ce n’est pas uniquement parce qu’il appartient aux arts de la performance que le jazz est susceptible d’intéresser les gens de théâtre. Bien au-delà de son acception musicale, c’est en tant que paradigme qu’il interroge la création contemporaine. À l’origine, dans la culture africaine-américaine, la pratique artistique revêt une dimension fonctionnelle. Socialement utile, l’activité poétique trouve sa place au sein des expériences les plus banales de la vie quotidienne. En ce sens, cette conception contredit la logique de l’autonomie esthétique et, par là même, elle remet en question un des principes fondamentaux du modernisme. Qu’il soit violemment récusé ou farouchement défendu, le principe d’une séparation de l’art d’avec les sphères de l’existence ordinaire a largement contribué à forger les conceptions qui prévalent encore aujourd’hui, bien que les mondes de l’art soient intégrés au marché global et que la culture soit administrée. Comme le résume Jean-Pierre Cometti : « […] l’art a acquis une position autonome dans l’histoire, jusqu’à conditionner la représentation que nous en avons et les théories que nous en proposons, mais il ne fonctionne pas de manière autonome ». Ce hiatus est d’autant plus problématique pour le théâtre que celui-ci charrie l’idée d’un art destiné à prendre place au cœur de la cité. La notion de « théâtre d’art » eut beau instiller ce principe d’autonomie, la séparation du théâtre avec les autres sphères de l’existence s’accorde mal avec son histoire. Plus qu’ailleurs, le spectre d’un « public absent » – entendons un public populaire, profane ou simplement extérieur au monde de l’art – plane sur ce monde comme un appel pressant à repenser sa vocation.
Ces problèmes de séparation ne se sont longtemps pas posés dans le paradigme du jazz. Dès leur apparition dans les plantations du Sud des États-Unis, les pratiques artistiques africaines-américaines ont revêtu un caractère fonctionnel. L’esthétique se fonde ici sur un socle culturel étranger à l’idée de finalité sans fin et au principe attenant d’autonomie de la sphère artistique. En outre, elle évolue ensuite au sein d’industries culturelles qui, au contraire de la logique de l’art pour l’art et de ses possibles dérives élitaires, cherchent à introduire ses productions au cœur de la vie du plus grand nombre. Et de fait, avant de s’institutionnaliser, le jazz est longtemps resté un art populaire. Plus encore, dans le contexte d’oppression raciale et d’injustice sociale qui a marqué et qui, dans une certaine mesure, marque encore la société américaine, il a fonctionné comme une instance de légitimation de la culture des Noirs, comme un pendant artistique des luttes menées sur d’autres fronts, dans les tribunaux, dans le monde du sport ou dans la rue. Ainsi, combinant les fonctions de communion, de divertissement et d’émancipation sociale, le jazz ne s’est jamais trop soucié de sa propre nécessité.
Si ce que Denis Guénoun nomme la « crise du théâtre » réside dans la déliquescence de la relation entre ceux qui le font et ceux qui s’y rendent, si cette crise va jusqu’à mettre en question la nécessité du théâtre elle-même, le jazz peut effectivement se poser en modèle, voire en remède, ainsi que le suggère l’auteur en conclusion de son essai. Il n’est pas sûr que les gens de théâtre confèrent une telle signification à leur attrait pour cette musique. Il est en revanche certain qu’on ne saurait cantonner la réflexion à des problèmes de transferts intersémiotiques et d’expérimentations interdisciplinaires. S’emparer de l’esthétique du jazz implique de se confronter à un paradigme dans lequel la séparation catégorielle des beaux-arts, l’autonomie esthétique et l’opposition entre distraction et vocation politique n’ont plus cours. Autrement dit, il s’agit, au moyen du théâtre, de déployer les potentialités d’une conception qui, pour reprendre les termes de Paul Gilroy, « refuse la séparation – caractéristique de la modernité occidentale – entre éthique et esthétique, culture et politique ». Sans aucun doute, cette spécificité culturelle coïncide avec les préoccupations du théâtre contemporain et, plus largement, avec les problématiques des arts de notre temps. Il y a là quelques raisons de tenter d’identifier les rapports d’analogies qui rapprochent ces deux arts, et de se représenter les relations qu’ils sont susceptibles d’entretenir.
Le jazz et le théâtre sont des arts de la performance, à ce titre, ils ont en commun un certain nombre de traits essentiels. Cependant, un tel constat se révèle à la fois primordial et insuffisant. Car cette évidence en appelle une autre non moins fondamentale : le jazz et le théâtre sont des arts distincts, et leur appartenance à une même catégorie ne saurait conduire à les confondre. Pour être opératoire, l’instrument de l’analyse doit instaurer une tension entre les deux termes. L’idée que le concert de jazz se donne à voir et à entendre à l’instar du théâtre et de toute autre pratique spectaculaire ne nous dit pas grand-chose. Au contraire, se demander s’il y est question de rôle, de drame, de mimèsis ou de scénographie, autant d’éléments que charrie la notion de théâtralité, permet d’examiner les rapports d’identité et de différence, et de faire apparaître des aspects méconnus de la performance jazzistique. Envisager l’art du jazz à travers cette notion, revient donc en quelque sorte à postuler une parenté dont il convient d’établir la nature, de baliser les limites, d’analyser les manifestations concrètes et, éventuellement, de concevoir les virtualités non explorées. Dans le cadre de cette étude, la notion de théâtralité fonctionnera donc comme un instrument heuristique faisant apparaître les modèles de représentation compris dans les œuvres de jazz.
« Selon le sens que l’on donne au mot théâtre, écrit Yannick Seité, l’idée d’une fraternité du jazz et du théâtre est la plus évidente, la plus indiscutable des idées. Ou bien alors la plus problématique – ce qui ne signifie pas qu’elle ne soit pas féconde, au contraire, puisque cette tension ouvre sur d’importantes questions théoriques et pratiques. » Il s’agit bien ici de mettre à profit la tension qu’implique l’association de ces deux termes afin d’élucider cette parenté aussi flagrante que méconnue, quitte à réinterroger jusqu’au sens qu’on leur donne. Aussi convient-il en premier lieu de clarifier la définition de ces termes afin de s’engager dans l’analyse muni d’un appareil notionnel opératoire. Nous proposons donc deux développements liminaires : l’un destiné à cerner l’objet « jazz », et l’autre consacré à la notion de théâtralité.
« Jazz » : cerner l’objet
Définir le jazz ne va pas sans difficulté. Le premier obstacle ressortit à l’historicité de la question. Ce que le terme désigne en 1920 ne correspond pas à ce qu’il recouvre vingt ou trente ans plus tard. Les aspects formels et les fonctions sociales de la musique ont évolué rapidement tout au long du vingtième siècle, et la pratique a souvent eu une longueur d’avance sur la théorie. Sans cesse dépassés par une forme constamment en mouvement, les critiques et les savants ont principalement adopté deux attitudes : remettre en question leurs critères définitionnels ; ou exclure les nouvelles pratiques de leurs typologies. À toutes les époques, là où certains percevaient un renouveau, d’autres diagnostiquaient une décadence. Elles-mêmes prises dans des dynamiques socio-historiques, les tentatives de définition ont rarement échappé à la normativité. Or, et c’est là le second problème, aucune norme ne saurait prévaloir à toutes les époques et pour tous les courants stylistiques. L’esthétique du jazz comporte des tendances, et non des invariants. L’expression « jazz » concerne des œuvres et des pratiques qui se ressemblent, qui sont liées par une forme de parenté – évidente aimerait-on dire –, mais dont on peine à identifier l’essence qui permettrait de produire une définition catégorique. Toutefois, si ces œuvres se ressemblent, c’est qu’elles ont quelque chose en commun. Ce trait commun, difficulté ultime, ne réside pas seulement dans le domaine musical mais dans le champ culturel, dans ce que l’on a coutume de nommer une attitude. Aussi, pour cadrer l’objet d’étude, on s’intéressera successivement au vocable en lui-même, à la définition musicale du phénomène et à cette notion d’attitude.
La première occurrence écrite avérée du terme « jazz » se trouve dans un article de Ernest J. Hopkins justement intitulé « In Praise of “Jazz”, a Futurist Word Has Just Joined the Language ». Comme le remarque Daniel Soutif, « que le jazz ait ainsi fait son entrée dans le monde, comme nouveauté linguistique plutôt que musicale, n’est pas indifférent ». Avant de prendre la signification qu’on lui connaît aujourd’hui, le mot a comporté des connotations diverses qui excèdent largement le domaine de la musique.
L’étymologie du mot a fait l’objet de discussions sans fin, mais le consensus règne désormais sur certains points : ses racines se trouvent à la croisée de termes africain (le wolof jess qui évoque l’excès et l’étrangeté), français (chasse ou chassé désignant un pas de danse) et anglais (chass : chasser, pourchasser et par extension combattre). « Autre hypothèse : la déformation de chasse beau, figure du cake-walk, devenue jasbo, surnom des musiciens. […] Tony Palmer, lui, signale qu’en argot cajun les prostituées de la Nouvelle-Orléans sont appelées jazz-belles, en référence à la Jézabelle de la Bible… En général, il y a association de jass (ou jazz) à la danse, à la vitalité, l’acte sexuel. »
Derrière ces considérations d’exégètes se cache un phénomène moins connu de rejet du vocable par les musiciens noirs. Ce fait, relevé en premier lieu par Amiri Baraka, a récemment été réaffirmé avec vigueur par l’anthropologue Alexandre Pierrepont. Dans son essai de 2002, l’auteur propose un florilège d’une trentaine de citations issues d’entretiens avec les plus grandes sommités de l’histoire du jazz. Il s’en dégage sinon une franche hostilité à l’égard du terme, du moins une remise en question de la légitimité de cette dénomination. Bien que son origine argotique n’en fasse pas un terme infamant, la généralisation de son usage à propos de l’idiome musical africain-américain est révélatrice de certaines hiérarchies culturelles. « Le mot, dit Duke Ellington, n’a jamais perdu la connotation qui lui venait des bordels de La Nouvelle-Orléans. » Nommer c’est catégoriser ; c’est, par extension, assigner à quelque chose une identité et un rôle. On ne saurait dire qui a ainsi baptisé le jazz, mais il est certain que la parole des musiciens témoigne d’une volonté de disposer librement de leur identité artistique et culturelle. Aussi ont-ils constamment oscillé entre la répudiation et la réappropriation d’un nom que personne n’avait choisi, mais qui, par la force des choses, avait fini par devenir l’emblème de toute une culture. Par conséquent, il n’y a jamais eu de rejet unanime du mot « jazz », mais plutôt une vigilance à l’égard de son emploi.
À chaque époque les musiciens se sont positionnés vis-à-vis du nom donné à leur art. Le champ jazzistique a toujours été un espace de confrontation entre des préoccupations artistiques, des intérêts économiques et des discours idéologiques. Et ces conflits se sont souvent cristallisés autour du nom. En général, les désaccords entre les musiciens traduisent à la fois un désir de reconnaissance et une méfiance à l’égard de mécanismes de légitimation qui ont quelquefois frisé la logique de récupération. Le vocable « jazz » peut-il désigner des conceptions hétérogènes ? Doit-on l’appliquer seulement à des périodes précises comme certains auteurs ont suggéré de le faire<span class="typo_Exposant CharOv