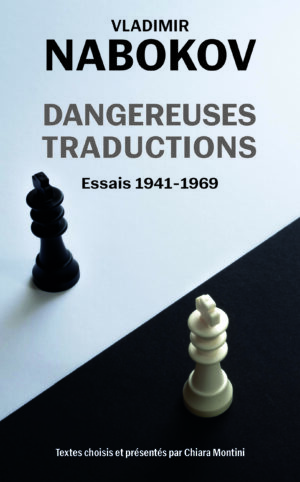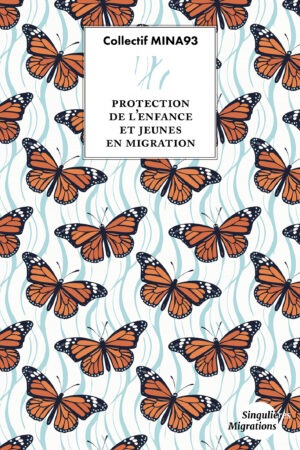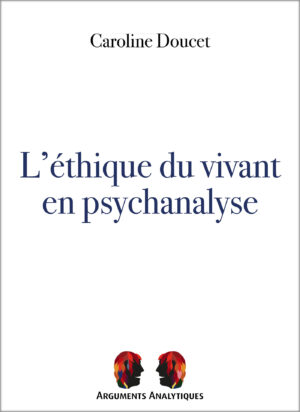Introduction :
Le langage comme « instrument fouisseur » : un tournant dans l’écriture de la recherche en sciences humaines et sociales ?
Violaine Houdart-Merot
Cet ouvrage est né d’un constat ou du moins d’une hypothèse, celle d’un tournant actuel, dans la plupart des sciences humaines et sociales, dans la manière d’écrire la recherche et de penser l’écriture de la recherche. On observe en effet une porosité nouvelle ou du moins accrue entre écriture de la recherche et écriture dite littéraire, sous des formes variées que cet ouvrage se propose d’analyser. Peut-on parler de nouveaux « genres » de la recherche ? Pourquoi ces changements ? Quels en sont les enjeux ? Quelles conceptions du littéraire et de la recherche émergent de ces nouvelles approches ?
Le conflit historique en France entre écriture scientifique et « belles lettres »
Depuis la fin du xixe siècle, dans le monde universitaire en France, l’écriture de la recherche s’est pensée par opposition à une écriture littéraire, en raison d’une conception binaire, opposant vérité et fiction, objectivité et subjectivité, transparence de l’écriture et usage rhétorique. Ce clivage a coïncidé avec la mise en place de plusieurs disciplines. C’est à la même époque en effet que l’histoire et la littérature ont pris leur autonomie après la période des « belles-lettres » qui englobaient non seulement l’histoire mais les autres savoirs profanes. Tandis que l’histoire se rallie à la science, les études littéraires s’écartent de la rhétorique, soupçonnée d’être contraire à l’esprit scientifique. Or cette mise à l’écart de la rhétorique a contribué, comme l’a rappelé Marielle Macé dans Le Temps de l’essai, à installer une représentation « agonistique » des rapports entre style et pensée 1. La sociologie aussi de son côté a tenté de trouver sa spécificité par rapport à la littérature. Le « conflit de territoire » entre les différentes sciences humaines et sociales amène alors chaque discipline à se définir par rapport aux autres 2. Ainsi, l’écriture de la recherche est marquée, depuis la fin du xixe siècle, par le contexte positiviste dans lequel elle s’est développée et par le désir de trouver une légitimité en prenant modèle sur les sciences dures. On constate en philosophie le même clivage entre pensée et écriture, avec pour conséquence la scission entre littérature et philosophie, comme l’a rappelé Mathilde Vallespir dans La pensée a-t-elle un style ?. Selon cette conception « héritière d’un certain idéalisme classique 3 », la langue du philosophe est alors entendue comme « révélation du Vrai » et le langage, conçu comme simple véhicule de la pensée, doit se faire le plus transparent possible 4.
Cette conception du travail scientifique touche tout particulièrement la place de l’écriture dans le processus de la recherche. Comme dans les sciences expérimentales, l’écriture ne peut commencer qu’une fois la phase de recherche achevée 5. Elle se focalise sur des résultats. Dans ces conditions, l’écriture de la recherche ne saurait avoir de dimension heuristique : elle est là pour consigner les recherches, une fois celles-ci effectuées. Dans Antithèses 6, ouvrage qui étudie l’évolution des thèses d’écrivains depuis le xixe siècle, Charles Coustille constate que, dans les manuels destinés aux doctorants, la question du style est pour ainsi dire absente, tout étant focalisé sur la dispositio. Il parle de « non-style » pour les recherches en littérature, tout comme Ivan Jablonka parle de « non-texte emballé dans une non-écriture 7 » pour les travaux d’historiens.
Il importe aussi de rappeler qu’avant l’éclatement des belles-lettres en plusieurs disciplines et le divorce entre science et littérature au xixe siècle, à l’inverse, au siècle des Lumières, science et littérature faisaient encore bon ménage. Les « gens de lettres » qui rédigent l’Encyclopédie sont aussi bien des mathématiciens et physiciens comme D’Alembert que des romanciers et dramaturges comme Diderot. Les philosophes, pour diffuser les savoirs dans différents domaines, ont recours à une multitude de genres considérés aujourd’hui comme littéraires, tels que le conte, le roman par lettres ou le dialogue 8. Et l’on pourrait trouver des modèles encore plus lointains de ces porosités disciplinaires : sans remonter au poème philosophique de Lucrèce, on a pu voir en Montaigne l’ancêtre méconnu des anthropologues, comme le suggère Bernard Traimond 9 dans Terrains d’écrivains.
Un tournant dans toutes les disciplines
Mais ce qui se passe aujourd’hui n’est pas un retour au De natura rerum ou au siècle des Lumières. Les enjeux diffèrent et ces transformations ne touchent sans doute pas de la même manière, selon la même chronologie, toutes les disciplines. Nous avons souhaité les confronter de manière à dégager les éventuels points de convergence entre elles dans la façon de concevoir l’écriture de la recherche.
Dans le domaine de l’anthropologie, se pose depuis longtemps la question de l’écriture. Nastassja Martin rappelle que dès 1947 Marcel Mauss écrivait que les ethnologues devaient être non seulement des « chartistes » mais aussi « des romanciers capables d’évoquer la vie d’une société tout entière 10 ». Cependant la tradition même des « deux livres » qu’a étudiée Vincent Debaene, constatant dans L’Adieu au voyage (2010) qu’un bon nombre d’anthropologues écrivaient un premier livre scientifique suivi d’un livre littéraire, cette tradition même manifestait encore une forme de clivage. Mais cette partition n’est pas nécessaire chez tous les anthropologues, comme en atteste ici Dominique Casajus, tandis qu’Éléonore Devevey analyse les transformations du rapport à l’écriture dans le second xxe siècle, aboutissant désormais à un « continuum de pratiques ».
En littérature, plusieurs phénomènes convergent, expliquant les transformations de l’écriture de la recherche : d’une part la présence plus forte à l’université d’écrivains qui sont également chercheurs, tels que Philippe Forest, et d’autre part celle d’universitaires qui revendiquent une approche créatrice de la critique, dans la lignée de Roland Barthes qui déjà appréhendait la lecture comme acte créateur 11 mais aussi dans celle, plus récente, de Michel Charles. Cette transformation de l’écriture de la recherche dans le domaine des études littéraires est également favorisée par l’émergence récente en France des travaux de recherche-création 12 qui abordent la recherche par l’expérimentation littéraire et associent à leur manière démarche critique ou théorique et démarche créative. L’imbrication entre création et théorisation amène souvent à aborder différemment l’écriture théorique. Relèvent aussi de la recherche-création des formes de poésie expérimentale qui conçoivent la poésie comme action, créative de publics, démarches explorées ici par Nancy Murzilli.
Dans une moindre mesure, la question du style de la recherche concerne également la linguistique, comme l’observe Sébastien Favrat en pénétrant dans l’atelier de jeunes chercheurs en linguistique et en questionnant la dimension heuristique ou non de leur processus d’écriture.
En sociologie aussi, les modalités d’écriture se transforment. Charles Coustille se propose de mettre en lumière la manière dont Bourdieu déjà, à partir de 1975, développe un style propre et se fait écrivain. De plus, un certain nombre de sociologues aujourd’hui n’hésitent pas à se prendre eux-mêmes comme objets d’étude, tels que Didier Eribon ou Édouard Louis, deux chercheurs transfuges de classe 13 dont la démarche autobiographique rejoint d’une certaine manière les « autosociobiographies » de l’écrivaine Annie Ernaux. Marion Coste étudie dans cet ouvrage le cas de deux sociologues qui se frottent aux genres autobiographiques, Amandine Gay et Kaoutar Harchi.
Dans le domaine de l’histoire, le concept d’ego-histoire, né à l’initiative de Pierre Nora en 1987 14, rompt avec l’impératif d’objectivité historique et réhabilite, comme en sociologie, la place du sujet, transformant les modalités d’énonciation. Isabelle Lacoue-Labarthe analyse ici les différents enjeux de ces nombreux écrits autobiographiques d’historiens. L’œuvre de Régine Robin, étudiée par Sara De Balsi, est un exemple encore plus singulier d’une démarche historique en partie autobiographique, mêlant théorie et fiction.
En philosophie aussi s’est opérée une mutation de l’écriture, apparue dès les années 1970, avec Deleuze, Derrida et Lyotard, comme l’a mis en lumière Mathilde Vallespir 15. Chez eux, le style agit sur la pensée. Plusieurs philosophes contemporains se situent dans cette lignée 16 de penseurs qui croient au pouvoir de la langue de « mettre au travail la raison 17 ». Et Riccardo Barontini examine ici des tentatives plus audacieuses encore en étudiant les démarches de philosophes ou éthologues qui ont recours à la fiction, comme Vinciane Desprets ou Tristan Garcia.
Ainsi, dans toutes ces disciplines on assiste à des formes de porosité de l’écriture de la recherche avec une écriture littéraire et se pose désormais la question de savoir si ce n’est pas l’écriture elle-même qui devient productrice de savoir 18.
Rhétorique et réconciliation entre science et littérature ?
On peut donc se demander si l’on n’assiste pas, d’une certaine manière, à une réinvention de la rhétorique. Fanny Lorent et Adrien Chassain mettent en lumière ici l’apport décisif de Michel Charles pour développer une rhétorique « active » ou « créatrice » et non plus seulement spéculative et l’importance de ses disciples aujourd’hui. Cette culture rhétorique déborde la seule perspective de la critique créative en littérature, telle qu’elle est conçue par Pierre Bayard ou par les adeptes des « textes possibles » comme Marc Escola et Sophie Rabau. Ainsi, les philosophes des années ١٩70 ont redécouvert les possibilités heuristiques des figures de rhétorique 19, et notamment de la métaphore, dans sa proximité possible avec le concept. Et l’on peut faire l’hypothèse 20 que les pratiques universitaires récentes qui abordent la littérature par l’expérimentation, qu’il s’agisse des ateliers d’écriture créative, des masters de création littéraire ou des doctorats en recherche-création, relèvent au moins partiellement de la « culture rhétorique », au sens de Michel Charles, c’est-à-dire d’une culture tournée vers la création et vers l’écriture et non plus seulement vers la lecture comme c’est le cas dans une « culture du commentaire 21 ». De fait, la tradition rhétorique, comme ces nouvelles pratiques d’écriture, refuse la séparation entre science et littérature, entre pensée et style. Mais leur ambition est plutôt d’explorer ce qui se conçoit mal 22 et non ce qui se conçoit bien comme à l’époque de Boileau, de manière à ce que chacun apprenne l’art de « fonder sa propre rhétorique », conformément au vœu de Francis Ponge 23.
Les réflexions de Pascal Quignard dans Rhétorique spéculative vont assurément dans le même sens. S’il défend la tradition rhétorique contre la philosophie, c’est parce que, pour cette tradition, écrit-il, « tout le langage, le tout du langage, est l’instrument fouisseur 24 », cet instrument fouisseur délaissé dans une perspective positiviste.
L’écriture comme « instrument fouisseur »
C’est aussi cette dimension de l’écriture comme « instrument fouisseur », pour reprendre la métaphore de Pascal Quignard, que cet ouvrage explore. En effet, la plupart des contributions de cet ouvrage s’interrogent sur la dimension « heuristique » de l’écriture, comme source de découverte, consubstantielle à la recherche.
Ainsi, pour Philippe Forest, aussi bien dans son œuvre de romancier que dans ses essais, il y a, explique-t-il, une porosité entre l’herméneutique et l’heuristique : interpréter c’est toujours d’une certaine manière inventer. Et l’image de la taupe et du langage comme outil qui creuse et met au jour une vérité enfouie correspond bien à sa conception de l’invention comme découverte ou du moins approche d’une vérité sinon inaccessible. Pour lui, c’est bien « en écrivant que le sens surgit » comme il le confie dans cet ouvrage à Sophie Jaussi.
De même Sébastien Favrat met en lumière les processus d’écriture des apprentis chercheurs en sciences du langage et les divergences entre les encadrants de thèses qui croient comme Vygostki que la pensée « se réalise dans le mot » et les autres, pour qui la rédaction ne peut se faire qu’une fois la recherche effectuée.
Dans un domaine très différent, pour la sociologue Claire Bodelet, dans son travail de thèse sur les clowns à l’hôpital, l’écriture est devenue « comme une possible extension du terrain ». Elle tente de rendre perceptible par l’écriture un spectacle vivant, parfois uniquement visuel, corporel ou musical. À la suite de Clément Rosset 25, elle appréhende l’écriture comme moment d’enquête, de recherche et non pure transcription d’observations de terrain.
Mais cette dimension heuristique concerne bien, peu ou prou, toutes les contributions de cet ouvrage. Ainsi, Sara De Balsi montre en quoi les métaphores dans les ouvrages de l’historienne Régine Robin ont une valeur heuristique. De son côté, Dominique Casajus conclut ainsi son analyse fine de l’écriture de plusieurs anthropologues : « […] ce que Claude Lefort dit de l’histoire est vrai aussi de l’anthropologie : l’une et l’autre sont une “œuvre de pensée [qui] s’ordonne en raison d’une intention de connaissance et à quoi pourtant le langage est essentiel 26” ».
On pourrait même tenter de définir une écriture littéraire comme étant une écriture qui ne se cantonne pas à une fonction instrumentale, qui n’est pas un simple intermédiaire de la pensée, mais pour laquelle « le langage est essentiel » ou, comme le formule avec force Quignard, qui fait du langage un levier de mise à jour d’un sens sinon enfoui.
De nouveaux « genres de la recherche » ?
Ainsi, cet ouvrage offre une réflexion sur l’idée de littérature qui est en jeu dans ces transformations. La confrontation des disciplines amène à dégager plusieurs fils rouges, et l’on serait tenté de parler de nouveaux genres de la recherche ou plutôt de constater le recours, à des fins de recherche, à des genres communément considérés comme littéraires, comme l’essai, l’autobiographie, le récit ou la fiction, voire la poésie. S’agit-il là de franchir des frontières dangereuses ? La recherche risque-t-elle d’y gagner ou d’y perdre son âme ?
La plasticité de l’essai
Traditionnellement, l’essai était opposé à une écriture académique, comme le rappelle Irène Langlet dans L’Abeille et la Balance. Penser l’essai : « Les écrits académiques sont les formes académiques du traité, plus clairement posées comme anti-essais 27. » Ce refus, voire cette « haine de l’essai 28 » va de pair avec le rejet de la rhétorique dans les dernières années du xixe siècle. Or, si l’on l’entend par essai un genre pour lequel « toute connaissance est dépendante de son écriture 29 », autrement dit qui ne dissocie pas travail de recherche et travail de la langue, on peut penser que l’essai, y compris l’essai dit littéraire, est en train de s’affirmer de manière plus forte comme genre de la recherche, aussi bien en histoire qu’en littérature, en sociologie ou en anthropologie. En effet, nombre des écritures de recherche aujourd’hui sont en quête d’une forme qui soit la plus adéquate, la plus juste possible, et qui, par là même, s’autorise implication de l’énonciateur, plasticité, interaction avec le lecteur, effets rhétoriques, attention à l’écriture et au processus d’écriture.
Ainsi la plupart des écrits de Barthes, pionnier dans ce domaine, sont des essais 30, où le désir de rendre le monde intelligible est indissociable du style. Ainsi, dans L’Empire des signes, le choix de l’essai lui permet bien d’inventer une forme nouvelle, adéquate à son projet de concilier savoir et imaginaire, comme le montre Claude Coste dans cet ouvrage.
C’est aussi le genre de l’essai littéraire que choisit Régine Robin dans Deuil de l’origine, conforme à son désir d’une écriture anti-académique, explique Sara De Balsi, une écriture très proche de son écriture de romancière, nourrie d’inventions verbales et de phrases nominales, « discours hybride », selon ses propres dires.
Le genre de l’essai, parce que sa plasticité est constitutive, permet donc de combiner des traits génériques divers 31. Ainsi, comme le met en lumière Éléonore Devevey, les anthropologues français du second xxe siècle « ouvrent le spectre des registres d’écriture », mêlant comme Condaminas chronique narrative et analytique, récit autobiographique et réflexif.
La plasticité de l’essai convient tout particulièrement à l’hybridité générique que l’on observe dans un certain nombre de travaux de recherche-création 32, où l’expérimentation artistique amène à être plus attentif aux processus d’écriture eux-mêmes. C’est ce dont atteste ici le témoignage de Virginie Gautier sur son travail de thèse en création littéraire, qui relève d’une « élaboration circulatoire » entre son propre récit poétique et sa recherche sur les travaux d’autrui.
L’écriture même de Pierre Bourdieu pourrait être considérée comme essayiste, quand bien même le sociologue fustige « l’essayiste impressionniste » autant que le « cuistre positiviste ». Mais à condition d’en faire, comme le revendique ici Charles Coustille, « une lecture littéraire », sensible à sa syntaxe singulière, à son humour et à ses « confessions cachées ».
De par sa plasticité, le genre de l’essai porte en germe finalement d’autres formes littéraires qui sont en train de pénétrer dans les écrits universitaires, écriture du moi et écriture narrative, et même diverses formes de fiction. Dans tous les cas, il y a, selon la définition que Marielle Macé donne de l’essai, « cet effort conjoint de style et de pensée, celui qui consiste à se tenir au plus près des mouvements de la conscience dans sa recherche du vrai 33… ».
Subjectivité et écriture du moi
Si le je est souvent proscrit des travaux universitaires, la présence d’une dimension réflexive n’est pas nouvelle dans les sciences sociales, et notamment la sociologie et l’anthropologie, disciplines dans lesquelles le retour sur sa position de chercheur est même une exigence fondamentale. À commencer par Pierre Bourdieu, recommandant au chercheur, rappelle Charles Coustille, de « procéder à une critique sociologique de la raison sociologique ». Mais sans doute cette exigence prend-elle une ampleur nouvelle aujourd’hui en anthropologie, comme l’analyse Éléonore Devevey, notamment à propos de l’écriture « affectée » de Jeanne Favret-Saada chez laquelle on observe un retournement : la subjectivité est pour elle un gage d’objectivité. De la même manière, la sociologue Patricia Hill Collins appelle à une valorisation de l’intime comme critère de validité du discours, ainsi que le souligne Marion Coste à propos des écrits autobiographiques de deux sociologues. On relève aussi la présence d’une dimension réflexive dans le travail d’habilitation à diriger des recherches en littérature (HDR) de Jean-Marc Quaranta, qui devient le récit à la première personne des étapes d’une recherche. C’est encore une autre forme de subjectivité que revendique Barthes dans L’Empire des signes, comme l’explique Claude Coste. Quant aux écrits autobiographiques des historiens, ils trouvent en partie leur légitimité, selon l’analyse d’Isabelle Lacoue-Labarthe, dans une exigence d’autoréflexivité, sur le modèle précisément des sciences sociales. Le cas de Régine Robin est plus radical encore, dans la mesure où son expérience personnelle sert de moteur à toute son œuvre, selon l’analyse de Sara De Balsi.
On observe ainsi un continuum entre d’une part les différentes formes de réflexivité ou de subjectivité présentes dans des travaux de recherche et d’autre part les écrits autobiographiques, qui eux-mêmes peuvent prendre des formes très variées, plus ou moins ponctuelles ou indirectes. L’écriture du moi, sous ses formes multiples, devient donc un nouveau genre de la recherche, transformant profondément son écriture, et dépassant le clivage traditionnel entre subjectivité et objectivité. Certains s’inquiètent des dérives possibles de cette présence subjective. Plusieurs contributions font état de méfiance, chez les historiens par exemple, attachés à une posture distanciée. On peut aussi s’interroger sur la frontière entre les nombreux récits de vie qui paraissent aujourd’hui et ceux qui revendiquent un apport sociologique ou historique.
Récit et écriture narrative
Comme l’écriture du moi, l’écriture narrative traverse bien des recherches analysées dans cet ouvrage, en littérature comme en sociologie, en anthropologie comme en philosophie. L’anthropologue Daniel Fabre, comme Marcel Mauss, conseillait ainsi à ses étudiants de préférer le style narratif au modèle hypothético-déductif et de faire de leur thèse un roman, lançant une énigme, déroulant les étapes de l’enquête 34. C’est aussi le choix qu’a fait Paolo d’Iorio dans Le Voyage de Nietzsche à Sorrente que Jean-Marc Quaranta étudie en parallèle avec son propre travail de recherche sur Agostinelli, chauffeur et secrétaire de Proust. P. D’Ioro choisit le récit pour explorer « un moment clé de la genèse de la pensée du philosophe ». De même, J.-M. Quaranta choisit la forme narrative pour mener son enquête sur Agostinelli, dans Un amour de Proust, et ce choix, comme pour Daniel Fabre, répond d’abord au désir de rendre un travail universitaire accessible au grand public. Par là même, il nous fait pénétrer dans l’atelier du chercheur. Pour les deux auteurs, la mise en récit est en même temps une « mise en intrigue » : le lecteur n’est plus devant le résultat d’une recherche mais participe au processus de la recherche.
Claire Bodelet aussi, pour « tenir » ses lecteurs, s’est efforcée de dégager une intrigue, avec des effets d’attente et de suspens. Ainsi, le choix du récit et de la mise en intrigue n’est pas seulement un déplacement de la recherche du côté des processus de la recherche. Elle relève aussi d’une forme de captatio benevolentiae.
Mais là encore, il convient d’être attentif aux dangers d’une dépréciation de la valeur scientifique, comme le pointe J.-M. Quaranta à propos de son « polar littéraire », Un amour de Proust.
La question épineuse de la fiction
À de nombreuses reprises, il est question dans cet ouvrage de fiction, terme qui peut paraître contradictoire dans des écrits qui ont l’ambition d’être des discours de vérité, contribuant à élaborer des savoirs. Mais l’on peut distinguer différentes conceptions de la fiction selon les chercheurs. Pour certains, toute recherche serait une fiction en tant que construction intellectuelle, conformément à son origine latine, fingere, façonner. Pour d’autres, les écrits sont des fictions en tant qu’interprétations 35.
Philippe Forest, qui par certains aspects se rapproche de la conception de Roland Barthes ou de Pierre Bayard, associe la fiction à l’invention, considérant que celle-ci consiste à dégager un sens caché qui ne pourrait être trouvé sans le travail de l’écriture. La fiction est pour lui solidaire de l’expérience du réel comme étant inaccessible de manière directe en sorte que « la vérité ne vient jamais à nous que sous la forme de la fiction 36 ». Pour Isabelle Lacoue-Labarthe, la dimension fictionnelle est appelée par la nécessité de combler les lacunes de l’histoire : l’écriture de l’histoire est toujours recréation plutôt que « reflet d’un passé objectivé », de même qu’un récit autobiographique contient inévitablement une part d’invention. La fiction n’est pas éloignée alors de l’imagination 37. De son côté, l’œuvre théorique de Régine Robin, comme le rappelle Sara De Balsi, citant l’historienne, est aussi « une autofiction par procuration », une « méta-fiction » ou même une « fiction théorique ». Quant à Barthes, selon Claude Coste, c’est « l’imaginaire de la subjectivité » qu’il revendique dans L’Empire des signes.
Mais ce sont des formes plus radicales encore de fiction et de « savoirs de la fiction » que Riccardo Barontini étudie chez deux éthologues contemporains, Vinciane Despret et Tristan Garcia. Pour étudier le langage des animaux, le recours à la fiction chez ces chercheurs ne se réduit pas à un habillage ou à une forme de vulgarisation plaisante, mais devient consubstantiel à leur exploration. Les outils romanesques viennent combler les lacunes de la méthode scientifique. Ils leur permettent de se projeter dans un possible encore « indémontrable scientifiquement » tout comme la critique littéraire peut envisager une « théorie des textes possibles ». On pourrait rapprocher ces fictions des éthologues des « fictions théoriques » de Pierre Bayard dans le domaine littéraire. L’auteur se positionne comme personnage « à qui il cède la parole 38 », ce qui lui permet une prise de distance humoristique pour aborder telle ou telle question littéraire.
Ainsi, le terme de fiction est tantôt synonyme de construction et d’interprétation, tantôt d’invention et de mise en mots de vérités latentes, tantôt d’imaginaire, tantôt encore de projection dans un avenir possible, mais, dans tous les cas, la fiction est liée de façon intime au travail de la langue et elle agit là encore comme « instrument fouisseur ».
Traducteurs et explorateurs de la langue
Enfin, bien des contributions dans cet ouvrage soulignent le rôle essentiel de la traduction dans le travail de la langue. Dominique Casajus le dit avec force à propos de l’anthropologie : pour comprendre une autre culture, d’autres peuples, il faut connaître leur langue et se faire soi-même traducteur. Ses analyses attentives au choix des mots chez des anthropolo-gues qui n’ont pas eu besoin d’un deuxième livre « littéraire », mettent en lumière la nécessité de travailler avec et sur la langue : « Enrichir notre langage et notre pensée de potentialités nouvelles pour les mettre à même de recevoir une pensée étrangère, je ne crois pas connaître de plus belle définition de l’anthropologie », écrit-il. Ce sont aussi des activités de « passeurs » et traducteurs qu’Éléonore Devevey décèle chez Balandier, Condominas et Clastres, avec une visée politique, celle de restituer au plus près la parole de l’autre.
En cela, le travail des anthropologues se rapproche de celui de Régine Robin, traductrice elle-même et explorant dans Deuil de langues les langues oubliées ou méconnues d’écrivains juifs, ou bien inventant elle-même une langue et des néologismes qui rendent compte de sa propre histoire de migrante traversée par les langues. De son côté, Claire Bodelet parle de traduction pour rendre compte de ses tentatives pour restituer avec des mots le travail des clowns à l’hôpital qui passe souvent par des formes de communication non verbales.
Pour aborder la question des langages animaliers, c’est encore un travail de traductrice auquel se livre Vinciane Desprets. Elle rejoint de la sorte, explique R. Barontini, la démarche de Baptiste Morizot pour lequel, face à la crise de sensibilité à l’égard des autres formes du vivant, « on est voué à traduire des intraduisibles 39 ».
On voit là qu’il n’y a pas réellement de solution de continuité entre traduction et interprétation ou déchiffrage du monde. Sans rabattre le terme de traduction à l’usage métaphorique que Proust fait de la traduction dans Le Temps retrouvé : « Le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le sens courant, à l’inventer, puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire », on peut rappeler que Proust lui-même a été traducteur de l’œuvre de l’anglais Ruskin et considérer, à la suite d’Edward Bizub 40, que c’est cette expérience de la traduction pendant sept ans qui a été à l’origine de son travail de création, de sa poétique de la traduction et de sa conception du monde comme ensemble de signes à déchiffrer. L’expérience de la traduction est sans doute fondatrice chez bien des écrivains et indissociable de l’approche du langage comme instrument fouisseur.
Entre recherche et création : déplacement de l’idée de littérature
Outre les travaux de Philippe Forest, plusieurs contributions font état dans ce volume de chassés-croisés entre recherche et littérature. Ainsi, Adrien Chassain et Fanny Lorent étudient les nouvelles façons d’aborder la recherche littéraire sous la forme de critique créative ou de création critique, dans le sillage de Michel Charles et de sa conception des textes possibles et des « énoncés fantômes ». Dans un retour sur sa thèse de recherche-création, Virginie Gautier met en lumière « l’écosystème » formé par l’articulation forte entre son propre travail poétique et sa recherche sur des récits de déplacement. De même, Jean-François Puff, universitaire et poète « qui a lu Wittgenstein », analyse les divergences d’interprétation de ce philosophe chez un bon nombre de poètes, et plus particulièrement les connexions, dans son propre travail de poète, avec la pensée de Wittgenstein, connexions entre écriture théorique et écriture poétique. De son coté, dans un exposé « programmatique », Nancy Murzilli s’intéresse à des formes de recherche-création « agissantes », celles que l’on peut observer chez des poètes comme Olivier Bosson, franck leibovici ou Marielle Chabal pour lesquels la poésie se définit comme action sociale et construction de publics, supposant de mettre au premier plan des dispositifs poétiques qui bouleversent la partition habituelle entre science et arts.
Ces chassés-croisés sont rendus possibles par une nouvelle approche de la littérature, non plus comme un ensemble d’œuvres reconnues, patrimonialisées, mais comme une pratique d’écriture et même comme un agir. C’est aussi une nouvelle « idée » de la littérature, plus extensive, ouverte, comme l’a observé Alexandre Gefen, à l’anthropologie culturelle, à la littérature écologique et à la littérature dite d’intervention. La notion d’autonomie de l’art, suggère-t-il, se trouve critiquée aujourd’hui « au nom de la notion de relation et d’exigence d’intervention 41 ». L’idée contemporaine de la littérature ne répugne pas à assumer une fonction « cognitive, anthropologique et politique 42 ». Il faudrait ajouter que cet élargissement du littéraire se fait aussi en direction des autres arts, musique et arts plastiques notamment, mais aussi danse et tous les arts vivants, à la faveur du numérique et de ses possibilités infinies de dialogues entre les arts. C’est sans doute ce retour à une conception plus extensive de la littérature – qui était celle de l’époque rhétorique – qui explique cette porosité entre écriture littéraire et écriture de la recherche dans les autres sciences humaines et sociales.
Mais ce déplacement de l’idée de littérature s’accompagne aussi d’une relation nouvelle aux savoirs, une manière différente d’appréhender le réel, sans écarter la sensibilité. C’est ainsi que sociologues, anthropologues, philosophes et historiens s’autorisent, comme on l’observe dans cet ouvrage, une écriture impliquée, affectée, mêlant théorie et expériences vécues, faisant appel à l’émotionnel autant qu’à l’intellect 43 ou à la méthode scientifique. À l’inverse, un certain nombre d’écrivaines et d’écrivains aujourd’hui, notamment parmi les tenants de la littérature du réel et de l’enquête, revendiquent de contribuer à la production de savoirs par d’autres voies, tels Emmanuelle Pireyre, Hélène Gaudy ou Patrick Modiano 44. D’autres encore, comme le souligne Nancy Murzilli, expérimentent des dispositifs pour « rendre visibles des problèmes publics ».
Pour autant, il ne s’agit pas de dire que les frontières disciplinaires ne sont plus pertinentes, qu’un écrivain peut se prétendre anthropologue 45 ou qu’un sociologue devient un écrivain par le seul fait de raconter sa vie. Il s’agit plutôt pour chacun d’être attentif à la complexité des savoirs et de réaffirmer l’importance, pour toutes ces disciplines, du langage comme opérateur de recherche.
Écriture littéraire ou écriture ?
Toutes ces contributions montrent donc en quoi les oppositions binaires qui régissaient l’écriture scientifique par opposition à l’écriture littéraire sont mises à mal dans ces écritures de chercheurs et chercheuses contemporain·es : les clivages traditionnels entre objectivité et subjectivité, entre vérité et fiction, entre transparence et opacité, voire entre sciences et arts, ne sont plus toujours opératoires.
Si, dans certaines disciplines, l’écriture littéraire peut se cantonner à une recherche stylistique et au « recours à des matrices rhétoriques et thématiques issues de textes classiquement 46 considérés comme littéraires » comme l’analyse Sébastien Favrat à propos de la linguistique, pour bien d’autres, les choses vont beaucoup plus loin : la dimension réflexive transforme les modalités d’énonciation ; l’écrit académique se transforme en essai, cette « tierce forme » à l’écriture beaucoup plus personnelle et plastique ; la démonstration a recours au récit ; le chercheur se prend parfois lui-même comme objet de recherche et ose parler de lui ; il se fait traducteur et parfois la fiction devient un outil au service d’explorations inédites.
Sans doute serait-il plus sage ou plus prudent de parler d’écriture plutôt que d’écriture littéraire pour désigner ces écrits qui ne séparent pas la recherche de l’acte d’écrire et qui considèrent, à la suite de Clément Rosset dans Le Choix des mots qu’il n’y a pensée « qu’à partir du moment où celle-ci se formule, c’est-à-dire se constitue par la réalité des mots 47 ».
1. Macé 2006 : 49.
2. Voir Jablonka 2014.
3. Voir Vallespir 2022 : 9.
4. Ibid. : 10-11.
5. Instrumentalisation du langage dénoncée depuis longtemps par Barthes : « Pour la science, le langage n’est qu’un instrument, que l’on a intérêt à rendre aussi transparent, aussi neutre que possible… » (1967 : 12.)
6. Coustille 2018.
7. Jablonka 2014 : 96.
8. Voir à ce sujet Stéphanie Génand (2018).
9. Bernard Traimond (2012 : 402). La séparation des disciplines, le modèle des sciences de la nature, l’intérêt d’abord exclusif pour les sociétés lointaines pourraient selon cet anthropologue expliquer pourquoi n’a pas été perçue cette convergence avec Montaigne.
10. Nastassja Martin (2021 : 9). Voir aussi son récit de 2019, Croire aux fauves, qui mêle l’intime et la réflexion anthropologique et explore la métamorphose qu’entraîne l’enquête de terrain pour elle-même dans son rapport à l’ours et à l’animisme.
11. Voir Barthes1964 : 12 : « le critique est un écrivain ».
12. Voir Houdart-Merot 2018 et 2021.
13. Eribon 2009 ; Louis 2014. Voir aussi Lagrave 2021.
14. Nora 1987.
15. Vallespir 2022.
16. Notamment Catherine Malabou, Donna Haraway, Giorgio Agamben ou Jean-Luc Nancy, cités par M. Vallespir.
17. Vallespir 2022 : 15.
18. Voir aussi Jablonka 2014 : 14.
19. Voir Vallespir 2022 : 141.
20. Houdart-Merot 2021a.
21. Charles 1985 : 51-52 et 185.
22. Voir Ponge 1999a : 530 : « [r]ien n’est intéressant à exprimer que ce qui ne se conçoit pas bien ».
23. « Enseigner l‘art de résister aux paroles devient utile, l‘art de ne dire que ce que l‘on veut dire, l‘art de les violenter et de les soumettre. Somme toute fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l‘art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public. » (Ponge 1999b : 193.)
24. « La tradition d’une pensée pour laquelle tout le langage, le tout du langage, est l’instrument fouisseur, aussi bien le stilus que la pinna (c’est-à-dire aussi bien le stilus-épée que la pinna-flèche de l’arc), est antérieure à la métaphysique. » (Quignard 1995 : 15.)
25. Rosset 1995 : 30.
26. Lefort 1978 : 141.
27. Langlet 2015 : 52.
28. Macé 2006 : 49.
29. Ead. 2015 : 24.
30. Voir Macé 2006. Elle présente Barthes comme une figure centrale de l’essai dans les années 1960.
31. Voir Langlet 2015 : 52.
32. Voir Houdart-Merot 2022 : 75 sqq.
33. Macé 2014 : 322.
34. Entretien avec Daniel Fabre, réalisé par Thierry Wendling en avril 2013 à Paris et publié sur internet par la revue ethnographiques.org : http://ethnographiques.org/L-intelligence-du-conte-Entretien.
35. C’est le cas des anthropologues américains dont parle Vincent Debaene, Clifford Geertz et Paul Rabinov, ces « pères du tournant rhétorique de l’anthropologie nord-américaine » (Debaene 2005 : 219-232).
36. Forest, p. 23 dans ce volume.
37. On pourrait rapprocher cette revendication d’imagination chez l’historien de celle de l’écrivain et naturaliste Benoît Vincent : « On sait pourtant bien, avec Einstein ou Bachelard et tant d’autres exemples que cela
n’est pas vrai, et qu’au contraire l’imaginaire (ou la poésie, même si elle est celle des
équations et des formules) est nécessaire à la méthode même (ne serait-ce que pour
formuler une hypothèse : “et si… ?” ») (Publifarum, 2022.)
38. Bayard 2018.
39. Morizot 2020, cité par Barontini p. 133 dans ce volume.
40. Bizub 1991.
41. Gefen 2021 : 31.
42. Ibid. : 200.
43. Voir aussi les travaux de Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale, qui revendique une « écologie du sensible » (2020). Il y aurait eu selon lui une rupture ancienne avec le sensible chez les philosophes, rupture qui aurait trouvé son point d’aboutissement avec Descartes. Voir aussi Benoît Vincent (2021) qui rend Descartes responsable du positivisme du fait d’une séparation entre l’âme et le corps.
44. Voir aussi Le Nouvel âge de l’enquête (Demanze 2019 : 163).
45. Voir la mise en garde de Vincent Debaene (2005).
46. Au sens de « au sein des classes », c’est-à-dire « par le système scolaire ».
47. Rosset 1995 : 29.