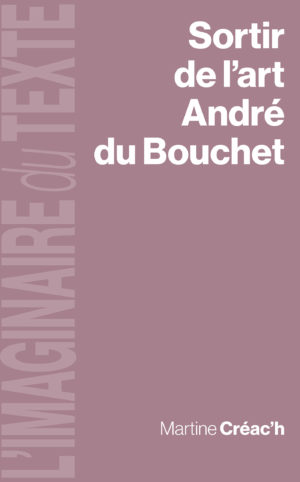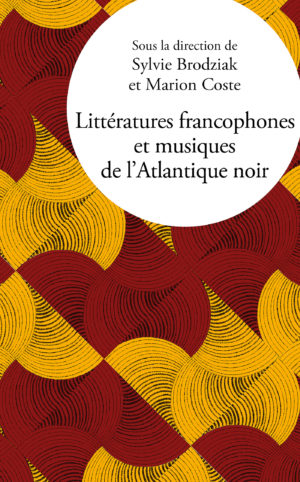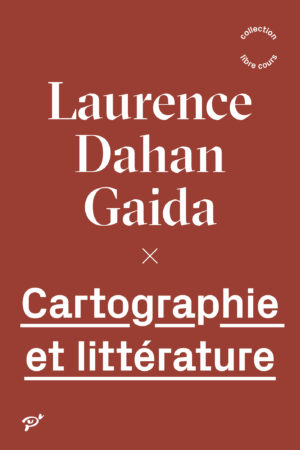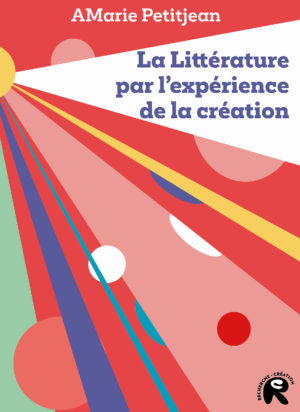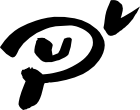Introduction
Si un essai est quelque chose d’essayé – quelque chose de risqué, qui n’est pas définitif, qui ne fait pas autorité, quelque chose que l’auteur avance sur la base de son expérience personnelle et de sa subjectivité –, il semblerait que nous vivions un âge d’or de l’essai .
Jonathan Franzen, « L’essai dans les temps obscurs », Et si on arrêtait de faire semblant ?
Sans doute est-il désormais complexe d’écrire des livres qui se veulent des avancées sans butée vers une démonstration gommant les incertitudes, plus encore concernant l’écopoétique. Il s’agira donc ici de définir cette (in)discipline dans sa pluralité, ses troubles et sa manière de se réinventer sans cesse en réponse aux bouleversements que nous traversons. Ce livre entend être à la fois une introduction et un essai, au sens d’une approche de l’écopoétique, cette pratique critique comme narrative qui ne se laisse pas facilement enfermer dans des définitions univoques, qui s’entend à dérouter et dont le sens se précisera et se complexifiera au fil des pages. Face aux désordres climatiques et aux crises dans lesquelles nous sommes pris, qu’ajouter sinon des pensées en devenir, à l’essai, tissées à d’autres voix et collectifs ?
C’est ce que Deborah Bird Rose et Libby Robin, dans un article de 2004, traduit en français sous le titre « Vers des humanités environnementales » (2019), nomment « la connexion comme mode de raisonnement » qui suppose de se « décentrer de la rationalité cartésienne au profit d’un cadre logique plus inclusif », de formes moins linéaires, de relations récursives. Le récit est pour elles « la méthode par laquelle la raison connective trouve sa voix la plus puissante » (Rose et Robin : 27-28). Habiter le monde, écouter les récits des peuples autochtones, comme ceux des Aborigènes, c’est entendre que « le monde a déjà ses propres histoires », que les arbres, les plantes et l’ensemble des vivants (non exclusivement humains) sont des « communicants expressifs » (29) qui peuvent nous apprendre à raisonner par contiguïtés et maillages, associations et métonymies. Nous devons « élargir les conversations humaines » (34), poursuivent les deux chercheuses australiennes, selon une « ontologie de la connectivité » (14), passer « d’un savoir universel à des savoirs situés, d’une grammaire unique à des grammaires multiples, de hiérarchies centrées à des réseaux décentrés, et de la structure au mouvement » (15).
L’essai, non purement théorique mais mâtiné de récits, à la fois situé et décentré de nos logiques occidentales, ne pourrait donc plus être que dérives, pour reprendre le titre du livre de Kate Zambreno (2022) qui en est aussi le manifeste poétique, annonçant une forme rhizomique et fluide, dans une absolue porosité au monde. Chez l’autrice américaine, fiction et non fiction sont indissociables, tout détail ou moment fait naître récit et théorie dans un même ensemble, en gardant trace d’un processus d’écriture comme de réflexion, pour donner forme au « désir » d’un texte « qui contienne l’énergie de la pensée » – ce qu’après Blanchot, Kate Zambreno nomme « une décréation ». Décréer revient à refuser les cadres anciens, à en inventer de nouveaux, à ne jamais rester dans l’abstraction, à enter la théorie sur l’expérience et faire de toute expérience le ferment d’une pensée. C’est ce que propose l’écopoétique, qui n’est pas seulement une manière de lier littérature et écologie. L’écopoétique est dérive, un terme disjonctif puisqu’il renvoie aussi bien à une filiation (découler) qu’à une bifurcation (déplacer).
Deborah Bird Rose et Libby Robin appellent de leurs vœux ce décentrement (elles parlent d’un « dépassement transversal ») quand elles montrent que les humanités écologiques sont l’espace de rencontre des sciences et des lettres, le lieu d’un « dialogue élargi, qui ouvre la possibilité de conversations interculturelles, interespèces » et interdisciplinaires (11 et 17). Privilégier le transversal, écouter des voix longtemps ignorées, changer de paradigmes réflexifs, décentrer nos regards sans jamais négliger de questionner ce que notre situation dans le monde leur impose, raconter ce qui nous lie est peut-être une manière pour l’écopoétique de répondre à la question que posait Sarah Kofman, Comment s’en sortir ? (1983). Comment dépasser l’aporie qu’est le dérèglement climatique, catastrophe inéluctable et exponentielle consécutive à nos modes de vies, que faire (le poïein du terme écopoétique) pour habiter autrement le monde qui est notre maison (le oikos du terme écopoétique) ? En quoi le récit peut-il être le poros, le stratagème, pour sortir de cette situation en apparence sans issue ?
L’écopoétique n’est pas la plate mise en fiction de programmes écologiques, un thème à la mode ou un tropisme tendance mais bien la lecture ou l’écriture de textes, fictionnels ou non, qui voient leurs sujets et surtout leurs formes infléchis par une pensée d’ordre écologique. Elle est un peu comme ce manchot empereur qui, dans La Fonte des glaces de Joël Baqué (2017), distord « l’espace-temps » par son surgissement puis sa « simple présence » dans la vie de Louis, charcutier à la retraite. L’animal empaillé provoque un décentrement, dans l’existence de Louis comme dans la manière dont l’écrivain (dé)construit son roman. Bruno Latour l’a écrit dans Face à Gaïa, notre « nouveau régime climatique » est aussi un nouveau régime narratif : telle est « la situation présente quand le cadre physique que les Modernes avaient considéré comme assuré, le sol sur lequel leur histoire s’était toujours déroulée est devenu instable. Comme si le décor était monté sur scène pour partager l’intrigue avec les acteurs. À partir de ce moment, tout change dans les manières de raconter des histoires » (2015 : 13).
(In)discipline, donc, que l’écopoétique, ce courant de critique littéraire et études culturelles qui a pris son essor dans le monde anglo-saxon sous le nom d’ecocriticism. William H. Rueckert en donne la définition dès 1978, dans un article qui énonce une forme d’expérience (« An Experiment in Ecocriticism ») et revient à appliquer des concepts de l’écologie scientifique à la critique, à l’enseignement et à l’écriture littéraires, à faire de « l’énergétique littéraire », et en particulier poétique, un levier du combat écologique, « puisque l’écologie (en tant que science, discipline et fondement de la représentation humaine) est la plus pertinente quant au présent et à l’avenir du monde ». Parmi ces lois de l’écologie scientifique, le fait que tout est connecté (du plus infime au plus large, du plus intime au plus collectif) devient le fondement d’une poétique conçue comme un organisme ou un écosystème avec ses flux, ses circulations, ses échanges complexes, formant une symbiose.
Cet article publié à l’hiver 1978 est à ce point considéré comme fondateur de l’ecocriticism anglo-saxon qu’il est repris, en 1996, dans un collectif qui s’offre comme le manifeste et la boîte à outils de ce champ émergent, The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, sous la direction de Cheryll Glotfelty et Harold Fromm (1996 : 105-123). Cet article est d’ailleurs peut-être le seul repère (landmark) et point stable d’un courant qui n’a de cesse de se réinventer, dès les termes pour le nommer : literary ecology, humanités environnementales, écopoétique, écocritique, humanités écologiques (Deborah Bird Rose), green studies, écologie du récit, écosophie (Félix Guattari), écopolitique (Camille de Toledo), etc. Le contexte dans lequel ces recherches s’inscrivent, ce « nouveau régime climatique » de Gaïa (Latour), est lui aussi pris dans une valse des noms : Anthropocène (Crutzen et Stoermer), Capitalocène (Andreas Malm), Occidentalocène, Thanatocène (Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz), Plantationocène (Donna Harraway, Anna Tsing, Nils Bubandt), Chthulucène (Donna Haraway), Pathocène (Romain Noël) – qui ont un suffixe en commun, -cène, dérivé du grec kainos, désignant une nouvelle ère géologique. Cette explosion onomastique figure la difficulté même à cerner les origines et désigner les causes d’un phénomène dont nous constatons pourtant toutes et tous les effets. Nous sommes face à un (in)connu, pris dans des écosystèmes profondément modifiés, voire pour beaucoup détruits, nous sommes entrés dans une ère dont nous (humains) sommes les agents et qui nous impose de recréer des cadres de pensée qui, sous couvert de rationalité et foi en un progrès technique, nous ont menés tout droit à ce chaos.
Qu’il s’agisse des textes ou de leur contexte, cette instabilité onomastique est aussi le signe patent d’une liberté radicale de pensée et de la réinvention constante d’un champ critique comme littéraire qui croise les disciplines, les investit pour se décréer, interroge sans cesse ses enjeux comme ses perspectives, alors que nous devons désormais « Vivre dans un monde abîmé » (revue Critique, janvier-février 2019) et écrire dans un monde en voie de disparition (Writing for an Endangered World, Lawrence Buell, 2001). Dans l’urgence de cet ici et maintenant, l’écopoétique s’offre tout à la fois comme une approche de ce qui s’écrit aujourd’hui et comme une (re)lecture des grands textes et mouvements littéraires passés. Si ce mode de lecture critique s’est imposé dans les dernières décennies, cette manière de se soucier du monde et des vivants dans le récit n’est en rien une pratique récente. L’écopoétique se développe selon une approche délibérément engagée (écoféminisme, postcolonialisme, gender studies, deep ecology) et une approche narratologique, pour sortir des représentations plaçant l’homme au centre d’une nature dont il s’est cru le maître et possesseur. Or, comme l’écrit Eduardo Kohn, « “nous” ne sommes pas le seul genre de nous » (2017 : 40).
Des récits ouvrent les perspectives et les imaginaires, replacent animaux, arbres, champignons ou fleuves au centre de la représentation littéraire, interrogeant ainsi nos systèmes politiques, sociaux et culturels et nous sommes de plus en plus nombreux à les écouter et même les entendre. Sortant des dualismes et oppositions binaires (nature/culture, humain/non-humain) pour produire des enchevêtrements complexes et cultiver le trouble, ces textes remettent en cause les systèmes de domination, une anthropisation devenue une norme. L’écopoétique réunit un ensemble d’œuvres, créations et essais qui ont en commun leur refus des frontières entre les genres ou les disciplines, puisant leurs fondements épistémologiques dans les littératures (quel que soit leur champ linguistique et culturel) et l’ensemble des sciences. Étudier les forêts dans cette perspective, par exemple, c’est tout autant lire l’anthropologue Eduardo Kohn (Comment pensent les forêts), le professeur de littérature Robert Harrison (Forêt. Promenade dans notre imaginaire), l’écrivain américain Richard Powers (L’Arbre monde) que la romancière française Marie Darrieussecq (Notre vie dans les forêts) dont la narratrice a conscience que « ça demande une révolution mentale, vraiment, de ne plus se voir au centre. Au centre de sa propre vision du monde. De comprendre qu’on est juste un surgeon périphérique » (Darrieussecq 2017 : 182). L’écopoétique permet ainsi de (re)lire un certain nombre de récits répondant à un « green script » (Buell 1995 : 33), interrogeant l’écocide en cours, les bouleversements climatiques et les sujets politiques induits par cette crise (dominations, migrations, pollution, surexploitation des ressources fossiles…). Les textes écopoétiques passés et présents sont en ce sens actuels, au sens étymologique du terme (actualis), c’est-à-dire actifs, agissants.
Les récits écopoétiques prennent bien souvent la forme de « mythologies de la fin du monde », sous-titre de l’essai que Christian Chelebourg a consacré aux Écofictions (2012). Prendre acte de la crise écologique revient pour nombre d’écrivains à revisiter la science-fiction, les dystopies et autres récits apocalyptiques pour prendre la mesure de notre situation historique et environnementale. Pour Jared Diamond nous sommes en effet au cœur d’un véritable scénario de film catastrophe, d’un Effondrement, dont le dénouement sera sans appel si nous ne réagissons pas. Paradoxalement la science-fiction serait même devenue une forme de récit réaliste : le pire est devant nous et, dans ces fictions climatiques, les déserts, les ouragans, les inondations, les mégafeux, les épidémies et autres catastrophes ne sont pas des décors, des images ou des allégories mais bien notre présent – ce qui est face à nous, notre ici et maintenant. La science-fiction et les dystopies ne sont donc plus (et n’ont sans doute jamais été) une manière d’imaginer des futurs hypothétiques, ils ne sont pas une projection mais bien une actualisation, une manifestation de notre situation collective.
Le rhizome, image empruntée à Mille Plateaux (Deleuze et Guattari 1980), innerve les récits et essais écopoétiques : les textes, à l’image des écosystèmes, sont des tissus d’interactions, des agencements en devenir. Nos lectures les actualisent, les pluralisent et les déploient, pour composer un nouvel écosystème, cette symbiose appelée de ses vœux par Rueckert dans son article fondateur de 1978. En somme, « le temps est venu pour de nouvelles manières de raconter de vraies histoires » (Tsing 2017 : 21). Tel est le lien fondamental de la littérature à l’écologie, le programme ouvert de l’auteur comme du lecteur de textes écopoétiques, proche de la mission de l’anthropologue définie par Eduardo Viveiros de Castro dans ses Métaphysiques cannibales, une « théorie-pratique » de « décolonisation permanente de la pensée » (2009 : 4) : apprendre en reconnaissant en l’Autre un sujet, considérer la planète non comme une ressource et un décor mais bien en tant qu’agent de nos récits. Donna Haraway le condense dans ses « Histoires de Camille. Les enfants du compost » : il est « important d’exercer l’esprit et l’imagination à aller en visite, à s’aventurer hors des sentiers battus ». Ce faisant, « on engage la conversation, on pose des questions intéressantes, on répond à d’autres. On propose, ensemble, quelque chose d’inattendu » (2020 : 280). Il est désormais « plus que temps de faire des histoires » (281), dans tous les sens de cette expression : provoquer le trouble par une rébellion, régler nos contes et inventer d’autres récits. C’est ce défi que propose l’écopoétique, celui que se donne ce livre essayant, par des rencontres et des mises en relations, de la définir.