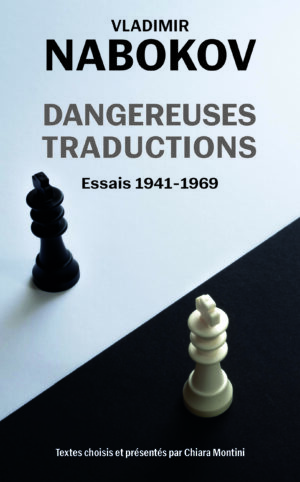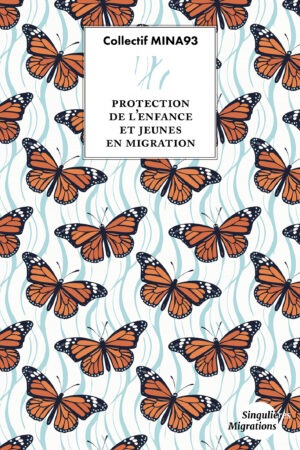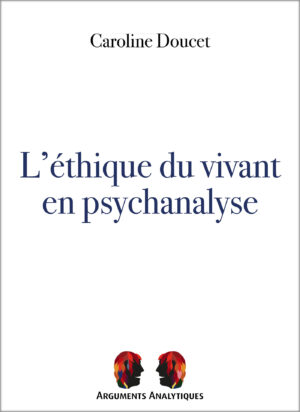Scènes politiques : controverses théâtrales et critique antiraciste
Maxime Cervulle et Bérénice Hamidi
Depuis une quinzaine d’années, du Retour au désert de Koltès mis en scène par Muriel Mayette à la Comédie-Française (2007) à la reconstitution des Suppliantes d’Eschyle par l’helléniste Philippe Brunet à la Sorbonne (2019), en passant par le vrai-faux zoo humain Exhibit B de Brett Bailey (2014), Moi, la mort, je l’aime comme vous aimez la vie de Mohamed Kacimi et Yohan Manca (2017) ou encore Kanata de Robert Lepage avec la troupe du Soleil (2018), la vie théâtrale française a été régulièrement émaillée de polémiques. Toutes présentent deux traits communs : la virulence pour ne pas dire la violence des débats et un même scénario à rebondissements dans lequel des spectacles visant à dénoncer des injustices liées, d’une façon ou d’une autre, à la question raciale et/ou coloniale, en viennent à susciter des réactions indignées… qui font à leur tour l’objet d’une indignation tout aussi virulente. De quoi la multiplication de ces affaires est-elle le signe ? En quoi renseigne-t-elle sur des reconfigurations idéologiques en cours dans le champ théâtral et plus largement dans les champs médiatique, intellectuel et politique ? Ces questions sont au cœur du présent ouvrage. Avant que d’y répondre, il a été d’emblée évident pour nous qu’il s’agissait déjà de trouver comment formuler au plus juste ces questions – quitte, peut-être, à les reformuler.
Scandales, polémiques et controverses sur la question raciale : vers de nouvelles formes-affaires
Il nous fallait une boussole pour nous repérer dans une matière profuse et pour prendre du champ vis-à-vis de son caractère hautement inflammable. C’est en ayant en tête ce double besoin que nous avons choisi d’emprunter à la sociologie et en particulier à la sociologie de la critique1 un panel de notions qui permettent d’analyser la façon dont certaines affaires, à travers l’opposition de deux ou plusieurs parties dans l’espace public, mettent en jeu un conflit entre différentes valeurs politiques et morales et reconfigurent ces valeurs et ces conflits. « Polémiques », « scandales », « controverses », « affaires » : ces termes, souvent employés indifféremment dans l’usage courant, peuvent aider à établir des distinctions éclairantes. La qualification de « polémique » insiste sur les enjeux émotionnels et la subjectivité des parties prenantes. Sa marque stylistique est donc la virulence du ton, reflet de l’intensité des affects mis en jeu – et souvent aussi mis en scène – par les camps qui s’affrontent2. Ce type de débat, particulièrement en vogue à l’ère du clic et du clash, laisse peu de place à la formulation ou l’écoute d’arguments rationnels. Il bouche ainsi l’horizon d’un accord ou d’un compromis possible : il s’agit bien plutôt de consolider l’idée que le différend est irréconciliable3.
Le scandale, seconde forme que prend volontiers le débat politique et médiatique aujourd’hui, n’est pour sa part pas défini par le style et le ton des débats et par la balance entre émotion et argumentation, mais par l’équilibre ou plutôt le déséquilibre des valeurs en conflit : les deux positions opposées ne renvoient pas chacune à un camp constitué car l’une des positions s’avère intenable, indéfendable, aux yeux de l’opinion générale. Autrement dit, le scandale opère comme révélateur de rapports de force entre différentes valeurs et groupes d’acteurs sociaux qui les portent, et constitue une sorte de test qui permet à une communauté, face à une provocation et un provocateur, de réaffirmer son attachement aux valeurs transgressées, ou au contraire de prendre conscience de l’obsolescence de ces valeurs.
À l’inverse du scandale et comme la polémique, la notion de « controverse » fait quant à elle exister un conflit entre valeurs qui sont toutes audibles dans l’espace médiatique. Cependant, à la différence de la polémique, la « controverse » permet de caractériser un débat certes fortement polarisé mais marqué par la production d’échanges argumentés, dans un contexte où les deux camps se sentent à la fois légitimes et tenus de défendre leur position avec des raisonnements de type rationnel4. Ces affaires impliquent souvent des membres du monde académique et empruntent donc en partie aux règles du débat scientifique. L’affaire la plus typique de ce point de vue ces dernières années est sans doute l’affaire Chénier5, qui portait sur une autre question qui fâche, les violences sexuelles, et plus précisément sur l’arbitrage entre lutte contre la culture du viol et liberté de création, et sur la question de la responsabilité de la littérature et des représentations culturelles dans la reproduction ou la transformation des représentations sociales. Née au sein de l’institution universitaire, elle a donné lieu à la production de centaines de pages défendant différents points de vue complexes et nuancés6.
Même si elle ne décrit pas au plus près tous les cas étudiés, nous avons choisi de privilégier cette notion de « controverse » parce qu’elle constitue un horizon pour leur analyse. Elle nous semble d’autant plus éclairante si on l’associe à une autre notion attentive, elle, à la question de la forme à la fois théâtrale et judiciaire que prennent ces affaires dans l’espace public. La « forme-affaire7 » observe ces cas au prisme de l’opposition entre deux scènes de justice. L’une, instituée, est la scène judiciaire établie qui incarne l’état antérieur des forces et des rapports de force en présence. L’autre, qu’on peut dire instituante8, opère quant à elle sur la place publique et comme une contre-scène judiciaire qui préfigure un nouvel ordonnancement des valeurs. De l’une à l’autre scène, les rôles canoniques du procès sont les mêmes : victime, accusé·e, procureur·e, juge, juré·es. Mais les acteurs sociaux qui occupent ces rôles changent. Celui qui était victime sur la scène judiciaire établie se retrouve accusé sur la seconde, l’accusé devient victime, etc. Et cette reconfiguration est due à l’arrivée d’un nouvel acteur, un « accusateur non professionnel9 », une figure intellectuelle (Voltaire dans l’affaire Calas, Zola dans l’affaire Dreyfus) dotée d’une capacité à reconfigurer la hiérarchie des valeurs légitimes dans l’espace public : les « arguments et preuves de conviction10 » qu’il présente sur la scène du débat public « font alors ressortir l’iniquité des fondements de justice de l’ancienne disposition11 » incarnée par le traitement de l’affaire dans l’arène judiciaire et font aussi « apparaître des groupes alliés qui permettent, par leur mobilisation, de la déceler et de la montrer, éclairant ainsi le collectif (le peuple, l’opinion, par exemple)12 ».
Si la notion de « forme-affaire » éclaire les cas qui nous intéressent, on peut réciproquement considérer que ces derniers ont pour intérêt de montrer une évolution de la forme qu’ont pris les affaires dans l’espace médiatique depuis une vingtaine d’années. C’est particulièrement l’identité de « l’accusateur non professionnel » qui tend à se pluraliser : Voltaire ou Zola revendiquaient une position a priori extérieure à l’affaire et désintéressée, au sens de déliée de tout sentiment d’appartenance au groupe, à la communauté culturelle, politique ou religieuse ou d’adhésion aux valeurs du groupe auquel appartenaient les accusés. Voltaire n’est pas protestant quand il dénonce l’intolérance envers les protestants que révèle selon lui l’affaire Calas, Zola dénonce l’antisémitisme dont a été victime Dreyfus sans être juif et même, pourrait-on dire, il le dénonce en tant qu’il n’est lui-même pas juif, au nom du fait qu’il se tient à équidistance des parties. C’est cette neutralité de principe qui, avec leur style, conférait à la position de ces intellectuels sa légitimité. Inversement, aujourd’hui, d’autres formes de légitimité sont revendiquées dans les affaires qui nous occupent. Ainsi, la controverse autour d’Exhibit B, qui fut l’un des événements déclencheurs de la création du collectif Décoloniser les arts, a mobilisé des universitaires habitué·es à intervenir dans l’espace public mais de nouveaux acteurs ont fait leur apparition, les artistes et militant·es réuni·es au sein du collectif Contre Exhibit B revendiquant de parler depuis une appartenance commune, celle de personnes faisant l’expérience de la discrimination raciale dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle d’artiste, et justifiant cette légitimité située par le fait que cette expérience vécue du racisme constitue la source d’une expertise irremplaçable. Au-delà de mettre en scène l’opposition entre des arguments en concurrence, une telle controverse donne donc à voir la tension entre des régimes d’énonciation distincts13 : l’adossement de la parole publique à des formes d’expertise fondées sur l’expérience minoritaire (revendiquée par les « Contre Exhibit B »), sur l’expérience esthétique (revendiquée cette fois par celles et ceux qui défendent le spectacle, accusant les premier·es de ne pas l’avoir vu), voire sur l’autorité institutionnelle.
Quelle que soit la manière dont on aborde ces affaires, force est donc de reconnaître qu’elles ont joué un rôle de reconfiguration du débat public à plus d’un titre. D’abord, elles ont participé du développement d’un activisme antiraciste dans le champ culturel, avec la mise en circulation large dans l’espace médiatique, autant pour leur reconnaître de la valeur que pour les disqualifier, de critères d’évaluation des œuvres excédant le seul niveau esthétique et interrogeant à nouveaux frais la responsabilité sociale des œuvres et des institutions culturelles. Ensuite, elles ont largement débordé du domaine exclusif du théâtre : certains des antagonismes forgés à l’occasion de ces controverses ont à la fois pris de l’épaisseur et du champ, en se trouvant remobilisés à l’occasion de controverses concernant d’autres types d’institutions ou de secteurs culturels – on peut penser par exemple aux débats sur le déboulonnage des statues ou à ceux portant sur l’émergence de « sensitivity readers » dans le champ de l’édition. Ce faisant, ces affaires ont contribué à la reconfiguration de la notion de « liberté d’expression ». Les interruptions de représentations ou les demandes de déprogrammation de certaines œuvres se sont déroulées dans un contexte marqué à la fois par des évolutions juridiques (telle que l’adoption en 2016 de la loi relative à la « liberté de création »14) et par l’investissement dans le concept de « liberté d’expression » d’une nouvelle charge politique et affective dans le sillage de l’attentat de 2015 contre Charlie Hebdo. Ces controverses ont, enfin, occupé une place de premier choix dans la configuration d’une panique morale15 cristallisée autour de termes épouvantails tels que « cancel culture », « wokisme » ou « islamo-gauchisme », et centrée autour de l’idée selon laquelle la période contemporaine verrait un basculement d’une censure d’État vers une censure ordinaire, de faible intensité, opérée par des groupes minoritaires vus comme porteurs d’intérêts « particularistes ». Ce récit relativiste, au sens où il occulte à la fois la puissance de prescription culturelle de l’État (et donc son revers, l’inégalité fondamentale du partage des moyens de production) et les restrictions effectives à la libre expression mises en œuvre par ce dernier durant les dernières années, a contribué à une forte dichotomisation des positions et à rendre ces débats particulièrement brûlants.
Les débats autour de la notion nébuleuse de cancel culture, tout comme la multiplication des cas de mises en cause d’œuvres, d’artistes ou de programmations, ont désormais une place de choix dans l’agenda médiatique. Pourtant, les controverses sur le racisme dans le champ théâtral ne constituent pas une simple manifestation parmi d’autres de la montée d’un activisme culturel antiraciste. Du point de vue médiatique, elles en seraient même le point d’origine. En effet, le cadrage médiatique actuel de l’activisme culturel antiraciste, focalisé sur l’idée de cancel culture, prend centralement appui sur le traitement journalistique antérieur des cas de contestations d’œuvres théâtrales. Les controverses théâtrales sont d’ailleurs régulièrement dépeintes par les journalistes comme un moment inaugural en France de l’importation de notions et approches militantes états-uniennes. Cette affirmation mérite pourtant nuance, car l’apparition de la question raciale est tout autant à resituer dans l’histoire du théâtre public français.
De la lente et difficile entrée en scène
de la question raciale dans le théâtre public
Ce n’est pas un hasard si, en France, ces controverses se sont cristallisées particulièrement sur la scène du théâtre public, dont la proto-histoire a commencé sous les expressions « théâtre populaire » et « théâtre du peuple » à la fin du xixe siècle, autrement dit au moment de la consolidation de la IIIe République16. Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que la scène théâtrale coalise les tensions du modèle républicain, et notamment celles que concentrent l’idéal universaliste et le principe de la démocratie représentative. Sans refaire ici l’histoire des politiques publiques du théâtre, rappelons que cet art est financé par la collectivité depuis la Seconde Guerre mondiale au nom de la promesse d’émancipation qu’il porterait par essence et du fait qu’il serait plus que tout autre un art démocratique, voire qu’il serait l’art de la démocratie par excellence et qu’il participerait du débat politique comme de la construction de l’espace public. Cette croyance s’explique en partie par le fait que cet art de la parole publique, en public, offre un cadre de réception collectif (par différence avec la littérature) et en co-présence des corps, sur la scène et dans la salle (à la différence du cinéma). Cette croyance ne tient cependant pas qu’aux spécificités matérielles du médium artistique, pour indéniables qu’elles soient. Elle prend aussi sa source dans ce qu’on peut véritablement qualifier de mythologie du théâtre public – au sens où il s’agit d’un récit fondateur glorieux qui soude l’ensemble des actrices et acteurs professionnels du champ théâtral – selon lequel la scène théâtrale opèrerait comme l’agora grecque antique et le public de théâtre comme l’assemblée citoyenne. La scène représenterait ainsi le peuple face au peuple présent dans la salle. De là, le paradoxe constitutif du théâtre public, où tout est fait au nom du peuple-public mais sans lui, par ses représentant·es, ce qui pose de façon aigüe la question de la représentativité desdit·es représentant·es… et du peuple-public. Côté salles, la prise de conscience du décalage avec la composition réelle de la société est assez ancienne : elle date des années 1968, de la Déclaration de Villeurbanne et des premiers travaux de Bourdieu, implacablement confirmés depuis par les enquêtes décennales sur les pratiques culturelles des Français, qui montrent que plus de 80 % de la population française manque à l’appel17 et que le problème est au moins autant qualitatif que quantitatif, puisque c’est particulièrement le peuple qui manque, si par ce mot on entend les classes populaires.
Côté scène, la prise de conscience du manque de représentativité est beaucoup plus tardive. Elle a commencé au milieu des années 2000, dans un contexte politique propice à l’élargissement de la question de la représentativité et de son manque au-delà de la classe, aux rapports sociaux de genre et de race. La question raciale est toutefois celle dont l’arrivée sur la scène du théâtre public a été la plus tardive – et la plus difficile.
Il y a d’abord eu une arrivée manquée en 2006, au moment de la publication du rapport connu sous le nom de son autrice Reine Prat, haut-fonctionnaire au ministère de la Culture et chargée de mission « ÉgalitéS ». Intitulé Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant, il visait dans son principe, comme l’indiquait le pluriel, à saisir ensemble les différents défauts de visibilité/représentativité, dans une perspective intersectionnelle. Toutefois, eu égard aux moyens modestes alloués à cette mission, ce premier rapport se focalisait sur les inégalités de genre et plus précisément les inégalités hommes/femmes, ce que précisait son sous-titre « 1. Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation ». C’est suite à ce rapport que s’est fondé le mouvement H/F « pour l’égalité femmes/hommes dans les arts et la culture ». Si cette question est toujours loin d’être résolue aujourd’hui – les statistiques le prouvent –, le fait qu’elle soit arrivée par le haut a contribué à la rendre audible et légitime.
À l’inverse, la question raciale est arrivée par le bas et de biais. Après cette première occasion manquée, elle est arrivée par la bande en 2007 avec l’affaire Koltès18, quand l’ayant droit de l’auteur a refusé la prolongation de la durée d’exploitation de la pièce Retour au désert par la Comédie-Française, au motif que la metteuse en scène Muriel Mayette avait distribué un comédien blanc dans le rôle d’Aziz, personnage d’Algérien arabophone écartelé entre le FLN et ses patrons pieds-noirs. C’est moins l’enjeu de vraisemblance de la distribution et donc le problème de crédibilité au regard de l’intrigue qui ont été mis sur le devant de la scène argumentative de cette controverse portée en justice, que le fait que ce choix de distribution contrevenait à la volonté explicite de l’auteur, que l’ayant droit se fixait pour devoir de faire respecter. Dans cette affaire, la question raciale s’est donc formulée non pas frontalement mais sous l’angle du respect (ou de l’abus) du droit d’auteur, et sous l’angle de la confrontation entre deux légitimités artistiques et deux libertés de création, celle de l’auteur et celle du metteur en scène.
Après ces deux fausses entrées, la question raciale est enfin arrivée en fanfare durant la saison 2014-2015 à la faveur de deux affaires, l’une portant sur un spectacle, Exhibit B, à l’automne 2014 ; l’autre sur un dispositif de recrutement des interprètes, « Premier Acte », au printemps 2015. Ces deux affaires ont configuré plusieurs aspects de la formulation de la question raciale au théâtre.
En termes d’acteurs et d’actrices de la contestation d’abord, puisque dans les deux cas, l’affaire est née par le bas et non pas du côté des créatrices et créateurs mais des récepteurs et réceptrices potentiel·les, qu’il s’agisse des publics de l’œuvre ou des bénéficiaires du dispositif de sélection. En termes de cadres d’intelligibilité ensuite, puisque les deux affaires ont en commun d’avoir articulé entre elles plusieurs questions esthétiques et d’avoir associé les questions esthétiques aux questions socio-économiques et socio-professionnelles (de distribution et de partage de l’auctorialité au sein des processus de création). Sur le plan esthétique, la question « quelles images sont représentées » s’est nouée à celle des types de représentant·es du peuple figuré·es (personnages) ou présent·es sur scène (interprètes), ainsi qu’à celle du type d’adresse au public. Un autre aspect de la configuration de la question raciale comme question esthétique a porté sur la possibilité (ou non) de séparer la question de l’intention artistique du metteur en scène de celle des effets esthétiques produits par l’œuvre dans un contexte de réception contemporain où l’activité interprétative des publics se trouve toujours lestée du poids de l’histoire racialisée des représentations19. Exhibit B, créé par le metteur en scène sud-africain blanc Brett Bailey, est ainsi une œuvre à l’intention antiraciste explicite et indiscutable, qui s’est pourtant vue accusée de produire une esthétique susceptible d’être qualifiée de raciste pour trois raisons. D’une part, parce qu’elle assignerait les personnages représentés à une place de victime absolue essentialisée. De fait, ce spectacle qui joue sur le double sens du mot « exhibit » (exposition et preuve) et qui parodie de façon critique le dispositif des zoos humains de l’époque coloniale et l’exhibition de personnes noires, plaçant les spectateurs et spectatrices, pour l’essentiel blanc·hes, moins dans une position de voyeurisme complice que de réflexivité culpabilisée, ne représente aucune des nombreuses formes de résistances à l’esclavagisme et au (néo) colonialisme qui n’ont pourtant cessé d’exister au cours de l’Histoire. D’autre part, le spectacle a aussi été critiqué parce que cette assignation des personnages et de la version de l’histoire représentés serait redoublée par l’assignation des interprètes présent·es sur scène, qui seraient réduit·es à un rôle passif car silencieux. Ce point a toutefois davantage fait l’objet de discussions, du fait de l’intensité du travail sur les regards et des effets d’empathie et de réciprocité produits par l’inversion du rapport regardant·e/regardé·e dont beaucoup de spectateur·ices ont témoigné. Enfin, le spectacle a été critiqué pour la façon dont ces choix esthétiques s’inscriraient dans un rapport de travail artistique lui-même racialisé, où la ligne de couleur se superposerait exactement à la ligne de démarcation hiérarchique séparant le metteur en scène/décideur artistique/employeur blanc et les interprètes/exécutant·es/employé·es racisé·es, et redoublerait ce rapport de domination.
La plupart de ces questions se sont retrouvées au cœur du vif débat qui a eu lieu lors de la soirée de lancement du dispositif « Premier Acte » le 30 mars 2015. Là aussi, un projet à l’intention antiraciste s’est vu accusé avec virulence de renforcer les discriminations raciales sous couvert de lutter contre elles20, au motif qu’il ciblait spécifiquement ces discriminations et se présentait alors comme une alternative aux grandes écoles destinées à l’ensemble des apprenti·es comédien·nes, ces critiques étant inséparables dans leur formulation du constat que le dispositif avait été mis en place par un metteur en scène blanc et que le plateau composé pour en vanter les mérites reproduisait une forme d’hégémonie blanche.
C’est par ces deux affaires que s’est formulée dans le débat public la question raciale théâtrale. C’est d’ailleurs à leur suite que s’est fondé le collectif Décoloniser les arts, volontiers réduit dans les discours médiatiques au qualificatif de collectif militant alors qu’il réunit aussi beaucoup d’artistes. Cette opposition entre artistes et militants, mais aussi entre militantisme antiraciste et liberté de création, s’est ensuite retrouvée en 2019 avec l’affaire des Suppliantes. Si, cette fois, l’œuvre ne se voulait pas antiraciste, c’est la même question de savoir si l’absence d’intention raciste du metteur en scène suffit à exonérer l’œuvre de tout effet de sens raciste possible, et suffit à autoriser l’utilisation d’un outil esthétique inscrit dans l’histoire des représentations culturelles en tant que cette histoire est racialisée et a longtemps été raciste.
Cette affaire a ainsi posé la question de savoir si l’on peut ou non faire fi de cette histoire et donc de la charge raciste contenue dans le blackface, pratique culturelle dont les significations ont été plurielles au cours de l’Histoire21 mais qui s’est indéniablement popularisée à la fin du xixe siècle aux États-Unis, son histoire étant d’ailleurs si étroitement liée à celle du racisme institutionnel que les lois de ségrégation raciale sont connues sous le nom de « lois Jim Crow », du nom du plus célèbre personnage de Minstrel Show de l’époque. Ce lien a laissé des traces dans la structuration de nos imaginaires et y a ancré des stéréotypes racistes contenus dans le blackface, tant en termes phénotypiques (le maquillage noir, les grosses lèvres rouges et les grands yeux étonnés cernés de blanc) qu’en termes comportementaux (les clichés oscillant de l’indolence naïve et la paresse infantile à la bestialité sauvage). C’est toutefois l’argument adverse, disqualifiant la pertinence de ces considérations au profit de la défense de la liberté de l’acteur de tout jouer et du metteur en scène de s’emparer de toutes les histoires qui a dominé dans le discours médiatique.
Si les contributions de l’ouvrage s’arrêtent après 2019 et cette affaire, soulignons toutefois que, depuis, le travail de formulation de la question raciale poursuit son cours, le même argument de la défense de la liberté de création s’étant trouvé en 2023 mobilisé à nouveau par les « grands » du théâtre public, mais cette fois pour défendre la liberté d’une autrice-performeuse, Rébecca Chaillon, de créer une œuvre, Carte Noire nommée désir, dont tous les choix dramaturgiques et scéniques peuvent s’interpréter comme une défense et illustration esthétique de la pertinence percutante de l’antiracisme politique. Et cette fois, les spectateurs ayant violemment manifesté leur opposition au spectacle se sont vus accusés de racisme sans hésitation par les défenseurs de la liberté de création.
Il est enfin un dernier argument qui s’est trouvé mobilisé dans la plupart des affaires depuis 2014 : celui de la responsabilité spécifique des représentations culturelles dans la fabrique de nos imaginaires collectifs et leur possible transformation. La rhétorique des « récits/personnages/voix/corps manquants » insiste ainsi sur la nécessité de les inclure pour que s’incarne enfin scéniquement l’idéal universaliste, et pour que l’ensemble de la population puisse s’identifier à ces histoires, ces personnages et donc ces vécus jusque-là relégués dans les marges de la représentation. C’est donc souvent sous l’angle de l’entrave aux possibilités d’identification que le manque de représentativité se trouve mis en question. Ainsi, c’est le témoignage d’une jeune fille à la peau noire qui avait signifié à Stanislas Nordey qu’il lui était impossible de se projeter dans le métier d’actrice parce qu’elle ne voyait jamais personne qui lui ressemblait, ni dans les salles ni sur les scènes de théâtre, qui a justifié pour le metteur en scène l’existence du dispositif « Premier Acte ». À l’inverse, ceux et celles qui arguent que l’acteur peut tout jouer et qui déplorent un possible tournant identitaire des revendications des minorités en matière de représentation insistent volontiers sur la capacité de tout un chacun à s’identifier à n’importe qui. Ils tendent même à juger de la qualité d’une œuvre par sa capacité à constituer un support d’identification universel.
Si tout le monde est de fait a priori capable de s’identifier sur d’autres bases que la simple ressemblance et la reconnaissance d’un unique trait commun physique ou social entre soi et le personnage (qu’il s’agisse du phénotype, du genre, de l’orientation sexuelle), il n’en reste pas moins que le privilège de se voir représenté·e sans même avoir à y prêter attention n’est pas également distribué. Les groupes sociaux en position minoritaire ne voient en effet que très rarement ces supports d’identification représentés et encore, quand c’est le cas, ils le sont le plus souvent de façon caricaturale et dévalorisante. C’est donc moins une question de capacité d’identification que de supports de projections disponibles et de possibilité ou non de sentir que tel ou tel aspect de ce qui constitue tel sujet ou tel groupe, et qui fait partie d’eux, même s’il ne les définit pas intégralement et à quoi ils ne s’identifient pas de façon exclusive et continue (car on ne s’identifie jamais à une seule chose ni pour toujours), a non seulement droit à l’existence mais est digne d’être représenté et constitue un support de projection positive désirable, susceptible de faire rêver. Inversement, à force de répétition de cette absence ou, au mieux, d’une présence précaire et marquée au sceau du négatif (violence, souffrance, etc.), il est des apparences, des appartenances constituant des supports d’identification existentiels et donc des vies qui sont altérisées, rejetées dans l’ombre, hors du sentiment de commune appartenance à l’humanité universelle. À travers ces affaires, ce sont donc à la fois la répétition structurelle de l’absence de personnages et d’interprètes non blancs comme supports d’identification positifs22 et, réciproquement, la « répétition itérative de la blanchité23 » et d’une blanchité valant comme ensemble des couleurs et comme seul support d’identification positif possible pour les personnes blanches comme pour les personnes non blanches, qui se sont trouvées formulées comme un problème.
L’étude de ces controverses et celle de leur élaboration discursive et argumentative dans l’espace public médiatique permettent ainsi d’appréhender, par-delà la variété des modalités de la critique antiraciste et des objets culturels auxquelles elle est appliquée, la configuration de la question raciale théâtrale en tant que question esthétique et politique, tout autant que la configuration du discours hégémonique de disqualification de l’activisme culturel antiraciste.
Circulation transnationale du lexique antiraciste
Le caractère inflammable de ces controverses est manifeste aussi bien sur le terrain médiatique et dans le secteur théâtral que dans le champ universitaire lui-même. En effet, une autre particularité de ces controverses est qu’elles impliquent les universitaires non simplement comme analystes mais aussi, souvent, comme protagonistes d’une conflictualité tout à la fois esthétique, théorique et politique24. Certes, chaque cas soulève des enjeux spécifiques et l’une des tâches est ici d’ailleurs de discerner ces singularités et d’établir des comparaisons aussi attentives aux différences qu’aux ressemblances entre eux. Toutes ces controverses ont toutefois en commun de poser et donc aussi de faire exister la « question raciale ». Que ce soit pour le saluer ou le déplorer, beaucoup de commentaires ont d’ailleurs appréhendé ces controverses et leur accumulation comme la manifestation d’une montée en puissance de formes d’antiracisme inédites en France, se déployant sous la forme d’un « activisme culturel » impliquant de nouveaux groupes militants. Ceux-ci appuient leurs revendications sur une conception systémique du racisme, mais aussi sur des corpus analytiques et des concepts peu usités jusqu’ici et pour l’essentiel importés du continent nord-américain.
De fait, il serait difficile de saisir ce qui se joue dans ces controverses sans mobiliser les notions de « blackface », d’« appropriation culturelle », de distribution « colorblind » ou « color-conscious » ou encore de « privilège blanc », convoquées par les détracteurs des spectacles et désormais largement débattues. C’est la raison pour laquelle plusieurs chapitres de l’ouvrage proposent des ouvertures vers l’analyse de la configuration de tels débats aux États-Unis ou au Canada, permettant de comprendre la diffusion de certains cadrages interprétatifs ou, à l’inverse, les effets de décalage entre des espaces publics français et nord-américains traversés par des attentes, des normes et des manières de concevoir le rôle social et politique du théâtre fort éloignées. C’est par exemple le cas du chapitre de Mathilde Barraband et Anne-Marie Duquette qui, à partir de l’étude du traitement médiatique et de la réception de la polémique autour du spectacle Slāv au Québec, donne à voir la spécificité respective des contextes québécois et français : tandis que le premier voit celles et ceux qui défendent les œuvres incriminées se présenter en « protecteurs de l’espace démocratique », en France ils adopteraient plus volontiers un « positionnement esthète », en revendiquant une autonomie du champ artistique. Dans le chapitre qu’il consacre à « l’affaire Kanata », Jean-Philippe Uzel montre de son côté non seulement la profonde distorsion de cette polémique québécoise lors sa circulation en France, mais analyse surtout la montée de la tension autour de cette coproduction franco-québecoise comme l’expression d’un « clivage culturel qui fait ressortir des lignes de fractures importantes entre la France et le Canada sur les questions de la liberté d’expression artistique et de la censure, mais aussi sur celles de l’autochtonie et de la place des minorités dans l’espace public ».
Par le dialogue plus ou moins implicite qu’elles entretiennent avec le contexte nord-américain, les controverses qui se déploient en France mettent autant en cause qu’en lumière le modèle-républicain-universaliste-à-la-française. Or ce modèle structure non seulement le champ politique et médiatique mais aussi les champs intellectuel et académique, dans les disciplines qui prennent les œuvres d’art pour objet (études théâtrales, histoire de l’art, sociologie et sciences de l’information et de la communication notamment). Le conflit porte donc aussi sur le fait de considérer ou non que ces concepts et idées peuvent être mobilisés non simplement en tant qu’éléments du discours des acteurs sociaux impliqués, mais aussi en tant que catégories opérantes pour l’analyse. Peut-on alors faire l’hypothèse que ces controverses témoignent, un siècle après les débats politiques sur la notion de « peuple » et de « théâtre populaire » dans les premières années de la Troisième République, d’une capacité retrouvée du théâtre à opérer comme scène de cristallisation de débats politiques brûlants sur les contours et les valeurs de la démocratie et de la République française ?
De la critique antiraciste des œuvres
au débat institutionnel sur la « diversité »
Les controverses théâtrales sur le racisme recèlent une dimension esthétique, aussi bien au sens ranciérien d’un « partage du sensible » définissant « les places et les parts respectives »25, qu’en ce qu’elles interrogent les formes artistiques au travers desquelles le racisme peut être représenté, critiqué ou déjoué. Elles mettent ainsi à l’avant-plan la question de la signification du corps des interprètes au plateau, et de la manière dont on peut ou non se défaire des significations socio-historiques attachées à la couleur de peau, mais aussi les enjeux relatifs à l’énonciation théâtrale ou aux dimensions inextricablement éthiques et esthétiques de la reproduction scénique de la violence. Les questions esthétiques, qui sont souvent posées dans les études théâtrales comme relevant d’un champ d’analyse autonome, se trouvent toutefois formulées au sein de ces controverses en articulation avec la structuration du champ socio-économique professionnel et plus largement du champ social dans lequel les œuvres sont créées et reçues – notamment sous la forme d’un questionnement autour de l’imaginaire social véhiculé. L’ouvrage interroge donc la manière dont ces controverses impliquent une redéfinition et une extension du cadre d’analyse des œuvres comme des critères de jugement ordinaires. Il propose ainsi d’aborder le questionnement esthétique soulevé par ces controverses depuis un point de vue décentré, non comme une dimension souveraine mais comme un registre argumentaire, parmi tous ceux qui participent de leur configuration publique. Il s’agit donc moins d’apprécier la contribution de ces controverses à l’esthétique per se que de rendre compte des conditions dans lesquelles un argument peut être reconnu comme relevant pleinement du champ de l’esthétique, ainsi que d’exposer les façons par lesquelles les enjeux pourtant indissociablement socio-politique et esthétique de ces controverses en sont venus à être pensés comme concurrents voire antagonistes.
Plusieurs controverses posent frontalement la question de savoir comment et dans quelle mesure les œuvres peuvent faire exister textuellement et scéniquement des discours et des images aujourd’hui jugés inacceptables. Certaines mettent au centre la question de la nécessité ou non de prendre en compte l’histoire des représentations artistiques, qui s’inscrivent dans une histoire des représentations sociales marquée par l’existence de stéréotypes racistes et ce, que les œuvres s’affranchissent de cette histoire (blackface des Suppliantes) ou entendent la critiquer (Exhibit B). C’est ce qu’explore notamment Sylvie Chalaye dans un article consacré à ce qu’elle appelle non pas le blackface mais le barbouillage, façon de rappeler combien ces questions sont aussi inscrites au cœur de l’histoire des représentations et de celle du théâtre français depuis le Moyen Âge. Son analyse montre aussi combien sont entremêlées les questions esthétiques, en l’occurrence des représentations reproduisant des stéréotypes racistes, et les questions socio-économiques comme celle des choix de distribution induisant des formes de discrimination dans l’accès aux emplois artistiques, quand certain·es comédien·nes – celles et ceux qui, parce que blancs, ont le privilège de n’avoir pas de couleur et peuvent ainsi tout jouer alors que d’autres interprètes, « de couleur », se voient cantonné·es à des rôles réduits tant quantitativement que qualitativement (rôles stéréotypés). Sa réflexion mène vers une reformulation de la question du blackface, trop souvent abordée sous l’angle de l’intentionnalité : quelle place accorder à la question de l’intention ou l’absence d’intention de discrimination de la part d’une ou d’un metteur en scène, dès lors que ses choix d’images ou de distribution produisent un effet discriminant ?
Par ailleurs, la question du grimage d’interprètes blancs pour jouer des personnages non blancs ne se limite pas au blackface. Il y a lieu de préciser et de diversifier l’analyse des formes qu’ont pu prendre historiquement les représentations stéréotypées racistes en incluant le yellowface. L’article d’Élisabeth Viain ouvre ainsi le champ d’une réflexion qui émerge à peine dans le débat public en France (notamment grâce à la série Drôle ou au roman de Grace Ly Jeune fille modèle) alors qu’elle est travaillée depuis une trentaine d’années aux États-Unis. L’enjeu est d’importance. D’abord, pour faire droit aux spécificités des représentations stéréotypées et des discriminations raciales que subissent les personnes perçues comme asiatiques. Ensuite parce que, selon les arts, le yellowface est une pratique au moins aussi fréquente voire plus que le blackface. C’est le cas à l’opéra, mais aussi dans une certaine mesure au cinéma – un des exemples les plus célèbres étant sans doute celui de Mickey Rooney dans le film de Blake Edwards Breakfast at Tiffany’s. Enfin parce que ce sont les critiques du yellowface qui ont été le support d’un élargissement du questionnement d’un usage strict de la notion vers une utilisation même hors de tout maquillage, et d’autre part, d’une critique du grimage proprement dit à celle white-washing et de l’appropriation culturelle.
Une question commune à la plupart des controverses porte donc sur les enjeux politiques des choix de distribution et plus largement sur la question de la couleur de peau des artistes. Dans certains cas, la controverse a porté sur le recours à des comédien·nes blanc·hes pour jouer des personnages non blancs (l’affaire Koltès et Les Suppliantes). Dans d’autres, toute l’affaire était de savoir si le fait de mettre en scène des histoires et des personnages appartenant à certaines populations impliquait ou non de solliciter des comédien·nes émanant de ces groupes sociaux (Kanata). Plusieurs de ces controverses ont donc impliqué un débat sur les approches naturalistes de l’emploi et sur les conceptions de l’incarnation théâtrale qui ont longtemps prévalu et prévalent encore. En invitant à un pas de côté via le contexte nord-américain, le chapitre d’Angela Pao, spécialiste de l’histoire des pratiques de distribution « inclusive » aux États-Unis, constitue un éclairage précieux sur cette question. Il montre à quel point le mode de distribution « colorblind », qui s’oppose précisément à une approche naturaliste de l’emploi en considérant que le choix des comédien·nes ne saurait tenir compte de leur couleur de peau, s’est trouvé sous le feu des critiques dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Ce mode de distribution a été notamment accusé d’occulter l’histoire du racisme, ainsi que de limiter l’expression sur scène de récits situés et incarnés du monde social, qui aux yeux de certain·es militant·es antiracistes seraient seuls en mesure de donner une forme dramaturgique pertinente aux inégalités raciales.
En France, ces controverses ont aussi articulé ces questions de distribution à un débat, bien plus institutionnel, sur la diversification des corps, des voix et des récits présents sur les scènes et plateaux26. Elles ont donc été l’occasion de formulation de revendications en matière d’accès à la formation, à la programmation et à des positions de pouvoir institutionnelles de groupes qui s’estiment assignés à des rangs subalternes en raison de leur couleur de peau. Ces revendications ont ensuite été portées, au sein du champ théâtral, par des collectifs en lutte contre les discriminations ethnoraciales (Décoloniser les arts) puis par des artistes situé·es en haut de la hiérarchie du théâtre public et par les pouvoirs publics (les dispositifs Premier Acte et la classe préparatoire intégrée à la Comédie de Saint-Étienne).
Inscrites dans un contexte socio-professionnel dont la prise en compte est nécessaire à leur intelligibilité, ces controverses ont donc aussi produit en retour des effets de transformation de ce contexte, que l’ouvrage entend également interroger. C’est en particulier le cas au travers d’un entretien collectif réunissant la metteuse en scène Marine Bachelot Nguyen, la dramaturge Penda Diouf et le metteur en scène David Bobée, autour des enjeux que soulève la « politique de diversité » dans le théâtre public. Interrogeant la conceptualisation et la mise en œuvre de cette politique, qui survient dans le sillage de la controverse autour du spectacle Exhibit B en 2014, l’entretien explore la manière dont cette question invite à repenser divers enjeux – de la distribution artistique à la formation des comédien·nes, en passant par le système de financement public et la composition des commissions – tout en réaffirmant une conception du théâtre public comme assurant une mission de service public, celle de la conversion « d’une population par essence diversifiée en un peuple un et indivisible avec un vocabulaire et référentiel communs27 ».
Polarisation énonciative et médiatisation
des controverses
La médiatisation de ces controverses revêt clairement une dimension centrale, dans la mesure où celles-ci se déploient pour l’essentiel dans des arènes médiatiques, qu’il s’agisse des colonnes des journaux et des pages des hebdomadaires ou des réseaux socio-numériques. Quel rôle joue donc le traitement journalistique dans la mise en forme de ces conflictualités ? Quels sont les cadrages médiatiques prédominants et ces derniers épousent-ils pleinement le cadrage proposé par les « définisseurs primaires » que représentent ici les institutions culturelles28 ? Quelles sont les stratégies de communication employées par les militant·es mobilisé·es ? Et à quelles conditions ces militant·es peuvent-ils et elles parvenir à se constituer en source d’information ? Quels discours et quels silences, quelles présences et quelles absences structurent la médiatisation de ces controverses ? Il s’agit, en particulier dans la deuxième partie de l’ouvrage intitulée « Construire des controverses : stratégies de lutte, médiatisations et (in) visibilités », de considérer le rôle que joue la médiation médiatique, en étudiant la manière dont elle façonne les antagonismes politiques et tensions discursives. Cela permet également de questionner l’effet du cadrage médiatique sur la montée en affectivité des débats, qui tend à dichotomiser les positions selon un ordre manichéen29. C’est ainsi l’espace public médiatique lui-même, et la manière dont il se trouve transformé par ces controverses successives, qui se trouvent au cœur du questionnement.
Parmi les tensions discursives particulièrement manifestes dans la médiatisation de ces controverses se trouve la question de la manière dont les publics sont pensés au sein du champ culturel et en particulier du théâtre public. Tandis que la définition ordinaire de la culture a changé – passant d’une délimitation étroite, focalisée sur l’expression artistique, à une conception anthropologique désormais partie intégrante du sens commun30 – les appels à l’expertise des publics se sont multipliés31. Or, cette expertise constitue l’un des points centraux de crispation dans plusieurs des controverses. L’expertise des publics mobilisés contre les spectacles fait l’objet, parmi certains acteurs culturels et dans la majeure partie de la presse, d’une profonde disqualification, allant au-delà de la simple contestation de leurs méthodes d’action. La description de ces publics, par certains de leurs contradicteurs, comme étant caractérisés par l’ignorance ou l’incompétence en matière esthétique32 est-elle le signe d’un raidissement de l’expertise professionnelle face à la montée de la valorisation des compétences profanes et du débat sur les droits culturels33 ? Ou d’un souci de préserver une autonomie des critères esthétiques dans l’évaluation des œuvres ? Là encore, la tâche première est de partir de la manière dont sont décrits les détracteurs dans le discours des défenseurs : sont-ils considérés comme des publics de théâtre, destinataires a priori des œuvres, et faisant preuve a posteriori d’incompétence, ou comme des organisations militantes et donc comme des acteurs exogènes au champ, imprévus et importuns ? C’est l’une des voies suivies par Maxime Cervulle et Marie Tomasweski dans leur contribution, qui démontre, à partir d’une analyse de l’évolution du cadrage médiatique de la controverse sur le racisme théâtral entre le cas Exhibit B et celui des Suppliantes, une forme de polémisation mettant en suspens l’argumentation au profit d’une disqualification des voix portant une critique antiraciste qui donnera naissance au fantasme d’une supposée cancel culture menaçant rien de moins que les fondements de la République.
À l’inverse, on peut se demander quels discours tiennent les détracteurs à l’endroit des défenseurs des œuvres, à la fois en tant qu’opposants politiques et comme experts patentés ? Et comment fondent-ils leur critique ? C’est notamment la question que pose Clément Scotti di Clemente dans un chapitre qui interroge la « stratégie du boycott » des détracteurs, qui en refusant parfois de voir les spectacles qu’ils incriminent les instrumentaliseraient, et évacueraient donc les enjeux proprement esthétiques, pour porter un débat plus large relatif aux conditions de production, aux mécanismes de subvention et, ainsi, à la politique culturelle. On voit ici l’intérêt d’interroger précisément, au-delà des traitements médiatiques souvent réducteurs, les mots d’ordre, registres de justifications, répertoires d’actions et destinataires des discours des différents groupes mobilisés pour et contre les œuvres. Cela implique aussi de faire droit aux hiérarchies de légitimité entre les discours et positions des différents camps impliqués – autrement dit de ne pas abstraire les discours en circulation de leur inscription effective dans des rapports de pouvoir leur conférant une capacité instituante ou une force performative nécessairement asymétrique. C’est ce que montre bien l’analyse de la forte « polarisation énonciative » opérée par Giuseppina Sapio à propos du traitement médiatique de la controverse autour des Suppliantes, qui souligne le puissant alignement de la presse sur un discours de défense de l’œuvre non seulement posé comme celui de l’expertise culturelle et politique, mais comme la seule option « républicaine » et « éclairée » possible.
Reconfigurations de la liberté d’expression
Portant à la fois sur le cadre conceptuel, sur la manière de définir l’esthétique et sur les dimensions socio-économiques et institutionnelles du champ théâtral professionnel, le conflit entre soutiens et détracteurs des œuvres incriminées porte également sur la manière de considérer la façon dont ces controverses convoquent les valeurs de liberté d’expression, de « liberté de création » et de censure34. La troisième partie de l’ouvrage, consacrée à cet enjeu, tente de discerner la manière dont les différentes formes de contestation des spectacles par les groupes sociaux mobilisés – appel au boycott, interruption et chahut lors des représentations, demande d’interdiction auprès de la justice – relèvent ou non d’entraves à la liberté d’expression, mais aussi la manière dont elles viennent interroger ses redéfinitions actuelles et faire se confronter la liberté d’expression des artistes à celle des publics au sens large. Dans les débats invoquant la « liberté d’expression », le syntagme opère comme valeur mais aussi comme cadre juridique : aussi, l’appel à la loi et à la justice constitue une butée récurrente, qu’il émane des détracteurs ou des défenseurs des spectacles. On a alors pu voir dans ces controverses la manifestation d’une juridicisation voire d’une judiciarisation accrue des querelles esthétiques et d’une mise en accusation croissante de la fiction sur fond de crise de la représentation35. Pour certain·es, ces controverses sont autant de preuves d’une menace sur la liberté d’expression propre à nos démocraties actuelles où la menace n’émanerait plus de l’État, non plus censeur mais au contraire protecteur des libertés, ou de l’Église, désormais inoffensive en tant qu’institution – même si les religions peuvent encore, elles, constituer une véritable menace – mais de groupes sociaux usant et abusant de leur statut de minorités pour revendiquer au nom de leur identité des droits spécifiques à être protégés qui mettraient en péril le droit de toutes et tous à la liberté d’expression36. Pour les autres, ces controverses présentent au contraire l’intérêt d’en appeler à une redéfinition de la liberté d’expression à l’heure de la loi sur la « liberté de création » et des droits culturels.
Pour mieux comprendre ce point, nous avons souhaité faire place à la contribution d’une juriste, Emmanuelle Saulnier-Cassia, portant sur un autre corpus de controverses qui n’ont, elles, engendré aucune conflictualité au sein du champ théâtral, académique ou médiatique en France. Les spectacles Sur le concept du visage du fils de Dieu de Roméo Castellucci et Golgota Picnic de Rodrigo García (2011) n’ont pu se dérouler sans la présence des forces de police, après avoir fait face à des accusations de blasphème formulées par des associations catholiques qualifiées par la presse et les professionnels d’« intégristes ». S’interrogeant sur le rôle du juge comme arbitre de querelles de nature à la fois esthétiques, sociales et politiques, Emmanuelle Saulnier-Cassia rappelle à la fois la rareté de ces contentieux et les arbitrages systématiques en faveur de la défense des œuvres. Au-delà du strict champ judiciaire cependant, il est intéressant de considérer la manière dont ces cas spécifiques sont convoqués par les différents protagonistes des controverses précédemment évoquées, et la façon dont ils s’inscrivent dans l’histoire de l’affirmation publique de sensibilités minoritaires, qu’il s’agisse de « sensibilités religieuses blessées » par des œuvres jugées blasphématoires depuis les années 1960 (Favret-Saada, 2017) ou de sensibilités acquises à des revendications minoritaires et heurtées par des œuvres émanant des groupes sociaux majoritaires, jugés dominants.
Le texte d’Emmanuelle Thiébot, qui compare les réceptions de deux types de spectacles traitant du conflit géopolitique entre Israël et la Palestine depuis les années 1980 montre lui aussi, sous l’angle des études théâtrales cette fois, que le fait même d’avoir accès à la controverse constitue un marqueur des rapports de force en place et constitue un enjeu analysable en termes de liberté d’expression. Elle montre que d’un côté, les tournées de plusieurs troupes palestiniennes en France depuis les années 1980 ont suscité des « controverses silencieuses », c’est-à-dire des controverses qui ont existé mais « n’ont pas engendré de conflictualité dans le champ théâtral » ou médiatique, tandis qu’à l’inverse, les productions d’artistes français sur le même sujet, très en vogue dans les années 1980-1990, ont connu un succès qui n’a souffert d’aucune polémique. Ni dans un cas ni dans l’autre il n’y eut de controverse, mais cette absence commune cache un double standard : pour les uns, relégation politique et symbolique à un statut de théâtre militant, autrement dit, assignation identitaire ; pour les autres, droit à s’emparer de la question palestinienne comme de n’importe quelle autre, depuis un point de vue doté de la légitimité à incarner l’universel que l’autrice analyse à l’aide de la notion de « privilège blanc ».
La question de la redéfinition de la liberté d’expression se pose aussi au regard du cas-limite que constitue « l’affaire Dieudonné », en ce que, malgré l’antisémitisme avéré du spectacle Le Mur, qui fut au cœur de la polémique en 2014, son interdiction administrative par la voie d’arrêtés préfectoraux a représenté – notamment aux yeux de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) – une forme de censure, marquant une rupture avec la jurisprudence antérieure. Le chapitre de Laetitia Dumont-Lewi analyse cette affaire en soumettant à l’analyse critique aussi bien le discours scénique et médiatique de Dieudonné, que l’impasse qu’ont constitué les stratégies politiques, judiciaires et médiatiques employées pour le contrer. Elle montre en particulier combien la censure s’est révélée inefficace pour en empêcher la circulation, mais aussi combien elle fut même contre-productive en permettant à l’humoriste de se donner « à peu de frais […] le beau rôle de héros de la liberté d’expression ».
Les soubresauts de la liberté d’expression dans le pays, ses effets sur le champ artistique, ainsi que la consécration récente par la législation française de la « liberté de création »37 sont au centre du chapitre qui clôt l’ouvrage. Cet entretien croisé entre l’artiste et autrice québécoise Marilou Craft et les metteurs en scène français Mohamed El Khatib et Stanislas Nordey, interroge en particulier les formes de protection de la création, tout en insistant sur la nécessité de tenir compte des conditions effectives d’accès aux moyens de création, notamment pour les artistes en situation minoritaire. Il insiste aussi sur la nécessité que des publics puissent exprimer leur désaccord face à une œuvre – sous peine de restreindre fortement, si ce n’est d’empêcher, le débat culturel et son nécessairement renouvellement.
*
Pour arpenter la diversité et l’hétérogénéité des questions que soulèvent ces controverses, cet ouvrage considère donc leur dimension instituante, au sens où elles ont ouvert à une transformation de l’espace institutionnel d’où elles ont émergé comme du champ médiatique qui s’en fait le relais. Nous proposons ainsi d’explorer la manière dont ces controverses ont pu constituer des « occasions pour les acteurs sociaux de remettre en question certains rapports de force et certaines croyances jusqu’alors institués, de redistribuer entre eux ‘‘grandeurs’’ et positions de pouvoir, et d’inventer de nouveaux dispositifs organisationnels et techniques appelés à contraindre différemment leurs futures relations38 ». En l’occurrence, les analyses menées dans ces pages donnent à voir combien ces controverses sur le racisme peuvent être appréhendées comme des tentatives de mise en débat de la prétention du théâtre public français à opérer comme une des formes de l’espace public39. Elles montrent aussi combien l’élaboration d’un nouveau langage critique à même de qualifier, de délimiter, de formuler et de reformuler les problèmes au cœur de ces controverses sans les figer constitue un enjeu majeur de la réflexion, comme y revient Bérénice Hamidi dans un épilogue subjectif sur le lexique, la syntaxe et la poétique de la lutte contre la domination40.
- 1. Claverie (2002) ; Boltanski, Claverie, Offenstadt et Van Damme (2007).
- 2. Charaudeau (2015).
- 3. Rennes (2016) : 25.
- 4. Charaudeau (2015) ; Rennes (2016) : 26.
- 5. En 2018, la mise au concours de l’agrégation d’un poème de cet auteur du xviiie siècle, « L’Oaristys », avait suscité une controverse pour savoir si la scène pastorale décrite, entre un berger et une bergère, devait être qualifiée de scène de séduction ou de scène de viol.
- 6. Deux sites recensent les contributions des différentes parties prenantes à la controverse : le site Malaises dans la lecture [https://malaises.hypotheses.org/a-propos] et le site Transitions [http://mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles.html].
- 7. Claverie (2002).
- 8. Sur la distinction institué/instituant, voir Castoriadis (1990) : 113.
- 9. Boltanski, Claverie, Offenstadt et Van Damme (2007) : 9.
- 10. Claverie (2002) : 42.
- 11. Claverie (2002) : 42.
- 12. Claverie (2002) : 42.
- 13. Cervulle (2020).
- 14. La loi du 7 juillet 2016 consacre la liberté de création et constitue en délit le fait de lui porter atteinte. Elle introduit ainsi dans le Code pénal des sanctions visant « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique ». (Article 431-1 du Code pénal.)
- 15. Cohen (1972).
- 16. Hamidi (2017).
- 17. D’après les chiffres des enquêtes publiées depuis la fin des années 1970 par La Documentation française et le ministère de la Culture, seuls 16 % à 18 % de la population française de plus de 15 ans va au théâtre une fois dans l’année.
- 18. Desclés (2015).
- 19. Sur le rôle que joue la racialisation dans la configuration de l’interprétation, voir notamment Berger (2005) ; Cervulle (2021).
- 20. La réalisatrice Amandine Gay a ainsi qualifié le dispositif Premier Acte d’« école pour bougnoules », lui opposant la classe préparatoire intégrée à la Comédie de Saint-Étienne, dont le recrutement repose sur des critères de sélection sociaux et non ethno-raciaux. Voir Claire Diao (2015) : 4.
- 21. Voir Lhamon (2004).
- 22. Foster (2003).
- 23. Cervulle (2013) : 142.
- 24. Hamidi (2019).
- 25. Rancière (2000) : 12 ; Hamidi (2025).
- 26. Voir Martin-Lahmani et Poirson (2017).
- 27. Pour reprendre les termes de David Bobée dans cet entretien.
- 28. Hall, Critcher, Jefferson, Clarke et Roberts (1978).
- 29. Quemener (2018).
- 30. Guy (2016).
- 31. Dutheil-Pessin et Ribac (2017).
- 32. Cervulle (2017) et (2020b).
- 33. La Déclaration des droits culturels – dite « Déclaration de Fribourg » – affirme en 2007 un droit inaliénable de « participation à la vie culturelle », et invite les actrices et acteurs du champ culturel à veiller à l’effectivité de cette participation, « en particulier pour les personnes les plus défavorisées en raison de leur situation sociale ou de leur appartenance à une minorité » : cf. Groupe de Fribourg (2007) : 9. Suite à d’intenses débats, la loi de décentralisation du 7 août 2015 (loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République) introduit la notion en droit français, mais sans ouvrir aucun droit formel pour les publics, ni imposer de dimension contraignante pour les structures culturelles.
- 34. Tricoire (2011) ; Preuss-Laussinotte (2014).
- 35. Jeudy-Ballini et Poirson (2017).
- 36. C’est par exemple la position défendue par Pierrat (2018).
- 37. Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
- 38. Lemieux (2007) : 192.
- 39. Hamidi (2018).
- 40. Afin que chaque autrice et auteur puisse faire entendre sa langue singulière, et précisément parce que le langage est porteur d’enjeux politiques, nous avons fait le choix de leur laisser le soin de déterminer s’ils et elles souhaitaient avoir recours à une modalité d’écriture inclusive, et laquelle.
Titre partie