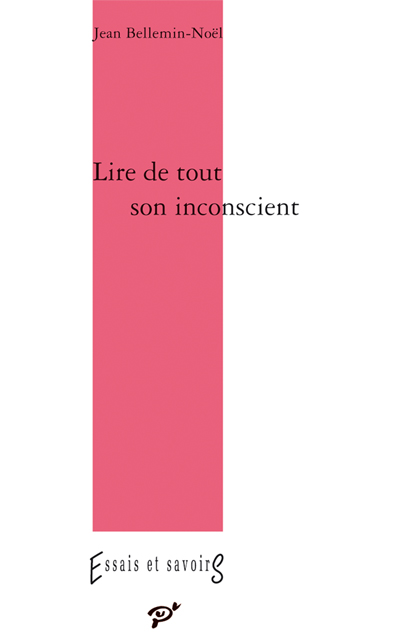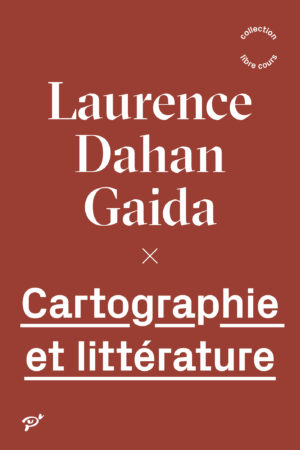Présentation
En faisant écho dans mon titre, avec un effet de décalage dont je ne renie assurément pas l’humour, à des expressions courantes comme « aimer de tout son cœur » et « travailler de toutes ses forces », j’ai souhaité souligner l’aspect d’engagement aussi total que possible qui, selon moi, doit marquer le recours à l’inconscient lorsqu’on lit en textanalyste, autrement dit quand on cherche à entendre le non-dit et même l’indicible des œuvres littéraires.
Mais du même coup, en passe de m’interroger sur l’accueil que je réserve aux textes dans ma pratique concrète, je souhaiterais que ceux qui liront le présent recueil avec la conviction ou le pressentiment qu’il y a là un mode d’approche de la littérature stimulant, perçoivent dans l’usage que je fais du verbe « lire » l’intention de mettre à jour des positions théoriques qui n’ont cessé d’évoluer au cours du développement de mon activité de critique.
Pour le résumer en peu de mots, mon projet serait de faire sentir comment une « lecture du texte avec l’inconscient » a pu, en quoi même elle a dû, succéder en toute légitimité, sinon en toute logique, à des formules que j’estime depuis longtemps dépassées, quoiqu’elles aient la vie dure, telles que « l’inconscient du texte » et « le travail inconscient du texte » 1.. Ces deux formules ont sacrifié en leur temps, dans les années 70 et durant les deux décennies suivantes, à l’effet de mode qui a conduit bon nombre de critiques, de linguistes et de philosophes à traiter le Texte comme un objet fétichique. Même si l’accent porté sur le produit afin d’évacuer le créateur – fidèle image d’un prétendu Créateur – répondait à un besoin réel, l’avantage recherché est devenu peu à peu une tare. Nous sommes loin aujourd’hui de réifier la chose textuelle, de lui accorder une autonomie qui apparaît de plus en plus difficile à penser sans la prise en compte des sujets dont l’un fabrique le texte tandis que l’autre le fait signifier, les deux étant coresponsables de la naissance et de l’épanouissement de cette œuvre d’art particulière qu’est un ouvrage littéraire.
On m’a fait récemment toucher du doigt – c’était à l’étranger mais je gage qu’il en irait de même chez nous – que mon avancée n’avait pas toujours été bien suivie par ceux qu’intéresse le principe de la démarche, à savoir se soustraire à l’emprise de l’auteur, surtout à l’heure où les médias audiovisuels le portent au pinacle faute de pouvoir faire état des œuvres elles-mêmes. Cela allait au point, me disait-on, que la discrétion entourant ce renouvellement laissait imaginer que j’en étais resté aux efforts de théorisation qui justifiaient le choix même du mot textanalyse. Le portrait du lecteur en vampire que j’ai esquissé à la fin de mon dernier recueil 2. a, paraît-il, un peu surpris alors que le principe de méthode en avait été formulé clairement et en partie analysé à différentes reprises. J’ai depuis eu l’occasion de faire le point sur tout cela en donnant une version nouvelle et mise à jour de mon « Que sais-je ? » dans la synthèse intitulée psychanalyse et littérature 3.. Il ne me paraît pas inutile de revenir encore, sept ans après, sur ce qui, à mes yeux, fonde l’entreprise à laquelle je me consacre depuis si longtemps.
Autotransfert
La première occasion de pousser la réflexion théorique sur la lecture avec l’inconscient m’avait été fournie dès 1990 4. lors d’un colloque organisé par un groupe de psychanalystes dont certains appartenaient au monde universitaire. Devant eux, j’ai essayé d’étayer sur leur notion d’autotransfert une théorie de l’élaboration artistique conforme aux enseignements du freudisme.
Cette notion, en effet, est familière aux praticiens. Pour eux, le transfert affectif entre l’analyste et le patient, reproduisant en quelque sorte celui qui a uni jadis le petit enfant à ses proches, est le mécanisme fondamental permettant la rencontre des inconscients et donc offrant une possibilité d’interpréter les formations insoupçonnées afin de mettre au jour et de faire assimiler (ils disent : perlaborer) des traumatismes très anciens. Au sortir de la cure, non seulement le patient mais l’analyste, chacun de leur côté, prolongent à l’intérieur d’eux-mêmes le travail d’écoute qu’ils ont mis en œuvre ensemble, le maintenant toujours actif en vue d’une récupération plus large ou mieux assurée de leur passé refoulé. Il va de soi que ledit travail ne débouche pas à chaque instant ni nécessairement sur une interprétation en forme : tout se passe comme si chacun percevait à demi-mot, comme par allusion, l’affleurement de données pulsionnelles déjà plus ou moins identifiées ou localisées au cours des séances en commun. Cette poursuite du travail analytique, qui est proprement un travail d’analyse au sens où l’entendait Freud, présuppose qu’il existe alors, entre le Je et un Moi dont les racines plongent dans l’archaïque, une espèce de dialogue invisible qu’on peut qualifier d’autotransfert.
Mon hypothèse, donc, consistait à dire que, du point de vue de l’inconscient, l’œuvre d’art se présentait – du moins pouvait être représentée – comme le point de rencontre de deux autotransferts distincts, l’un chez l’artiste, l’autre chez l’amateur. Un objet d’art, c’est bien connu, n’est rien tant qu’il n’y a pas là quelqu’un qui le contemple, qui l’écoute, qui le lit ; quelqu’un qui au bout du compte le fait exister en tant que tel et qui, du même coup, justifie le travail et l’existence même de l’artiste. Dans la pratique, l’œuvre réalise, et même matérialise, la synthèse des deux opérations de mise au jour et de réception, qui entrent en résonance en la faisant exister et pour la faire exister comme œuvre.
Il va de soi que dans la situation ordinaire, ni l’un ni l’autre des opérateurs n’a conscience de ce qui est ici actualisé ou mis en question et qui relève de l’inconscient. On sait par ailleurs qu’en dehors des symptômes il n’existe pas d’autre phénomène inconscient saisissable que la combinaison singulière d’images décrites et de paroles citées (dans un rêve ou sur le divan) à travers laquelle se déguise une pulsion libidinale qui cherche à s’exprimer. Une combinaison dont l’énigme se trouvera résolue si un autre, voué et préparé à cette tâche, vient réagir, vient retentir à ce qui s’évoquait là, puis le renvoyer à celui qui en fut la source avant d’en devenir, peut-être, l’hôte un peu rassuré sinon réassuré.
Moins ordinaires, on le sait aussi, plus rares en tout cas sont les deux situations parallèles où, d’une part, l’artiste fait pour son compte une analyse et découvre à cette occasion ce que son imagination créatrice a coutume de mettre en jeu, et où, d’autre part, le lecteur – revenant spécifiquement à la sphère des activités artistiques qui nous préoccupe, je pense à un lecteur au courant de ce qui se passe en lui d’inconscient –, où un lecteur éclairé, donc, se met à l’écoute des ébranlements suscités au fond de lui par le contact avec le texte, c’est-à-dire avec les fantasmes inconsciemment déposés là par l’auteur.
Tout à fait exceptionnelle paraît alors la situation, dans laquelle nous place la textanalyse. Dans un premier temps, un critique entreprend de formaliser à l’usage d’autrui les données lacunaires qu’il croit percevoir en lui par autotransfert lorsqu’il s’investit dans une lecture ; ensuite, dans un second temps, il entreprend de partager avec d’autres, de communiquer au public ces lueurs qui ont surgi en lui pour l’occasion. Bien évidemment, c’est en offrant aux lecteurs cette dimension de sens supplémentaire susceptible d’enrichir le texte qu’il participe à l’effort global de la critique pour expliquer en quoi une œuvre peut être déclarée belle.
Interlecture
Envisagé sous un tel angle, le texte perd une large part de son statut de chose en soi. Il apparaît tout à la fois comme un terrain de rencontre entre deux sujets et comme un espace d’engendrement du sens en même temps ponctuel et indéfiniment renouvelable, avide de cohérence et toujours en fuite au-delà de lui-même – fantôme flottant dans une brume de significations plutôt que bloc de marbre sous le soleil du sens.
Mais une deuxième atteinte à sa prérogative lui a été infligée de manière oblique à propos de l’intertextualité. Celle-ci, quoique l’on n’ait pas tout de suite mesuré le scandale qu’elle représentait, était déjà le ver dans le fruit : que penser en effet d’un texte autonome, visé comme le « Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur » dont parle mallarmé, si son absoluité est grevée par un réseau de relations d’emblée relativisantes ? Il m’a paru qu’on ne pouvait se dispenser de contester un peu la régence que l’Intertexte cherchait à exercer auprès du jeune roi Texte, et pour cela j’ai proposé de substituer à l’expression consacrée celle d’interlecture 5..
Elle aussi fait clairement appel au dehors du texte pour éclairer certaines de ses dimensions, mais elle ne feint plus de croire que ce dehors soit de part en part enfoui dans l’énoncé par l’effet d’on ne sait quelle magie. Les éclairages marginaux capables de susciter des reliefs à la façon d’une lumière rasante émanent de la subjectivité du lecteur, sans ignorer ni tenter de voiler qu’ils correspondent ou même répondent à la subjectivité de l’écrivain. Si de toute évidence les citations créent des effets d’intertextualité, l’allusion elle aussi relève de l’interlecture car, abandonnée par l’auteur à une réelle indétermination, elle n’est pas perçue ni indexée à tout coup, il arrive même assez souvent qu’elle ne soit point décelée ni relevée. La réception de l’écrit, toujours singulière, imprévue en qualité comme en quantité, si l’on ose dire, peut aller jusqu’à ignorer les sous-entendus et les non-dits sans pour autant perdre toute aptitude à faire sens. Elle sera simplement pauvre. Car si le texte est responsable de ses richesses, c’est le lecteur qui est responsable de son appauvrissement.
Un lecteur, en fait, qui se renouvelle à chacun des parcours qu’il effectue du texte, à chacune de ses lectures. Ce qui s’est substitué au texte-chose en soi, c’est la lecture-événement. Dans ces conditions, on n’a pas seulement changé de vocabulaire, on a, comme disent les scientifiques et les épistémologues, changé de paradigme.
Lecture versus texte
On peut donc estimer de bonne foi que cette transformation et pour tout dire cette radicalisation de certains de mes présupposés théoriques attendaient une plus large illustration et peut-être une mise au point touchant aux questions de fond. Commençons par ces dernières.
Parler de travail inconscient du texte, c’était en quelque sorte donner l’initiative de l’interprétation aux traits constitutifs de l’œuvre : signifiants, signifiés, structures génériques, charges intertextuelles, plis métatextuels, etc. L’interprète feignait d’être la voix du texte en train de s’autocommenter grâce aux forces déposées en lui par la cohérence interne de sa lettre et de son appareil d’imagerie – figures de rhétorique, représentations parlant à l’imaginaire, torsions de ce que Jean-François Lyotard appelait « le figural ». Forçons un peu les choses, même s’il est bien entendu qu’un pareil herméneute n’a jamais existé : comme tout interprète digne de ce nom, ce critique par délégation mais autoproclamé que voulait devenir aux yeux de tous le textanalyste s’efforçait de minimiser l’importance et la portée de sa propre subjectivité en assignant au Texte déifié, auquel faisait écran le texte réifié, la capacité de faire signe que les devins de l’Antiquité attribuaient à la volonté des dieux –, des dieux dont ils ne voulaient être que les porte-voix, à peine les porte-parole puisque leurs oracles étaient opaques à eux-mêmes comme à tout le monde.
Que signifie alors le projet et le souci d’accorder une place prépondérante au travail d’une lecture en forme d’écoute ? Cela revient à accroître encore chez le critique l’autonomie dont on pouvait penser qu’elle était déjà excessive à l’époque où la textanalyse fétichisait les œuvres. Il ne s’agit plus désormais, dira-t-on, de simplement séparer l’ouvrage de celui qui l’a écrit ; il n’est plus seulement question de donner au lecteur, fût-il une sorte de superlecteur ou d’« archilecteur » (Riffaterre), la possibilité exorbitante de substituer pour ainsi dire son inconscient à celui de l’auteur et à celui de tous les lecteurs virtuels – ne serait-on pas revenu aux pires travers de l’impressionnisme sous couleur d’une vague scientificité ? – voilà qu’on demande maintenant au public de faire confiance aux seules réactions hic et nunc d’un homme pour instaurer en modèle herméneutique la fermentation, les effervescences de son inconscient à un moment donné, au cours d’un parcours de lecture qu’il aura jugé exemplaire, entendons : susceptible d’être montré en exemple.
Le problème de fond est toujours le même : comment le lecteur d’une étude critique peut-il estimer valable une interprétation donnée pour exemplaire, donc un tant soit peu objective, sachant qu’elle résulte de l’engagement autotransférentiel d’un sujet qui, selon la formule consacrée, « ne s’autorise que de lui-même » pour affirmer (tout au moins laisser entendre) qu’il est un interprète qualifié ? Comment ne seraient pas partisanes (tout au moins partiales) des réactions que l’on peut deviner grevées par sa propre constitution inconsciente, déformées par la prépondérance en lui de certaines formations fantasmatiques qui le prédisposent, de façon permanente ou au cours de cette lecture-ci, à voir d’abord, à reconnaître surtout tel fantasme qui lui vient à l’esprit par association ?
La question est à la fois rationnelle et raisonnable. On notera tout de même qu’elle vaut pour tout travail critique, quelle que soit sa méthode d’investigation, laquelle rencontre très vite ses limites avec la problématique des preuves. Par exemple, l’historien de la littérature, censé être le mieux armé pour posséder toutes les garanties d’objectivité, est tributaire en premier lieu d’une connaissance de l’environnement historique qui ne peut jamais être exhaustive puisqu’elle baigne dans le devenir sans cesse mouvant de son historialité ; tributaire en deuxième instance d’une certaine perspective sur l’historicité qu’il a choisie parmi d’autres possibles ; tributaire à un troisième niveau du degré et du mode d’insertion dans l’Histoire de l’écrivain dont il s’occupe ; j’en passe, et peut-être de plus rédhibitoires. On en dirait autant a fortiori du sociocriticien, et même, à l’autre bout de l’éventail, de l’adepte d’un imaginaire anthropologique (Gilbert Durand) que l’on enracine dans des « structures » réputées universelles et transhistoriques.
D’un autre point de vue, quant au fond du problème de savoir quelle légitimité possède une interprétation faisant appel à l’inconscient, la situation n’est guère différente de celle qui prévaut dans la cure, sauf que la validité de celle-ci est en quelque sorte assurée parfois grâce au fait qu’il se produit des effets de vérité dont le patient tire bénéfice. La grande différence, de taille certes, est que les acteurs vivants peuvent vérifier concrètement que la vie du patient a été améliorée tandis que le lecteur ordinaire ne saura jamais ce qui en lui a contribué à lui faire trouver plus fascinante ou plus réussie l’œuvre qu’il a explorée en compagnie du textanalyste.
Il reste que ce dernier n’a lui-même aucune prise sur la réalité de ce qui se passe là. Et que, puisque seul l’inconscient peut se mettre à l’écoute de l’inconscient, un total subjectivisme est la condition même de son travail, il est condamné à n’être que lui-même, avec toutes ses capacités et toute son énergie. En revanche, ou au moins en compensation, il a la possibilité – et même il faut qu’il ait la volonté – d’écrire lui-même ce qu’il ressent, de telle façon et d’une façon telle qu’il se produise une relance de son interprétation dans l’âme secrète de mon lecteur 6.. Ce point est à mes yeux capital et c’est sur lui que j’insisterai tout à la fin de ce livre, lorsque les lecteurs auront pu se confronter avec quelques-unes de mes plus récentes études.
Lire versus appliquer
En somme, l’arrière-plan de ce projet auquel je m’accroche avec un entêtement que certains jugeront phobique ou obsessionnel comporte toujours les mêmes trois volets : aucun souci de « psychanalyser » l’auteur, impossibilité de mélanger les problèmes de la création et ceux de la lecture, confiance dans le surcroît d’éclairage enrichissant apporté à la critique littéraire par la psychanalyse, fût-elle dite « appliquée ».
Ce dernier adjectif, dans cet emploi, demande qu’on se livre à un petit tour d’horizon théorique. « Appliquée » a de nos jours mauvaise presse, et pas seulement chez ceux pour qui la psychanalyse se réduit à ce qu’en a formulé Jacques Lacan. Même si c’est Freud lui-même qui a accrédité ce terme, le projet d’une « psychanalyse hors cure » (comme on dit en général maintenant à la suite de Jean Laplanche) embarrasse certains analystes freudiens, qui veulent donner ou garder son plein sens au mot cure. Outre les réticences de ces puristes, qui à la décharge du Maître font tout de même valoir qu’il était à l’époque obligé de faire flèche de tout bois pour que la psychanalyse prît pied sur les scènes de la science et de la pensée mondiales, il me semble que l’expression de « psychanalyse appliquée » a été récemment victime de ce qu’on pourrait appeler, toute proportion gardée, des « dommages collatéraux ».
Je pense expressément à l’effet déformant qu’exerce la façon dont Pierre Bayard a résumé sa propre entreprise critique quand il l’a décrite et défendue sous le titre Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? 7.. Parler couramment de « littérature appliquée » en manière d’allusion humoristique (et amusante, il est vrai) référant à la formule consacrée par Freud, cela peut ressembler au bout du compte à une récusation, ou tout au moins à une péjoration, de la psychobiographie, de la psychocritique et de la textanalyse mises pêle-mêle dans le même sac. Bien que ce ne soit évidemment pas là l’intention première de l’auteur, cela revient à ne pas se préoccuper de ce que la prise en compte de l’inconscient apporte aux lecteurs quand ils redimensionnent la signification virtuelle des œuvres, à la façon dont Freud nous a jadis offert quelques magnifiques exemples.
Pierre Bayard cherche à lire dans les œuvres les visions du monde qu’elles impliquent en utilisant la grille interne qu’elles sont supposées posséder, afin de les déchiffrer selon leur logique propre – fût-ce contre l’écrivain, comme le montrent ses subtiles relectures de romans policiers d’Agatha Christie ou Conan Doyle et son enquête sur Hamlet : on peut lui demander si ce n’est pas là ce qu’ont toujours fait les critiques, de manière spontanée ou calculée, depuis Boileau jusqu’à La Harpe, depuis Sainte-Beuve jusqu’à Maurice Blanchot ou, de façon exemplaire, Georges Poulet ? Écrire comme il le fait que dans la pratique qu’il prône on va « clairement de la psychanalyse vers la littérature » (p. 29, P. B. souligne) est une formulation très approximative : en réalité, sa façon de lire va de la littérature à la littérature en passant peut-être ou parfois par la psychanalyse, comme d’autres passent communément par l’histoire, par la stylistique, par l’anthropologie, par la sociologie, etc.
Comment, d’ailleurs, faire autrement, si l’on reconnaît que la littérature n’est pas une doctrine, un outil de pensée ou un appareil à penser abstrait, mais seulement un art et un plaisir d’imaginer autrement notre monde quotidien ? Un tel projet aurait dû s’intituler : « Peut-on appliquer à la littérature une autre grille de lecture qu’elle-même ? » – mais on aurait alors été en droit de regretter que la pratique couverte par une telle formule ait l’air de mettre en cause la seule psychanalyse.
Soyons sérieux et honnête : qu’on la dise « appliquée » ne réduit pas ipso facto la psychanalyse à l’état d’une de ces grilles de décryptage que l’on pose sur une page qui serait spécialement préparée pour rendre ainsi lisibles certains mots ou signes à l’exclusion des autres, ajoutés sans doute en vue de constituer un énoncé trompeur, quand bien même il s’est rencontré ici ou là des travaux critiques dont les interprétations avaient l’air automatiques, décalquées à l’aide d’une teinture de freudisme vulgarisé ; le maître avait déjà averti en souriant qu’il arrive que le cigare qui figure dans un rêve ne soit rien d’autre qu’un cigare, introduit là par l’envie de fumer. En outre, le terme allemand utilisé, angewandt, comporte le mot Wand (mur, paroi) et suggère d’abord l’idée d’adosser contre, d’étayer sur : ainsi les mathématiques dont a besoin l’industrie s’appuient-elles sur les mathématiques pures pour faire fonctionner des machines, comme les sciences appliquées en général tirent profit des apports des sciences fondamentales. L’ennui, c’est qu’il n’existe rien comme une psychanalyse « pure » ou « fondamentale » : il n’y a que des utilisations à des fins diverses de la théorie de l’inconscient (parfois baptisée à la suite de Freud « métapsychologie »), dont la principale et la première en date fut consacrée à soulager par la parole la souffrance psychique.
Toute parole, c’est-à-dire tout énoncé adressé-et-reçu 8., peut en principe recéler une certaine teneur inconsciente et donc être interprété sauvagement puisque l’on parle pour de telles interventions de « psychanalyse sauvage » – tout cigare apparaissant dans un rêve y sera ipso facto considéré comme la mise en cause du pénis. Il est de la responsabilité de celui qui « écoute » un texte de ne pas tomber dans un tel travers plus que ne fait celui qui, après avoir fait son analyse, se met professionnellement à l’écoute d’un patient. Leur meilleur garde-fou sinon le seul, répétons-le, est l’obligation qu’ils s’imposent de mettre en mots leur intuition aux fins de la communiquer soit à un analyste expérimenté (chargé de « contrôler » le suivi d’une analyse), soit dans un « récit de cas » mis à la disposition du public, soit enfin, pour ce qui nous concerne directement, dans l’exposé en forme d’une textanalyse.
Illustration
L’illustration de ces principes sera constituée d’un choix d’études relativement récentes – la plus ancienne a été publiée au dernier trimestre de 1999 – où sont réunis des articles parfois difficiles à se procurer. La plupart ont en effet paru dans une revue de « psychanalyse appliquée » domiciliée à l’étranger (Gradiva, Lisbonne), les autres dans des revues de sciences humaines (Semen, Besançon et la Revue des Sciences Humaines, Lille), dans une revue spécialisée (bulletin des études valéryennes) et dans une revue carrément exotique (études francophones, Séoul) ; une seule est à ce jour inédite. La republication m’a permis, bien entendu, de leur apporter quelques aménagements de détail.
J’ai choisi ces articles en essayant à la fois de faire le tour des champs d’intervention possibles et d’honorer la fiction romanesque, qui sera majoritaire ici comme elle l’est dans l’édition : trois romans, une nouvelle en même temps poétique et fantastique et un récit étranger dont l’intérêt ici sera avant tout doctrinal. Et puis un poème, une œuvre picturale et deux essais dus à des écrivains consacrés. Il semble que cela constitue un tour d’horizon quasi exhaustif. Ces études sont classées dans un ordre que j’ai voulu significatif de l’ouverture en direction de l’inconscient de la lecture, et qui soit doté par sa progression de quelques vertus pédagogiques.
Pourquoi placer comme effrontément un tableau de Picasso à la tête d’un recueil en principe consacré à la critique littéraire ? Parce que La Jeune fille à la chèvre est pour moi une occasion inappréciable de faire pénétrer les lecteurs dans mon laboratoire secret. Souhaitant rendre compte de ma pratique de la façon la plus concrète, la plus sensible, la plus immédiate possible, je me suis aperçu que j’étais plus libre de rêver devant un tableau que devant un texte littéraire ; probablement parce que l’écrit, à cause du pouvoir de la lettre, contraint davantage, bride et peut-être brime l’imagination, en tout cas la mienne. Les lecteurs jugeront mieux sur pièce comment dans mon travail – ma rêverie – de co