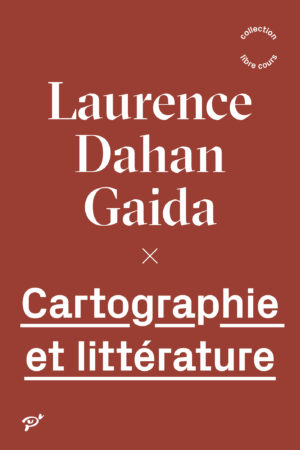Entrée dans la collection de la Pléiade en 2014, à l’occasion du centenaire de sa naissance, Marguerite Duras continue au XXIe siècle de séduire de nombreux lecteurs et d’influencer l’écriture contemporaine. Mais ce qui semble faire obstacle à une connaissance plus approfondie de cette œuvre est que, pour certains, elle demeure obscure ou trop intellectuelle, et pour d’autres emplie de facilités. De même, l’image médiatique et médiatisée de cette auteure, si elle a enchanté bien des lecteurs, en a découragé d’autres, quand ce n’est pas une franche hostilité qui lui reste réservée.
Nullement consensuelle, cette œuvre ne cesse de déclencher les ferveurs qui étaient légion du vivant de Duras. Il n’est pas rare d’en entendre résonner des bribes : des phrases, des titres de livres, d’articles, de scénarios, comme on pourrait écouter des ritournelles de chansons connues : « Tu me tues, tu me fais du bien », « Sublime, forcément sublime », « Dans le livre que je n’ai pas écrit il n’y avait que toi », « Que-le-monde-aille-à-sa-perte-c’est-la-seule-politique », « India Song », « Hiroshima mon amour ». De même, les faits stylistiques typiquement durassiens comme l’itération syntaxique, lexicale et sémantique sont presque devenus une parlure contemporaine renvoyant à une œuvre qui martèle les présentatifs : « C’est Cholen. C’est à l’opposé des boulevards […]. C’est tôt dans l’après-midi » (Amt : 46), qui multiplie la parataxe et fait du verbe de locution « dire » un paradigme : « Dit-elle », « Vous dites que », « Vous auriez dit », « On dit ». Que penser aussi de cette aire géographique, où coule le Mékong, qui s’est trouvée tout à coup au centre d’un mythe avec le prix Goncourt décerné à L’Amant en 1984 et qui est désormais récupérée par les agences et les guides de voyage proposant des « pèlerinages durassiens » ?
Assurément il existe un effet Duras qui fait perdurer le mythe mais qui risque de dissoudre et de banaliser la force de sa parole. Car Duras a inventé une prose poétique rythmée d’hyperboles, d’insistances, de ressassements, mais aussi d’ellipses et surtout de silences. Il faut dès lors éviter de tomber dans les stéréotypes. Le « mot-trou » qui manque à Lol V. Stein signifie l’impuissance du langage, partant l’échec du verbe. Nombre de personnages durassiens s’interrogent sur la validité des mots – le vice-consul, Anne Marie Stretter, Emily L., Ernesto, la reine de Césarée –, quand ce n’est pas Alissa qui appelle formellement à la destruction de la parole : « Détruire, dit-elle. »
On comprend que la musica de Duras refuse non seulement de se plier à la rhétorique du vouloir bien dire, mais s’emploie aussi à créer une nouvelle langue qui finira par aboutir à ce que l’écrivaine nommera dans les années 1980 une « écriture courante », cette écriture qui « court sur la crête des mots » (Duras, Le Masson, « L’inconnue de la rue Catinat » 1984), comme impatiente de s’exprimer au plus près de l’intention orale, de la vitesse même de la pensée créative.
Il faut reconnaître à l’auteure, qui a fait de ses initiales M.D. une marque de fabrique, non d’avoir mis au centre de la société la figure d’une écrivaine qui péchait sans doute aussi par narcissisme, mais d’avoir eu la force de redonner à la littérature sa dimension originelle, cette puissance qui faisait du chant de l’aède la voix qui disait le monde. Cette voix est celle d’Orphée qui ravit aux Enfers l’ombre d’Eurydice, la perd par impatience, signe son arrêt de mort, mais n’efface jamais son désir de chanter. La langue de Duras possède le charme magique qui suscite des émotions profondes, et ceci commence dès la publication d’Un barrage contre le Pacifique en 1950. L’hubris propre à faire retentir le mythe est donc aussitôt à l’œuvre et ne cessera de rythmer la production de l’auteure dont les chemins de création seront multiples : récits, cinéma, théâtre, mais aussi articles et entretiens. Pour Duras, tout est prétexte à l’avancée de la poésie dont elle explore tous les moyens du dire et du faire, sans ne jamais rien figer. Elle bouscule toutes les frontières, y compris celles du Nouveau Roman qu’elle n’a pas rejoint, mais dont elle a su se montrer complice, notamment pour affirmer sa voie.
Cette parole plurielle, qui épouse le mouvement de la littérature depuis sa naissance, se décline en deux grands ensembles qui s’entremêlent : fiction et mémoire. Comme l’infatigable conteur, Duras dessine un monde imaginaire suspendu à des allées et venues incessantes depuis une histoire personnelle qu’elle modifie à souhait. Et la mémoire individuelle est amenée également à croiser l’histoire collective, car Duras a traversé une époque de grands bouleversements : la colonisation et la décolonisation, la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration et d’extermination, la destruction atomique. Du scénario Hiroshima mon amour au journal fictionnel La Douleur en passant par les chroniques de L’Été 80, les articles recueillis dans La Vie matérielle ou encore dans Le Monde extérieur, l’écrivaine fait du vécu la matière de ses écrits, en déjouant sans cesse les codes de l’autobiographie.
Cette étude se propose de suivre l’évolution d’une œuvre qui se construit à partir d’une mythologie de l’enfance s’ouvrant sur la première publication de l’auteure en 1943, Les Impudents, roman familial qui annonce une épopée aux accents tragiques publiée en 1950 : Un barrage contre le Pacifique. On s’attardera ensuite sur la mise en place d’une esthétique nouvelle dans Le Marin de Gibraltar en 1952 qui, depuis sa flânerie maritime, conduira au tournant que sera l’année 1958 avec la publication de Moderato cantabile. Le chapitre suivant s’intéressera au phénomène de la réécriture, qui est une véritable forme de palingénésie chez Duras, concernant en particulier ce qui a été appelé « le cycle indien » à partir du Ravissement de Lol V. Stein en 1964. L’art du recommencement étant toujours à l’œuvre chez l’auteure, on verra dans un chapitre consacré à l’écriture théâtrale que celle-ci épouse le même élan, comme un éternel retour : le roman Le Square devient une pièce de théâtre, La Musica se reflète dans La Musica deuxième, Les Viaducs de la Seine-et-Oise revient dans L’Amante anglaise. Le cinéma fera également l’objet d’un chapitre séparé puisque Duras pendant une décennie, de la fin des années 1960 jusqu’au début des années 1980, délaisse l’écriture de récits pour se consacrer à « l’image écrite » (YV : 142), en proposant ainsi son esthétique cinématographique. Entre 1980 et 1993, l’écrivaine fait paraître des recueils de textes écrits pour les journaux : L’Été 80, Outside, La Vie matérielle, Le Monde extérieur. Cette vocation de journaliste trouve dans l’expression « outside » sa conception de l’écriture journalistique, ce qui mérite qu’on l’étudie dans un chapitre. En outre, parce que pour Duras l’écriture n’est « rien de plus, sauf elle, la vie » (É : 53), l’œuvre des années 1980 sera analysée à l’aune de la fictionnalisation de sa vie privée, à partir de La Maladie de la mort en passant par La Douleur ou encore Les Yeux bleus cheveux noirs. Enfin, ses derniers écrits La Pluie d’été, publié en 1990 après de longs mois passés dans le coma, et le recueil de 1993 Écrire, autoportrait intellectuel et summa d’une vie d’écriture, feront l’objet d’un chapitre final, car assure-t-elle : « Ça va très loin l’écriture… jusqu’à en finir avec. » (É : 25)
L’effet incantatoire et scandaleux de la parole durassienne, la pratique et les procédés de son écriture, les thèmes et les motifs récurrents de l’œuvre seront étudiés comme autant de manifestations d’un geste qui, par les réseaux profonds de toutes ces relations, a trait à la mythopoétique, c’est-à-dire à la fabrication du mythe. Ce processus de création remonte à l’émerveillement du poète face au soleil, à la terre, à l’océan, au mouvement des nuées après l’orage, et appartient foncièrement à Duras : « À Trouville pourtant il y avait la plage, la mer, les immensités de ciels, de sables. […] C’est à Trouville que j’ai regardé la mer jusqu’à rien. » (É : 18)