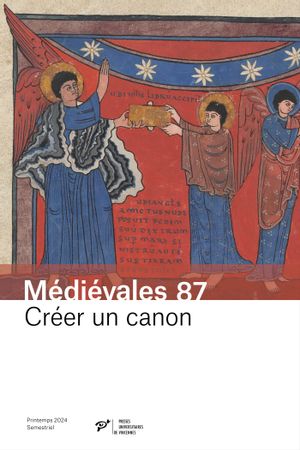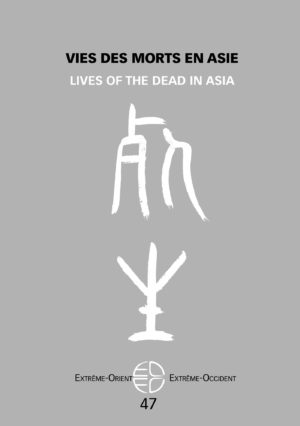Introduction
Matériel versus idéel
Une autre dimension de l’épistolarité
aux âges moderne et contemporain
Olivier Poncet
« L’histoire se fait avec des documents écrits, sans doute. Quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire, sans documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que l’ingéniosité de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots. Des signes. Des paysages et des tuiles. Des formes de champ et des mauvaises herbes. Des éclipses de lune et des colliers d’attelage. Des expertises de pierres par des géologues et des analyses d’épées en métal par des chimistes. En un mot, avec tout ce qui, étant à l’homme, dépend de l’homme, sert à l’homme, exprime l’homme, signifie la présence, l’activité, les goûts et les façons d’être de l’homme. »
Lucien Febvre, 19491.
Les correspondances par les réseaux qu’elles fabriquent et qu’elles portent sont un sujet inépuisable de l’historiographie des périodes moderne et contemporaine, pour lesquelles les archives de cette nature deviennent abondantes, voire surabondantes. De l’école méthodique au linguistic turn en passant par l’École des Annales, il n’est pas de grand courant d’écriture de l’histoire qui n’ait porté une attention spécifique et volontariste à cette source singulière, ce matériau privilégié de l’historien.
Matériau : le mot est lâché. La citation de Lucien Febvre placée en exergue de ce texte rappelle qu’il fut un temps pas si lointain où, pour les tenants d’une histoire renouvelée, la matérialité et son potentiel apport au discours historique étaient nécessairement extérieurs à l’écrit. En dehors de rares travaux d’épigraphistes, de paléographes ou de diplomatistes, cantonnés pour l’essentiel aux périodes antique et médiévale, les éléments concrets du discours épistolaire étaient au pire ignorés, au mieux négligés ou maltraités par les spécialistes des époques les plus récentes. Qu’il s’agisse du support, des dimensions, de la mise en page, de la structuration en chemises, liasses ou registres, tous ces éléments d’appréciation qualitative de l’épistolarité n’étaient et ne sont encore guère pris en compte par les historiens. Tout au plus la signature, ce lien si particulier entre le contenu et le contenant, entre le scripteur et l’individu, entre l’information et la validation, a-t-elle retenu une attention peut-être moins motivée par le questionnement sur l’individuation moderne et l’acculturation à l’écrit que par la fascination exercée par la présence d’une trace censément peu suspecte d’une autographie synonyme de proximité avec l’homme ou la femme surgie du passée2.
Depuis une trentaine d’années, l’historiographie doute. L’épuisement épistémologique des grandes théories explicatives – marxisme, structuralisme – a conduit l’histoire au bord de la falaise, pour reprendre l’expression de Roger Chartier3. Dans un moment où l’histoire se cherche entre mémoire et science et où elle est tiraillée plus que jamais par des enjeux communautaires, religieux ou géo-politiques, quoi de plus rassurant finalement que d’effectuer un retour aux sources et de se livrer à une « nouvelle érudition4 » ? Si les archives et leur fabrique ont une histoire5, les sources écrites en tant que telles ne sont pas qu’un agencement de mots, de lexiques, de syntagmes ou de phrases. Roger Chartier précisément a ainsi mis l’accent, après d’autres dont Henri-Jean Martin6, sur la fabrication matérielle du discours littéraire, sur les aspects concrets de la production des livres, sur les contraintes humaines et techniques qui pèsent sur la composition intellectuelle des ouvrages et dont toute analyse scientifique doit tenir compte pour porter un jugement adéquat sur l’expression d’une pensée portée par ce moyen de communication spécial qu’est le livre imprimé7.
Inversant ici la proposition de l’anthropologue Maurice Godelier8, l’historien est ainsi sommé de faire la part du matériel dans l’idéel, et singulièrement dans ses sources écrites. Si le livre peut aisément être perçu comme un artefact, obéissant à des lois industrielles ou commerciales car il est aussi un objet d’une économie propre9, il n’en va pas de même d’une correspondance manuscrite. Destinée à être échangée – en dehors de certaines situations tenant davantage de l’introspection personnelle ou de l’exercice littéraire –, la correspondance n’est pas objet de commerce, au moins pas de commerce possédant un marché propre et identifié avant l’apparition des ventes d’autographes au xixe siècle10. Pourtant à l’image d’autres documents d’archives où s’épanouit l’initiative individuelle, comme les livres de raison et autres écrits dits du for privé11, les correspondances de toute nature n’échappent pas à l’emprise de contraintes matérielles entendues ici au sens large.
Le support lui-même est un premier élément non négligeable. S’agissant des lettres, depuis le xive siècle, le papier règne en maître quasi absolu, si l’on veut bien exclure les supports extraordinaires rencontrés çà et là au fil de l’histoire, comme cette doublure de pourpoint adressée en trois exemplaires (et donc trois porteurs) et portant les instructions de Gaspard de Coligny aux réformés assiégés dans Rouen par les troupes catholiques au début de la première Guerre de religion le 25 septembre 156212. Que l’on en dispose ou pas, qu’on en dispose en abondance ou en faibles quantités, qu’il soit bon marché grâce à une mécanisation croissante ou rendu onéreux par une fiscalité ad hoc, l’accès au papier est une contrainte qui pèse sur la régularité d’une correspondance, sur la longueur des dépêches, sur la taille des caractères, sur les espaces laissés en blanc, etc. La raréfaction de papier, ou l’absence de production papetière locale peut même amener à une connaissance sensuelle de ce précieux support, comme ces imprimeurs anglais du xvie siècle qui pouvaient « nommer les types de papier selon leur lieu d’origine, comme on le fait pour des variétés de fromage »13.
Afin de satisfaire aux contraintes de la mobilité qu’implique la transmission à distance (y compris courte), le scripteur (ou son assistant) modifie lui-même la forme de son support pour l’adresser plié à son destinataire. S’il peut arriver que l’on réduise le format d’autres documents d’archives pour des raisons diverses (lettres closes de chancellerie, brefs pontificaux, sacs de procès, etc.), la lettre missive l’est en revanche systématiquement. Les pliures sont elles-mêmes un sujet d’interrogation et un indice des méthodes de transport : format standard pour être joint à un paquet de lettres similaires ou taille réduite à l’extrême pour tenir dans une ceinture ou une couture de vêtement et échapper aux inspections trop inquisitrices. À l’occasion, l’expéditeur peut joindre divers objets à son envoi épistolaire, objets précieux – les autorités y sont régulièrement opposées – ou non, comme ces échantillons de tissu (« rayeures des siamoises bleues ») que transmettaient des marchands à leur correspondant de Vabre à la fin du xviiie siècle14.
En outre, il est rare que la lettre missive soit remise directement à son destinataire. Ce dernier peut éventuellement faire attendre une réponse à sa propre lettre qu’il aura fait porter par un messager exprès. Toutefois, la règle générale est de confier son pli à un tiers, qu’il soit de confiance (le fameux « porteur »), ou qu’il s’agisse d’un voyageur de passage, marchand ou autre, qui accepte de se charger d’une lettre supplémentaire pour la joindre à un paquet déjà confectionné. Surtout, la multiplication des pratiques épistolaires a suscité la mise en place de réseaux postaux dès le xive siècle, d’abord à l’usage des pouvoirs politiques et universitaires mais très vite également pour les besoins d’un plus large public. Cette institution postale suscita en retour l’apposition de mentions de destinataire plus détaillées et la présence de signes d’affranchissement de toutes sortes, jusqu’à nos modernes timbres-poste lorsque le port devint standard et fut progressivement, à partir de 1839, à la charge de l’expéditeur, provoquant une hausse considérable du nombre de lettres expédiées et l’explosion du nombre des boîtes à lettres15.
L’espace et le temps dans lequel se meuvent les lettres missives entraînent des pratiques d’écriture qui influent sur leur présentation matérielle. Qu’il s’agisse des écritures codées, du recours à des supports incongrus (cf. supra), de l’obligation parfois de redoubler, voire de tripler l’exemplaire de la lettre en question, quand on n’a pas affaire à une combinaison de plusieurs de ces précautions (une lettre chiffrée envoyée en duplicata par exemple), la lettre missive exprime dans sa matérialité les sentiments de son auteur, de l’angoisse et de la peur de sa perte possible, ou à l’inverse de l’extrême confiance dans les moyens utilisés pour la conjurer.
On n’oubliera pas enfin de revenir sur les questions de mise en page et du rapport du texte à l’image, laquelle n’est toutefois pas en soi autre chose qu’un discours. Passons sur ces prouesses artistiques que constituent les calligrammes ou les lettres-miroirs, comme cette longue lettre de 21 pages du peintre Charles Giraud écrite à Papeete du 15 septembre au 9 octobre 1846 à son ami Harduin à qui il raconte sa vie à Tahiti en illustrant son envoi de sept aquarelles qui rehaussent le texte au fur et à mesure du récit épistolaire16. Dans l’immense majorité des cas, l’écriture des lettres missives obéit à des habitudes d’écriture qui s’affranchissent progressivement des actes diplomatiques pour s’autonomiser dès le xvie siècle, sous l’influence de manuels, de formulaires de lettres mais aussi de recommandations administratives qui acclimatent une complexification des apostrophes et des formules de politesse, une conquête de l’autographie dont l’usage peut avoir valeur de message politique17 et un usage de plus en plus maîtrisé des alinéas, de l’ajout post-scriptum et des espaces laissés en blanc par les scripteurs. En dépit de ce moule épistolaire partagé, qui s’impose à l’échelle de l’Europe occidentale, la responsabilité et la liberté de chaque auteur demeure qui lui permet de donner à l’aspect de sa lettre un tour plus ou moins personnel. On connaît l’aphorisme exprimé par Blaise Pascal dans sa XVIe Provinciale qui milite en faveur d’une écriture maîtrisée : « Je n’ai fait celle-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » L’occupation maximale de l’espace, marge et en-tête compris, le dispute ainsi à la recherche d’effet et à la subtile composition où le blanc et le vide l’emportent sur un texte ainsi davantage rehaussé, à l’image des rapports complexes qui règnent entre un tableau et son cadre.
Les textes que l’on va lire, d’excellente venue, sont l’œuvre de doctorants de l’École nationale des chartes et de l’Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis qui se sont réunis le 10 mars 2015 autour du thème de la matérialité de l’échange dans les réseaux de correspondance18. Ces jeunes historiens, issus de cette génération d’« enfants du numérique », pour reprendre la terminologie officielle française19, sont engagés dans la préparation de thèses de doctorat. Ils ont fait le choix courageux de s’intéresser prioritairement aux aspects les plus concrets des sources écrites auxquelles ils demandent ordinairement les éléments indispensables à leur démonstration. Ce choix est moins paradoxal qu’il y paraît, on l’aura compris, d’autant que leurs établissements d’appartenance y sont éminemment favorables.
Depuis ses origines, l’École des chartes promeut une approche aussi concrète qu’intellectuelle des sources du passé, qu’elles soient d’abord écrites ou qu’elles touchent à d’autres expressions de l’activité humaine. Installée pendant longtemps au cœur même des institutions de conservation – Bibliothèque royale, puis Archives impériales ou nationales –, l’École y a puisé une proximité essentielle avec le document original, en confectionnant dans les temps héroïques de la Restauration des recueils d’originaux ad hoc tirés de fonds des Archives nationales20. Lorsqu’il s’est agi de faciliter l’apprentissage d’une paléographie fondée sur des exemples issus de l’ensemble des ressources archivistiques françaises, qu’il n’était évidemment pas imaginable de faire venir en original à Paris, une vaste entreprise de reproductions sous forme de planches lithographiées, puis héliographiées fut mise en chantier entre la Monarchie de Juillet et la Troisième République21. Cet outil pédagogique unique n’empêchait pas les professeurs eux-mêmes d’acquérir pour les besoins de leur enseignement des documents anciens sur le marché de l’antiquariat22, les dernières grandes vagues d’acquisitions ayant eu lieu dans le dernier quart du xxe siècle à l’initiative de Henri-Jean Martin, professeur d’histoire du livre soucieux de faire mieux comprendre les nuances d’une gravure ancienne23.
Il était d’une certaine manière attendu que les doctorants de l’École soient tout aussi sensibles à cette facette matérielle de la documentation historique, quoique le doctorat y soit une création toute récente. Si le Centre universitaire expérimental de Vincennes, où l’interdisciplinarité fut érigée avec volontarisme en moteur de science et d’enseignement, ne fut pas doté à sa création le 1er janvier 1969 de la capacité doctorale, sa rapide transformation en 1971 en université de plein exercice sous l’appellation d’Université Paris 8-Vincennes (puis Vincennes-Saint-Denis après son déménagement en 1980) lui conféra l’habilitation à délivrer tous les diplômes universitaires, dont le doctorat. Quoique beaucoup plus ancienne (1821), l’École nationale des chartes a longtemps tenté de tenir à égale distance formation initiale et formation professionnelle, tant et si bien qu’elle est restée longtemps en marge des standards académiques alors que le sénateur Guillaume Bodinier, ancien auditeur libre des cours de l’École, n’hésitait pas à affirmer en 1904 à la tribune du Sénat que « le diplôme d’archiviste paléographe est en quelque sorte un véritable doctorat d’histoire de France24 ». Il a fallu attendre le tout début du xxie siècle pour que s’opère une relative normalisation dans ce domaine25, qui sans rien lui faire perdre de son originalité l’intègre encore plus nettement dans l’espace universitaire français, ce dont témoigne avec bonheur cette première publication d’actes de ses doctorants.
Les Chartes et Vincennes. L’ancien et le nouveau. Le matériel et l’idéel. La lettre et l’esprit. Comment mieux dire que l’historien s’efforce de briser tous les sortilèges et d’évacuer tous les faux semblants qui divisent et éloignent de l’ambition exprimée par Lucien Febvre au sortir de l’après-guerre, ambition un peu folle, certes, mais plus que jamais d’actualité : comprendre l’homme dans toutes ses dimensions.