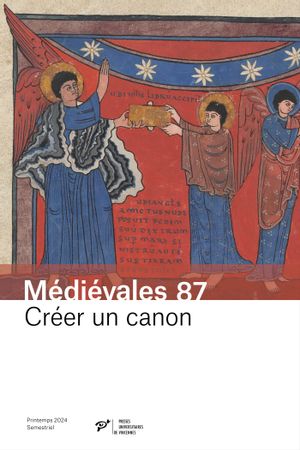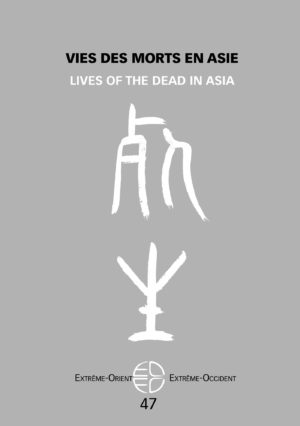Préface
Le démon de l’analogie Éric Fassin
En 1952, Claude Lévi-Strauss publie, sous l’égide de l’Unesco, Race et histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, ce court essai tourne la page du racisme scientifique, durablement discrédité par le cauchemar nazi. En réponse au traité de Gobineau sur l’inégalité des races humaines, il propose en effet une réflexion sur la diversité des cultures. Il faut cesser de renvoyer l’altérité culturelle « hors de la culture » ; au contraire, « le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie ». Ainsi, au mot « race », Lévi-Strauss substitue celui de « culture ». Au moment de renoncer au legs de la sociologie durkheimienne afin de s’ériger en père fondateur de l’anthropologie structurale, il entreprend de débarrasser sa discipline nouvelle d’un héritage encombrant : « Le péché originel de l’anthropologie consiste dans la confusion entre la notion purement biologique de race […] et les productions sociologiques et psychologiques des cultures humaines 1. » Écarter la race dans l’espoir d’en finir avec le racisme ? Ce programme n’appartient pas seulement au passé ; en France, il trouve aujourd’hui une actualité nouvelle.
Il est pourtant coûteux : ce dont on détourne le regard ne disparaît pas pour autant. Le spectre des camps de concentration hante ce texte, et d’autant plus qu’il n’en est jamais question. En revanche, la « situation coloniale », que Georges Balandier venait d’analyser en 1951, en est comme effacée 2. Comment ne pas faire le lien entre ces deux histoires, quand c’est le jour même de la victoire des Alliés en Europe, le 8 mai 1945, que se joue à Sétif et Guelma la répétition générale des « événements » qui s’ouvriront en Algérie à partir de 1954 ? Et qu’en est-il donc de la décolonisation, déjà engagée lorsque Lévi-Strauss publie son essai ? En 1947, n’avait-on pas été témoin, dans l’empire français, d’une autre répression sanglante à Madagascar, mais aussi, sur le versant britannique, de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan ? Comment appréhender les différences culturelles sans prendre en compte, non pas l’inégalité des races bien sûr, mais la hiérarchie géopolitique – l’année même où le vocable « tiers monde » apparaît pour la première fois sous la plume d’Alfred Sauvy ? Peut-on parler des cultures, dans leur diversité, en oubliant les liens dissymétriques du pouvoir ?
Le déplacement opéré par Lévi-Strauss rend impossible, et pour longtemps, de penser ensemble nazisme et colonialisme. Pourtant, en réponse à la même commande de l’Unesco, Michel Leiris avait déjà publié en 1951 Race et civilisation. Son propos est tout autre, puisqu’il est centré sur le colonialisme. Lui part explicitement du nazisme ; mais cet ethnologue entend rompre aussitôt avec l’aveuglement de l’Occident à son propre racisme. « Avec la chute d’Adolf Hitler on put croire que le racisme était mort ; mais c’était témoigner d’une vue bien étroite et raisonner comme si nulle forme du mal raciste ne sévissait dans le monde en dehors de cette forme – il est vrai la plus extrême et la plus virulente – qu’en avait représentée le racisme hitlérien ; c’était oublier que l’idée de leur supériorité congénitale est fortement ancrée chez la plupart des Blancs, même chez ceux qui ne se croient pas racistes pour autant. » Et loin de s’affaiblir avec les premiers signes de la décolonisation, pour l’écrivain, ce sentiment de « l’homme de race blanche et de culture occidentale » ne faisait que se renforcer 3.
Cet argument, on en trouvait la formulation la plus virulente, en 1950, dans le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire : « Il faudrait d’abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur. » Dans son livre important sur les mémoires entrelacées de la Shoah et du colonialisme, Debarati Sanyal cite un passage célèbre de cette puissante diatribe, qui établit un lien direct avec le nazisme : « On se tait à soi-même la vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en être la victime, on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’a absous, on a fermé l’œil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens. » Il s’agit donc de « révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du xxe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique 4 ».
Telle est la continuité historique qui, depuis Lévi-Strauss, nous est devenue impensable. Colonialisme ou nazisme, ces barbaries renvoient pourtant l’une et l’autre au démon de la race. Pour s’en convaincre, il suffit de relire Les Origines du totalitarisme, d’Hannah Arendt, publié en 1951, soit dans ce même moment de bascule entre la guerre mondiale et la Guerre froide, mais aussi entre colonialisme et décolonisation. En partant du racisme, la philosophe propose une généalogie du totalitarisme à partir de l’antisémitisme et de l’impérialisme. Si l’influence de cette pensée est considérable en France, du moins à partir des années 1970, c’est pour étayer la pensée antitotalitaire en rapprochant les totalitarismes communiste et nazi. Or on n’a lu cette somme, tardivement traduite, que par morceaux : c’est en 1982 seulement que paraîtra en français la partie centrale sur l’impérialisme, une dizaine d’années après les deux autres qui l’encadrent sur l’antisémitisme et le totalitarisme. Autrement dit, c’est bien l’articulation entre l’Holocauste et le colonialisme qui a disparu du paysage intellectuel et politique français.
Debarati Sanyal renoue les fils de cette double histoire en évitant tous les pièges tendus par les tensions politiques qui traversent aujourd’hui la question raciale dans notre pays, et en nous ouvrant ainsi un chemin pour n’y pas tomber. Pour y parvenir, elle évite d’emblée deux écueils symétriques, qui renvoient à deux noms propres. Le premier rejette radicalement « l’obscénité de la compréhension » : la Shoah doit rester de l’ordre de l’indicible. C’est que pour Claude Lanzmann, « l’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu d’horreur est intransmissible ». À l’inverse, d’après le second, Giorgio Agamben, les camps d’extermination nazis ont moins valeur d’exception que de paradigme de la vie politique moderne, ou plus précisément de paradigme de l’exception : pour lui, Auschwitz « se répète sans cesse ». Singularité absolue ou répétition sans fin : dans les deux cas, on perd la spécificité du lien entre les violences coloniale et nazie.
C’est la fiction qui permet à cette professeure de littérature à Berkeley d’échapper à une telle alternative. Il ne s’agit pas, à l’instar de Césaire, de voir le nazisme comme l’aboutissement du colonialisme ; à rebours de sa démarche, le livre s’attache à suivre les migrations de la mémoire de la Shoah dans des œuvres de la décolonisation. « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la littérature et le cinéma francophones ont sans cesse cherché à ne pas isoler l’Holocauste comme le paradigme du trauma historique, mais plutôt à relier sa mémoire à d’autres occurrences historiques de barbarie, en mettant bien souvent l’accent sur les complicités entre différents régimes de violence. » La complicité ne renvoie pas ici à la culpabilité, moins encore à la repentance : l’enjeu, c’est d’entendre les résonances historiques entre le passé et le présent. Autrement dit, une histoire est toujours impliquée dans une autre.
Cela suppose d’abord de surmonter l’interdit de la représentation posé par Lanzmann. Discuter Nuit et Brouillard d’Alain Resnais ou Les Bienveillantes de Jonathan Littell, c’est une manière de ne pas se laisser enfermer dans la « complicité traumatique » : « Je m’inscris en faux », avertit Debarati Sanyal, « contre la tendance actuelle visant à brouiller la distinction entre survivre à un traumatisme et hériter de sa mémoire ». La représentation nous sort en effet de l’identification traumatique. Cependant, partir de la figure littéraire ne va pas sans danger non plus : le risque est d’en tirer la conclusion qu’une histoire renverrait à une autre dès lors qu’elle la signifie, autrement dit, que le signifiant disparaîtrait au profit du signifié. Pareille lecture est d’emblée récusée : « Dans mon corpus, la Shoah ne fonctionne ni comme une référence de second ordre ni comme une référence de premier ordre à travers laquelle serait représentée une autre histoire. »
Ce caveat permet de comprendre le sens que Debarati Sanyal donne dans son ouvrage au mot « allégorie » : non pas une chose à la place d’une autre, mais une histoire qui en évoque en même temps une autre. « Les œuvres d’Alain Resnais, Jean Cayrol, Jean-Paul Sartre, et Albert Camus qui pouvaient sembler porter “sur” l’expérience de l’occupation, de la déportation, et de l’extermination, invoquaient simultanément la violence raciale caractéristique de la fin de l’époque coloniale. » L’exemple de Camus est sans doute le plus remarquable : il n’est ici ni « condamné parce que considéré comme un apologiste du colonialisme », ni « sacralisé en tant que témoin du fascisme et de l’Holocauste ». Au-delà de l’auteur et de son idéologie, « ses figures littéraires ont poursuivi leur travail éthique et politique » : l’image même de la peste va plus loin que La Peste. Elle hante toute une littérature « coloniale », à commencer par Le Métier à tisser de Mohammed Dib.
C’est toute la force de la littérature : par le jeu des figures, elle dit davantage que ce qu’elle dit. La poétique de l’allégorie apparaît ainsi comme une réponse aux apories de l’analogie. Il est sans doute devenu impossible de comparer les horreurs du colonialisme à celles du nazisme ; en effet, c’est s’exposer à mesurer les unes à l’aune des autres, dans une concurrence des victimes vouée à l’échec – qu’on privilégie une histoire ou bien l’autre. On le voit bien aujourd’hui, dans les débats politiques : lorsqu’on accole les mots « racisme et antisémitisme », on risque, en distinguant ces deux formes politiques de la race, de les opposer, voire de ne parler que du racisme des uns, et de l’antisémitisme des autres. Voilà pourquoi il importe de résister au démon de l’analogie – sans pour autant sacraliser l’unicité absolue d’une histoire première, ce qui reviendrait à en sacrifier une seconde : l’une en suggère toujours une autre. C’est ainsi que la littérature peut être appréhendée comme la chambre d’écho de l’histoire.
On peut comprendre ainsi que Debarati Sanyal n’est pas seulement une chercheuse ou une critique ; c’est aussi, et peut-être d’abord, une professeure. De fait, l’enseignement de la littérature trouve sa justification dans ce que la littérature nous enseigne. On pourrait songer ici à l’œuvre de Charlotte Delbo : condamnée aux camps nazis, la secrétaire de Louis Jouvet a trouvé son salut dans le théâtre. C’est en reconstituant, avec d’autres détenues, le texte du Malade imaginaire ou, à Ravensbrück, en se récitant Le Misanthrope pendant l’appel, qu’elle a pu survivre. Et c’est encore l’écriture qui, après la guerre, va donner forme à cette histoire tragique dont elle assure en retour la survie en même temps qu’elle confère un sens fort à la vie de celle qui devient ainsi écrivaine. À ce va-et-vient entre littérature et vie, Debarati Sanyal ajoute, avec la complicité entre passé et présent, la complexité d’histoires qui résonnent entre elles. Dans le livre qu’on va découvrir, l’œuvre n’est donc pas un mémorial, car plutôt qu’un « lieu de mémoire », c’est bien un « nœud de mémoire ».
1.Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, Denoël/Gonthier, 1952, citations p. 22, 10.
2.Georges Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, 1951, p. 44-79.
3.Michel Leiris, « Race et civilisation », Cinq études d’ethnologie. Le racisme et le Tiers monde [1951], Paris, Denoël/Gonthier, 1969 p. 9-10.
4.Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955, p. 13-14.
Introduction
Chemins de la mémoire, dangereuses intersections Debarati Sanyal
À travers une réflexion sur la complicité, le présent ouvrage s’attache à montrer comment la littérature et le cinéma peuvent témoigner de la violence et de la barbarie lorsqu’ils rapprochent des réalités historiques éloignées. Le mot « complicité » renvoie ordinairement à la participation d’un individu à des actes répréhensibles, voire à la collaboration avec le mal, mais ce terme ouvre également vers la complexité du monde dans lequel nous vivons. La racine latine de complicité, complicare, « plier ensemble », résonne comme une invitation à faire dialoguer les positionnements subjectifs, les histoires et les mémoires qui forment la matière de ce livre. Alors que l’époque est plus que jamais à la connexion des peuples et de leurs passés, la complicité et la solidarité peuvent être les deux faces d’une même pièce. La reconnaissance de notre propre place dans un pli historique donné, mais aussi celle des plis où différentes trajectoires historiques se rencontrent, n’est pas une tâche aisée. Il nous faut prendre du recul sur notre position, parfois contradictoire, dans le paysage politique d’un moment donné, comme victimes, criminels, complices, simples observateurs, témoins ou spectateurs. Ce travail nous demande de prendre conscience des fortes résonances du passé dans le présent, d’entendre et d’accorder les affinités imprévisibles entre des héritages disparates de violence et de deuil. Dans une recherche collective de reconnaissance et de justice, mettre au jour de telles complicités peut participer à créer des liens entre différentes communautés. L’enchevêtrement de mémoires traumatiques distinctes et asymétriques (l’esclavage, l’Holocauste, le colonialisme ou le terrorisme) peut modifier les usages traditionnels et communautaires du souvenir, et favoriser l’émergence de pratiques nouvelles. Mais il peut aussi conduire à de dangereuses intersections, où la différence est niée au profit de l’uniformité, où l’identification mène à l’appropriation, ou lorsque la récupération politique de la mémoire se heurte aux devoirs éthiques du témoignage. Reconnaître la contiguïté de, et les connexions entre, différentes réalités historiques peut agir à la fois comme un moteur et comme un motif de renoncement ; la conscience de la complicité peut éveiller la responsabilité, mais également accroître la résignation ou le déni. Les travaux qui forment le corpus de cet ouvrage sont autant d’études de cas montrant la difficulté d’approcher la notion de complicité. Ils témoignent de la puissance et des risques imprévisibles de « ce terrible besoin d’établir le contact 1 » entre des passés traumatiques et par-delà les différences ethnoculturelles.
Mémoire et complicité s’intéresse à l’utilisation de la mémoire de l’Holocauste dans la culture française et francophone, des années d’après-guerre à l’époque contemporaine, en s’emparant d’une tradition intellectuelle singulière dont l’objet est de mettre au premier plan la complicité plutôt que le traumatisme dans la conceptualisation et la représentation de la Shoah. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la littérature et le cinéma francophones ont sans cesse cherché à ne pas isoler l’Holocauste comme le paradigme du trauma historique, mais plutôt à relier sa mémoire à d’autres occurrences historiques de barbarie, en mettant bien souvent l’accent sur les complicités entre différents régimes de violence. Cette tradition a également mis en valeur la complicité en tant que mode de réception et d’approche de différentes réalités historiques. Les œuvres d’Alain Resnais, Jean Cayrol, Jean-Paul Sartre, et Albert Camus qui pouvaient sembler porter « sur » l’expérience de l’occupation, de la déportation, et de l’extermination, invoquaient simultanément la violence raciale caractéristique de la fin de l’époque coloniale. Ces usages comparatifs ou métaphoriques de la mémoire de l’Holocauste ont été très nettement oubliés ou effacés, depuis les années 1960 jusqu’aux années 1990, lorsque la Shoah a été réélaborée en tant qu’événement radicalement singulier auquel nul autre ne pouvait être comparé. Depuis les années 1990, un certain nombre d’écrivains français et francophones ont toutefois commencé à travailler sur les échos transnationaux de la mémoire de l’Holocauste pour mettre en évidence l’implication de la France dans d’autres sites de violence, de déplacements de populations et de pertes. Des auteurs contemporains de fiction tels que Jonathan Littell, Assia Djebar et Boualem Sansal brouillent par leurs écrits les frontières de la mémoire nationale en y mêlant des histoires singulières et en proposant des modèles complexes de réflexion sur l’éthique et la culture politique du souvenir. Dans une veine différente, certains philosophes comme Giorgio Agamben ont conceptualisé Auschwitz comme le paradigme d’un phénomène d’exception à l’œuvre dans différents lieux et différentes époques. Dans les chapitres qui suivent, c’est ce corpus que j’aborde, guidée par une série de questions fondamentales : quels enjeux politiques soulève-t-on lorsque l’on entremêle au sein d’une œuvre d’art des mémoires de violence en apparence radicalement différentes ? Quelles carences et quels apports la mise en relation de la mémoire d’un crime historique avec un autre comporte-t-elle ? Sous quelles conditions le croisement entre des héritages mémoriaux stimule-t-il un échange productif ? Quand le récit de certains faits historiques ou le dialogue sont-ils empêchés ou tus ? Pourquoi la littérature et le cinéma se sont-ils transformés en de si puissants vecteurs pour ce travail de mémoire ?
L’Holocauste est désormais devenu le paradigme du travail de mémoire dans l’historiographie, le discours juridico-politique, la philosophie, la théorie et la production artistique. Son statut a muté, passant de « l’exception à l’exemplum 2 ». Susan Suleiman relève « la présence de plus en plus universelle de l’Holocauste en tant que lieu de mémoire », « devenu un modèle pour la mémoire collective dans des régions du monde qui n’ont rien à voir avec ces événements, mais qui ont connu d’autres traumas collectifs » 3. L’émergence de l’Holocauste en tant que paradigme du génocide, de la violation des droits de l’homme, du trauma historique et de la mémoire collective, a conduit certains chercheurs à l’envisager comme un « “conteneur” universel pour la mémoire de victimes innombrables », promesse « d’opportunités sans précédent pour la justice ethnique, raciale et religieuse, pour une reconnaissance mutuelle, et pour un règlement non militaire des conflits mondiaux » 4. C’est le désancrage de l’Holocauste de son inscription historique, et son mouvement à travers le temps et l’espace, qui garantissent sa pertinence vis-à-vis d’autres crimes et d’autres expériences de souffrance. En d’autres termes, sa mutation en symbole est le gage de sa mobilité et de sa puissance significative. Andreas Huyssen émet l’observation suivante : « Dans le mouvement transnational des discours sur la mémoire, l’Holocauste a perdu sa fonction d’index à l’égard des événements historiques uniques et s’est transformé en métaphore opérationnelle pour d’autres histoires et d’autres mémoires traumatiques. La transposition de l’Holocauste en trope universel est une condition préalable à son décentrage et à sa mise en œuvre en tant que prisme puissant à travers lequel nous étudions d’autres cas de génocides. » Pourtant, si l’Holocauste est aujourd’hui un site de mémoire transposable qui peut servir toute une gamme de combats politiques et de causes éthiques, Huyssen signale que cette dynamique doit être abordée avec prudence : « Si la comparaison avec l’Holocauste peut dynamiser certains débats sur les mémoires traumatiques d’un point de vue rhétorique, elle peut aussi agir comme une mémoire écran, voire écraser la compréhension de certaines spécificités historiques 5. » Dans quelle mesure l’universalisation de l’Holocauste éclaire-t-elle ou empêche-t-elle le rapprochement avec d’autres histoires, d’autres mémoires et d’autres identités ? Doit-on opérer une distinction entre la transposition actuelle de l’Holocauste en exemplum ou en paradigme, et des utilisations plus mouvantes de sa mémoire à travers certains dispositifs esthétiques ? Et en premier lieu, qu’entendons-nous par mouvement de la mémoire ?
L’allusion de Huyssen au « mouvement transnational des discours sur la mémoire » reflète un profond changement dans la conceptualisation de la mémoire culturelle, passant de modèles fondés sur les territoires à des formes évolutives, en mouvement, qui captent la fluidité du souvenir dans une ère postcoloniale mondialisée et sujette aux migrations de masse. La mémoire bouge, et les chercheurs en littérature, les sociologues, les penseurs en politique et les historiens cherchent à conceptualiser ses itinéraires et ses formes prolifiques. Richard Crownshaw décrit cette transformation