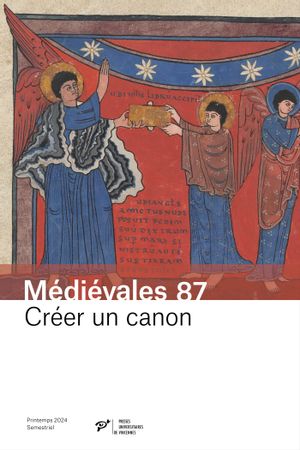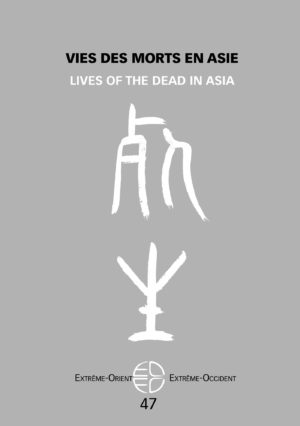Introduction Chrisitine Cadot
« Je me demande ce que le passé nous réserve. » Françoise Sagan, Les Faux-fuyants, Paris, Julliard, 1991.
En décembre 1973, les neuf pays membres des Communautés européennes réunis au sommet de Copenhague inscrivent au nombre des priorités fondamentales européennes la définition d’une identité partagée qui facilite et dynamise leurs relations extérieures communes. En décembre 2012, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont repoussé la date d’ouverture des négociations d’adhésion avec l’ex-république yougoslave de Macédoine, en raison notamment de la revendication de l’usage exclusif par la Grèce du nom « Macédoine ». A Skopje toujours, la même année, un pylône haut de 65 mètres sur lequel le drapeau macédonien flotte est érigé à la frontière avec la Bulgarie, dont les mâts ne dépassent pas 45 mètres. Cette affaire provoque l’irritation du Premier ministre Boïko Borissov, qui émet un véto à l’ouverture des négociations en vue de l’adhésion de la Macédoine à l’Union européenne. En janvier 2018, on note de nombreuses manifestations de militants nationalistes grecs qui veulent redorer l’image d’une Grèce humiliée par la crise de la dette européenne par l’usage politique exclusif d’un passé héroïque en rapport avec l’héritage militaire et culturel de l’empire d’Alexandre. En juin de la même année, la proposition du Premier ministre grec Alexis Tsipras de trouver un compromis autour de l’appellation « République de Macédoine du Nord » est finalement adoptée par le Parlement grec et les deux gouvernements. Cet accord est confirmé par les Macédoniens du Nord lors d’un référendum en septembre 2018 qui a lié explicitement la question du nom et la question de la candidature à l’espace européen et à l’OTAN (« Êtes-vous pour l’adhésion à l’Union européenne et à l’Otan, en acceptant l’accord avec la Grèce ? »). Cet usage national d’un héritage antique dont on n’interroge jamais les frontières et l’homogénéité supposée est nécessairement conflictuel et nourrit les nationalismes. À Skopje aussi, Alexandre est présenté comme une figure fondatrice. Une statue à son effigie a été érigée en grande pompe en 2011 pour célébrer les 20 ans de l’indépendance nationale, à grand renfort de parades en costumes antiques. La vaste campagne d’aménagement de l’espace urbain de Skopje 2014 en a été le vecteur monumental. Ces mémoires héroïques avaient déjà été mobilisées au XIXe siècle. Elles étaient alors utiles à l’affirmation d’une église orthodoxe autonome par rapport à la Serbie voisine ou à l’identification d’une langue et d’une nation présentées comme non assimilables à la culture bulgare. Le propre de l’usage politique de l’histoire est de pouvoir être réinvesti de significations diverses en fonction des agenda nationaux, locaux ou européens. Ce paysage mémoriel et ces usages politiques de l’histoire au sein d’États-membres de l’Union européenne se multiplient depuis plus de 50 ans. Ils ne peuvent que nous inviter à la plus grande prudence quant à l’utilité et à la possibilité d’une mémoire collective européenne unifiée. Les politiques de mémoire associées à la construction européenne ont souvent été entretenues comme autant de mémoires actives, de mémoires chaudes, froides ou vivantes, de mémoires saturées ou de mémoires enfouies, au point de brouiller la perspective dans laquelle les institutions nationales semblaient d’abord les inscrire. La fabrique des mémoires collectives a été très rapidement évoquée comme une nécessité par les institutions européennes elles-mêmes. Ces présents du passé devaient permettre une introspection individuelle et collective, un réexamen attentif des culpabilités originelles de certains États-membres et un apaisement relatif des tensions toujours existantes, en ramenant celles-ci au traumatisme indépassable de la Seconde Guerre mondiale. Dans un programme de promotion des entreprises mémorielles mis en place en 2004 (« Mémoire active »), la Commission européenne avance ainsi que : Le souvenir des atrocités et des crimes du passé permet aux citoyens de réfléchir aux origines de l’UE et à l’histoire de l’intégration européenne qui a permis de maintenir la paix dans les États membres et les a aidés à atteindre leur prospérité actuelle. Dix ans plus tard, cette action est reprise mot pour mot dans les priorités du programme L’Europe pour les citoyens, qui finance des actions destinées à une jeunesse européenne qui doit « comprendre le sacrifice de ses ancêtres » et entretenir le « devoir de mémoire » aux effets entendus, que celui-ci soit relatif aux crimes du nazisme ou du stalinisme. On voit ici clairement la tension existante entre les effets attendus de politiques mémorielles et le but assigné à cet exercice collectif qui doit aussi permettre de s’interroger sur les raisons d’être de l’intégration européenne, en ramenant son origine, ses fondements et ses valeurs à la négation des crimes des totalitarismes. D’abord lié au récit de l’intégration européenne, la mémoire aurait alors pour but d’aider les citoyens à réfléchir sur les horreurs de l’histoire, afin de mieux prendre conscience des progrès que constituait l’intégration européenne. Si nous faisons un pas de côté, cette vision d’une réconciliation nécessaire n’est-elle pas une condition dont l’exclusivité pose problème ? N’est-elle pas une vision occidentalo-centrée du récit fondateur de l’Union européenne ? Quel récit intégrateur proposer aux citoyens des États d’Europe orientale dont le rapport au passé ne peut s’énoncer exclusivement comme une origine se rapportant à la réconciliation franco-allemande ou à la signature de l’Armistice de 1945 ? Depuis une trentaine d’années, les études sur les politiques de mémoire se sont multipliées. Les milieux politiques les plus euro-enthousiastes rappellent à l’envi le poids de la mémoire partagée dans la construction des identités collectives. Les chercheurs, eux, sont beaucoup plus sceptiques quant à l’affirmation d’un devoir de mémoire européen, mais sont souvent renvoyés à l’accusation d’europhobie ou d’euroscepticisme qui pèse souvent sur ceux qui dénoncent les usages politiques des histoires européennes. L’histoire de l’intégration européenne s’intègre désormais à des enceintes auparavant réservées aux histoires nationales ou infranationales. Elle devient l’objet de réalisations scénographiées qui attirent de nouveaux visiteurs, alléchés par un contenu qui semble renouvelé, « au goût du jour ». Les musées de guerre, en particulier, ont fait un effort important dans l’exposition d’une vision plurinationale de leurs objets. Le musée de la Résistance de Besançon a fait appel à une conservatrice allemande, sans que cela ait soulevé d’opposition particulière. L’Historial de Péronne se présente comme un historial « européen », détaché de la recherche de la figure héroïque nationale. Cependant, cette vision non-héroïsante et plurinationale en devient-elle pour autant automatiquement européenne ? Cet ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité d’une énumération de tous les débats sur les mémoires collectives en Europe et sur l’Europe. Il n’en épuise ni tous les exemples ni toutes les catégories. Néanmoins, nous avons tenté de les exposer en illustrant cet ouvrage d’exemples et de lectures venus d’horizons géographiques variés, comme l’index des lieux de cet ouvrage en fait part. Le présent volume entend partir du constat porté par la quasi-totalité des chercheurs en science sociale : nos sociétés sont saturées de mémoires, historiques, culturelles, sociales, savantes, individuelles, que le discours ordinaire pare de toutes les vertus et de toutes les obligations morales. Qu’en est-il de ce constat lorsque nous parlons d’intégration européenne ? A l’heure où l’édifice européen peine à être conceptualisé en dehors des cadres narratifs, épistémologiques et philosophiques de l’État-nation et du droit politique (Mairet 1997 ; Ferry 2000), on peut penser que cette saturation mémorielle s’y retrouve sous des formes familières. C’est effectivement ce que révèle le premier chapitre, qui présentera les usages du passé de l’unification européenne auxquels nous sommes très tôt socialisés, ceux qui sont d’abord institutionnalisés dans les paroles politiques dominantes, dans les musées et les manuels scolaires. L’enseignement de l’histoire de l’intégration européenne y est présenté comme un enchaînement de dates et de traités qui se suivent sans violence ni chute. Les productions mémorielles institutionnelles sur l’histoire de l’intégration européenne sont pourtant l’enjeu de réappropriations et de concurrences multiples entre acteurs institutionnels et font l’objet d’usages hétérogènes (chapitre 1). Souvent jugé ennuyeux, l’enseignement de l’histoire de l’intégration européenne et les campagnes électorale européennes partagent ceci de commun avec le patinage artistique qu’ils ne réveillent les passions qu’en cas de chute ou de tensions héroïsantes (chapitre 2). Or, derrière la reconstruction historique se cache bien souvent la reconstitution manichéenne d’une histoire dont la fin est déjà connue, celle d’un élargissement et d’une intégration progressive et continue, tout juste perturbée récemment par le Brexit. Les enjeux locaux et la constitution d’hagiographies nationales sont bien présents, loin de la seule histoire positive et optimiste de l’histoire européenne qui serait seule à même (par la magie déjà éprouvée du roman national ?) de nous faire partager un sentiment d’appartenance commune. Ce sentiment est également espéré du devoir moral qui naît de l’expérience traumatique des totalitarismes européens. L’injonction à se souvenir des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale s’accompagne de mesures pour renommer les lieux, renommer le bourreau, renommer les victimes. Dans ce travail du passé, il est cependant rare que nous soyons invités ou enjoints à partager la connaissance des horreurs vécues par le voisin européen avec ses mots et ses chronologie différenciées (chapitre 3). Enfin, si les mots des mémoires des « autres » de l’Europe sont peu connus en dehors de nos récits nationaux, que dire des mots et des voix qui se tiennent à la marge de mémoires européennes dominantes, comme celles relatives à l’impensé colonial ? Il devient alors nécessaire de penser un espace public de la mémoire qui permette de réactiver l’autonomie politique d’individus et de groupes sociaux qui en ont parfois été privée (chapitre 4) et qui replace le projet européen au cœur d’un choix politique autonome, délivré d’un rapport aliénant et mortifère au passé.