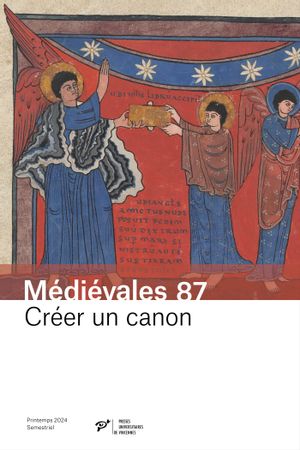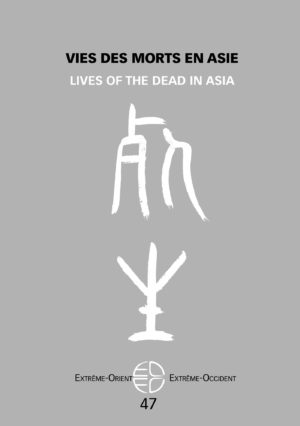Introduction
Paris et les médias, une histoire entremêlée Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin et Adeline Wrona
Paris, à la croisée des capitalismes urbains et médiatiques
Depuis plusieurs années, Paris se peuple d’incubateurs et d’accélérateurs de start-ups culturelles et créatives. Ces acteurs du Web et des industries médiatiques marquent non seulement l’espace urbain de leur empreinte matérielle au travers d’architectures parfois grandioses, à l’image du Cargo ou de Station F, deux sites inaugurés en juin 2017, mais ils sont aussi porteurs de nouveaux discours et imaginaires sur les médias et sur l’espace urbain dans lequel ils se déploient.
Promoteurs d’un imaginaire souvent euphorique de l’innovation – qui apparaît par exemple sous les traits du fantasme d’une productivité « créative » et technique, œuvrant à un « progrès » entendu comme la promesse d’un bien commun salvateur et riche –, ces entreprises développent une sémantique particulièrement ambitieuse. Le Cargo, implanté dans l’ancien entrepôt Macdonald1 sur la rive sud du boulevard du même nom (19e arr.), se présente comme « une réelle opportunité pour développer un véritable centre d’émergence et d’accélération de jeunes entreprises innovantes autour des contenus numériques et des industries créatives2 », et un acteur urbain à part entière en tant que « première brique de l’Arc de l’Innovation incarnant une ville mixte, durable, inventive, ouverte aux synergies et aux échanges avec les villes voisines de la métropole3 ». La Résidence Créatis, située dans le 11e arrondissement, se définit quant à elle comme une « [p]lateforme d’innovation dédiée aux acteurs de la culture et des médias », travaillant depuis 2012 « aux côtés de ceux qui innovent », tout en exploitant « un lieu unique, au cœur de Paris »4. L’imaginaire de la collaboration est porté haut, en tant que moteur d’une singularité créative et ciment d’une communauté de professionnels : « [U]n lieu qui rassemble sous un même toit entrepreneurs, experts, développeurs, créatifs et journalistes ». On retrouve à peu de choses près la même promesse « communautaire » chez le Tank, « un lieu pour créer son futur » où se côtoient, toujours dans le 11e arrondissement, « média, entrepreneurs, desi-gners, penseurs et agitateurs, à la croisée du numérique, de la société et de l’environnement »5. On l’entrevoit, ces lieux ont bien des choses en partage, comme la dynamique autotélique de l’innovation, la glorification euphorisée de la collaboration, ou encore la valorisation de ces espaces présentés sous la forme d’une événementialité perpétuelle. Ils reposent sur un même travail de fictionnalisation dans lequel la territorialité parisienne – géographique, topographique et symbolique – est érigée en valeur cardinale.
Cette dynamique récente, ou tout du moins présentée par ces acteurs comme particulièrement novatrice et contemporaine, s’inscrit en réalité dans la continuité de l’histoire du capitalisme médiatique, intimement liée à Paris et au xixe siècle, période au cours de laquelle les journaux se muent graduellement en médias de masse et essaiment dans la ville en infrastructures et sièges somptuaires. C’est d’abord un nouveau territoire qui se dessine : en effet, « [a]lors que jusqu’en ١٨١٥ la presse demeurait liée à l’imprimerie, dont le siège historique se situe sur la rive gauche autour de l’Université, dès la Restauration, la presse parisienne commence à migrer vers la rive droite, tandis que l’édition et l’impression des livres restent implantées au Quartier latin. Rompant les liens avec le Paris des intellectuels de la rive gauche, la presse rejoint le Paris populaire et marchand de la rive droite6 ». Cette histoire ne s’est pas faite sans à-coups. Ainsi, « [d]ès les années ١٨٣٠, deux conceptions du journalisme s’affrontent dans la géographie parisienne : alors que Le Journal des Débats, emblème de la presse politique d’influence, demeure au Quartier latin, 17, rue des Prêtres Saint-Germain l’Auxerrois, Émile de Girardin établit La Presse, symbole de la presse populaire naissante, au 16 de la rue Saint-Georges7 ». À partir de la fin du Second Empire, le territoire médiatique (celui des journaux mais aussi des imprimeries et des agences de presse) s’étend au-delà du 2e arrondissement (jugé parfois trop proche du pouvoir politique), pour franchir les Grands Boulevards et s’installer dans le sud du 9e et le sud-ouest du 10e, se rapprochant ainsi du monde des affaires (la bourse, les grands magasins, les banques), des activités culturelles (les théâtres bien sûr, mais aussi les cafés et les restaurants), et des infrastructures de communication (les bureaux de poste et les centraux téléphoniques, les gares, les grands axes) qui permettent la circulation des marchandises, des informations, des idées et des personnes.
Au xxe siècle, ce territoire médiatique va poursuivre son évolution, et se fragiliser aussi : les nouveaux médias, radios et télévisions, s’im-plantent dans d’autres quartiers parisiens puis, « dans les années 1970, la photocomposition et la transmission par fax viennent rompre cette pro-ximité géographique entre le monde ouvrier et le monde intellectuel. Le mouvement de déconcentration des imprimeries vers la banlieue parisienne conduit inévitablement les rédactions à quitter des bâtiments surdimensionnés8 ». Depuis la fin du xxe siècle, le capitalisme médiatique connaît de profondes mutations, et c’est tout un nouveau mouvement de concentration qui se met en place, dans lequel les acteurs du journalisme retrouvent une place, mais bien plus marginale. Cette évolution a pour corollaire de nouvelles inscriptions spatiales : ainsi le nouveau bâti-ment accueillant le groupe « Le Monde », désormais propriété d’une holding appelée « Le Monde libre », s’installe-t-il en 2020 dans le 13e arrondissement, sur les voies couvertes de la gare d’Austerlitz, en face de la Caisse des dépôts et des consignations, et surtout à deux pas du grand incubateur « Station F » lancé par Xavier Niel, actionnaire du journal. Le F, ici, n’a rien d’anecdotique : F comme Freyssinet, ingénieur de l’ère industrielle et constructeur de la halle ferroviaire accueillant ces start-ups, et aussi F comme Free, entreprise de télécommunication qui a fait la fortune de Niel. Tous les titres du groupe y sont regroupés, le deuil étant parfois difficile quand ce déménagement arrache une rédaction à un quartier historique : L’Obs, qui appartient aussi à la holding, quitte la place de la Bourse, cœur battant du Paris médiatique au xixe siècle, pour ce « Far East » encore un peu désertique. Racheté par l’homme d’affaires Patrick Drahi, Libération abandonne en 2015 son immeuble historique du quartier de la République (3e arr.), lieu politique s’il en est, pour intégrer d’abord un immeuble impersonnel de la rue de Châteaudun (9e arr.), puis en 2018 l’immense bâtiment du quartier Balard, à la frange du 15e arrondissement, où son nouveau propriétaire a installé l’entreprise SFR, dont il est le PDG. Il y rejoint les autres médias acquis par le groupe Altice – BFM TV, L’Express, RMC –, avant d’en être expulsé à la faveur d’une cession du titre, à l’été 2020. Ces déplacements successifs s’inscrivent dans des logiques de valorisation financière, liées à des opérations de recapitalisation ; car les bâtiments occupés au xxe siècle par tous ces titres ont acquis une valeur immobilière attisant les convoitises. Pendant ce temps, le quartier historique de la presse, après un relatif déclin dans les années 1970-1990, se transforme à la faveur de processus de gentrification : les espaces pu-blics « s’embellissent », la population résidente s’embourgeoise et les activités économiques se renouvellent. De nouveaux acteurs médiatiques et du Web s’y installent, ainsi que dans d’autres anciens arrondissements populaires du nord-est de Paris, aux côtés d’agences de communication, de marketing et de média, mais aussi de nouveaux commerces de restauration, de boutiques de décoration intérieure ou encore d’espaces de coworking. Cette nouvelle territorialité médiatique du xxie siècle accompagne ce que certains ont appelés la « ville postfordiste » puis la « ville néolibérale »9, et pose la question de la « spatialisation10 » du capitalisme médiatique.
Mais le Paris médiatique ne se résume pas à l’implantation de ces entreprises dans des quartiers spécifiques. Il tient aussi aux ambiances et aux sociabilités qui se développent autour de leurs activités, et qui reposent tout à la fois sur des pratiques et des imaginaires. La presse, avec tous ses métiers, rythme ainsi la vie des Grands Boulevards à partir de la fin du xixe siècle et ce pendant un siècle. Il faut dire que pas moins de « deux ou trois milliers […] de journalistes […] arpentent chaque jour les Boulevards et les rues adjacentes11 » au début du xxe siècle. Sans oublier les nombreux autres professionnels du monde médiatique, affichistes, hommes-sandwichs, crieurs, porteurs, kiosquiers ou encore lithographes, qui peuplent et animent les rues de ce vaste espace, formant un véritable écosystème. Comme l’écrit Girardin lui-même dès 1836, « l’œuvre des classes lettrées » (journalistes et hommes de lettres) « fait vivre une multitude innombrable d’acteurs », et c’est par l’extension de toute cette population qu’elle « touche aux choses industrielles » : « […] commerce de la papeterie, ateliers de brochages, fonderies de caractères, fabriques de machines à imprimer » ; les journaux donnent un salaire « à des milliers de compositeurs, de distributeurs et de commis »12.
Les cafés et les établissements gastronomiques constituent un élément central de cette sociabilité : leur prospérité tient à la fréquentation impor-tante qu’en font les journalistes et autres professionnels de la presse, qui se retrouvent là pour échanger, travailler et se divertir. Le Café de Paris, Tortoni, le Café anglais, tous situés sur le « Boulevard » (des Italiens ou des Capucines) offrent des salons fermés propices à des échanges confidentiels, tout en se présentant comme des lieux splendides, aux décors spectaculaires qui n’ont rien à envier aux scènes de théâtre toutes proches. Le Café de Paris, au coin de la rue Taitbout, s’installe par exemple en 1822 dans les appartements d’un extravagant millionnaire russe, le prince Demidoff. Son aura est telle dans toute l’Europe que, selon l’un des habitués, Louis Véron, journaliste, fondateur de la Revue de Paris et directeur de l’Opéra, « l’officier anglais qui se bat contre les Birmans, l’officier russe qui se bat à Khiva, au-delà de la mer d’Arad, sur les bords de l’Oxus, rêvent au bivouac les joies d’un bon dîner au café de Paris13 ». Au Café de Paris, dans les vastes pièces couvertes de tapis, luxe rare à l’époque, on croise des journalistes de toutes tendances ; « c’était un terrain neutre où les opinions les plus contradictoires se rencontraient », écrit le romancier Roger de Beauvoir, « à cette table venaient s’asseoir MM. Véron, Émile de Girardin, Nestor Roqueplan… »14. Pour Guillaume Pinson, « l’histoire médiatique est [de fait] étroitement corrélée à celle des sociabilités : démarrage rapide de l’ère médiatique sous la monarchie de Juillet et invention du “Tout-Paris” à la même époque ; prudence des journaux sous le Second Empire et floraison d’une sociabilité compensatrice comme le café ; libéralisation du journal sous la Troisième République et reprise d’une sociabilité plus vive que jamais. Le rapprochement pourrait être poussé jusqu’à proposer que certaines formes de sociabilités, comme le cercle ou le salon, vont ensuite connaître leur déclin progressif du fait même de l’avènement de la société médiatique de masse15 ».
« Qui n’a pas vu le Café de Paris vers 1837 ou 1840 n’a rien vu », note encore Roger de Beauvoir. Voir et être vu : dans ces lieux de sociabilité se trament aussi des jeux de regards qui font des journalistes les acteurs de plus en plus visibles des scènes de la vie parisienne. Les voilà d’ailleurs qui entrent dans la vaste galerie des types parisiens, éléments centraux de ce que Benjamin nomme la « littérature panoramique16 ». Balzac leur consacre ainsi une savoureuse « physiologie », tout à fait parodique, la Monographie de la presse parisienne17, pendant que les caricaturistes, çà et là, s’en donnent à cœur joie. Émile de Girardin, qui est l’un des acteurs majeurs du monde médiatique parisien au xixe siècle, connaît ainsi son lot de caricatures comme l’analyse le chapitre d’ouverture de cet ouvrage.
Cent cinquante ans plus tard, il suffit de parcourir certaines rues parisiennes pour se rendre compte que la présence des entreprises médiatiques continue à définir l’ambiance des quartiers de la capitale, notamment aux heures du déjeuner et le soir après la journée de travail, à travers des manières spécifiques de se rencontrer et de travailler, mais aussi des façons particulières de (se) parler ou de s’habiller. Station F propose même des espaces de sociabilité qui ambitionnent de se hisser parmi les hauts-lieux parisiens, faisant rayonner la renommée du lieu au-delà des frontières du « campus de start-up18 » : un « huge food market » – le plus grand « food hall » de France apprend-on –, au nom prometteur de « Felicità » (l’initiale F est inévitable), a en effet ouvert dans l’ancienne Halle Freyssinet19. Ici se restaurent les professionnels du site mais aussi d’autres usagers du quartier et, plus largement, tous ceux qui, comme Véron, Girardin ou Dumas au temps du Café de Paris, souhaitent participer au spectacle délivré par le monde de l’innovation médiatique. Le « Parvis Alan Turing » a simplement pris la suite du Boulevard, car le code et la calculabilité deviennent les clés ouvrant toutes les portes d’un avenir digitalisé. Le souvenir d’une ère du rail qui avait soutenu l’industrialisation au tournant des années 1840 peuple encore les lieux, folklorisé par les deux immenses wagons SNCF trônant dans le hall central.
Un troisième lien unit enfin Paris et les médias : ceux-ci participent activement, de manière plus ou moins consciente, à la production de nombreux discours sur la capitale, prenant leur part à la fabrique du « mythe de Paris » qui s’élabore à partir du milieu du xixe siècle. La ville est alors non seulement le lieu de l’économie médiatique, mais elle devient aussi son objet : les journaux publient en effet pléthore de discours concernant la capitale et ses habitants, s’attachant à produire des représentations et des imaginaires parisiens qui ne sont pas sans effets de retour sur le réel. Nous y reviendrons. Les médias participent donc pleinement à la dynamique décrite par Benjamin pour qui la transformation haussmannienne de Paris est « fantasmagorie faite pierre20 ». Dès lors, on peut comprendre le capitalisme médiatique parisien comme l’une des concrétisations du ca-pitalisme urbain qui engloberait : « a/ les mécanismes d’urbanisation du capital, b/ les modes de production capitalistes de l’espace (induits par ces mécanismes), c/ les spécificités matérielles et symboliques des espaces ainsi produits, et d/ les rapports sociaux et les représentations sociales qui se développent dans ces espaces21 ». Le présent ouvrage, Paris, capitale médiatique, se propose d’explorer quelques-unes des articulations qui lient Paris aux mondes médiatiques, et ce depuis le xixe siècle et l’entrée dans la « civilisation du journal » sous la houlette entre autres d’Émile de Girardin – entrepreneur de presse, homme d’affaires intraitable, politique habile, et auteur à succès –, jusqu’à ses manifestations les plus contemporaines. Autrement dit, il s’agit de mettre au jour les liens entre processus urbains et processus médiatiques en les considérant dans leurs dimensions matérielles, sociales, économiques, politiques et symboliques.</