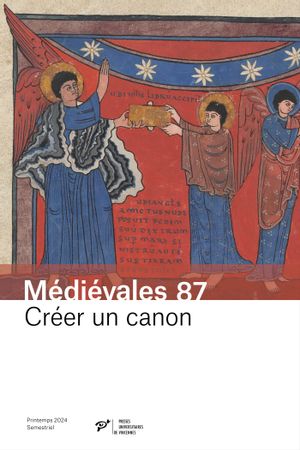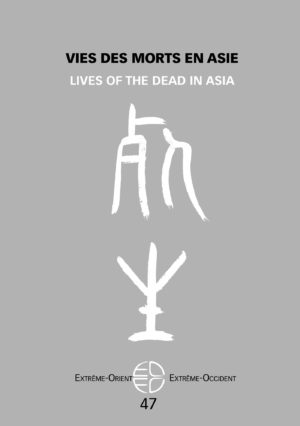Daniel Struve
Terada Sumie
Le Roman du Genji et la société aristocratique
du Japon ancien
Au début du xie siècle, à l’heure où Murasaki Shikibu prenait le pinceau pour rédiger le Roman du Genji, le Japon était soumis à l’autorité d’une cour impériale dominée par quelques familles aristocratiques. Selon certaines estimations, l’archipel aurait compté alors une population de sept à huit millions d’habitants, dont 100 000 environ étaient rassemblés dans la capitale du pays, Heian-kyô, l’actuelle ville de Kyôto (fig. 1). Parmi eux, un millier environ constituait la noblesse de cour (du 1er au 5e rang), familles comprises, dont la plus haute sphère (du 1er au 3e rang) ne comptait guère qu’une centaine de personnes. Une culture d’un très grand raffinement avait pu naître et s’épanouir en assimilant les apports du continent venus de la grande civilisation de la Chine des Tang, dans un contexte où pouvoir et richesse étaient concentrés dans les mains d’une poignée d’hommes placés à la tête d’une organisation administrative centralisée couvrant l’ensemble du territoire. Nous nous proposons, dans cette introduction, de présenter un aperçu de cette société en nous limitant aux éléments indispensables pour situer et comprendre le Roman du Genji.
Le cadre historique
C’est au viie siècle de l’ère chrétienne qu’à la suite de l’introduction du bouddhisme et de l’écriture chinoise, le Japon adopta un système de gouvernement imité de la Chine impériale, ce qui lui permettait d’entrer de plain-pied dans la culture continentale. Sur le modèle chinois, un code administratif et un code pénal furent rédigés à la fin du viie et au début du viiie siècle, fixant les moindres aspects du gouvernement et de l’administration de la cour et du pays. L’État fondé sur les codes institués au début du viiie siècle se maintient tout au long de l’époque de Nara (viiie siècle), puis de celle de Heian (ixe–xiie siècles), même si une partie des codes cesse d’être appliquée à partir du xe siècle. Autour de l’empereur, une aristocratie de cour domine le pays. En 794, la capitale est transférée de Nara à Heian-kyô, l’actuelle Kyôto, située dans la partie centrale du Japon au croisement des principales voies de communication. Une grande partie des richesses des provinces est acheminée dans cette capitale, favorisant l’essor d’une brillante culture.
Une famille occupe dans ce système une place prépondérante : celle des Fujiwara, descendants de Nakatomi no Kamatari (614-659) et de son fils Fuhito (659-720), qui ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration des codes. À partir du milieu du ixe siècle, la branche dite du Nord de cette famille prend le contrôle de la cour grâce à une politique d’alliance matrimoniale avec la famille impériale qui permet aux dignitaires Fujiwara de faire monter sur le trône leurs propres petits-fils, nés de leurs filles, dont ils deviennent les régents. Le pouvoir des Fujiwara se maintiendra jusqu’en 1086, tant que les régents auront des filles qu’ils pourront donner pour épouses aux empereurs. Maîtres des promotions grâce au droit de regard qu’ils obtiennent sur toutes les décisions impériales, les régents Fujiwara accroissent leurs domaines et nouent des liens de clientèle avec les gouverneurs de province qui assurent leur prospérité. La figure de Fujiwara no Michinaga (966-1027), le plus brillant et le plus puissant des régents Fujiwara, dont il est question dans l’article de Charlotte von Verschuer qui ouvre ce dossier, marque l’apogée de la civilisation de cour de l’époque de Heian. C’est dans son entourage que naît le chef-d’œuvre reconnu de la littérature japonaise, le Roman du Genji.
En même temps que les régents Fujiwara s’imposaient en étroite liaison avec la famille impériale comme le pouvoir dominant à la cour, les provinces connaissaient aussi une évolution qui, à terme, allait miner l’emprise de la cour sur le pays. Le système de redistribution des rizières, adopté conformément aux codes, est progressivement abandonné et devient obsolète à partir du début du xe siècle. Les gouverneurs de province, issus des familles de fonctionnaires de rang moyen, s’appuient sur les notables locaux et le personnel qu’ils emmènent avec eux depuis la capitale. Ils gèrent les provinces d’une manière de plus en plus autonome, à charge pour eux d’acheminer à la cour les redevances attendues. La cour jouit d’un prestige qui lui permet de rester source de légitimité et arbitre des conflits. Cependant, le rapport des forces évolue en faveur des provinces. Une noblesse locale, faite de descendants de familles aristocratiques n’ayant pas trouvé d’emploi à la capitale ou de notables locaux, s’affirme et se militarise afin d’assurer un ordre que la cour ne peut plus garantir à elle seule.
Cette déliquescence de l’État fondé sur les codes prend une tournure dramatique au milieu du xiie siècle quand les guerriers se trouvent en position d’arbitrer les conflits à la cour. Ce tournant marque le début de l’âge des guerriers et de la longue période allant jusqu’au milieu du xvie siècle, désignée au Japon comme le « Moyen Âge » (chûsei). La période allant du viie au xiie siècle avec la gestation, puis la mise en place de l’État fondé sur les codes (époques d’Asuka et de Nara), puis l’établissement de la capitale à Heian-kyô et la montée en puissance de la famille Fujiwara, remplacée à partir de 1086 par la maison des Empereurs retirés, est, elle, désignée comme l’« Âge ancien » ou l’« Antiquité » (kodai). On observe donc un décalage entre la périodisation japonaise et la périodisation occidentale. Ensemble, l’« Âge ancien » (viie–xiie siècles) et le « Moyen Âge » japonais correspondent à peu près à la période médiévale occidentale. En littérature, l’époque d’Asuka et de Nara (viie et viiie siècles) est connue comme l’époque antique (jôdai). L’époque de Heian correspond, elle, à l’âge classique et connaît, outre la floraison des lettres chinoises, l’émergence d’une riche littérature en langue vernaculaire, au sein de laquelle un rôle éminent est joué par les femmes.
Les grands traits de la culture de l’époque de Heian
La généralisation progressive de l’écriture et de la culture continentale, au cours du viie siècle, se traduit par la formation d’une culture de cour qui rayonne dans l’ensemble du pays grâce à l’établissement de capitales provinciales et d’un réseau d’institutions monastiques. La poésie en chinois de caractère cérémoniel se développe dans l’entourage de l’empereur Tenji (626-672, qui régna de 668 à 672), à la cour d’Ômi sur le lac Biwa. Elle fleurit aussi dans la première moitié du ixe siècle à la cour de l’empereur lettré et calligraphe Saga (786-842, qui régna de 809 à 823), et connaît son apogée avec l’œuvre du poète en chinois et homme d’État Sugawara no Michizane, issu d’une vieille famille de lettrés liée à l’Office des Études supérieures ou Université (Daigakuryô). Les familles de la grande aristocratie, qui n’envoient pas leurs enfants à l’Université, les forment dans leurs propres institutions, comme celle de la famille Fujiwara, dotée d’une riche bibliothèque. Plus encore que la connaissance des classiques du confucianisme, est prisée à la cour l’habileté à composer en poésie et en prose chinoises, ce qui explique le prestige dont jouit entre toutes la Voie des Lettres.
Les autres formes d’expression artistiques ne sont pas moins fleurissantes dans une société où les rites et les cérémonies, publiques ou privées, jouent un rôle prédominant. La vie du palais et de la capitale est rythmée par les différents événements annuels (nenjû gyôji), dont le déroulement est réglé dans les moindres détails et qui font l’objet de minutieuses descriptions dans les notes journalières des courtisans afin de servir de précédents pour la postérité. La musique instrumentale est omniprésente dans les cérémonies et les distractions de la cour ou dans les demeures aristocratiques. La peinture d’inspiration chinoise (karae) ou japonaise (yamatoe) décore les paravents et les portes coulissantes du palais impérial et des résidences aristocratiques. Les diverses fonctions de la peinture sont analysées ici par Estelle Leggeri-Bauer, notamment la dimension de faste cérémoniel que met en valeur le livre « Les Concours de peintures » du Roman du Genji. La poésie en chinois et en japonais donne lieu, elle aussi, à des rassemblements de caractère cérémoniel, comme ceux qu’évoque, dans son étude, Michel Vieillard-Baron.
La prose en chinois joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’État bureaucratique calqué sur le modèle chinois depuis ses débuts. Les généalogies et les mythes nationaux ou locaux, transmis jusqu’alors par voie orale, ont été compilés et couchés par écrit par Ô no Yasumaro dans les Récits des temps anciens (Kojiki, 708). Avec les Chroniques du Japon (Nihon shoki, 721), suivies par cinq autres histoires réalisées entre 797 et 901, le Japon se dote d’une histoire officielle, à la manière chinoise. Après cette date, la compilation d’historiographies officielles est abandonnée, de même, du reste, que l’envoi d’ambassades en Chine.
Il convient enfin de signaler que la connaissance du chinois comprenait aussi l’étude des écritures bouddhiques, enseignées dans des monastères qui entretenaient des liens étroits avec la cour et l’aristocratie. Les enseignements qui y étaient dispensés ont exercé une profonde influence sur la culture de cour. On peut ainsi citer la figure du moine Kûkai (774-835), introducteur au Japon de l’école ésotérique Shingon, mais aussi auteur d’un premier traité de poétique chinoise. Ou celle, plus tardive, du lettré et fonctionnaire dévot Yoshishige no Yasutane (933-1002), proche du régent Fujiwara no Michinaga, qui fut un des initiateurs des réunions du Kangakukai (Assemblée pour la promotion de l’étude), où moines et laïcs se réunissaient afin de réciter conjointement le Sûtra du Lotus et composer des poèmes en chinois dont l’inspiration bouddhique rejoignait celle du poète chinois Bai Juyi (772-846).
Pensée et croyances bouddhiques imprègnent toute la culture de l’époque de Heian et l’attrait pour la retraite religieuse, fondé sur une prise de conscience de la vanité de la vie dans le monde, est un thème qui traverse de part en part le Roman du Genji. Pratiqué au sein du Tendai, l’amidisme ou croyance en la Terre pure du bodhisattva Amitabha (Amida en japonais), qui a fait le vœu de sauver tous les êtres invoquant son nom, se répandit dans les milieux aristocratiques, notamment sous l’influence de l’ouvrage du moine Genshin (942-1017), le Compendium pour la renaissance dans la Terre pure (Ôjô yôshû, 985). Le monde était censé entrer prochainement dans la période de la « fin de la Loi » (mappô), dans laquelle la prédication de la Loi apportée par le Bouddha historique était si dégradée que le salut n’y était plus guère possible que par la « force d’autrui », en l’occurrence celle du vœu d’Amida. Fujiwara no Michinaga fait construire pour sa retraite le temple Hôjôji, dédié au culte d’Amida, et y meurt avec l’espérance de renaître dans la Terre pure.
Si nous avons insisté sur l’importance de l’élément chinois, c’est qu’il constitue le cœur de la culture de l’époque classique. Il ne s’agit pas pour autant d’exclure la littérature d’expression japonaise. Dès le viie siècle se développe au Japon à côté des lettres chinoises une poésie en langue vernaculaire, le waka (ou yamato-uta, littéralement « chant japonais »). Une partie importante de cette production a été recueillie dans l’Anthologie des Dix mille feuilles (Man.yôshû), dont la dernière compilation date d’environ 780. Dès cette époque, la poésie en japonais, contrairement à la culture chinoise, faisait la part belle aux femmes. Le poète de cour et fonctionnaire Ki no Tsurayuki (866 ?-945 ?) acheva de donner à la poésie japonaise sa forme classique et assura définitivement sa place parmi les activités officielles de la cour, en participant à la compilation de la première anthologie impériale de poésie japonaise, le Recueil des poèmes anciens et modernes (Kokin wakashû). Il en rédigea également la préface en japonais, posant ainsi le début de la réflexion poétique proprement japonaise. La forme longue (chôka), qui avait fleuri au viie et viiie siècle, ne se maintient alors qu’à titre d’archaïsme, laissant toute sa place à la forme courte de 31 syllabes (tanka), fortement codifiée tant du point de vue du vocabulaire que des thèmes traités : saisons, amour, voyage, deuil, séparation, célébrations. Cette poésie en langue vernaculaire remplit une fonction sociale aussi bien que cérémonielle.
Au début du xie siècle, au côté de nombreuses figures féminines, dont beaucoup s’illustrent également en prose, mérite d’être mentionné le nom du poète et poéticien Fujiwara no Kintô (966-1041), auteur de nombreux traités et compilateur du recueil Poèmes japonais et chinois à réciter (Wakan rôeishû), où sont appariés poèmes japonais et fragments de poèmes chinois. Ce recueil, qui devait connaître un immense succès, consacre le double caractère chinois et japonais de la culture de cour, analysé dans l’article d’Ivo Smith. Fukutô Sanae aborde, elle, la part jouée dans la culture féminine par cette double culture poétique.
Malgré sa brièveté, la poésie en japonais (waka), et tout particulièrement la poésie amoureuse, possède également une dimension narrative. Tout poème d’amour – et a fortiori tout échange poétique entre amants – s’inscrit au moins virtuellement dans une histoire, souvent évoquée dans les brèves introductions en prose (kotobagaki) qui précèdent de nombreux poèmes. Cette dimension, déjà présente dans le Man.yôshû, est héritée par les recueils de poésie waka de l’âge classique. Elle est à l’origine de la forme mixte, mélangeant poésie et prose, que sont les récits à poèmes (uta monogatari), dont le plus fameux est le recueil intitulé Contes d’Ise, regroupant de courts récits intégrant un ou plusieurs poèmes. Ce recueil se serait constitué progressivement, sans doute au xe siècle, autour des poèmes et de la figure du poète Ariwara no Narihira (825-880), parangon de raffinement et d’élégance et un des modèles du héros du Roman du Genji.
Au début du xe siècle naît le récit de fiction ou monogatari. Tout en incluant de nombreux éléments merveilleux, il est consacré à la peinture du milieu aristocratique et fait la part belle aux intrigues politiques et amoureuses. Mais, contrairement à la poésie japonaise, il ne possède aucun caractère officiel. Si une trentaine de titres sont connus, très peu d’œuvres ont été conservées. Outre le Conte du Coupeur de bambou, qui comprend encore de nombreux traits hérités du conte, deux œuvres romanesques de la fin du xe siècle nous sont parvenues, Le Roman de l’arbre creux (Utsuho monogatari) et le Roman de la chambre basse (Ochikubo monogatari), qui témoignent du haut degré d’élaboration qu’avait alors acquis le genre romanesque. Le roman est considéré avant tout comme un pur divertissement. Mais, dans la mesure où il intègre la description d’événements de la cour (Roman de l’arbre creux) ou des mœurs domestiques des grandes familles (Roman de l’arbre creux, Roman de la chambre basse), il acquiert le caractère d’une chronique parallèle, ouvrant sur une réflexion politique et morale.
On ne saurait enfin comprendre l’apparition du roman de cour sans mentionner deux autres développements importants : les Mémoires d’une Éphémère (Kagerô no nikki), autobiographie d’une épouse du régent Fujiwara no Kaneie, connue comme la Mère de Michitsuna (936 ?-995), et les Notes de chevet, rédigées par la dame du palais Sei Shônagon (966 ?-1024 ?). Ces deux œuvres marquent le début de la prédominance des femmes dans la littérature vernaculaire. Dans une société aristocratique où les alliances matrimoniales jouent un rôle décisif pour l’acquisition du pouvoir et des richesses, l’éducation des filles, décrite dans l’article de Fukutô Sanae, devient une nécessité. Dans l’entourage des impératrices ou des grandes dames de l’aristocratie se constituent de brillantes sociétés féminines qu’on a pu qualifier de « salons », où la maîtrise de la poésie japonaise et des arts d’agrément sont indispensables. Les Mémoires d’une Éphémère, dont l’auteur évoque sa liaison de vingt ans avec un des plus hauts personnages du temps, innovent par leur écriture aux longues phrases allusives qui mettent au premier plan les impressions plutôt que les faits et qui utilisent toutes les ressources de la syntaxe japonaise. Les Notes de chevet, suite de notations variées sans ordre ni plan, sont célèbres par les listes d’éléments hétéroclites qu’affectionne Sei Shônagon, mais aussi par l’acuité de l’observation et la liberté de jugement dont elle fait preuve dans la peinture de la société de cour de son temps.
Le Roman du Genji
Considéré comme un des sommets de la littérature japonaise, le Roman du Genji naît à la confluence de toutes ses influences à un moment qui correspond à l’apogée de la puissance de la cour et des régents Fujiwara, dans l’entourage immédiat du plus puissant d’entre eux, Fujiwara no Michinaga. Constitué de cinquante-quatre livres, il évoque l’enfance puis les aventures amoureuses et la carrière brillante du Genji, prince impérial réduit à l’état de sujet quoiqu’il présente tous les signes d’une vocation royale, qui sera néanmoins conduit par son talent au sommet de la fortune terrestre en parvenant à faire de sa fille unique une impératrice et en devenant ainsi l’aïeul d’un empereur. Cette brillante réussite politique est doublée d’une trame secrète. Fils d’une favorite impériale prématurément disparue, le Genji a été élevé au palais auprès de son père et de la nouvelle favorite de celui-ci, la dame Fujitsubo, dont il s’éprend. De cet amour interdit et malheureux naîtra un enfant qui montera sur le trône et qui participera à la fortune du héros, tout en lui rappelant sa faute. Comme par rétribution, le Genji vieillissant sera à son tour victime d’un adultère, et deviendra le père putatif d’un enfant qui, en réalité, n’est pas le sien. Cependant, autant qu’homme d’État, le Genji est un amateur de galanterie. Il collectionne les aventures amoureuses tout en restant fidèle à l’image de la femme idéale qu’il a trouvée en la personne de l’inaccessible Fujistubo, et qu’il retrouve encore en celle de dame Murasaki, une parente de cette dernière, qu’il enlève encore jeune et élève auprès de lui pour en faire son épouse. Il finit par l’installer dans un quartier de la somptueuse demeure qu’il fait construire sur la Sixième Avenue pour y réunir ses diverses épouses. Comme elle ne lui donne pas d’enfant, il la charge d’élever sa fille, née d’une liaison qu’il a eue pendant son exil et qui deviendra impératrice. La mort du Genji intervient peu après celle de Murasaki, au 41e livre dont le texte n’a pas été écrit et dont il n’existe que le titre : « L’Occultation dans les nuages ». Le roman se prolonge alors dans les livres dits d’Uji, qui relatent les aventures amoureuses, le plus souvent contrariées, du fils putatif du Genji, Kaoru (le Parfumé), ainsi que de son royal petit-fils le prince Niou (l’Embaumant), et les tourments que leur rivalité inflige à trois sœurs installées dans une résidence à l’écart de la capitale sur la rivière Uji. La troisième, Ukifune (Barque flottante), partagée entre les deux jeunes gens, se jette dans la rivière puis, sauvée des eaux, décide d’entrer en religion et refuse tout contact avec Kaoru, qui cherche à la rencontrer après avoir retrouvé sa trace.
Ce bref résumé du roman ne donne qu’une faible idée de la multiplicité des intrigues et des personnages, rassemblés dans une trame d’une parfaite maîtrise et d’une cohérence sans commune mesure avec les romans précédents, qui permet à l’auteur d’intégrer dans le temps de l’histoire, marqué par la succession des règnes, la multitude des temporalités individuelles. On distingue généralement t