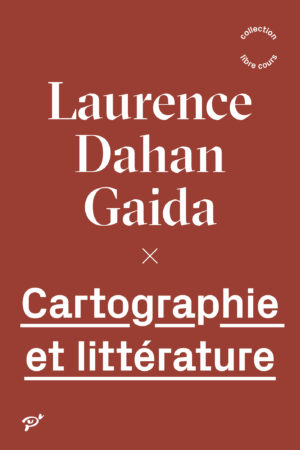Introduction
Il est bien connu que les études portant sur les tournants de siècles souffrent des ruptures consacrées par la chronologie et adoptées par l’université. La période post-révolutionnaire en pâtit sans doute encore plus que les autres, pour des raisons historiques et littéraires. Entre 1789 et 1830, la rupture historique et ses conséquences sont telles que l’analyse littéraire semble déserter le terrain au profit de l’analyse historique. De plus, cette période considérée du point de vue littéraire paraît assez pauvre au regard du siècle des Lumières auquel elle fait suite et du Romantisme qu’elle précède 1. Elle est alors tenue, au mieux, comme une période de transition et, au pire, comme une époque de dégénérescence. Il est difficile, au vu de ces trois phénomènes (rareté de l’analyse critique, importance de l’histoire politique et pauvreté supposée de la production littéraire) de démêler les causes des effets.
À cet égard, l’étude du genre romanesque semble particulièrement problématique. Entre Marivaux et Laclos, d’une part, Stendhal et Balzac, d’autre part, c’est comme si le roman disparaissait. Bien sûr, il y eut Chateaubriand, Senancour ou Benjamin Constant, mais on a quelques réticences à les qualifier de romanciers. Ils sont poètes ou autobiographes et René, Obermann ou Adolphe semblent plus participer d’une sensibilité que d’un genre. Les histoires du roman consacrent quelques pages au début du xixe siècle avant d’entrer dans le vif du sujet avec Stendhal et Balzac 2. Pourtant, à parcourir ces quelques pages, on voit revenir fréquemment certains noms, des noms jusqu’alors peu connus, voire inconnus, mais qui finissent par devenir familiers.
Or ces noms sont des noms de femmes. Non que l’on en dise beaucoup, mais ces quelques lignes, toujours présentes sur les romancières, finissent par rendre curieux. Alors on cherche, on épuise les bibliographies et la récolte est maigre. À tourner autour de cette énigme, les noms reviennent, cités par les plus grands : Chateaubriand, Balzac, Sainte-Beuve… On décide finalement d’aller lire ces mystérieux romans et on ne les trouve pas, ou difficilement : ils sont perdus dans les fonds patrimoniaux de nos bibliothèques, peu d’entre eux ont été réédités depuis la fin du xixe siècle. Cependant, à consulter les dates de leurs rééditions durant la première partie du xixe siècle, on s’aperçoit qu’ils ont été beaucoup lus.
Il apparaît donc, de manière assez évidente, que le roman entre 1789 et 1825 a été marqué par un engouement certain du public pour les productions romanesques féminines. De fait, « jamais le nombre des romancières n’a été aussi élevé qu’aux alentours de 1800 3 ». Il apparaît, de manière tout aussi évidente, que ces romans oubliés relèvent tous d’un genre (ou sous-genre) spécifique : le roman sentimental.
Ce vocable est en usage à l’époque puisqu’en 1791, paraît Werthérie, roman sentimental, un roman épistolaire de Pierre Perrin. En 1819, Pigoreau, dans son Dictionnaire des romans anciens et modernes, destiné aux tenanciers de cabinets de lecture, introduit la catégorie « romans sentimentaux ». C’est sans doute le premier exemple d’un usage taxinomique de l’expression. En 1908, Gustave Reygner consacre le premier ouvrage critique au genre avec Le Roman sentimental avant L’Astrée, qu’il définit comme un texte « dont le caractère distinctif est qu’il attache moins d’importance aux aventures, aux éléments extérieurs de l’action, qu’à l’analyse et à l’expression des sentiments 4. » Pour autant, lorsque Henri Coulet reprend l’expression pour catégoriser certains romans du xviiie siècle, il ne cache pas son caractère approximatif :
Sous cette dénomination, nous rangeons assez arbitrairement des romans qui diffèrent par le sujet et par la forme, mais qui ont pour objet la peinture et l’analyse des sentiments plutôt que la description des mœurs et de la société 5.
Les travaux d’Ellen Constans permettent de mieux appréhender l’objet car elle en propose une analyse théorique. Elle définit trois invariants. D’abord, le roman sentimental développe une fable constituée d’une seule histoire d’amour. Cette condition discrimine, par exemple, roman libertin et roman sentimental. Corollairement, les deux protagonistes de cette fable sont désignés comme éléments d’un couple dès les premières pages et on retrouvera le même couple au dénouement. À ce titre, la scène prototypique de la première rencontre, étudiée par Jean Rousset 6, est un signe fort d’appartenance générique. Par voie de conséquence, les autres personnages deviennent des utilités (au sens théâtral du terme). Le troisième invariant concerne le programme narratif tel qu’il se déroule à partir de la rencontre : disjonction (qui va occuper l’essentiel du volume) puis conjonction finale dans le malheur ou le bonheur 7. Le genre est ainsi défini hors de toute exclusive formelle. Tout comme il n’impose nulle contrainte du point de vue de l’univers de référence. En revanche, cette définition structurelle présente conjointement un système axiologique : l’amour est l’objet du désir et, en conséquence, il est aussi la valeur suprême.
Ellen Constans propose ensuite une périodisation. Dans les chapitres consacrés à la période 1715-1830, qu’elle nomme « l’âge d’or du roman sentimental », elle choisit comme entrée certaines œuvres (Les Lettres portugaises, Manon Lescaut, La Nouvelle Héloïse…), certains auteurs (Mme de Villedieu, Mme de Lafayette, Richardson…), des phénomènes (« l’influence de Richardson ») ou des entrées plus chronologiques (« romans du tournant du siècle »). La dernière entrée concerne « le roman sentimental féminin » 8. Il est consacré aux romancières de la fin du xviiie siècle et du début du xixe siècle. De la même manière, à propos de ce qui s’écrivait et se lisait alors que Stendhal et Balzac fourbissaient leurs premières armes, Margaret Cohen parle de « Sentimental works by women writers » 9. L’expression « romancières sentimentales » tente de rendre compte de cette double dimension du phénomène littéraire posé ici en objet d’étude. La question du genre et celle du gender y sont, de fait, historiquement conjointes.
En 1802, paraît une nouvelle de Mme de Genlis, La Femme auteur, qui illustre le dilemme de l’héroïne, Natalie, condamnée à renoncer au bonheur privé parce qu’elle devient une femme bénéficiant d’une notoriété publique. La condamnation de ce personnage par la voix narrative y est pour le moins suspecte, lorsque cette dernière glorifie, à la fin, le bonheur de Dorothée, la sœur de Natalie :
Elle n’eut point de renommée ; ses aventures ne furent point romanesques ; elle n’inspira point de grande passion ; on l’aima sans emportement, mais avec constance ; son nom, inconnu dans les pays étrangers, ne fut jamais prononcé dans le sien qu’avec estime et vénération ; elle fut utile à ses amis, elle fit le bonheur de sa famille ; tout cela vaut bien un roman : et cette félicité si pure vaut bien la célébrité d’une femme auteur 10.
Ce bonheur, qui n’est que l’envers du malheur de Natalie, et ne se décline qu’en termes négatifs, s’oppose aux pages dans lesquelles est évoqué le bonheur d’écrire de Natalie : « Écrire est pour moi une occupation délicieuse », affirme-t-elle, tandis que la voix narrative déclare : « Quand on écrit avec sincérité, qu’on ne cherche que dans son cœur les sentiments touchants qu’on veut exprimer, il y a dans cette occupation un tel charme, qu’elle peut facilement tenir lieu de bonheur 11 ». De fait, le discours du roman narre les aventures sentimentales de la femme auteur et la pose en héroïne. Quelles que soient les voix qui la condamnent (discours des personnages ou voix narrative) et quel que soit son destin, le lecteur éprouve de l’empathie pour Natalie. Si, au sein de la fiction, elle est le personnage socialement condamné, elle est, axiologiquement, la véritable héroïne. La voix narrative, souvent ambiguë ou ambivalente à l’égard du stéréotype négatif de la femme-auteur, ne saurait se confondre avec le discours du roman qui, condamnant l’héroïne au malheur et la plaçant au premier rang du personnel romanesque, condamne le stéréotype. De sorte que le discours du roman condamne le discours social institué par la fiction.
Est-ce à dire que Mme de Genlis s’inscrit en rupture avec son époque ? Certainement pas. En effet, la femme auteur posée en héroïne dans la nouvelle est une romancière du sentiment qui ne se résout à publier son œuvre que par charité, pour venir en aide à des malheureux, « pour faire une bonne action 12 ». Elle est cette femme auteur que l’époque autorise, apprécie et valorise même. Elle est une « romancière sentimentale » de fiction, qui doit beaucoup à Mme de Genlis elle-même 13.
À propos des écrits des romancières entre 1789 et 1800, Huguette Krief affirme :
L’ampleur du champ littéraire abordé par certaines romancières de la décennie révolutionnaire, la grande disparité des tons et des formes, montrent la mobilité extrême de leur écriture et le plaisir qu’elles éprouvent à manier des esthétiques différentes 14.
Très rapidement, le champ s’est réduit. Puisqu’on ne peut faire taire les femmes, on autorise et valorise la parole sentimentale féminine, ce qui est manière de la circonscrire strictement. En témoigne ce que Fontanes écrivait, en 1800, lors de la parution de l’ouvrage de Mme de Staël, De la littérature :
La littérature, quand elle est cultivée par des femmes, devrait toujours prendre un caractère doux et aimable comme elles. Il semble que leurs succès dans les arts, ainsi que leurs bonheurs dans la vie domestique, dépendent de leur respect pour certaines convenances. On veut, et c’est un hommage de plus qu’on rend à leur sexe, on veut en retrouver tout le charme dans leurs traits et dans leurs discours. À ce prix, leur gloire est assurée si elles montrent quelque talent ; et même après une tentative malheureuse, l’indulgence publique les excuse et les protège. Mais quand une femme paraît sur un théâtre qui n’est pas le sien, les spectateurs, choqués de ce contraste, jugent avec sévérité celle-là même qu’ils auraient environnée de faveurs et d’hommages, si elle n’avait point changé sa place et sa destination 15.
Le discours de Fontanes rend parfaitement compte du statut de la femme de lettres au tournant du siècle. Celle-ci a toute latitude pour écrire tant qu’elle reste sur « le théâtre qui est le sien ». Ce théâtre, c’est le roman sentimental. Ghetto pour les unes, espace de liberté pour d’autres, il constitue le cadre dans lequel peut s’exercer et continuer à s’inventer une forme d’expression féminine. Si elle s’y cantonne, la femme auteur peut aussi y gagner une grande notoriété. La femme auteur de Mme de Genlis est une de ces femmes aimables, qui n’a « point changé sa place et sa destination ».
L’année suivante, Mme de Genlis écrira une autre nouvelle, La Femme philosophe, attaque en règle contre Mme de Staël et Delphine, paru l’année précédente et dont le succès était immense. Relayant les critiques violentes que le roman suscitait, la fiction de Mme de Genlis, intégrant des citations nombreuses de Delphine et des déformations parodiques de De l’influence des passions, fait de l’héroïne une caricature de femme savante 16.
La « femme philosophe » est le négatif de la « femme auteur ». Ce faisant, Mme de Genlis, tout en surenchérissant sur la critique masculine, dénie à Mme de Staël la possibilité de s’inscrire, avec Delphine, dans le même registre que le sien, celui de la femme auteur acceptée. Elle cherche à l’exclure du champ littéraire auquel elle appartient, en faisant de Mme de Staël une « femme philosophe » et donc de Delphine autre chose qu’un roman sentimental, susceptible d’entrer en concurrence avec ses propres romans et nouvelles, au premier rang desquels on placera Mademoiselle de Clermont, parue la même année que Delphine, auréolée d’un immense succès et de louanges venues de tout bord.
La stratégie de Mme de Staël est différente. Dans la préface de Delphine, elle s’inscrit dans une histoire du genre dans laquelle le genre sentimental est au sommet de la hiérarchie : « Les romans que l’on ne cessera jamais d’admirer, Clarisse, Clémentine, Tom Jones, La Nouvelle Héloïse, Werther, etc., ont pour but de révéler ou de retracer une foule de sentiments 17 ». Inscrire Delphine dans cette continuité revient aussi à faire de son auteure l’égale des romanciers masculins cités : Richardson, Rousseau, Fielding ou Goethe. Dans le même temps, Delphine, inscrite dans une histoire générique, déserte ainsi l’espace contemporain dans lequel il prend effectivement place et que la préface ignore.
Lorsque Mme de Genlis fait l’éloge de la femme auteur et conspue la femme philosophe, lorsque Mme de Staël s’inscrit dans une histoire du genre relevant du masculin, elles définissent toutes deux, avec des tempéraments et des armes différents, chacune à sa manière, l’une en plein et l’autre en creux, un espace-temps de l’histoire littéraire auquel elles appartiennent, celui des romancières sentimentales, qui, on l’aura compris, ne faisaient pas toujours dans le sentiment !
Le présent ouvrage se propose de (re)visiter cet espace-temps en donnant à lire les textes qui le constituent et les discours qui l’instituent, en convoquant, comme dans les exemples proposés ici, le discours de la fiction, le discours préfaciel ou le discours critique de l’époque. Ces textes sont donc des romans sentimentaux de femmes, écrits entre 1794 et 1825 et ayant connu un succès remarquable. Mais on ajoutera un dernier élément de définition à l’objet. En effet, il convient de remarquer que ce succès est suivi d’un oubli très rapide et pratiquement total des œuvres et de leurs auteures. En témoigne, à titre d’exemple pris parmi tant d’autres, un article de Gaschon de Molènes, paru en 1842, dans La Revue des deux Mondes, évoquant Mademoiselle Justine de Liron (1832) de Jean- Étienne Delècluze :
Eh bien ! même dans cette histoire d’amour où auraient pu se glisser quelques rayons du jour enchanteur des bosquets de Clarens, de leur molle et mystérieuse clarté, on sent circuler l’air pénétrant et subtil qu’on respire dans Adolphe et dans Obermann.
Pour évoquer un roman sentimental qui, par de nombreux aspects, se rapproche de ceux dont il sera question dans cet ouvrage, sont convoqués Rousseau, Senancour et Benjamin Constant. Nulle mention de ces femmes auteurs, dont les « noms [sont] peu connus ou déjà oubliés, et hors de la grande route battue » comme l’écrivait Sainte-Beuve en 1839 18. La critique masculine d’un roman masculin convoque uniquement des références masculines 19. Pour autant, l’explication phallocratique suffit-elle à comprendre l’oubli et le dédain dans lesquels la postérité a tenu les romancières et leurs œuvres ? Qu’y trouvaient leurs contemporains que nous n’y trouvons plus ? Quel sens le lecteur conférait-il à ces textes que l’histoire littéraire a si vite réputés illisibles ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles on tentera de répondre ici.
Dès lors, l’histoire littéraire à laquelle ce livre voudrait contribuer est tout autant une histoire des textes et des auteurs qu’une histoire des lecteurs et des lectures, une histoire qui s’intéresse au « lecteur ordinaire » :
Sans ces lecteurs-là, nous ne comprendrions pas, pour l’essentiel, l’histoire des genres littéraires, le destin de la « bonne » et de la « mauvaise littérature », la persistance ou le déclin de certains modèles ou paradigmes 20.
Lorsque l’on considère « la littérature elle-même comme témoin principal des suggestions qu’elle a reçues de l’esprit public 21 », l’objet d’étude le plus approprié est indéniablement le livre à succès « qui exprime ce que le groupe attendait, qui révèle le groupe à lui-même 22 ». Romancières sentimentales s’intéresse ainsi à cet « esprit public », à ce que les romans sentimentaux féminins oubliés révèlent des lecteurs qui les ont dévorés et admirés. Dans cette perspective, il participe d’une histoire culturelle, d’une histoire des sensibilités et des mentalités 23 et il donne à lire les romans en essayant de reconstruire l’espace – essentiellement discursif – dans lequel les textes s’inscrivent.
Sophie Cottin était, à cette époque, une des plus célèbres et assurément la plus lue de ces romancières 24. Alors qu’elle était en train d’écrire Mathilde, en 1805, elle affirme dans sa correspondance : « La religion ébranlée a besoin d’être prêchée dans toutes les langues, et celle du roman est aujourd’hui la plus générale 25 ». Cette « langue du roman » constitue l’objet de cette recherche, la langue du roman telle qu’elle s’écrivait et se comprenait, la langue oubliée d’une époque-charnière. Si le roman est une langue, alors le chercheur qui l’étudie est un linguiste. Aussi, et pour en terminer avec cette analogie, seront ici convoquées une linguistique de l’énoncé et une linguistique de l’énonciation. Autrement dit, cet ouvrage donne à lire les textes mais toujours en référence au contexte dans lesquels ils s’énoncent et qui les éclaire. C’est donc à une immersion dans le passé que le lecteur est ici convié, qui privilégie d’abord la mise en relation des textes et des discours de l’époque. Ce faisant, on tente de se dégager d’une lecture qu’informent massivement les codes réalistes 26, on s’essaie à une réception de ces romans qui ignorerait la suite de l’histoire, à l’instar de celle des lecteurs de l’époque qui ont le sentiment que les possibilités offertes par le genre romanesque s’épuisent. Ainsi, dans « Les Promenades d’un fou », sorte de billet d’humeur qui paraît en 1800 dans La Décade Philosophique, l’auteur dit à un jeune romancier : « Tout est épuisé : les actions de l’homme ont été recueillies ou devinées par les romanciers, ils ont raconté de leurs héros tout ce que vous raconterez des vôtres 27. » Aux alentours de 1820, Sismondi écrit à Madame de Souza :
Il me semble […] que le genre même du roman commence à s’épuiser et en effet on doit s’étonner d’en voir si peu paraître aujourd’hui ; non seulement de bons, mais même de médiocres ou de mauvais. […] Chaque nouvel écrivain cherche à exploiter un filon nouveau et c’est bien l’indication que la mine principale est épuisée28.
Il s’agit donc de tenter de lire les romans que l’on lisait durant les premières décennies du xixe siècle, en faisant comme si Balzac et Stendhal n’avaient rien publié, en faisant comme si on ne savait pas tout ce que le roman serait au siècle naissant.
On comprendra donc que l’objectif de cet ouvrage n’est pas prioritairement de réhabiliter une littérature que l’on aurait injustement oubliée. Il s’agit d’abord de participer au comblement d’un vide relatif. Lorsque Michel Delon écrit, à propos des personnages créés par les romancières sentimentales : « Il faut donner leur juste place aux aspirations de Claire d’Albe et d’Adèle de Sénanges [sic] 29, aux combats de Delphine et de Corinne. Elles ont contribué à faire le roman moderne et la société nouvelle 30 », la formule finale est forte. Pourtant, la « juste place » accordée aux personnages comme aux romancières tient, dans l’ouvrage cité, en une demi-page.
Il s’agit dans le même temps de contribuer à une nouvelle histoire littéraire, celle rêvée par Henri Mitterand :
On rêve d’une histoire de la littérature qui apporterait pour toute époque charnière […] une analyse globale de ce qui se disait, de ce qui s’écrivait, dans l’arrière-texte des grands textes. Ce serait là une véritable sociocritique, la sociocritique des totalités, ou du moins des intertextualités. Seule elle permettrait de saisir les corrélations qui donnent à chaque œuvre prise à part sa profondeur originale, et qui dessinent le paysage intellectuel d’un temps 31.
En effet, on aimerait, au tournant des xviiie et xixe siècles, à l’aube de l’avènement du roman moderne réaliste, à l’époque où Balzac, Stendhal ou Hugo apparaissent, saisir une partie « de ce qui se disait, de ce qui s’écrivait », faire émerger ce qui participait d’une doxa littéraire, chercher à quelles « questions » les textes étudiés et lus avec ferveur apportaient des « réponses » suivant la terminologie de Jauss, tout en sachant que « les textes non canoniques sont des fragments de solutions égarées, ou des réponses à des questions que nous n’entendons plus 32 », étudier « l’appel et la réponse [car] ce sont les passions des hommes vivant en société et des groupes qu’ils composent qui fournissent à la littérature ses tâches et son aliment 33 ».
S’inscrire dans cette « sociocritique des totalités », c’est proposer de l’analyse des œuvres réputées mineures une approche qui n’est plus seulement fondée sur une simple curiosité – au demeurant légitime et source de plaisirs vifs. L’objectif est sans doute plus ambitieux quant à ses enjeux, mais aussi peut-être plus modeste parce qu’il n’a réellement de sens qu’associé à d’autres travaux. Pierre Bourdieu a posé les bases et défini le sens de cette approche :
L’analyste qui ne connaît du passé que les auteurs que l’histoire littéraire a reconnus comme dignes d’être conservés se voue à une forme intrinsèquement vicieuse de compréhension et d’explication : il ne peut qu’enregistrer, à son insu, les effets que ces auteurs ignorés de lui ont exercés, selon la logique de l’action et de la réaction, sur les auteurs qu’il prétend interpréter et qui, par leur refus actif, ont contribué à leur disparition ; il s’interdit par là de comprendre vraiment tout ce qui, dans l’œuvre même des survivants, est, comme leur refus, le produit indirect de l’existence et de l’action des auteurs disparus 34.
L’entreprise relève bien d’une lecture fortement inspirée par les théories de Bourd