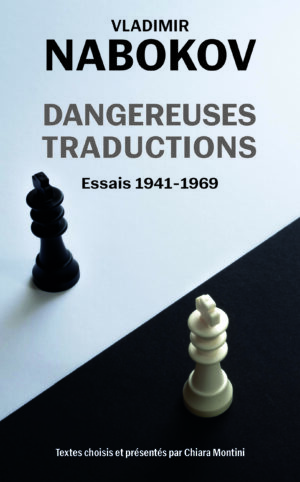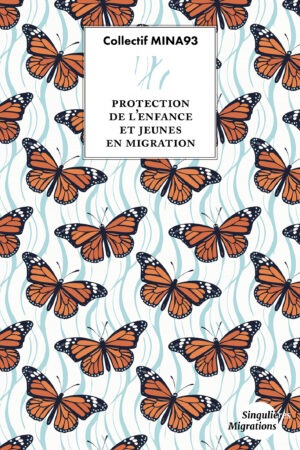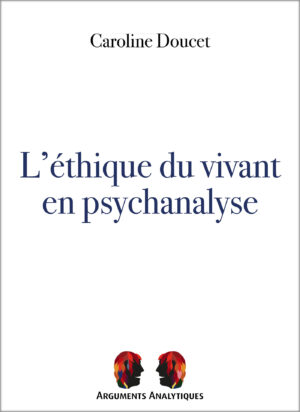Rencontres en contexte (post)colonial
À propos d’Eli, Abdou, Aris, Bineta, Marie et Aya
« Nous sommes les pions d’un jeu de dames », assène Eli O. un jour d’hiver de l’année 2017, à Rabat. Nous sommes en pleine discussion à la maison, où il a l’habitude de venir pour passer le temps ensemble. Eli est alors un jeune Camerounais de 24 ans. Nous nous sommes rencontré·es dès mes premiers mois au Maroc, en 2015. Il était l’ami de Justin L., un artiste congolais qui venait souvent travailler dans le petit studio d’enregistrement de musique situé dans un riad de la médina où je louais moi-même une chambre. Au fil du temps, Eli et moi nous sommes lié·es d’amitié et il est devenu l’un des principaux informateurs de ma recherche. Son parcours depuis le Cameroun – il a fui des persécutions en tant que Pygmée, puis a déserté l’armée avant de traverser plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, et l’Algérie – et ses cinq années de vie au Maroc en font une source intarissable d’informations, d’anecdotes, de savoirs sur le contexte que je tente alors de comprendre. Quand Eli, qui parle beaucoup par métaphores, me lance la phrase ci-dessus, nous sommes en train de parler de la situation des migrant·es dit·es subsaharien·nes à Nador, une ville marocaine voisine de l’enclave de Melilla. Il raconte :
Parfois, nous étions fatigués, nous restions plusieurs jours, parfois plusieurs semaines dans les campements en forêt sans faire une seule tentative à la barrière. Je me souviens que, de temps à autre, les militaires venaient nous trouver là-bas et nous disaient : « Mais qu’est-ce qu’il se passe les gars, vous êtes fatigués ou quoi ? Il faut aller à la barrière ! » Ces mêmes militaires qui d’habitude nous pourchassaient, nous tabassaient quand nous faisions des tentatives, là, ils nous incitaient. Elsa, tu sais, nous sommes les pions d’un jeu de dames !
Eli utilise cette image pour illustrer la façon dont est gérée, avec de multiples intérêts politiques, diplomatiques et économiques, la frontière maroco-espagnole. Les pions se réfèrent aux migrant·es labellisé·es « subsaharien·nes » qui sont devenu·es à la fois objets de rejet et de convoitise à la frontière, ainsi qu’un levier diplomatique et une manne financière importante à bien des égards, pour de multiples protagonistes. Eli fonde cette analyse sur les quatre années qu’il a passé aux frontières, à tenter de franchir les barrières de Ceuta et Melilla. Il a même fait « boza » plusieurs fois à Melilla, mais a systématiquement été refoulé par la Guardia civil, en collaboration avec les militaires marocains. L’expression « boza », forgée par des ressortissant·es d’Afrique de l’Ouest et qui proviendrait du wolof ou du bambara, selon diverses explications, signifie la réussite du passage de la frontière. Après le massacre de Tarajal, en 2014 (cf. Chapitre 1), Eli s’est replié à Rabat en tant que demandeur d’asile, puis comme réfugié, en interaction permanente avec les organisations internationales et une multitude d’associations. Les savoirs des premier·es concerné·es comme Eli ont été indispensables pour décrypter le mille-feuille des enjeux et intérêts cristallisés dans la militarisation de cette frontière, au-delà des discours officiels. La première année de mon enquête, je m’entretiens surtout avec des hommes. Après Eli, je fais la connaissance d’Abdou Z., un exilé politique ivoirien arrivé au Maroc en 2011.
C’est par l’entremise d’un collègue du Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (Gadem) que nous nous rencontrons. Étant donné notre écart d’âge – il a alors une quarantaine d’années –, il m’appelle Pehi sœur. Avant le Maroc, Abdou a eu des tas de vies : du monde des boîtes de nuit à Abidjan, au business du café ; il a aussi été haut conseiller en politique et c’est un militant panafricain. Demandeur d’asile au Maroc, il s’est très vite impliqué, au quotidien, dans l’aide de ses « frères et sœurs migrants », malgré sa propre précarité, et a fondé une association, Africa Unite. En 2016, je suis en poste dans l’organisation non gouvernementale (ONG) Caritas en tant que chargée d’études. Devant mener une enquête de grande ampleur sur « l’accès des migrant·es aux services publics », j’ai besoin de collaborateurs et propose alors à Abdou de venir travailler avec moi en tant qu’enquêteur. Une fois embauché, Abdou accomplit un travail colossal. Nous ne serions jamais parvenu·es à passer les cinq cents questionnaires prévus auprès des personnes ciblées sans lui. Les migrant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest lui font confiance – plus âgé que la moyenne, tout le monde l’appelle respectueusement Vieux-Père – et il connaît bien le terrain. C’est pour cela que Caritas lui proposera de nouvelles fonctions par la suite. Les mois passant, Abdou devient indispensable à cette organisation. En effet, sa position de migrant lui-même, son altruisme, ses compétences d’analyses sociales et politiques font de lui une sorte de mentor pour l’ONG. Il n’en reste pas moins qu’Abdou n’est pas dupe du système humanitaire et des rapports de pouvoir qui le traversent. Sa dédication est alimentée par sa solidarité envers les ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest, qui souffrent de la précarité et de la répression sécuritaire qui les cible, dans le cadre de la lutte contre l’immigration vers l’Europe. Mais des personnes qui n’envisagent pas la traversée vivent aussi la violence dans leur chair. C’est le cas d’Aris K., un ressortissant sénégalais rencontré fin 2015 à Rabat.
Quand je fais sa connaissance, Aris, alors âgé de 34 ans, réside au Maroc depuis six années. Venu depuis Dakar, à la suite de sa grande sœur qui l’avait convaincu que les conditions d’emploi étaient meilleures qu’au Sénégal, il travaille à l’époque dans un centre d’appels, service délocalisé de la compagnie française d’assurances AXA. Les compétences linguistiques d’Aris en français – qu’il parle « comme un Parisien », selon les avis de ses compatriotes – ont constitué un atout important pour obtenir des postes dans les méga-centres d’appels de Casablanca et Rabat. Les Sénégalais·es, qui parlent un français à l’accent souvent moins marqué que les Marocain·es – d’après ce que l’on m’explique –, sont nombreux et nombreuses dans ces plateformes où des milliers de travailleurs et travailleuses performent leurs qualités de conseiller·es clientèle, tout en devant prétendre être basé·es en France (ou ailleurs en Europe). C’est aussi du fait d’accords bilatéraux entre le Sénégal et le Maroc qu’il est plus aisé pour les Sénégalais·es d’obtenir un titre de séjour et de travailler dans le Royaume. Aris, lui, n’a pas tenu plus d’un an dans la même entreprise. Les semaines de travail de 50 heures payées au rabais, la pression aux résultats, les pauses déjeuner chronométrées qui ne permettent pas de manger correctement, le plafond de verre qui empêche d’être promu ou augmenté, car il est Noir et étranger, et le racisme formulé de certain·es collègues le font régulièrement craquer. Le reste du temps, il y a la vie enfermée dans des appartements en colocation décrépis et pourtant payés au prix fort, du fait de propriétaires pratiquant des tarifs discriminatoires. Aris, comme beaucoup de ses compatriotes, reste beaucoup chez lui quand il n’est pas au travail. Il porte des grigris de protection pour survivre aux agressions qu’il a déjà vécues et pourrait vivre encore dans les rues des grandes villes marocaines. Des amis à lui sont morts, comme l’étudiant Charles Ndour, assassiné en 2014 à Tanger dans des conditions non élucidées, lors d’une opération policière anti-immigré·es. Alors il sort peu, seulement pour trouver à manger et échanger quelques mots avec des compatriotes sénégalais·es qui vendent des produits à l’étalage, devant la médina de Rabat. Aris se sent bloqué. Il ne veut pas rester au Maroc, n’a jamais envisagé d’aller en Europe – car pour lui, son avenir est en Afrique –, mais ne veut pas retourner au Sénégal si c’est pour « galérer ». Ses maigres salaires ne lui permettent jamais d’économiser. Il travaille pour payer son loyer, ses tacos et ses thieps, fumer des joints dans sa chambre en écoutant du reggae, et quand il a le temps et qu’il est inspiré, faire ce qu’il aime le plus : slamer (voir l’un de ses slams reproduit en fin d’ouvrage) ou dessiner. Rencontrer Aris me permet de comprendre que les expériences des personnes qui tentent les traversées vers l’Espagne et celles des travailleurs et travailleuses de centres d’appels sont très proches. Et nombre de personnes passent de l’un à l’autre de ces groupes.
Faire un terrain long permet peut-être plus aisément d’enquêter « avec » et non « sur » les personnes. Dans mes relations d’enquête, je me suis souvent laissée être affectée (Favret-Saada, 1990) et, à certains moments, je me suis engagée au-delà des enjeux de la recherche. J’ai parfois cohabité avec des enquêté·es et j’ai souvent dépanné les plus fauché·es en dirhams. Parmi les personnes violentées aux frontières, certaines attendaient de moi une contribution à leur quête de justice, quant aux exactions qu’elles et ils vivaient. Dans ces cas-là, je leur montrais par exemple les rapports ou les communiqués de presse qui étaient nourris de leurs récits et analyses. D’autres, plus désabusé·es des possibilités de rompre avec l’impunité des violences, attendaient plutôt une aide concrète de ma part pour s’en extraire, c’est-à-dire pour passer la frontière maroco-espagnole. Face aux demandes impossibles, il fallait composer. L’empathie prononcée et l’engagement militant étaient en général valorisés. D’autres personnes n’attendaient rien de moi, mais voulaient que leur voix soit entendue. C’est le cas de Bineta T., une Sénégalaise rencontrée dans les forêts de Nador en 2016, alors âgée de 19 ans.
Bineta fait partie de ces rencontres décisives qui per-mettent de percevoir, tout d’un coup, une nouvelle dimension sociale de la situation étudiée. C’est grâce à elle que j’ai commencé à appréhender les expériences des femmes d’Afrique centrale et de l’Ouest en quête de traversée, et entrevoir ce que ces actrices pouvaient m’apprendre du contrôle migratoire en place.
– Elsa : Depuis deux ans que je suis là, je n’ai pas beaucoup eu l’occasion de parler avec des femmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Toi, tu en penses quoi ?
– Bineta : À mon avis, elles ont peur. Parce qu’à chaque fois, on nous dit : « Non, surtout évite, ils vont mettre ta photo quelque part. » Donc on se cache. D’autres aussi ne veulent pas, tout simplement.
– Elsa : Et pourquoi tu penses que les hommes veulent bien ?
– Bineta : Oh bon, parce que tu es Blanche, donc quand ils te voient à mon avis, bon… Quand ils te parlent, ils ont l’espoir, ils se disent : « Peut-être, je vais sortir avec elle, elle va m’aider à traverser. » Du coup, c’est facile avec les hommes. C’est à cause de ça.
– Elsa : Ah oui, donc les femmes, elles n’ont pas cette illusion-là…
– Bineta : (Rires) Oui voilà, tu as compris. Elles, elles se disent : « Bon, c’est son travail, donc ça ne me rapporte rien », voilà. Mais le gars, lui, il pense qu’il y aura un truc. Vous êtes potes, il se dit : « Pourquoi pas, elle va m’aider à partir. » Avec eux c’est facile comme bonjour, tu lui demandes de discuter, il te dit : « Avec plaisir. »
– Elsa : Ah oui, c’est peut-être pour ça que j’ai pu parler avec beaucoup d’hommes…
– Bineta : (Rires) Oui voilà, c’est à cause de ça !
– Elsa : Mais toi, tu penses que c’est important qu’on entende aussi la voix des femmes sur ce qui se passe aux frontières ?
– Bineta : Ouais ouais, c’est très important. On ne vit pas les mêmes choses. [Entretien avec Bineta T., Rabat, 2017]
Bineta est arrivée au Maroc à l’âge de 17 ans, grâce à un arrangement organisé depuis le Sénégal par un homme marocain. Des Ouest-Africaines sont fréquemment recrutées ainsi pour répondre aux demandes en termes de personnel de maison pour des familles marocaines aisées. La jeune femme rêvait de pouvoir faire des études – ce que lui refusait son père au pays –, de trouver un bon travail et de mener une vie sereine. Après un long voyage en voiture à travers la Mauritanie et le Sahara Occidental, elle se retrouve à Fès, employée comme travailleuse domestique dans une famille marocaine. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Elle est exploitée au travail, violentée et enfermée pendant deux ans dans la maison. Elle parvient ensuite à fuir. Elle décide alors de tenter sa chance à la frontière pour quitter le Maroc et aller en Europe. C’est ainsi que je la croise dans le campement nommé Bolingo, dans les forêts de Nador, fin 2016. Après trois mois éprouvants sur place et des tentatives de traversée infructueuses, elle retourne dans la capitale. Quand je retrouve Bineta en mars 2017 à Rabat, elle travaille à nouveau dans une famille, mais dans laquelle elle se sent respectée. Néanmoins, son projet reste celui de partir en Europe, car rester au Maroc n’est pas une possibilité pour elle. D’une part, car elle ne souhaite pas continuer le travail domestique, ni recourir au travail du sexe ou à d’autres types d’arrangements économico-sexuels qui lui sont fréquemment proposés – seules options, selon elle, pour les femmes dans sa situation. D’autre part, le racisme et l’impunité des exactions commises à l’encontre des ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest au Maroc constituent pour elle les motifs impérieux de poursuite de sa migration.
Parce que les femmes vivent des violences racistes et sexistes, et notamment sexuelles, ayant des conséquences matérielles immédiates – comme le fait d’être enceinte –, mon implication, dans des modalités très variables, a souvent été attendue, voire suggérée. Des tactiques de survie, voire de mobilité, ont parfois été élaborées autour de la chercheuse que je suis. Pour sortir d’une vision binaire enquêtrice Blanche versus enquêtée Noire, les cas de ce que j’appelle « accord tacite d’utilité mutuelle » aident à percevoir aussi l’agentivité de ces dernières, et à rompre avec une vision d’elles comme passives/contraintes dans la relation d’enquête. Le cas de ma relation avec Marie B., Libérienne de 26 ans, en est un exemple.
Marie a quitté le Liberia en 2017, enceinte de plusieurs mois. Elle n’avait pourtant pas fini ses études de comptabilité à l’université de Monrovia, mais elle craignait alors les réactions de sa famille quant à sa grossesse contractée hors mariage. Marie fait des demandes de visas européens qui n’aboutissent pas. Son petit copain l’encourage alors à partir au Maroc pour tenter la traversée vers l’Espagne. Elle prend l’avion pour Casablanca et arrive très vite dans les campements situés dans les forêts frontalières de Melilla. C’est ainsi que je rencontre Marie à la maternité de Nador en juin 2017, quelques jours avant son accouchement. Après plusieurs semaines d’interactions avec elle dans le cadre de mes visites à l’hôpital, et aussi du temps passé ensemble dans une ONG où je suis bénévole et où elle est hébergée, Marie décide de me nommer marraine de son nouveau-né, Tom. Faire de moi la marraine de son enfant permet à Marie – qui ne reçoit pas d’aide de sa famille, pourtant relativement aisée à Monrovia – de me demander de temps en temps une contribution financière, pour « fêter l’anniversaire du petit » ou lorsqu’elle n’arrive pas à payer son loyer. J’accepte ces règles du jeu édictées par Marie, en retour de mon invitation à ce qu’elle participe à ma recherche. Il s’agit d’un accord tacite entre elle et moi, qui nous permet toutes deux d’aller de l’avant dans nos projets respectifs – sans résoudre nullement l’asymétrie des possibilités de chacune dans cette relation. Me nommer marraine de son enfant implique aussi que notre relation perdure dans le temps, au-delà de cette recherche. Comme Bineta, Marie m’en apprend beaucoup sur la dimension genrée de la situation aux frontières et sur la pluralité des instances productrices de la violence. Grâce à elle, et à d’autres, je comprends que les rapports de genre façonnent tant les pratiques de contrôle que leurs effets sur les personnes en quête de passage et leurs modalités de résistance. Une autre des protagonistes principales de cet ouvrage est Aya C., rencontrée à la même époque que Marie, à la maternité de Nador.
Aya a 19 ans lorsque je fais sa connaissance à l’été 2017. Elle est malienne mais est née en Côte d’Ivoire, d’une famille d’exilé·es malien·nes ayant fui un contexte de guerre. C’est très jeune qu’elle prend la route, seule, pour fuir des conditions de vie difficiles et chercher où construire son avenir, avec un lourd secret, celui de ses questionnements sur son genre et son orientation sexuelle. Aya vit de longues périodes en forêt à Nador, dans l’espoir de monter dans une embarcation qui traverse la Méditerranée et l’amène en Europe. Mais cela ne se produit pas. Dans les moments les plus durs, et notamment après la naissance d’un premier enfant qu’elle ne désirait pas, elle se pose à Rabat pour reprendre des forces, avant de retenter sa chance à la frontière. Notre communication n’a jamais pu être fluide, faute de maîtriser une langue commune. Mais cela ne nous a pas empêchées de tisser des liens. Comme Bineta et Marie, Aya m’a fait prendre conscience des blessures particulières affectant les corps et les esprits des femmes autour de la frontière, mais aussi de leur capacité d’agir, malgré les maigres possibilités de résistance (cf. Chapitre 4).
Une myriade de voix fonde les descriptions et les analyses portées dans ce livre. C’est notamment à travers les yeux d’Eli O., Bineta T., Aris K., Aya C., Abdou Z. et Marie B., mais aussi ceux de dizaines d’autres personnes, que la situation, et notamment la violence à ces frontières, est disséquée. Pour comprendre en profondeur l’actualité du contrôle migratoire autour de Ceuta et Melilla, il faut aussi replacer d’emblée ces territoires coloniaux dans leur contexte et leur historicité (Tyszler, 2019). Je le fais ici à grands traits – quelques approfondissements se trouvent en fin d’ouvrage, section « Pour aller plus loin ».
Des conquêtes de Ceuta et Melilla à la lutte contre l’immigration vers l’Europe
Il est essentiel de revenir sur l’histoire des territoires de Sebta et Mliliya – leurs noms marocains – pour percevoir la colonialité du contrôle migratoire qui y est mis en œuvre aujourd’hui. La genèse de ces frontières, qui commence au xve siècle, amène à les penser d’abord en tant que balises raciales. Je m’inspire des travaux du sociologue péruvien Aníbal Quijano (2007) sur la colonialité du pouvoir pour démontrer qu’il y a, à la frontière maroco-espagnole, une situation coloniale de longue date, et que ce qui s’y passe aujourd’hui tient au moins en partie à cette situation coloniale. Par « colonialité du pouvoir », Quijano entend l’entreprise de racialisation du monde et de hiérarchisation de l’humanité par l’Occident, depuis 1492 et les premières conquêtes de « l’Amérique », et qui perdure jusqu’à aujour-d’hui. L’enquête menée autour de Ceuta et Melilla montre, de façon concrète, comment des dispositifs et des imaginaires coloniaux sont réactivés dans les pratiques contemporaines de défense de la frontière. De la Reconquista et des guerres coloniales contre un ennemi musulman à la répression de personnes migrantes illégalisées, différents processus de racialisation sont cristallisés dans les pratiques de contrôle aux frontières.
Les conquêtes de Sebta et Mlilya se produisent dans le cadre de la continuation de la lutte contre l’islam et de la Reconquista de la péninsule ibérique. Les Portugais occupent Sebta/Ceuta en 1415. Mlilya/Melilla est conquise en 1497 et devient la première frontera espagnole. À cette époque, le terme frontera désigne une place militaire avancée en territoire ennemi (Zurlo, 2005). Les conquêtes de ces territoires ne sont pas pensées comme coloniales au départ, mais elles annoncent bien le début de l’ère du colonialisme. Rapidement, les Espagnols et les Portugais sont confrontés aux résistances des populations autochtones : les Rifains, et ne parviennent pas à occuper l’arrière-pays. Ceuta et Melilla sont ensuite qualifiées de presidios, un terme qui désigne la prison, les deux enclaves acquérant très tôt cette fonction. En 1889, Ceuta devient officiellement une prison coloniale où sont enfermés les dissidents espagnols de l’ordre colonial, mais aussi des territoires américains, comme les bannis de Cuba, et notamment les esclaves hommes Noirs libérés (Sánchez, 2018). Hormis quelques exceptions de catégories d’indigènes utiles à l’armée ou au commerce espagnol, la population musulmane, elle, est bannie des enclaves jusqu’à la fin du xixe siècle.
Au cours des siècles d’occupation espagnole, la place des militaires est importante à Ceuta et Melilla. Avec l’apparition des officiers africanistas – dont le plus célèbre est Francisco Franco, le futur dictateur espagnol –, une nouvelle génération de soldats trouve dans l’action coloniale sa raison d’être et fait pression sur le pouvoir politique pour poursuivre la pénétration militaire du Maroc (Aziza, 2012 ; Fernández Parrilla et Cañete, 2019). Ceuta et Melilla deviennent les véritables têtes de pont de la pénétration coloniale espagnole, qui débute par une guerre meurtrière contre la résistance d’Abdelkrim El Khattabi, figure du mouvement rifain. En 1921, à Annoual, près de Melilla, une défaite espagnole aurait fait, selon les sources, entre 9 000 et 13 000 morts dans les rangs espagnols – les chiffres restant méconnus côté rifain. Le « désastre d’Annoual » suscite un « syndrome de la vengeance compulsive » (Balfour, 2002) au sein de l’armée espagnole d’Afrique, qui se traduit par son obsession pour le castigo (punition) du moro rebelde (maure rebelle) lors de la contre-offensive espagnole dans le Rif. Après plusieurs guerres sanglantes et une alliance franco-espagnole contre la résistance rifaine – notamment dans la guerre du Rif (1921 et 1926), au cours de laquelle des armes chimiques sont utilisées (Charqi, 2014) –, un double protectorat espagnol et français est établi au Maroc. Ceuta et Melilla sont progressivement peuplées de civils originaires de la péninsule espagnole et de l’arrière-pays marocain. Après l’indépendance du Maroc en 1956, les deux villes restent sous contrôle espagnol et ce, jusqu’à aujourd’hui.
En constante augmentation, la population d’origine marocaine suscite encore les craintes de certain·es autour de la perte d’« espagnolité » des enclaves. Une ségrégation sociale et spatiale, et des discriminations à tous les niveaux, y perdurent et sont régulièrement dénoncées par les résident·es musulman·es. La condition des résident·es musulman·es démontre la colonialité du pouvoir régissant encore les deux villes. En outre, ce pouvoir organise progres-sivement un contrôle accru des circulations à ses frontières, y compris envers les Rifain·es des régions voisin·es.
Pendant près de quarante ans, le statu quo étant respecté entre le Maroc et l’Espagne, et le statut des deux villes restant inchangé, une certaine « coexistence » semble établie entre les deux pays, autour des enclaves. En 1991, les deux royaumes signent un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération. Mais en 1995, dans le cadre de l’achèvement de l’organisation administrative et politique de l’État espagnol, un statut d’autonomie est accordé à Ceuta et Melilla qui deviennent alors des « communes autonomes » (Comunidades Autónomas). Avec ce nouveau statut, l’Espagne cherche, selon l’opinion marocaine, à les intégrer pleinement à son territoire national pour empêcher toute revendication du Maroc. Aujourd’hui encore, côté marocain, Ceuta et Melilla restent officiellement considérées comme des « présides occupés ».
Si la menace « musulmane », ou « marocaine », continue d’être brandie depuis les enclaves, une nouvelle figure d’envahisseur a été érigée à partir des années 1990 : celle du migrant en provenance de l’Afrique dite subsaharienne « assaillant » Ceuta et Melilla. Les images d’îlots occidentaux, d’« espaces blancs » (Anderson, 2015) en danger sont utilisées par les autorités. Si cette pensée s’inscrit dans la continuité de la menace d’invasion par des migrant·es des Suds qui circule globalement et alimente les politiques anti-migratoires dans le contexte européen (Huysmans, 2006 ; Bigo, 2008) et ailleurs – en Israël par exemple (Havkin, 2017) –, l’analyse des cas de Ceuta et Melilla souligne combien elle s’inscrit dans des histoires coloniales à la fois singulières et globales (Havkin et Tyszler, 2019). La production d’une figure Noire et masculine du danger migratoire réactive une défense violente de ces territoires coloniaux, dans le cadre plus large de l’obsession sécuritaire européenne contre la migration dite clandestine et de son externalisation vers l’Afrique (cf. section « Pour aller plus loin »).
Les arrivées des personnes d’Afrique centrale et de l’Ouest aux frontières de Ceuta et Melilla sont concomitantes de l’instauration du régime des visas pour accéder aux pays européens, et donc de difficultés croissantes pour se rendre légalement en Europe. Sur place, ces arrivées sont d’emblée violemment réprimées. Jugées préoccupantes par l’Espagne et ses homologues européens, les autorités espagnoles – quelle que soit la couleur du parti politique au pouvoir – ont cherché à améliorer l’imperméabilité de ces espaces frontaliers en érigeant des obstacles de plus en plus hauts, et ont multiplié les dispositifs matériels et humains de contrôle et de surveillance. C’est ce qu’illustre l’évolution du dispositif des barrières de Melilla. À la fin de la guerre d’Afrique (1860), et en particulier pendant le protectorat espagnol (1912-1956), les frontières de Ceuta et Melilla sont perméables. Cette situation se poursuit après la fin du protectorat et jusqu’au début des années 1990.
C’est à la suite de l’adoption de la loi sur les étrangers, en 1985, et son adhésion en 1991 au traité de Schengen, que l’Espagne commence réellement à mener une politique de fermeture croissante de ses frontières et qu’elle amorce la construction des barrières. Le directeur du Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla – ancien haut gradé de la Guardia civil – rencontré en 2015 explique : « À par-tir de 1991-1992, arrivent les migrants subsahariens, c’est-à-dire au moment où les anciens pays colonisateurs bloquent l’accès à l’Europe, via la généralisation des visas. La première barrière à Melilla est ainsi construite en 1997. » Plus tard, « quand la grande immigration est arrivée, un peu avant 2005, a été mise en place une barrière double de trois mètres avec du barbelé à lames tranchantes, mais les migrants la cassaient chaque jour. Ensuite, elle est montée à six mètres. » En 2007, une troisième barrière est construite. Mais le renforcement des dispositifs n’empêche pas les personnes de continuer à tenter de franchir la frontière et d’y parvenir parfois.
Comme ce sont de vrais athlètes, ils ont réussi à passer les trois barrières en une minute. Il a alors été décidé d’installer un grillage « anti-grimpe » sur les barrières, c’est-à-dire qui ne laisse même pas passer les doigts. C’est là que les migrants ont inventé des outils comme les crochets pour les mains ou les chaussures cloutées pour monter la barrière. Nous les avons neutralisés avec une plaque micro-perforée qui ne laisse passer que l’air et qui a été apposée dans les endroits les plus vulnérables. [Entretien avec le colonel de la Guardia civil en fonction, Melilla, pour Gadem et al., 2015]
Les propos du colonel ci-dessus informent de la façon dont l’ingénierie militaro-sécuritaire s’adapte à chaque nouvelle tactique de contournement déployée par les personnes tentant de franchir la frontière. Ils révèlent l’ingéniosité développée par ces dernières, qui élaborent continuellement de nouvelles techniques pour arracher leur liberté de mouvement. En 2015, quand je commence mon enquête, la barrière de Melilla est quadruple. Elle est donc composée d’une triple barrière espagnole, et encore renforcée d’une barrière marocaine qui a été construite à partir de 2014.
En 2020, la barrière espagnole de Melilla atteint dix mètres, devenant le mur de séparation frontalière le plus haut du monde. Si la hauteur est un élément important de l’obstacle érigé, une autre donnée doit être mise en exergue : des portes situées dans les barrières sont utilisées pour opérer les refoulements immédiats vers le Maroc, les dénommés « refoulements à chaud » (devoluciones en caliente, en espagnol). Avant la mise en place des barrières, dix-huit bornes au sol marquaient la délimitation de la frontière entre les territoires sous contrôle marocain et espagnol. La majorité d’entre elles se trouvent aujourd’hui de l’autre côté de la triple barrière, « côté marocain ». Le Maroc n’a pas accepté que le dispositif espagnol empiète sur son territoire, entraînant ainsi un « conflit entre le droit et la réalité », comme l’indique un agent de la Guardia civil en entretien : dans la pratique, c’est la triple barrière qui est censée marquer la frontière, or, la frontière délimitant les zones de contrôle se trouve, de fait, avant la barrière de Melilla. Ainsi, toute personne qui arrive devant le dispositif espagnol, et a fortiori le franchit, se trouve déjà en territoire sous contrôle espagnol. Il s’agit donc d’une fiction juridique, la triple barrière ne correspondant pas à la délimitation légale établie par les traités internationaux du xixe siècle (Acosta, 2016).
À Ceuta, le modèle de construction des barrières est similaire : il s’agit de clôtures équipées de moyens technolo-giques de pointe (câbles de détection, caméras de surveillance, capteurs sonores, de mouvements et thermiques, équipements lumineux et de vision nocturne). Entre 2005 et 2013, l’administration espagnole aurait ainsi investi 47 millions d’euros dans la barrière de Melilla, et 25 millions pour celle de Ceuta. L’entretien des barrières des deux enclaves aurait coûté 10 millions d’euros par an pendant cette période (selon Migrant Files, 2015). Ces dispositifs, leur évolution et les coûts qu’ils engendrent témoignent de l’existence d’une industrie de la sécurité frontalière espagnole (PorCausa, 2017), qui s’ancre plus largement dans l’industrie de la sécurisation des frontières européennes, et est illustrative d’un capitalisme racial. Bien qu’elles soient construites avec de l’argent européen, les barrières qui cernent les enclaves en territoire marocain peuvent être vues comme partie de la continuité coloniale matérielle espagnole (Andersson, 2014). Mais il est important de souligner qu’elles ont été construites pour freiner les migrations « Subsahariennes ». Par ailleurs, les intérêts du Maroc dans cet ouvrage sont multiples et le rôle des clôtures de Ceuta et de Melilla évolue en fonction des circonstances régionales, des intérêts nationaux, de l’équilibre des forces et de la nature des relations entre le Maroc et l’Espagne (Saddiki, 2012). Simultanément au processus d’emmurement, le premier système électronique de surveillance maritime a été mis en place dans la zone hispano-marocaine de la Méditerranée (cf. section « Pour aller plus loin »), demandant là aussi la participation du Royaume chérifien.
Le Maroc est l’un des premiers pays africains à collaborer avec l’Union européenne (UE) dans la lutte contre l’immigration dite clandestine. Il est pour cela souvent qualifié de « gendarme de l’Europe » ; une vision réductrice et eurocentrée qu’il convient de nuancer (El Qadim, 2015). C’est par toute une série d’accords et de processus que le Royaume chérifien est incité – par les États membres de l’UE et plus particulièrement l’Espagne – à coopérer en matière de gestion des migrations, depuis les années 1990 et jusqu’à aujourd’hui. À partir des années 2000, la collaboration maroco-espagnole qui se met en place autour de Ceuta et Melilla commence à être décriée. Des deux côtés de la frontière, la matérialisation des politiques anti-migratoires passe par l’emploi de moyens et dispositifs militaro-sécuritaires, mais aussi de la répression physique. Durant toute la décennie 2003-2013, les observateur·rice·s des effets de l’intensification du contrôle migratoire dénoncent la violence déployée, notamment autour des barrières. Après les massacres de 2005 qui font au moins onze morts et des centaines de blessé·es, une scène militante émerge au Maroc, autour de la figure du migrant dit « Subsaharien » (cf. section « Pour aller plus loin »). En septembre 2013, le souverain marocain annonce le lancement d’une nouvelle politique migratoire plus « humaniste ». Si certaines mesures positives sont mises en œuvre sur le territoire (Alioua et Ferrié, 2017) – comme des campagnes de régularisation administrative –, les violences se poursuivent sans relâche dans les zones frontalières. Malgré l’ordre migratoire imposé, les personnes catégorisées « Subsahariennes » contestent, négocient l’espace et l’occupent là où aucune spatialité légitime n’est prévue pour elles.
Mais qui sont les « Subsahariens » ?
Il subsiste aujourd’hui encore une vision biaisée des personnes en présence aux frontières de Ceuta et Melilla. Cela résulte d’une mise en visibilité sélective, et notamment d’une sur-visibilisation desdits Subsahariens. Depuis les années 1990, l’image du sauteur de barrière est érigée en figure emblématique du « migrant clandestin ». J’ai moi-même été amenée à me focaliser d’emblée sur cette catégorie de migrant·es, du fait des organisations dans lesquelles j’étais insérée. D’abord routes d’émigration marocaine, les frontières de Ceuta et Melilla ont ensuite constitué des points de passage de migrations et d’exils de personnes provenant de diverses régions d’Afrique, mais aussi d’Asie et du Moyen-Orient, avec des variations importantes selon les périodes. La fonction de filtrage racial des frontières maroco-espagnoles se révèle davantage quand on examine les différentes catégories de populations qui les traversent, et comment, et celles qui y sont stoppées et réprimées (cf. section « Pour aller plus loin »). Cet ouvrage se concentre sur l’expérience des personnes Noires africaines, avec l’objectif de dénaturaliser leur prise pour cible première par les politiques de contrôle migratoire.
Il faut souligner que les circulations entre les régions d’Afrique centrale et de l’Ouest et le Maroc sont très anciennes et informent de processus de racialisation très ancrés. Des mouvements forcés ont eu lieu dans le cadre de la traite transsaharienne et des razzias ont été opérées par des monarques africains et des Arabo-Maures (Ould Cheikh, 1985 ; Ndiaye, 2008 ; El Hamel, 2012). Entre le viie et le xixe siècle, les différentes traites dites « musulmanes » auraient conduit à la déportation d’environ 14 millions de personnes (Grenouilleau, 2018). Si le manque de recherches sur les traites dans les mondes musulmans d’Afrique du Nord et d’Orient reste décrié, celles-ci n’en continuent pas moins (Oualdi, 2024) et l’on sait que ces systèmes ont organisé des rapports de soumission et d’esclavage, réduit des populations Noires autochtones du Sahara à la servitude et produit une diaspora noire interne à la société arabo-berbère marocaine (El Hamel, 2012). À ces circulations forcées s’ajoutent aussi une présence ancestrale ou autochtone de minorités Noires dans les pays du Maghreb et d’autres types de circulations, pour des raisons de guerre ou de travail (Mrad Dali, 2014), entre autres. Il y a aussi, de longue date, des circulations religieuses entre certains pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc, comme celles liées au soufisme par exemple, à travers la confrérie musulmane transnationale de la Tijanniyya, très implantée au Sénégal, et qui effectue des pèlerinages vers Fès (Timera, 2011) ou, plus récemment, celles de musulmans ivoiriens qui viennent faire des études coraniques et du tourisme religieux dans le Royaume (Bamba, 2016). Le Maroc contemporain est aussi une terre d’immigration pour des commerçant·es (Pian, 2005), des étudiant·es (Nzamba, 2015), des travailleurs et travailleuses tel Aris K., embauché·es dans les centres d’appels délocalisés d’entreprises françaises (Weyel, 2016) ou encore pour des artistes, comme j’ai pu en rencontrer. Il y a ainsi une multiplicité de profils de personnes provenant d’Afrique centrale et de l’Ouest au Maroc. En outre, s’agissant de celles et ceux en quête d’Europe, le Maroc est devenu pour de nombreuses personnes plus qu’un pays de transit, une véritable étape où elles doivent se loger, travailler, se soigner, parfois même défendre leurs droits (Alioua, 2011), avant d’essayer de continuer leur « aventure » (Timera, 2009).
Lorsque j’arrive à Rabat en 2015, je n’entends donc parler que de « Subsahariens ». Au départ, je ne comprends pas exactement de qui l’on parle. Ce terme ne m’est pas inconnu, bien sûr, mais je n’y suis pas habituée. Avec le temps, j’apprends que celles et ceux que l’on assigne à cette catégorie ont en commun d’avoir la peau noire et d’être assigné·es à la catégorie de « migrants clandestins ». L’expression « Afrique subsaharienne » s’est substituée à celle d’« Afrique noire » après les décolonisations (Ogundipe-Leslie, 1994). Éminemment politique, ce glissement sémantique repose sur une classification à la fois infondée géographiquement, et raciste, visant à pointer une « insignifiance géostratégique de cette masse continentale » (Ekwe-Ekwe, 2011 : 185). Des ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest que je rencontre l’analysent comme une expression hypocrite utilisée par des personnes qui n’osent pas dire « Noir·e », mais qui prétendent bien marquer une distinction raciale. « Je n’avais jamais utilisé ce terme avant le Maroc, c’est quand on arrive ici qu’on devient subsaharien, subsaharienne », m’explique Aminata B., une Sénégalaise rencontrée à Rabat. La plupart des personnes dont il est question, à l’époque de mon enquête, viennent des pays d’Afrique centrale (neuf pays) et de l’Ouest (seize pays), ce qui réduit de plus de moitié le spectre d’une supposée Afrique subsaharienne. Surtout originaires du Sénégal, du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso – pour l’Ouest –, et du Cameroun, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Congo « Brazza », ou encore de la République centrafricaine, les profils de ces personnes sont divers et variés. La catégorisation « migrant·es subsaharien·nes » amalgame et homogénéise une pluralité de parcours et de profils et traduit des processus d’altérisation radicale des personnes Noires en quête de passage vers l’Europe. Systématiquement étiqueté·es comme « migrants économiques » par les autorités espagnoles comme marocaines, les raisons de leurs migrations sont très variées, mais beaucoup pourraient prétendre au statut de réfugié·e. Pourtant, l’accès aux bureaux de demande d’asile mis en place aux frontières des deux enclaves en 2015 leur est rendu impossible.
« Le bureau d’asile, c’est pour les Syriens », m’explique Anthony V., un Nigérian rencontré à Nador. « Si vous êtes Noir·e et que vous approchez la frontière, vous serez battu·e comme un serpent », poursuit-il. Cette analyse est partagée par des agents de la Guardia civil qui travaillent aux barrières de Melilla :
Il y a vraiment une question de Blancs et de Noirs. Ça, c’est de la politique, priorité à certaines personnes et pas à d’autres. Pourquoi est-ce que la problématique focalise sur certaines personnes de couleur et pas sur les autres ? En fait, aucune personne Noire ne va demander l’asile, car on ne va pas la laisser s’approcher pour le simple fait qu’elle est Noire, alors que si elle est syrienne… Le bureau d’asile à la frontière, c’est juste pour faire taire les gens. Revenez dans quatre ans pour demander si un Noir a pu demander l’asile. Tout ça c’est un gros mensonge. [Entretien avec des membres de l’Association unifiée de gardes civils (AUGC), Melilla, 2015]
Les chapitres qui suivent examinent la violence aux frontières, en commençant par se placer du point de vue de celles et ceux qui la vivent dans leurs chairs.