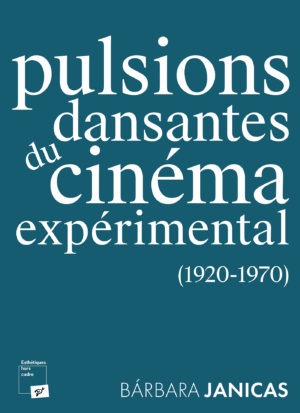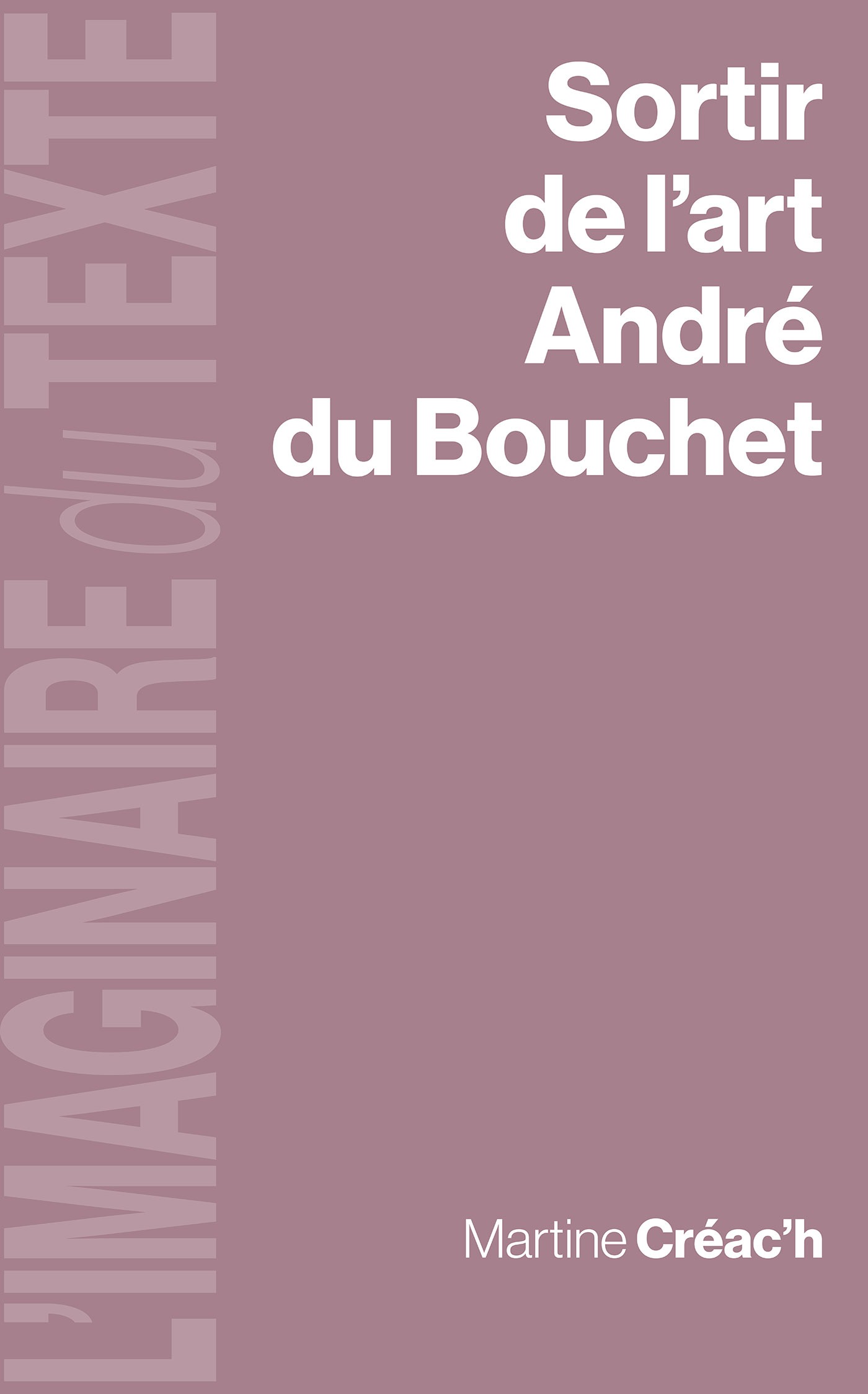Introduction
« … tournant au plus vite le dos au fatras de l’art1 »
En 1969, en réaction à la rétrospective Giacometti au musée de l’Orangerie à Paris, le poète André du Bouchet publie un essai intitulé « … tournant au plus vite le dos au fatras de l’art »2. Cette façon de prendre ses distances avec « le fatras de l’art » plutôt qu’avec le « fatras » du monde étonne : avec constance en effet, le poète s’éloigna de la société. Les lieux où habita André du Bouchet, né à Paris en 1924, auteur de nombreux livres de poésie de Air en 1946 à tumulte en 2001, apparaissent en effet comme autant de lieux de retrait. Fils d’un père américain, d’origine française, Victor du Bouchet, et d’une mère d’ascendance russe juive Nadia Wilter, il se réfugie d’abord en 1940 avec sa famille aux États-Unis pour fuir l’antisémitisme jusqu’à son retour en France en 1948. À Paris, il s’installe en 1961 dans un appartement rue des Grands Augustins, « faille quasi alpestre3 » pour l’écrivain suisse Georges Piroué.
À partir de 1971, c’est dans un hameau isolé de la Drôme, à Truinas qu’il se retire jusqu’à sa mort en 2001.
En sortant de l’exposition Giacometti
En faisant résonner « art » et « fatras », comme dans un slogan, ce titre prolonge le geste de révolte contre les institutions des mouvements de mai 68, au côté desquels le poète s’était engagé. Au terme d’« art », générique et abstrait, André du Bouchet préfère celui, plus concret, de « peinture » :
La peinture […] n’est pas objet d’art. Tout est peinture… Le rapport qu’on peut avoir avec le monde est peinture, dans le sens d’une apparition, d’une représentation et de l’annulation de cette représentation que l’on traverse pour être. […] Il s’agit, par le mot, d’être en rapport un instant, avec ce qui est en dehors du mot, ou, dans la peinture, avec quelque chose qui n’est pas de l’ordre du tableau4.
« L’art » accueilli dans le musée est un « cadre fixé d’avance », comme il l’expliquait dès les années quarante :
Dans certains ouvrages de la Renaissance qui traitent de la perspective, on trouve un visage humain rivé contre la pointe d’une sorte de pyramide aiguë : un pas de plus et on se crèverait les yeux. Cela explique le désagrément que nous causent certaines salles de musée. Ce glaive théorique, cette pyramide visuelle nous maintiennent à distance. […] Eh bien, aujourd’hui, la poésie, la peinture qui nous semblent les plus urgentes, se passent des intervalles vacants, des chevilles de l’espace, du mot « comme ». Et nous faisons corps avec elles. La matière poétique qui leur est commune n’est plus située dans un cadre fixé d’avance, mais se trouve en perpétuel déplacement5.
L’agacement d’André du Bouchet est à la mesure du lien intime, profond, qu’il entretenait avec Alberto Giacometti mort à Coire trois ans plus tôt. Comment accorder la vision des œuvres exposées sur les cimaises, irrémédiablement achevées, avec le souvenir de l’inlassable énergie d’un créateur qui ne supporte pas l’immobilité ? Il avouait, dans une note d’avril 1947, l’impression pénible ressentie devant La Fiancée juive de Rembrandt : « Ces deux mains superposées sur la poitrine de la femme, immobiles et définitivement me devenaient insupportables6. » « Les essais c’est tout. Oh merveille ! » clamait Giacometti et cela valait pour « peinture, sculpture, dessin, écriture ou plutôt littérature »7. La formule de Giacometti, déjà citée dans le premier numéro de L’Éphémère, rythme le texte d’André du Bouchet de 19698, « parole choquante ayant allure de paradoxe, sans doute, ou de plaisanterie, et comme dite à la légère9 ». C’est précisément cette dynamique qui lui importe. Tourner « au plus vite le dos au fatras de l’art », c’est, pour André du Bouchet, manifester la même irritation que Giacometti devant des œuvres « immobiles et définitivement » :
Et, quant à A.G., qu’aura valu une “exposition”, lui vivant, autrement que comme l’urgence de bâcler telle figure, la toute dernière, qui aurait pu demeurer en cours à jamais et la voiturer humide, peinture pas sèche ou plâtre, pour y apporter plus loin quelques retouches encore – au risque de l’endommager – dans un lieu peu approprié à ce qui n’est pas sec10…
Contre la récupération institutionnelle après la mort du sculpteur, André du Bouchet se veut l’héritier de l’œuvre vivante, précaire, de « ce qui n’est pas encore sec », fidèle au « dehors, ennemi de la conservation »11. À l’œuvre achevée s’oppose une confiance dans l’inachèvement qu’André du Bouchet appelle, dans ses carnets, « réserve » comme, dans les arts visuels. Il consacre un article pour la Réunion des musées nationaux à ce « suspens du dessin » qui nous prend « de court »12. Cette « réserve » en effet, malgré sa neutralité apparente, nous oblige à déplacer notre regard vers l’espace resté blanc : « On peut dire de Giacometti, en le paraphrasant, que son trait valorise tout ce qu’il ne dessinera pas13. »
L’attitude revendiquée ici n’est cependant pas réservée aux seules œuvres de Giacometti, son contemporain et son ami. Elle témoigne d’une attitude plus générale à l’égard de toute œuvre d’art, peinture ou poésie, contemporaine ou appartenant à l’art du passé. Le geste de « tourner le dos » trahit l’intensité de l’émotion ressentie devant une œuvre, comme il l’indique encore dans un entretien de 1995 :
[…] je me suis souvent aperçu que, quand une peinture me touche, je ne m’y attarde pas ; elle est l’amorce d’une accélération du temps qui m’incite à tourner très rapidement le dos à la peinture et à m’engager dans la lumière de l’espace qu’elle m’a ouvert14.
Dès 1949, à propos de Tal Coat, André du Bouchet montrait la nouveauté de sa peinture en soulignant qu’elle ouvrait sur le monde « Oui, nous avons bien fait de sortir15 ». Cette ouverture, ce lien dynamique avec l’extérieur exprimés en 1969 à propos de l’exposition Giacometti16, seront affirmés de nouveau, avec force, en 1983, dans Peinture, « … dans telle œuvre ce n’est pas l’attrait d’une œuvre accomplie qui continue de s’exercer […] mais ce qui au travers de l’œuvre déjà, brusquant les écarts, nous rend très vite au-dehors…17 ».
Le dehors
Qu’est-ce donc que ce dehors qui insiste non seulement dans la poésie d’André du Bouchet, comme l’ont montré plusieurs études18, mais aussi dans sa relation aux œuvres ? Il s’agit moins d’un concept que d’une façon de marquer un écart. Très tôt, cette approche négative, comme on parle d’une théologie négative, s’imposa, inspirée peut-être par la lecture de Pierre Reverdy pour qui « la poésie est dans ce qui n’est pas. Dans ce qui nous manque19 ». En 1951, André du Bouchet lui consacre un article intitulé « Envergure de Reverdy » dans lequel il souligne : « Le sentiment de manque […] si violent chez Reverdy, qu’il n’est jamais comblé20. » Plus tard, il reviendra sur cette « œuvre qui jamais ne se sera voulue œuvre21 ». La même année, il publie un essai sur Victor Hugo qu’il intitule « L’infini et l’inachevé »22 avant d’éditer, en 1956, une anthologie de fragments. André du Bouchet y affirme son admiration pour l’œuvre de Victor Hugo en prenant le contre-pied de toute une tradition critique sur le poète. Alors que l’obsession de l’infini dans la poétique de Victor Hugo est traditionnellement associée par ses commentateurs à des poèmes achevés, André du Bouchet relève que cette obsession s’exprime précisément par des fragments inachevés, supprimés par ses éditeurs dans les recueils de poèmes, contre la volonté même de l’auteur. Grâce à la nouvelle publication de deux recueils de fragments Océan et Pierres, André du Bouchet peut relever un double paradoxe : le paradoxe, d’abord, d’une œuvre qui, contre la perspective téléologique la plus couramment adoptée par les éditeurs, ne peut s’achever que par l’inachevé, d’une poésie « précieuse par son imperfection ».
L’œuvre de Victor Hugo gagne à être revue dans la perspective ouverte par ces recueils de fragments […] comme si dans ces recueils qui permettent d’entrevoir le livre qu’il avait projeté, sa poésie avait trouvé sa forme la plus accomplie23.
Le paradoxe aussi d’un infini (in-fini) qui ne peut s’atteindre que par l’interruption :
Il semble que cette hantise de l’infini, de l’ininterrompu, qui marque si fortement son œuvre, doive toujours aboutir, par une dialectique étrange, à précipiter une sorte d’interruption perpétuelle. Le désir immense de l’éternel, du continu, ne peut se satisfaire qu’en englobant son contraire. Il devient immense solution de continuité. […] L’infini, devenant l’inachevé, se disloque brutalement en éclat.
La vue égarée se ressaisit dans son univers de fragments visionnaires24.
Pour montrer l’importance de ces « éclats » pour la compréhension du poème, André du Bouchet étudie le lien entre les vers qui inaugurent chaque chant de Dieu et la double rangée de points de suspension qui les précèdent et en modifient le sens.
Même si la disposition des mots sur la page semble se rapprocher alors de la disposition fameuse du Coup de dés, l’enjeu est radicalement autre puisque André du Bouchet s’oppose à l’idée selon laquelle « tout, au monde, existe pour aboutir à un livre25 ». Il pense au contraire que nous devons, en quelque sorte, inachever l’œuvre, l’empêcher de se clore, comme il l’indique à l’occasion de sa traduction de celle de Joyce. Il l’accompagne de deux textes dans lesquels il relève la singularité du dispositif de lecture de cette œuvre qui « entend abolir fin et commencement26 » et, pour le donner à voir, il choisit, dans l’édition de sa traduction, de présenter le début de Finnegans Wake après le final. Cependant, alors que le dispositif est généralement interprété en faveur de la nécessité d’une lecture cyclique, du Bouchet rompt le cycle : puisque « les dernières lignes du volume nous ramènent derechef à la première page », puisque l’œuvre exhibe son illisibilité, ce n’est pas seulement le trajet d’une lecture qui est mis en cause mais la nécessité même d’une lecture. Le titre interrogatif choisi par André du Bouchet prend, dans cette perspective, toute sa signification : Lire Finnegans Wake ? peut signifier : faut-il continuer à lire Finnegans Wake ou renoncer à l’achèvement du monde dans un livre ? C’est la seconde perspective que choisit du Bouchet :
La parole arasée en quoi, indéfiniment, sombre Finnegans Wake se précise lorsque nous cessons de lire. Et c’est contre l’injonction d’un livre qui entend abolir fin et commencement, de guerre lasse, au premier tournant où, soudain, il se découvre impénétrable, que nous suspendons notre lecture27.
Si, comme le propose du Bouchet, nous « refusons de relire » Finnegans Wake, nous donnons à ce livre le statut des « grandes œuvres » : « Celles qui donnent accès plutôt que prise28. »
Opposé à l’enfermement de l’œuvre achevée, accomplie, morte, le dehors est doté de toutes les connotations positives de l’espace extérieur. Il est, avant tout, un espace de mouvement et de respiration, espace modèle pour un poète qui accorde, comme l’a souligné Michel Collot29, la valeur de son poème à la mesure de son pas de marcheur et qui a ouvert son œuvre poétique par un recueil intitulé Air30. Il valorise ce lien entre l’intérieur et l’extérieur dans une lettre à Pierre Tal Coat :
Je suis passé hier à la galerie de France pour voir vos dernières toiles : j’ai particulièrement aimé une cascade de verdure qui se déverse dans un bassin, et une autre, plus petite, qui ne se laisse pas nommer : dans cette dernière, en effet, vous avez réussi à abattre la cloison étanche (des mots, des signes, toute la mécanique de la carapace humaine) qui sépare par habitude l’intérieur de l’extérieur, en créant une ambiance pure
31
.
Toutefois, le dehors modèle n’est pas seulement l’espace naturel qu’appelle la « cascade de verdure ». Il est aussi, pour André du Bouchet, l’espace des autres, l’espace de l’histoire auquel le poète porte une attention aiguë et dont il fait, dès les ébauches des années 1952-1953, le combustible de son œuvre :
[Le poète] ne peut proprement voir, tolérer sa poésie que par l’entremise d’un autre, que par les autres où elle cesse d’être poésie, et devient chaleur. On ne pense plus à ce charbon glacé, pas plus qu’on ne pense au charbon quand il commence à faire plus chaud
32
.
Un an avant « tournant au plus vite le dos au fatras de l’art », André du Bouchet avait consacré aux graffiti qui se sont affichés en mai 1968 sur les murs de Paris des pages dans la même revue l’Éphémère sous le titre : « Sous les pavés, la plage »
33
.
L’accès au dehors est donc l’enjeu majeur, constant, de l’œuvre d’André du Bouchet, enjeu souvent déceptif comme il l’entend très tôt dans le combat de la poésie de Francis Ponge contre les mots usés :
Il ne peut répondre que par des mots à une question qui n’est pas de leur ressort ; et cette gêne nous touche au plus vif dans notre déception quotidienne : quand, au lieu de gagner accès au dehors, comme nous nous le proposons, nous nous retrouvons aux prises avec quelque chose de totalement différent – les mots dont nous aurions voulu nous servir
34
.
Certaines œuvres cependant tiennent le « pas gagné » : celle de Baudelaire (« De ce qui, du dehors, paraît la contredire, lui imposer un coup d’arrêt, l’œuvre de Baudelaire fait son moteur : elle l’englobe
35. ») ou celle d’Éluard à laquelle, le jour de la mort du poète, André du Bouchet offrit un éclatant hommage dans l’ombre d’un carnet d’écriture (Carnet 15 daté du 18 novembre 1952) :
Jour de la mort d’Éluard
…
Quand la réalité touche celui qui a vécu pour devenir presque
plus tendu qu’un homme, elle semble plus terrible que d’habitude.
Il l’a déjà transfigurée.
il l’avait élargie d’avance
il l’avait conquise d’avance
en parlant
avant qu’elle ne soit venue le dominer
et quand elle est venue, il était trop tard pour elle,
elle était parlée
elle parlait sans lui
les mots qu’il lui avait appris36
Écrire s
ur la pe
inture
On le constate : le dehors est invoqué avec la même constance dans les poèmes et dans les textes sur les peintres car ce qu’André du Bouchet nomme poème excède très largement les distinctions génériques : « J’appelle poème tout fragment ou paysage de langue porté à un degré / d’intensité ou de précision où il vous met dans un rapport vivant avec vous-même
37
. » Pourtant, à l’occasion de la publication du recueil L’Incohérence en 1979, il distingue soigneusement l’activité du poète, de celle du critique écrivant sur des œuvres, littéraires ou plastiques, qui existent « indépendamment » de lui :
Il m’a toujours paru difficilement défendable de concevoir deux fonctionnements du langage, un langage poétique qui serait le langage de l’immédiat et le langage de justification qui serait le langage de la formulation théorique. Au fond, j’aurais voulu user de la même langue pour rendre compte d’un instant de vie ou d’une œuvre. La différence, c’est peut-être que le poème traduit quelque chose qui est sans antériorité. Tandis que dans les textes réunis dans L’Incohérence, qu’il s’agisse d’œuvres de Tal Coat, ou de Segers, ou de pages écrites par Pasternak, Hölderlin ou Hopkins, ce sont des œuvres qui existent tout à fait indépendamment. Je les prends en charge avec toute l’attention dont je dispose, mais dans cette attention, elles se perdent aussi
38
.
Dans cette distinction, se manifeste également la singularité de l’approche des œuvres d’art par André du Bouchet. Alors que les historiens d’art jugent sévèrement les approches de poètes dans la seconde moitié du xxe siècle – « des généralités ampoulées, du bran métaphysique, de l’adjectif et de la métaphore à satiété, des flonflons rhétoriques, du vent (et surtout pas le moindre effort d’analyse historique
39
») – , « l’attention » d’André du Bouchet aux œuvres dont il parle est, comme je voudrais le montrer, remarquablement informée. Cette attention aiguë aux œuvres, à leur contexte et à leurs conditions d’existence, fut favorisée par les rencontres américaines du poète, celle du peintre André Masson en 1943, celle de l’historien d’art Georges Duthuit qui lui fera découvrir, dès 1948, le nouvel espace ouvert par l’œuvre de Pierre Tal Coat et l’emploiera comme éditeur pour la revue américaine Transition. Sous l’impulsion de Georges Duthuit qui dirigea entre 1948 et 1950 cette revue (fondée à Paris en 1927 par Eugène et Maria Jolas parents de Tina que du Bouchet épouse en 1949), Transition fit le lien entre l’art américain contemporain et l’art européen. André du Bouchet avait lui-même découvert certaines œuvres du passé à Harvard (« Il y a une très belle collection d’eaux-fortes, de Daumier et de peintres japonais qui n’est pas classée. Je travaille à les classer, deux heures par jour40 ») et dans de fabuleuses collections privées, comme en témoigne, par exemple, une lettre à sa mère du 6 janvier 1948 :
J’ai vu dans cette maison les plus beaux Seurat, Van Gogh, Matisse, Renoir, Monet, Degas, Gauguin, Rouault… les œuvres de chacun de ces peintres se chiffraient par dizaines. Atterrant de beauté. Perdu au milieu d’une réception monstre, je ne faisais que regarder les murs41.
Une réflexion sur les différentes façons de parler de l’art accompagne cette découverte : entre 1944 et 1948, André du Bouchet lit les Salons de Baudelaire et les écrits sur l’art de Félix Fénéon. Le poète, qui partagea à partir des années soixante-dix la vie d’Anne, fille du peintre Nicolas de Staël, fut proche de quelques artistes de son temps. Ceux-ci furent aussi, pour certains, des écrivains : Giacometti et Tal Coat, bien sûr, mais aussi Geneviève Asse, Miklos Bokor, Jean Hélion, Jack Ottaviano, Jean-Paul Riopelle et Bram van Velde.
Comment expliquer cependant que les œuvres soumises à cette « attention » « se perdent aussi », de l’aveu même du poète ? Il faut, pour le comprendre, revenir à la distinction établie par André du Bouchet entre « connaissance critique et connaissance poétique » : « C’est que la critique marque invariablement un pouvoir […], alors que la poésie dégage souvent une impuissance. Le discernement critique est un discernement de proie
42. » L’image de la « proie », empruntée à l’étymologie allemande du mot concept (Begriff vient du verbe begreifen qui signifie saisir), n’est pas choisie au hasard. Elle dit que l’approche poétique doit se protéger de l’abstraction du concept. Marquée par « l’impuissance », elle doit prendre le risque d’aborder autrement les œuvres, de les perdre pour mieux les atteindre, dans un effort créatif analogue à celui de Baudelaire qui affirmait, dans le Salon de 1846, que « le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie43 ».
« Aucune critique au sens appréciatif ou descriptif ou analytique de ce mot n’a place dans L’Éphémère » : le prière d’insérer du premier numéro de la revue que créa André du Bouchet avec Yves Bonnefoy, Louis-René des Forêts et Gaëtan Picon est sans appel. L’approche des arts par André du Bouchet ne constitue pas une critique d’art et cela pour plusieurs raisons. L’approche excède d’abord, très largement la seule étude des œuvres contemporaines qui distingue, depuis Diderot, la critique d’art de l’essai sur l’art. Elle évite également la position de surplomb sur les œuvres. Ainsi l’essai sur Seghers dans le second numéro de la revue sera intitulé, modestement, « Notes devant Seghers ». Elle cherche moins, surtout, à déchiffrer les œuvres qu’à relever en elles ce que Maurice Merleau-Ponty, qui permit à André du Bouchet de publier ses premiers poèmes en 1949 dans Les Temps modernes, nomme des « matrices d’idées » :
Ce qui n’est pas remplaçable dans l’œuvre d’art, ce qui fait d’elle beaucoup plus qu’un moyen de plaisir : un organe de l’esprit, dont l’analogue se retrouve en toute pensée philosophique ou politique, si elle est productive, c’est qu’elle contient, mieux que des idées, des matrices d’idées, qu’elle nous fournit d’emblèmes dont nous n’avons jamais fini de développer le sens, que, justement parce qu’elle s’installe et nous installe dans un monde dont nous n’avons pas la clef, elle nous apprend à voir et finalement nous donne à penser comme aucun ouvrage analytique ne peut le faire, parce que l’analyse ne trouve dans l’objet que ce que nous y avons mis
44
.
Dans cette conception, il s’agit moins de « développer le sens » du tableau que de poursuivre un travail de création. Rappelant le mot de Baudelaire qui, dans le Salon de 1845 à propos des toiles de Corot, Merleau-Ponty affirme « qu’il y a une très grande différence entre un morceau fait et un morceau fini, et qu’une chose très finie peut n’être pas faite du tout
45 ». C’est dire que « l’œuvre accomplie » « n’est pas celle qui existe en soi comme une chose, mais celle qui atteint son spectateur, l’invite à reprendre le geste qui l’a créée46 ». En reprenant « le geste qui l’a créée », le poète peut avoir accès au dehors de l’œuvre pour la maintenir vivante.
Sortant de l’exposition, André du Bouchet ne propose donc pas une critique d’art mais un poème, « non sans joie » comme il l’indique dans le texte intitulé « … tournant le dos au fatras de l’art »47. Dans les dernières lignes du texte, par le jeu des répétitions et des sons, André du Bouchet crée, à partir de la formule du titre, un rythme et une cadence qui exposent le travail sur la langue dans ses dimensions sensibles :
…dehors, tournant – au plus vite – le dos au fatras… Au fatras ajouré… si ajouré qu’il soit, jamais suffisamment défait… dit art… Où nulle parole au ras même de sa ligne ne peut être à hauteur – pas plus que suffire. Mais, à côté – En place, comme à côté48.
Un brouillon de ce texte conservé à la Bibliothèque Doucet marque, par des signes typographiques d’espacement, les « embrasures » (pour reprendre un terme cher à André du Bouchet) par lesquelles il fait entrer de l’air entre les mots et les ouvrent sur le vif du dehors.
L’art et la vie
Cette continuité entre l’art et la vie est également l’enjeu des conférences données en 1931 par John Dewey à Harvard, université où enseigna André du Bouchet quelques années plus tard. Ces conférences, réunies sous le titre Art and Aesthetic Experience puis publiées en 1934 sous le titre Art as Experience ne furent traduites en français qu’en 2005 mais elles purent avoir une influence profonde sur André du Bouchet pendant son séjour américain et orienter, sa vie durant, non pas le choix de ses objets d’admiration (la peinture et la sculpture européenne) mais, comme j’essaierai de le montrer, la façon de les aborder. Cette perspective donne une autre signification à la valeur de l’expérience dans la poésie d’André du Bouchet analysée sous l’angle phénoménologique par Elke de Rijcke dans son livre de 201349. Le philosophe pragmatiste américain est en effet extrêmement critique à l’égard de l’exposition, dans les musées ou dans les galeries, dont nous devons nous éloigner pour retrouver la relation entre l’art et la vie50.
L’étude de cette relation constituera le fil conducteur de mes analyses. En rapportant l’approche esthétique d’André du Bouchet à ses influences américaines, cet essai participera également aux recherches récentes qui tendent à relativiser l’opposition, très française, entre poètes lyriques et poètes littéralistes influencés par les poètes objectivistes américains.
Consacré aux textes sur les peintres, cet essai va enfin tenter de retrouver, dans l’approche des œuvres par André du Bouchet, les multiples gestes qui témoignent de leur relation avec les « conditions ordinaires de l’expérience ». Nous montrerons que ces gestes, aussi variés que les œuvres qu’ils tentent d’approcher, vont créer des liens dans la longue durée de l’influence qu’elles exercent, avec les autres activités de celui qui les regarde, avec ses lectures surtout. Parce qu’ils créent aussi des liens avec d’autres œuvres, ils nous interrogent sur notre relation au monde et à l’Histoire. Ils témoignent enfin des conditions matérielles de leur production, et de la relation avec celui qu’André du Bouchet nomme « l’interlocuteur ».
- 1. André du Bouchet, « …tournant au plus vite le dos au fatras de l’art », L’Éphémère, no 12, hiver 1969, p. 538-550. Le titre sera repris pour la troisième section du recueil intitulé Qui n’est pas tourné vers nous, Paris, Mercure de France, 1972.
- 2. Cette circonstance est rappelée par son ami le poète Philippe Jaccottet, « Une montagne nous sépare », L’Ire des vents, no 6-8, Espaces offerts à André du Bouchet, 1983, p. 410.
- 3. Georges Piroué, « Avec André du Bouchet », entretien paru dans le Mercure de France, no 1179, novembre 1961. Repris dans L’Étrangère, no 14-15, La Lettre volée, Liège, 2007, p. 230.
- 4. André du Bouchet, « Remous », Autre Journal, no 1, décembre 1984, p. 138-139.
- 5. André du Bouchet, [Poésie et peinture], La Peinture n’a jamais existé. Écrits sur l’art, 1949-1999, éd. Thomas Augais, Le Bruit du temps, Paris, 2017, p. 237-238.
- 6. Alberto Giacometti, Écrits, Paris, Hermann, 1990, p. 190.
- 7. Ibid., p. 100.
- 8. André du Bouchet, « …tournant au plus vite le dos au fatras de l’art », op. cit., p. 540, 544 et 547.
- 9. Ibid., p. 539.
- 10. Ibid., p. 543.
- 11. Ibid., p. 545
- 12. André du Bouchet, préface du catalogue de l’exposition « Réserves – les suspens du dessin » (Musée du Louvre, 2 novembre 1995).
- 13. André du Bouchet, D’un trait qui figure et défigure, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1997, p. 11.
- 14. André du Bouchet, Surpris par la nuit, France Culture, 24 janvier 1995.
- 15. André du Bouchet, « Trois expositions : André Masson – Tal Coat – Joan Miró », Transition, no 5, 1949, La Peinture n’a jamais existé, op. cit., p. 68.
- 16. André du Bouchet, « … tournant au plus vite le dos au fatras de l’art », op. cit., p. 545.
- 17. André du Bouchet, Peinture, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1983, p. 49.
- 18. Jacques Depreux, « André du Bouchet ou l’approche du dehors », Critique, no 524-525, janvier-février, 1991, p. 71-82 ; Victor Martinez « Aux sources du dehors : poésie, pensée, perception dans l’œuvre d’André du Bouchet », Paris III Sorbonne-Nouvelle, 2008 ; thèse reprise dans André du Bouchet : Poésie, langue, événement, Editions Rodopi, Amsterdam / New York, 2013 ; Stéphane Baquey, « Le sens du dehors », numéro spécial André du Bouchet, éd. V. Martinez, Europe, no 986-987, juin-juillet 2011, p.84-93.
- 19. Pierre Reverdy, En vrac, Monaco, Éditions du Rocher, 1956, p. 139.
- 20. André du Bouchet, « Envergure de Reverdy », Critique, no 47, avril 1951, p. 314-315. Repris dans Aveuglante ou banale. Essais sur la poésie, 1949- 1959, éds. C. Layet et F. Tison, Paris, Le Bruit du temps, 2011, p. 47.
- 21. André du Bouchet, Matière de l’interlocuteur, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1992, p. 22.
- 22. André du Bouchet, « L’infini et l’inachevé », Critique, no 54, novembre 1951. Repris dans Aveuglante ou banale, op. cit., p. 65-81.
- 23. Ibid., p. 66.
- 24. Ibid.
- 25. Entretien d’André du Bouchet avec Monique Pétillon, « André du Bouchet, poète de l’abrupt », Le Monde, 4 mai 1979. Repris dans L’Étrangère, no 14-15, op. cit., p. 128. Stéphane Mallarmé, « Le Livre instrument spirituel » dans Quant au livre, Œuvres complètes, tome II, éd. B. Marchal, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 378.
- 26. André du Bouchet, Lire Finnegans Wake ? Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 2003, p. 9.
- 27. Ibid.
- 28. Ibid., p. 11.
- 29. Michel Collot, André du Bouchet. Une écriture en marche, Strasbourg, Deyrolle, 2021.
- 30. André du Bouchet, Air, Paris, Aubier, 1946 et 1951.
- 31. André du Bouchet, « Lettre à Pierre Tal Coat », 1950. Cité par Florian Rodari, Catalogue de l’exposition, Tal Coat devant l’image, Genève, Musées d’art et d’histoire, 1997, p 205.
- 32. André du Bouchet, « Banalité », Aveuglante ou banale, op. cit., p. 142.
- 33. André du Bouchet, « Sous les pavés, la plage », L’Éphémère, no 6, été 1968, Paris, Maeght, p. 7.
- 34. André du Bouchet, « Le Verre d’eau », Critique, no 45, février 1951, p. 183. Repris dans Aveuglante ou banale, op. cit., p. 44.
- 35. André du Bouchet, « Baudelaire irrémédiable », Courrier du centre international d’Études Poétiques, no 9, mai 1956, repris aux éditions Deyrolle, 1993.
- 36. André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride. Carnets 1949-1955, éd. C. Layet, Paris, Le Bruit du temps, 2011.
- 37. Entretien d’André du Bouchet avec Alain Veinstein, « Surpris par la nuit », rediffusion du 24 janvier 1995, France Culture.
- 38. « André du Bouchet, poète de l’abrupt », op. cit., p. 123-124.
- 39. Yve-Alain Bois et Rosalind Krauss, L’Informe : mode d’emploi [Centre Georges Pompidou, 22 mai-26 août 1996], Paris, édition du Centre Pompidou, 1996, p. 130.
- 40. André du Bouchet, Lettre à sa mère, [Amherst, 1944], L’Étrangère, no 14-15, op. cit., p. 363.
- 41. André du Bouchet, Lettre à sa mère, [Cambridge (Mass.)], 6 janvier 1948, ibid., p. 370.
- 42. André du Bouchet, « Connaissance critique et connaissance poétique », L’Étrangère, op. cit., p. 103.
- 43. Charles Baudelaire, Salon de 1846, Œuvres complètes, II, éd. C. Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 418.
- 44. Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 96-97. L’auteur souligne.
- 45. Charles Baudelaire, Salon de 1845, op. cit., p. 390. L’auteur souligne.
- 46. Maurice Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 64.
- 47. André du Bouchet, « …tournant au plus vite le dos au fatras de l’art », op. cit., p. 538. Je remercie Gilles du Bouchet d’avoir attiré mon attention sur cette expression qui confond l’expérience du peintre et celle du poète et qui éclaire la poétique réputée austère d’André du Bouchet.
- 48. Ibid., p. 550.
- 49. Elke de Rijcke, L’Expérience poétique dans l’œuvre d’André du Bouchet, Liège, La Lettre volée, 2013.
- 50. John Dewey, L’Art comme expérience [1934], trad. J.P. Cometti et al., Paris, Gallimard, 2010, p. 37-40 notamment.

Figure 1. Feuillet manuscrit extrait du dossier « … tournant au plus vite le dos au fatras de l’art » d’André du Bouchet. Copyright André du Bouchet, avec l’aimable autorisation d’Anne de Staël, Chancellerie des universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques Doucet cote ADB 10 (3), p. 1.
Figure 2. Feuillet manuscrit extrait du dossier « … tournant au plus vite le dos au fatras de l’art » d’André du Bouchet. Copyright André du Bouchet, avec l’aimable autorisation d’Anne de Staël, Chancellerie des universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques Doucet cote ADB 10 (3), p. 13.