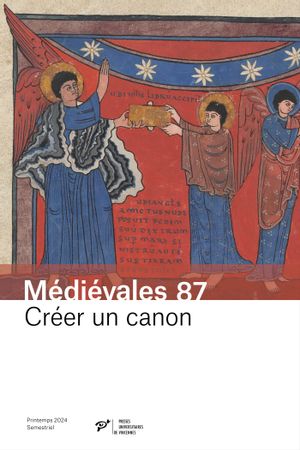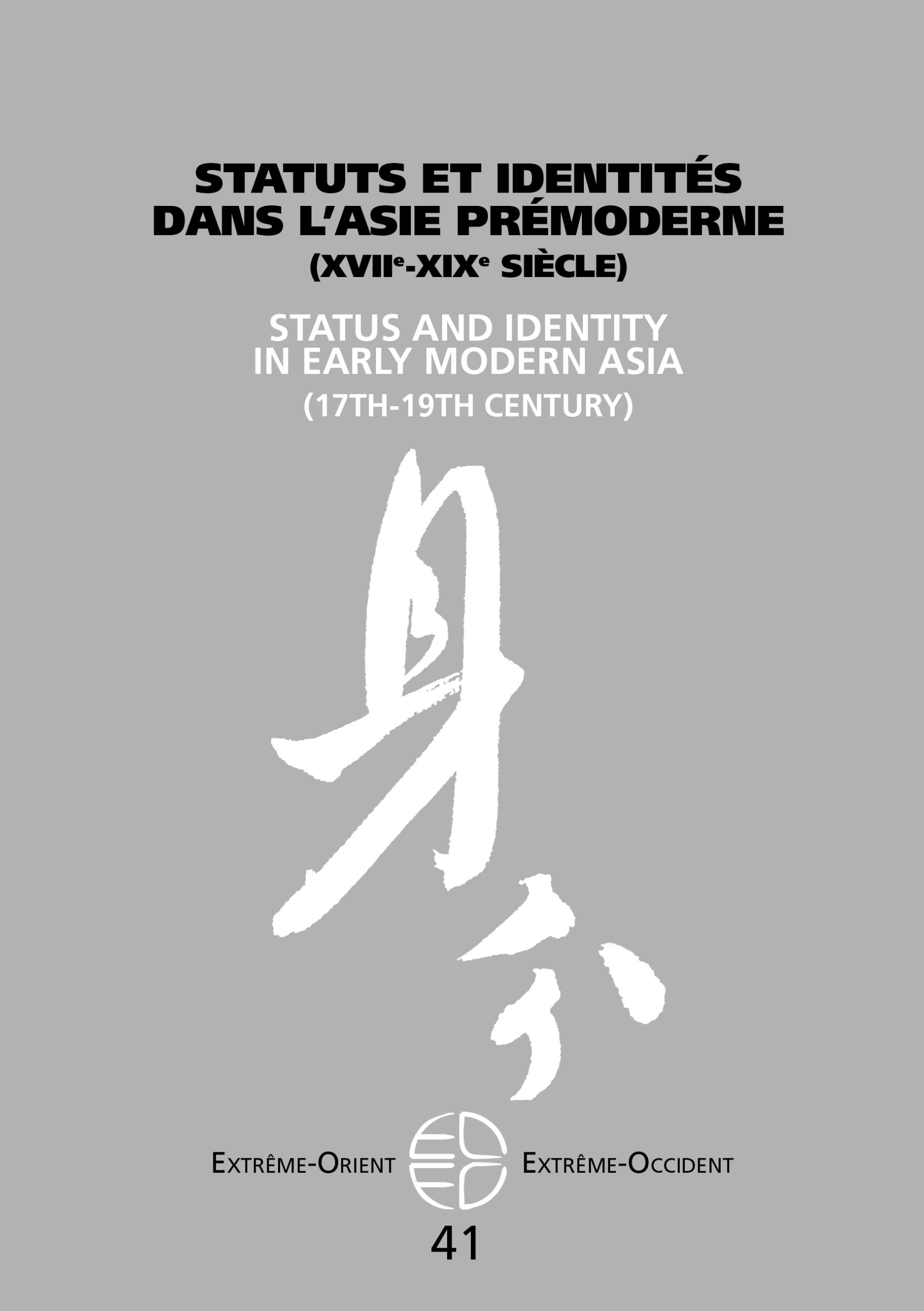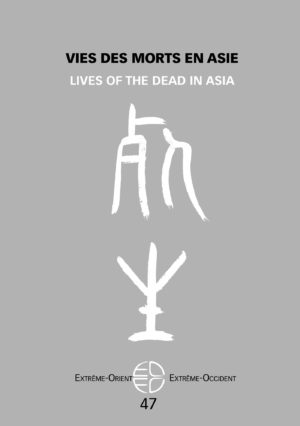Statuts et identités dans l’Asie pré-moderne (XVIIe-XIXe siècle)
Annick Horiuchi
Les études consacrées à l’histoire sociale de l’Asie orientale à l’époque prémoderne n’ont pas été très nombreuses en France ni d’ailleurs dans aucun pays occidental, à l’exception de ces dernières années. Derrière ce manque d’intérêt, il y a sans doute l’idée persistante que les structures sociales dans ces pays, puissamment dominés par l’idéologie confucéenne, ne pouvaient guère évoluer, et qu’en dehors des moments de rébellion, il n’existait guère d’espace où des identités sociales puissent s’affirmer.
On ne s’étonnera donc pas que l’attention des chercheurs, pour le cas du Japon, se soit portée plus particulièrement sur les révoltes paysannes ou encore sur les mouvements religieux qui ont précédé les événements de Meiji. L’élite guerrière, dans la mesure où elle occupait la position de pouvoir, a fait l’objet de plus d’attention, mais la dimension politique, économique ou culturelle a été privilégiée au détriment de la dimension humaine ou sociale. Le fait que cette classe n’était pas homogène et qu’il existait en son sein différents statuts, déterminant de manière essentielle leur conduite et leurs ressources, n’a pas été perçu comme suffisamment significatif pour être observé de près. L’attention s’est portée surtout sur les classes élevées ou les intellectuels d’exception. Quant aux marchands, ce sont évidemment en tant qu’acteurs de l’industrialisation du Japon qu’ils ont attiré l’attention, mais il semble qu’il reste encore beaucoup à faire pour éclairer leur rôle de bourgeois dans la société urbaine. Enfin, les études sur la société villageoise sont demeurées elles aussi assez réduites, si l’on exclut celles consacrées aux révoltes ou celles qui voient dans le développement économique des régions rurales le fondement de l’industrialisation du Japon, mais on reconnaîtra la grande qualité des travaux existants. Quant aux études sur les femmes, elles ont été longtemps basées sur la littérature écrite par des hommes. Ce n’est que récemment que des sources judiciaires ont été mises à contribution pour apporter un éclairage sur le monde de la prostitution.
Le biais que l’on perçoit dans l’approche de la société japonaise est aussi lié à la forte coloration marxiste des travaux japonais eux-mêmes. Mais cette dernière s’est beaucoup estompée depuis les années 1990, notamment sous l’effet des nombreuses études qui ont vu le jour au Japon même, notamment sous l’étiquette des « marges statutaires » (mibunteki shūen). On ne reviendra pas ici sur les séries d’ouvrages collectifs publiés sous ce titre, à l’instigation d’historiens réunis autour de Yoshida Nobuyuki et Tsukada Takashi, car elles sont désormais bien connues du public français. Ce courant d’études a été d’une grande fécondité mais il n’était pas dépourvu lui-même de biais ou d’angles morts. Ces derniers ont été récemment épinglés par les historiens d’un autre courant, réunis autour de Fukaya Katsumi et Ōhashi Yukihiro. Ces derniers veulent pour leur part redonner une place centrale aux ressorts de l’individu. En ce faisant, des questions nouvelles sont apparues comme : le désir d’ascension sociale, le rôle des femmes, le statut des populations « étrangères », la diversité des profils du « paysan » ou encore la question de l’identité régionale. Les articles réunis dans le présent numéro sont plus proches de ces orientations.
Si l’on se tourne vers les autres pays que sont la Chine et la Corée, on peut percevoir la même empreinte de l’historiographie marxiste, les mêmes tendances à privilégier le politique ou l’économique aux dépens du « social », en entendant par ce terme les valeurs et les pratiques qui structurent le quotidien des couches les plus humbles. L’attention des chercheurs s’est très nettement portée sur la bureaucratie impériale, supposée absorber les forces vives du pays et dotée d’un pouvoir symbolique sans égal. Si les historiens, et plus particulièrement les historiens occidentaux, n’ont que timidement cherché à étudier les couches plus modestes voire invisibles de la société, cela tient aussi à la difficulté de les saisir autrement que par des sources produites par cette bureaucratie ou par la littérature. Il convient cependant de souligner que le développement des gender studies et les facilités d’accès aux sources juridiques et aux archives judiciaires ont suscité dernièrement des études d’un nouveau type, appliquées notamment à l’étude de la sexualité et de la famille.
Le présent numéro réunit huit articles, issus pour sept d’entre eux d’une journée d’étude organisée en novembre 2015 à l’Université Paris Diderot sur le thème des « Statuts et identités dans les sociétés prémodernes en Asie ». La journée visait d’une part à montrer que la société japonaise sous les Tokugawa ne pouvait se résumer aux fameux quatre statuts (mibun) shi-nō-kō-shō (guerrier-paysan-artisan-marchand) mis en exergue par le discours confucéen et qu’il existait d’autres conditions, périphériques ou intermédiaires, qui méritaient attention. Il paraissait d’autre part important de souligner que le statut n’expliquait pas à lui seul la conduite d’un individu. Un individu pouvait être mû par des valeurs et des identités acquises ou cultivées incidemment au cours de sa vie : identité religieuse, identité régionale, identité nationale, identité de lettré, valeurs guerrières, etc. Cela permettait de sortir des déterminismes de classes et des explications reposant uniquement sur des arguments économiques ou politiques.
Ce projet s’accompagnait dès le départ d’une volonté de ne pas se limiter aux frontières du Japon, même si l’accumulation des recherches sur les statuts sociaux semble être un phénomène propre à l’historiographie japonaise des vingt-trente dernières années. C’est donc volontairement que le présent numéro n’est pas uniquement axé sur le Japon, mais qu’il comporte aussi un article sur l’élite intermédiaire en Corée et un article sur la population servile en Chine. La diversité des pays considérés aurait pu faire craindre un éclatement, mais force est de constater qu’il n’en est rien. Il existe en effet une grande proximité entre les sociétés de ces trois pays d’Asie orientale qui ont cheminé côte à côte, tout en suivant des voies différentes. Si bien que les questions soulevées pour un pays conservent de leur pertinence pour les autres. S’il existe une différence notable entre ces trois pays, elle réside dans le type de sources conservées, celui-ci étant déterminées bien souvent par le régime politique. Le seul défaut sérieux que l’on pourrait trouver au numéro serait le déséquilibre entre le format restreint d’un numéro de revue, et l’immense champ d’étude que représente l’histoire sociale de l’Asie prémoderne. Il convient de voir ce numéro comme le premier d’une série.
Les articles ont été regroupés en trois parties. Dans la première, on abordera, par deux voies distinctes, la mentalité des marchands au xviie siècle. Guillaume Carré nous conduit tout d’abord au cœur des réflexions d’un marchand de Kawagoe, une ville castrale moyenne située au nord de la capitale shogunale, en s’appuyant sur deux documents à caractère autobiographique, laissés par un marchand du nom d’Enomoto Yazaemon. Si ces documents n’ont pas vocation à révéler tous les ressorts de sa psychologie, ils nous en apprennent néanmoins beaucoup sur la mentalité d’une bourgeoisie au faîte de son ascension. On découvre ainsi comment son identité de bourgeois (chōnin) se nourrit de manière essentielle du succès de son négoce, de l’estime de ses pairs, de la reconnaissance par ses proches de sa stature de chef de maisonnée, ainsi que des relations de proximité qu’il entretient avec les puissants (le seigneur). On note que l’élite bourgeoise, dont Enomoto est un représentant, tend déjà à intégrer dans son discours des valeurs telles que l’ardeur au travail et la frugalité, qui constitueront par la suite le credo de la classe marchande. L’article de Carré nous apprend aussi au passage que la même élite était parfois investie par les guerriers de la mission d’édifier le peuple.
L’article de Daniel Struve qui lui succède offre une parfaite illustration de la manière dont certains marchands, pénétrés d’idéologie confucéenne, se sont acquittés de cette mission de précepteur. À travers deux essais au fil du pinceau de Nishikawa Joken, La Besace du bourgeois et La Besace du paysan, respectivement imprimés en 1719 et 1731, Struve examine le regard à la fois critique et confiant qu’un marchand de Nagasaki porte sur le peuple de son époque, alors que l’essor de l’économie modifie profondément son mode de vie et le rapport qu’il entretient avec les puissants. Il s’adresse d’un côté aux bourgeois (chōnin), les habitants des quartiers urbains, qu’il cherche à ramener vers la voie de la frugalité, de la mesure et de l’étude. Quant aux paysans (hyakushō), il les met en garde contre les risques auxquels ils s’exposent en suivant l’exemple des bourgeois. Fort de l’objectivité que lui confère sa naissance à Nagasaki, unique ville ouverte au monde extérieur, il prône les vertus de la simplicité, une qualité du peuple japonais fortement idéalisée, qu’il fait remonter au temps des Dieux.
Dans la seconde partie, se trouvent rassemblés trois articles portant sur des catégories de populations que l’on pourrait qualifier d’invisibles, dans la mesure où elles ont rarement été étudiées par les historiens. Il s’agit d’une part des prêtres shintō dans les villages de l’époque d’Edo, des esclaves dans la Chine des Ming, et enfin, des femmes dans les familles guerrières. Ces trois populations n’ont évidemment rien de commun, si ce n’est qu’elles sont difficiles à saisir au moyen des sources connues.
Les prêtres shintō décrits par Yannick Bardy sont des personnages définis a minima comme les desservants de sanctuaires de villages. Leur habit de religieux pourrait donner à penser qu’ils jouissent d’une distinction comparable à celle des moines bouddhistes. Mais il n’en est rien. Loin de leur conférer un statut, Bardy constate que la fonction de desservant n’assure a priori aucun capital symbolique ni matériel. Preuve que la pérennité de la fonction n’était pas garantie pour tous, certains ont cherché à se procurer des patentes auprès de maisons anciennement attachées à la cour impériale, telles que les Yoshida ou les Shirakawa. On voit ainsi qu’une population, sans grande qualification, a pu, au fil du temps, gagner quelque prestige et reconnaissance auprès de la communauté villageoise, en faisant appel à une source d’autorité extérieure et en s’insérant dans un réseau national.
Si l’on se tourne à présent vers l’état d’esclave dans la Chine des Ming décrit par Claude Chevaleyre, la situation est sensiblement différente dans la mesure où la population ici ne peut être définie que négativement, par des droits qui lui font défaut, et qu’aucune fonction ne lui est spécifiquement attachée. L’auteur se propose de la cerner ici à travers les documents institutionnels édités sous les Ming. L’un des constats auxquels il aboutit est le lien indissociable qui lie la servitude au châtiment. Le Code des Ming n’y recourt que dans les cas où l’on veut épargner la mort à des proches (enfants ou épouses) de grands criminels. Il ne s’agit pas pour autant de créer une caste, puisque l’État est soucieux d’ôter ce fardeau à ceux qui le portent depuis longtemps. Cette réflexion, qui lève le voile sur un phénomène jusque là peu étudié, a également le mérite d’interroger sur l’existence d’un lien comparable dans les autres pays d’Asie, ainsi que sur la possibilité que cette population ait pu dans d’autres contextes être à l’origine d’une discrimination de plus longue durée.
On a déjà évoqué le fait que les femmes avaient été oubliées dans la première vague d’études consacrées aux statuts sociaux. Il n’y a là rien d’étonnant, dans la mesure où statut et fonction sont indissociablement liés à cette époque et qu’à quelques exceptions près les hommes étaient les seuls héritiers de la fonction (shoku) attachée à une maison. Faut-il en déduire que les femmes n’avaient pas de statut ? C’est la question posée ici par Yūta Segawa, qui se penche sur le régime du mariage et du concubinat au sein des familles guerrières de l’époque d’Edo. Si le mariage répondait à des normes précises, obligeant notamment l’épouse à être de naissance guerrière et à verser une dot, le choix de la concubine était beaucoup plus libre, dans la mesure où rien ne la distinguait d’une domestique. Segawa fait l’hypothèse que le concubinat, dans les familles guerrières, répondait à plusieurs préoccupations de l’époque comme la nécessité de perpétuer la lignée, le désir d’échapper à la misère et de jouir des plaisirs de la vie.
Nous avons regroupé dans une troisième partie des articles mettant en jeu des identités ou des statuts émergents. Comme c’est souvent le cas, l’identité ne se manifeste ou ne s’affirme que quand elle est confrontée à un refus de reconnaissance.
C’est le cas des catholiques japonais dont nous parle Martin Nogueira Ramos. On connaît le succès foudroyant que cette religion a connu sur la terre japonaise à partir du milieu du xvie siècle, après l’arrivée des premiers missionnaires dans l’Archipel. La répression violente qui s’ensuivit a fait l’objet de nombreuses études. On connaît moins bien, cependant, la perception que les Japonais ordinaires pouvaient avoir de cette pratique religieuse, ainsi que la manière dont les convertis se représentaient leur propre religion. La voyaient-ils comme une religion étrangère ? La pratique de cette religion portait-elle atteinte à leur japonité ? Ce sont des questions auxquelles Nogueira Ramos tente de répondre ici en s’appuyant notamment sur des lettres échangées entre les camps opposés, lors de la fameuse révolte chrétienne de Shimabara (1637-38).
L’article de Noémi Godefroy s’intéresse pour sa part à l’évolution que le statut des chefs aïnous a pu connaître, avec l’intégration croissante de cette population dans l’économie japonaise de l’île de Hokkaidō. Aux yeux des Tokugawa, la population aïnou est une population étrangère, avec laquelle ils communiquent et échangent des biens, par l’intermédiaire du fief de Matsumae dont c’est la prérogative principale. Si la mentalité de ces chefs ne se laisse pas aisément saisir, il apparaît, à travers l’iconographie ou les rapports établis par des émissaires du bakufu sur l’île, que leur aura reposait de manière essentielle sur des « trésors » acquis grâce au commerce régional. Godefroy nous montre que, avec la multiplication des sites de production proto-industrielle dans le Hokkaidō, où les Aïnous étaient utilisés comme main-d’œuvre servile, ces chefs seront de plus en plus exposés aux tensions intra-ethniques et aux compromissions avec les Japonais.
Cette partie s’achève par l’étude de Kim Daeyeol sur les chungin ou gens intermédiaires, une catégorie sociale composée d’hommes qui, bien qu’issus de familles nobles, font l’objet d’une discrimination les empêchant d’accéder à des fonctions autres que celles, techniques, de médecin, comptable, interprète, astronome, légiste, dessinateur… Kim évoque les parcours de ces individus et leur ressentiment à l’égard d’un système qui ne reconnaît pas leurs mérites. Il montre aussi que ces chungin n’ont pas toujours choisi de se mettre en retrait, et qu’ils ont contribué, de par leur idéologie confucéenne et leur niveau d’éducation, à jouer le rôle de passeur entre l’aristocratie et le peuple.
François-Joseph Ruggiu, dans le regard extérieur, nous invite dans un premier temps à un exercice de comparaison avec l’historiographie française ou européenne, pointant à la fois des convergences tant dans les objets étudiés que dans les démarches adoptées pour les analyser. Il montre à travers de nombreux exemples que la comparaison peut ouvrir de nouveaux champs d’investigation à l’historien des sociétés asiatiques en même temps qu’offrir des instruments d’analyse insoupçonnés. Dans la seconde partie, Ruggiu revient sur les débats et les travaux auxquels les notions d’identité et de statut ont donné lieu dans l’historiographie occidentale. Il fait l’hypothèse que la richesse de l’historiographie japonaise sur la question du statut pourrait bien à son tour inspirer de nouvelles manières de penser la société française de l’Ancien Régime.
Bibliographie
Chevaleyre Claude (2012). « Acting as Master and Bondservant. Considerations on Status, Identities and the Nature of “Bond-servitude” in Late Ming China ». In Stanziani, Alessandro (dir.), Labor, Coercion, and Economic Growth in Eurasia, 17th-20th Centuries. Leyde, Brill : 237-272.
Ikegami Eiko (1995). The Taming of the Samurai, Honorific Individualism and the Making of Modern Japan. Cambridge (Mas.), Harvard University Press.
Kalland Arne (1995). Fishing Villages in Tokugawa Japan. Honolulu, University of Hawaii Press.
Kouamé Nathalie (2001). Pèlerinage et société dans le Japon des Tokugawa. Le pèlerinage de Shikoku entre 1598 et 1868. Paris, École française d’Extrême-Orient.
Ooms Herman (1996). Tokugawa Village Practice : Class, Status, Power, Law. Berkeley, University of California Press.
Smith Thomas C. (1959). The Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, Stanford University Press.
Smith Thomas C. (1977). Nakahara Family Farming and Population in a Japanese Village. 1717-1830. Standford, Stanford University Press.
Sommer Matthew Harvey (2000). Sex, Law, and Society in Late Imperial China. Stanford, Stanford University Press.
Sommer Matthew Harbey (2015). Polyandry and Wife-Selling in Qing Dynasty China : Survival Strategies and Judicial Interventions. Oakland, University of California Press.
Stanley Amy (2012). Selling Women : Prostitution, Markets, and the Household in Early Modern Japan. Berkeley, University of California Press.
Vlastos Stephen (1990). Peasant Protests and Uprisings in Tokugawa Japan. Berkeley, University of Califronia Press.
Walthall Anne (1991). Peasant Uprisings in Japan : A Critical Anthology of Peasant Histories. Chicago/Londres, University of Chicago Press.
Walthall Anne (1998). The Weak Body of a Useless Woman : Matsuo Taseko and the Meiji Restoration. Chicago, University of Chicago Press.
Zöllner Reinhardt (2003). Japans Karneval der Krise : Ejanaika und die Meiji Renovation. Munich, Ludicium.