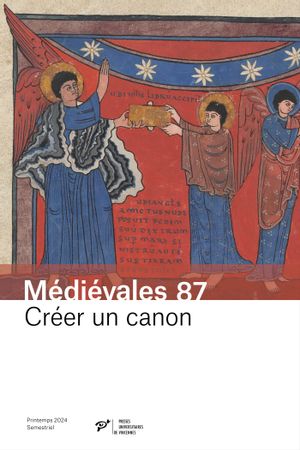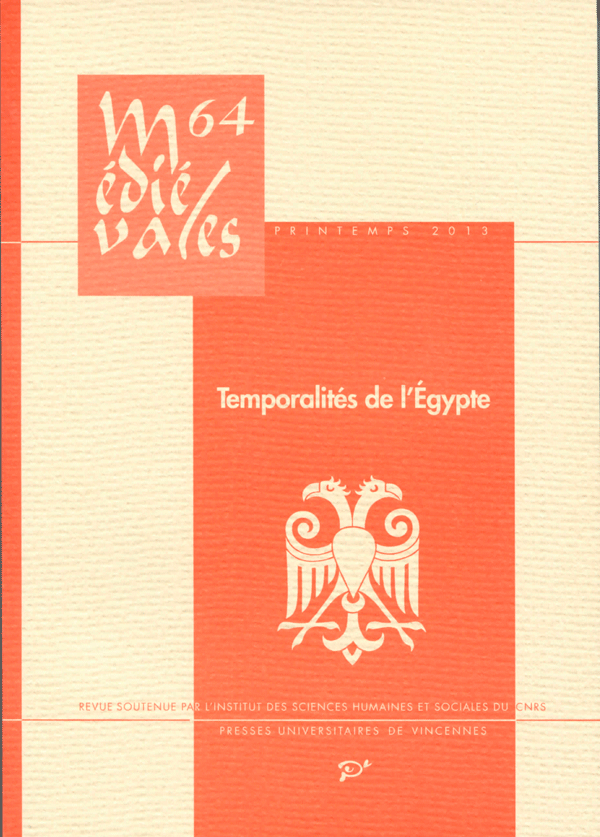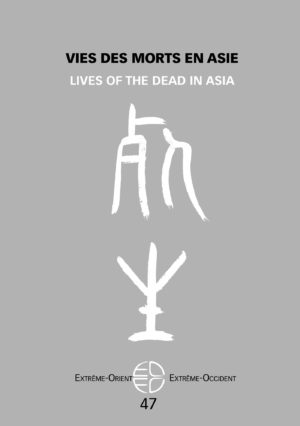Abbès Zouache
ruptures, transitions, continuités
dans l’histoire de l’égypte médiévale
Depuis peu, l’histoire de l’Égypte médiévale est « en chantier ». Cela peut s’expliquer diversement : les fouilles archéologiques (bien que peu nombreuses) ont livré une documentation qui commence à être prise en compte par les chercheurs ; ces derniers sont enfin touchés par le « retour critique » qui a essaimé, plus tôt, dans d’autres champs de la recherche ; un dialogue s’est engagé entre des disciplines (archéologie, histoire, philologie, linguistique, entre autres) jusque-là très cloisonnées.
L’ambition de ce dossier est d’illustrer le renouvellement en cours – d’où le bref état des lieux historiographique qui suit – et de contribuer à la réflexion sur les découpages chronologiques communément adoptés par les historiens de l’Égypte médiévale. Comme leurs pairs spécialistes d’autres aires culturelles, ils doivent procéder à des choix difficiles. Se démarquer des choix effectués par leurs prédécesseurs n’est pas chose aisée, même lorsqu’une documentation nouvelle apparaît. Tout discours savant est marqué par des déterminations dont Pierre Bourdieu a montré qu’il est souvent illusoire de vouloir s’en détacher. Les chercheurs découpent le monde et son histoire, le décrivent et l’interprètent en fonction de « schèmes cognitifs » qui les imprègnent « avec une telle profondeur » qu’ils en deviennent « invisibles ».
Ces déterminations pèsent probablement d’autant plus que les chercheurs sont peu nombreux et que leur discipline est fortement marquée du sceau de la tradition philologique, comme dans le cas de l’histoire de l’Orient musulman médiéval. Après la seconde guerre mondiale, les critiques qu’a subies l’orientalisme, du fait de ses liens avec la colonisation, ont conduit nombre de ses praticiens à réaffirmer leur ancrage philologique, et certains d’entre eux à adopter les objets et les méthodes des sciences sociales. L’un des objectifs affichés était d’atteindre une scientificité détachée des présupposés idéologiques et de rejeter les approches par trop généralistes au profit d’une histoire économique et sociale jusque-là largement délaissée. L’historiographie de l’Égypte médiévale n’a bénéficié que très progressivement de cette réorientation, avant donc de connaître un profond renouvellement, depuis quelques années.
L’effort d’édition et de traduction des sources orientales
La question des sources est fondamentale pour les historiens de l’Orient musulman, et notamment pour ceux qui s’attachent prioritairement à l’Égypte et au Bilād al-Šām, qui forment un couple rarement dissocié tout au long du Moyen Âge. L’effort d’édition et de traduction de sources inédites ou éditées de façon insuffisamment critique a été impulsé, en Europe, par des figures telles que Claude Cahen, décédé en 1991 après avoir été à l’origine de maintes entreprises individuelles ou collectives. Certaines de ces entreprises ont également été le fait de chercheurs arabes soucieux de se réapproprier un patrimoine dont ils estimaient en avoir été par trop dépossédés par les orientalistes. Beyrouth et Le Caire, qui concentrent l’essentiel des maisons d’édition arabes, jouent aujourd’hui un rôle moteur en matière éditoriale.
Cet effort a largement porté ses fruits. Cependant, la tâche est encore ample. L’on estime parfois (certes sans beaucoup de garanties) à trois millions le nombre de manuscrits médiévaux préservés dans l’ensemble de l’aire islamique. Certains textes, tels que les innombrables manuscrits de furūsiyya répertoriés dans les catalogues de bibliothèques, dont un bon nombre a été produit en Égypte, sont encore délaissés par les chercheurs, sans doute parce qu’ils sont écrits dans une langue technique et difficile d’accès même pour des arabisants confirmés.
Une « école historique » égyptienne
Les résultats les plus probants concernent les sources narratives (chroniques, dictionnaires biographiques), et en particulier celles de l’époque mamelouke (1250-1517). Nul historien de l’Égypte ne peut aujourd’hui en faire l’économie, même ceux qui tentent de réécrire l’histoire des débuts de l’islam : les chroniqueurs et les auteurs de dictionnaires biographiques d’époque mamelouke conservent souvent une documentation plus ancienne et aujourd’hui disparue. Les œuvres d’époque mamelouke les plus importantes sont désormais plus accessibles, et des synthèses fiables permettant de démêler les liens à première vue inextricables qui les unissent sont disponibles. La première de ces œuvres, les fameuses Ḫiṭaṭ d’al-Maqrīzī, a récemment été rééditée par Aymān Fu’ād Sayyid. Cette « autopsie de la ruine », qui témoigne de la fascination d’al-Maqrīzī pour le passé égyptien et plus particulièrement pour celui de sa capitale Fusṭāṭ-Le Caire, est considérée comme le chef-d’œuvre d’un genre littéraire, « l’histoire topographique ». Les Ḫiṭaṭ permettent de dessiner les contours d’une « école historique égyptienne » au caractère « national » marqué, attachée à l’histoire d’un territoire autant qu’à celle des hommes qui y vivent, un territoire à l’identité si affirmée que ces hommes et les dynasties qui s’y succèdent doivent s’y incarner.
Comme ses pairs, al-Maqrīzī peut encore s’appuyer, à l’époque où il écrit, sur les traces multiples laissées par ses prédécesseurs – documents administratifs et privés, monnaies, etc. – que l’Égypte médiévale a laissées en nombre, notamment grâce à des conditions climatiques propices à leur conservation. Concernant les « handwritten documents », papyri et autres supports, ils sont plus nombreux qu’on l’a longtemps cru et font désormais l’objet d’une attention soutenue des chercheurs, après avoir été ignorés ou simplement appréhendés comme des sources d’information secondaires. Désormais, l’on s’attache plus systématiquement – ainsi Sobhi Bouderbala et Mathieu Tillier dans ce dossier – à reconstituer les liens entre la documentation papyrologique et les sources narratives.
Les débats autour de la révélation muḥammadienne : l’histoire de l’Égypte quelque peu délaissée
Une telle documentation s’avère précieuse pour qui souhaite sortir de « l’impasse méthodologique » dans laquelle le courant « sceptique » a plongé les spécialistes de l’histoire des débuts de l’islam à partir des années 1970. Ce courant a remis en cause de manière radicale la fiabilité des sources islamiques narratives de l’histoire des premiers musulmans. Ces sources, qui ont été rédigées pour l’essentiel dans l’Iraq abbasside à partir du iiie/ixe siècle, ne feraient que mettre en scène la révélation muḥammadienne ; elles présenteraient une vision orientée et déformée des débuts de l’islam, correspondant aux attentes des musulmans qui vivaient à l’époque de leur rédaction.
Cette remise en cause a eu l’avantage de dynamiser la recherche. Différentes voies sont désormais explorées pour sortir de cette impasse méthodologique. Les uns privilégient le recours aux sources non musulmanes, notamment syriaques, qui posent également des problèmes d’interprétation ; les autres s’attachent à reconstituer « la genèse, l’élaboration et la canonisation de la tradition et de l’histoire islamique » par un patient travail d’archéologie des textes. Leurs travaux, qui provoquent parfois des réactions de rejet dans les pays musulmans, ont eu l’inconvénient de centrer l’analyse sur les sources narratives irako-syriennes, au détriment parfois de la documentation issue d’autres territoires conquis par les musulmans, comme l’Égypte.
Les sceptiques ont parfois mobilisé l’archéologie pour étayer leurs thèses. J. Koren et Y. Nevo ont nié l’existence de Muḥammad, en s’appuyant surtout sur la numismatique et l’épigraphie : il est absent des graffitis les plus anciens du Neguev mais aussi d’Arabie. Ils ont soutenu l’idée que l’islam n’apparaissait qu’à partir de la fin du viie siècle, la conquête et la création d’un État arabe ayant précédé la naissance de la religion. Leurs travaux, qui sont remis en cause, tiennent plus d’une « archéologie de la religion » (D. Northedge) que d’une archéologie s’attachant à la diffusion de pratiques culturelles dans différentes sociétés, dans différents espaces.
Celle-ci est pourtant assez active – surtout dans les pays qui appartenaient, au Moyen Âge, au Bilād al-Šām (Syrie, Jordanie, Liban, Israël et territoires palestiniens, frontière syro-turque) – et ne suscite pas de controverses aussi passionnées. En Égypte, elle est encore insuffisamment développée – et utilisée par les historiens –, peut-être du fait de la fascination qu’a toujours exercée son patrimoine archéologique antique. Les fouilles qui ont été menées à terme et publiées sont peu nombreuses. Celles du plateau d’Istabl ‘Antar, au sud de Fusṭāṭ (le Vieux-Caire actuel), la première capitale de l’Égypte islamique, sont en passe de l’être. Dirigées par Roland Pierre-Gayraud de 1985 à 2003, elles illustrent à merveille la « problématique des continuités, de l’innovation et des croisements culturels », qui est désormais privilégiée par les spécialistes de l’Égypte.
Transition linguistique, transition religieuse
Ces fouilles confirment ce que la documentation papyrologique ou les études toponymiques, en plein renouveau, montrent par ailleurs : la conquête arabe n’a pas provoqué, en Égypte, les changements abrupts et définitifs que les historiographes musulmans se plaisent souvent à décrire. L’arabisation et l’islamisation ont été des phénomènes lents, non concomitants. Au ier/viie siècle, une nouvelle langue est introduite par les conquérants arabes. Après leur victoire et leur installation dans le pays, ils doivent longtemps faire traduire les actes administratifs pour que les agents de l’administration puissent les faire appliquer. L’arabe semble s’être définitivement imposé comme langue de communication écrite dès la fin du iiie/ixe siècle, du fait sans doute des progrès de l’islamisation, mais aussi parce que cette langue était devenue une langue de savoir incontournable pour les lettrés.
Que la « transition linguistique » n’ait pas été rapide ne fait donc aucun doute. L’on parle d’ailleurs, à propos des trois siècles qui suivent la conquête arabe, « d’expérience multilingue ». Ont cohabité en Égypte le grec, le copte et l’arabe, en sus du judéo-arabique présent dans les documents de la Geniza du Caire. Concernant les périodes les plus tardives, la réflexion sur le multilinguisme est entamée : sous les Mamelouks, l’élite militaire pratique le turc et/ou le kiptchak, sans cependant ignorer l’arabe, et promeut la langue turque, dont la pratique est un signe de distinction. Cependant, on en sait peu sur la communication orale. Par exemple, la généralisation de l’arabe dans l’administration et dans la littérature (chrétienne ou musulmane) ne présume en rien de sa pratique en tant que langue de communication orale, notamment dans les milieux ruraux, où semble également avoir longtemps perduré une onomastique copte traditionnelle.
Sans doute les rythmes d’arabisation diffèrent-ils d’une région à une autre. Il en va de même de l’islamisation, en Égypte comme ailleurs. Dans le village de Damūyah, dans le Fayyūm, à une centaine de kilomètres du Caire, des archives analysées par Jean-Michel Mouton laissent penser que l’arabe s’est imposé à la fin du iiie/ixe siècle comme langue de communication écrite dans les actes notariés comme dans les correspondances privées ; mais la population demeure très majoritairement copte. Ces archives confirment que périodiser le processus d’islamisation (qui peut s’expliquer par la conversion mais aussi par la démographie) n’est pas chose aisée. D’ailleurs, depuis une quarantaine d’années, les chercheurs ont proposé plusieurs périodisations. Deux possibilités ont été privilégiées : pour les uns, les Égyptiens deviennent majoritairement musulmans dès le iiie/ixe siècle ; pour les autres, cela n’est vrai qu’à une période plus tardive – à partir du viiie/xive siècle pour Jean-Claude Garcin. Récemment, Shaun O’Sullivan et Tamer el-Leithy ont à nouveau plaidé l’un pour la période haute, l’autre pour la période basse.
En fait, la question qui doit se poser n’est pas seulement celle du nombre, mais également celle du poids et du dynamisme culturel de chacun des groupes socio-linguistiques. La communauté copte, par exemple, est sans doute moins nombreuse au viie/xiiie siècle que quatre siècles auparavant, alors qu’elle était culturellement en transition, mais elle n’en est pas moins dynamique. Tout au long de l’histoire égyptienne, l’installation de nouveaux maîtres (Arabes, puis Turcs) provoque des croisements culturels que l’on met désormais plus souvent en lumière. L’archéologie est à cet égard riche d’enseignements. À Fusṭāṭ, les reliefs floraux des plaquettes en os mises au jour sont de tradition alexandrine et antique ; ils n’en révèlent pas moins l’importation de nouveaux modèles venus d’Iraq qui semblent ensuite à leur tour essaimer à Alexandrie. La « continuité technique » est évidente ; en revanche, en matière artistique, ces objets dénotent une transition marquée par l’importation de motifs s’accordant avec la culture des musulmans. Plus tard, à la fin du vie/xiie siècle, la construction de la muraille du Caire semble donner lieu à une « architecture de transition » entre une architecture fatimide très raffinée et l’architecture ayyoubide plus monumentale, plus à même de représenter les nouveaux « sultans militaires » qui se sont imposés en Égypte à la fin des années 1160, et plus adaptée aux évolutions de la guerre de siège provoquées par l’installation des Croisés en Syrie.
Inscrire la réflexion dans le temps long
Ces croisements apparaissent clairement dans les textes de furūsiyya que j’envisage dans ce dossier, ou dans les différents manuscrits des Mille et Une Nuits étudiés par Jean-Claude Garcin. Ils participent d’une double dynamique : celle de l’importation d’une culture du centre irako-syrien et celle du lent renouvellement local de cette culture, renouvellement qui prend des formes diverses, selon les hommes qui l’impulsent. En Égypte, où un « sentiment national » perdure tout au long du Moyen Âge, il a une coloration typiquement égyptienne et se tourne vers une « conformation à la norme religieuse ».
Doit-on s’étonner de cette double dynamique et des temporalités multiples dans lesquelles tout renouvellement s’opère ? La recherche récente tend à montrer la nécessité d’inscrire la réflexion sur l’histoire égyptienne dans le temps long, de se garder donc de toute « rupture » entendue comme une coupure brutale, de se contenter de découpages plus lâches, et de penser cette histoire en termes de « transitions », des transitions entendues comme des temps de passage d’un mode de fonctionnement à un autre. Mathieu Tillier souligne d’ailleurs, dans sa contribution, que l’institution judiciaire ne se transforme que lentement, après la conquête arabe. Les procédures héritées perdurent longtemps, se remodèlent progressivement et s’étendent sur tout le territoire égyptien selon un rythme différent des périodisations dynastiques traditionnelles. Sobhi Bouderbala n’écrit rien de différent dans son étude sur les pratiques sociales en matière de biens inaliénables (ḥubs, pl. aḥbās). Malgré les efforts des pouvoirs publics soucieux de rompre avec le ‘urf (droit coutumier), la normalisation de ces pratiques est lente et sans doute encore incomplète, deux siècles après que les musulmans se sont installés en Égypte.
Cette normalisation dépend d’autres facteurs que la seule injonction des puissants, et notamment de la volonté des hommes d’occuper une place éminente dans la société et des stratégies qu’ils mettent en place pour y parvenir. Après la conquête arabe, la conversion à l’islam devient progressivement l’une des conditions de l’ascension sociale. Les Banū Ḥinnā s’y résolvent au tournant des xiie et xiiie siècles. Mathieu Eychenne ne peut reconstituer leur histoire que partiellement : les sources à sa disposition ne disent rien de certaines étapes de leur parcours. De ces silences, qui peuvent ou non faire sens, il s’accommode sans peine. Porté par sa documentation, il a accès, en retraçant la destinée de cette famille, au temps long, celui d’un pays et d’une ville, Fusṭāṭ-Miṣr, qui, dès sa fondation et pour longtemps, se mue en un lieu de mémoire pour ses habitants.
Un historiographe aussi brillant qu’al-Maqrīzī a également pris la précaution d’inscrire sa réflexion dans le temps long, ainsi que le rappelle Julien Loiseau. Non pas systématiquement : il réagit aussi parfois « à chaud », par exemple à propos d’une crise qui touche l’Égypte en 806/1403-1404. Il conçoit primitivement cette crise comme une rupture majeure dans l’histoire du pays et de la ville (Fusṭāṭ-Le Caire) qu’il chérit tant. Puis sa réflexion évolue au fil de son œuvre, et il offre une interprétation au long cours des mutations auxquelles l’Égypte est confrontée depuis la conquête arabe.
Quelle périodisation adopter ?
Le temps long est donc bien en passe, comme l’écrit Julien Loiseau, de devenir la « prédilection des historiens de l’Islam », et plus particulièrement de ceux, plus nombreux aujourd’hui qu’hier, qui se penchent sur l’histoire de l’Égypte médiévale. Cela les conduit, en s’appuyant sur d’autres disciplines que l’histoire (notamment la littérature et l’archéologie) à remettre en cause la périodisation adoptée par leurs devanciers, qui ont souvent suivi les périodisations dynastiques traditionnelles nonobstant le fait que chaque champ (politique, social, économique, intellectuel, technique, etc.) évolue selon son rythme propre et son échelle de déclinaison (locale, régionale, nationale). « Les milieux, les hommes et les objets évoluent dans des ‘‘temporalités’’ aux rythmes différents » ; le choix d’une périodisation dépend du champ que l’historien choisit d’étudier.
Pour peu que l’on s’astreigne tout de même à proposer une périodisation simple de l’histoire de l’Égypte médiévale en tenant compte tout à la fois des apports de l’histoire, de l’archéologie et des autres disciplines que l’historien est amené à pratiquer, l’on peut s’appuyer sur les réflexions de Konrad Hirschler sur l’ensemble de l’aire islamique. Faire débuter le Moyen Âge lors de la conquête arabe et le faire s’achever au début du xe/xvie siècle, ainsi qu’il l’écrit, « n’est pas très utile, même si [une telle périodisation] reflète, dans une large mesure, les schèmes choisis par les historiens arabes médiévaux eux-mêmes ». Ne faut-il pas plutôt parler d’une longue phase de transition qui serait rattachée à l’Antiquité tardive et qui s’écoulerait jusqu’à la fin du iiie/ixe siècle ou le début du ive/xe siècle, la langue arabe et l’islam s’étant enfin largement imposés en Égypte et les traits caractéristiques de la société islamique s’y étant nettement dessinés ? Et faire débuter au xe/xvie siècle un « Moyen Âge finissant » (dont les contours chronologiques restent à préciser), marqué par la provincialisation et l’ottomanisation progressives du pays ?
En tout état de cause, quelle que soit la périodisation adoptée par les chercheurs, il est difficile de faire l’économie des représentations des hommes du passé, fussent-elles connues à travers des sources partielles et partiales. Ainsi, lorsqu’il fait de l’année 755/1354, qui voit se multiplier en Égypte les violences et les mesures antichrétiennes, une année cruciale dans l’histoire égyptienne – une « rupture », au sens propre du mot&nbs