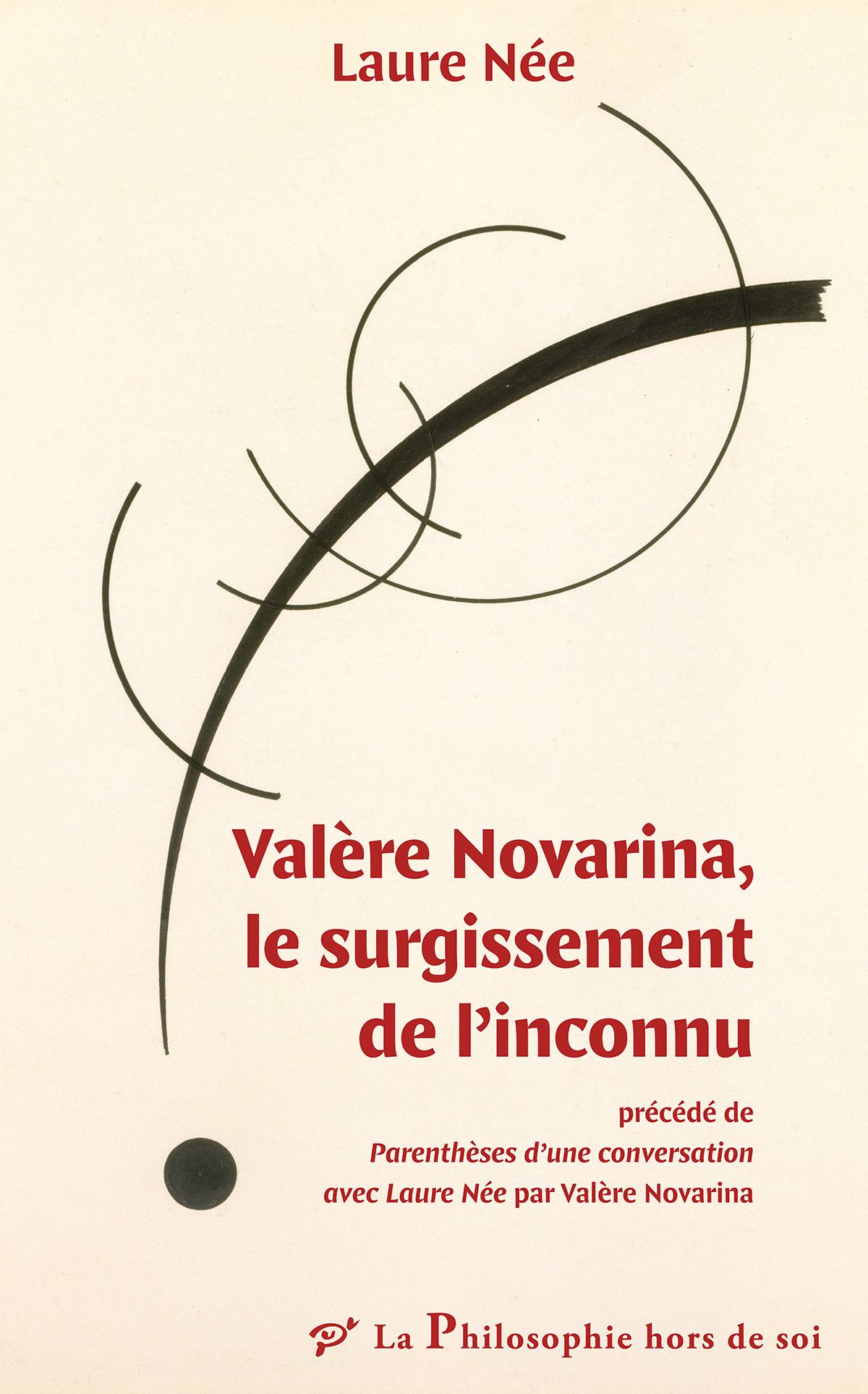Qui vive ?
L’œuvre de Valère Novarina échappe, elle n’est jamais là où on l’attend, elle court-circuite les prévisions et la mainmise qu’on pourrait prétendre avoir sur elle tant elle est diverse, perpétuellement en mouvement, en incessante effervescence. On pourrait reprendre, au sujet de l’expérience que nous faisons à la lire, ce que Maurice Blanchot dit de son expérience de lecteur de Lautréamont dans la préface qu’il écrit aux Chants de Maldoror : « Lire Maldoror, c’est consentir à une lucidité furieuse dont le mouvement d’enveloppement, d’embrassement, se poursuivant sans trêve, ne se laisse reconnaître qu’à son terme et comme l’accomplissement d’un sens absolu, indifférent à tous les sens momentanés par lesquels cependant doit passer le lecteur pour atteindre le repos d’une suprême signification totale 1. » Cette « folie » de Novarina, au sens où Blanchot parle de celle du jeune poète, nous entraîne dans un vertige. Celui de voir se brouiller les notions de raison et de déraison que, dans notre désir de repères stables, on croyait nettement séparées. Et l’on pourrait continuer à suivre la préface de Blanchot car, mot pour mot, les phrases du critique épousent mon sentiment de lectrice de Novarina : « Oui, la “raison” est étonnamment ferme chez Lautréamont, aucun lecteur “raisonnable” ne peut en douter. Mais justement cette raison est si forte, elle est d’une telle étendue qu’elle semble aussi embrasser tous les mouvements de la déraison et pouvoir comprendre les plus étranges forces aberrantes, ces constellations souterraines sur lesquelles elle se guide et qu’elle entraîne cependant avec elle sans se perdre et sans les perdre 2. » Apparence de désordre, structure mystérieuse à laquelle semble présider le refus d’un ordre trop attendu. Dans l’écriture novarinienne, comme dans celle d’Isidore Ducasse, « Nous ne savons pas où nous allons, nous nous perdons dans de tristes dédales, mais le labyrinthe qui nous perd se révèle exactement construit et pour nous perdre, et pour nous perdre plus encore en nous laissant croire que nous nous sommes retrouvés 3. » Sans doute une distinction est-elle à faire ici, car l’univers labyrinthique novarinien n’est pas construit pour nous perdre. Il impose sa forme chaotique, si surprenante que, sans repères par rapport à lui, nous nous y perdons, et nous nous y perdons encore, et sommes obligés de dépasser l’ancien réflexe qui est celui de vouloir tout embrasser par la force de notre raison pour tenter de nous y retrouver. Ce faisant, l’abandon des structures anciennes auquel nous oblige l’œuvre de Novarina est un levier puissant, non pour nous faire nous retrouver, mais pour faire le deuil de ce pli mental. Jetés en avant sommes-nous, sans certitude, désancrés de nos tentatives de repli identitaire, vigilants à l’instant, prêts à saisir ce qui est en train d’arriver. « Est-il un autre ouvrage qui, comme celui-là, d’un côté tout à fait à la merci du temps, inventant ou découvrant son sens à mesure qu’il s’écrit, étroitement complice de sa durée, demeure cependant cette masse sans commencement ni fin, cette consistance intemporelle, cette simultanéité de mots, où semblent effacées et à jamais oubliées toutes traces d’avant et d’après 4 ? » C’est bien ce sentiment que nous éprouvons de ne savoir par quel bout commencer, puisqu’une œuvre de Novarina n’est pas linéaire, pas plus que Les Chants de Maldoror, et qu’elle oblige le lecteur à plonger dans l’inconnu, sans assurance sur l’objet à y trouver, avec pour seul viatique l’idée que l’entreprise est sans doute à elle-même l’objet de la quête.
Nous sommes mis en appétit, jetés dans la surprise et la réjouissance, sans avoir d’abord à faire usage de notre rationalité. Contrairement à beaucoup d’univers théâtraux qui peignent un tableau sombre de la situation de l’homme dans le monde, un nouveau mode pour témoigner de la présence n’est-il pas, comme cela apparaît dans l’œuvre de Novarina, d’en finir avec l’idée de fin et de trancher le nœud gordien en redonnant leur légitimité à la santé et à la joie d’être au monde, sans pour autant nier la difficulté à vivre, les épisodes tragiques de l’Histoire ou la mort ? Au contraire même : en s’appuyant sur ce constat tragique. La force de ce qui n’est ni encore pensé ni encore arrivé traverse cette œuvre. À ne parler que des spectacles présentés depuis une quinzaine d’années, une gourmandise des mots met l’eau à la bouche, réjouit l’esprit, suscite l’étonnement, déclenche le rire : L’Espace furieux à la Comédie française en 2006, L’Acte inconnu en 2007 à Avignon et au Théâtre de la Colline, Le Monologue d’Adramélech, en 2009 au théâtre de la Bastille, L’Opérette imaginaire en novembre 2010 5 à l’Odéon, Le Vrai sang à l’Odéon en 2011, Le Vivier des noms en 2015 au Cloître des Carmes d’Avignon, L’Homme hors de lui en 2017 et L’Animal imaginaire en 2019, à la Colline – cette pièce signalant la nécessité d’une cure d’« hilarothérapie » – et enfin Le Jeu des ombres, à la FabricA d’Avignon en octobre 2020 – pièce dans laquelle des courants de vie traversent la mort d’Eurydice : nous devenons des Orphées, qui ne cessons de sortir de nos ténèbres.
Quels principes meuvent l’œuvre colossale ? À quoi doit-elle son énergie et son allant inépuisables ? Elle est un flux continu, comme un fleuve héraclitéen 6 qui sans cesse s’écoulerait toujours nouveau et brasserait pourtant toujours ses eaux anciennes. Œuvre qui se jette en avant dans un nouveau défi et qui reprend inlassablement, avec des variations, les mêmes questions : celles de l’homme parlant jeté dans l’univers. C’est encore cette question qui est convoquée dans les dernières pièces, L’Animal imaginaire et Le Jeu des ombres. Temps, espace, matière et langage sont au cœur de la problématique inlassablement reprise, toujours la même, toujours autre. « Que faire pendant la matière 7 ? » est une question centrale et récurrente posée par Novarina au travers de ses personnages. Étudier la façon dont l’inconnu prêt à surgir aimante le désir, court-circuite l’ennuyeux attendu, et déjoue les pièges de la glose sur des événements déjà révolus, la façon dont les possibles de la vie à venir sont maintenus ouverts, malgré le huis clos de l’homme dans l’espace et le temps, malgré l’incertitude de ce que sera l’avenir, et grâce à cette intranquillité même, c’est ce qui m’a aimantée dans l’œuvre de Novarina, ce qui m’a poussée à écrire. Comme dans un exercice spirituel, mon regard sur la vie, la mienne et celle des autres, sur le monde, a été traversé par l’œuvre. Les questions qu’elle nous invite à nous poser sur le récit de nos vies, nos raidissements idéologiques par crainte de l’incertain, notre inscription dans le temps, la peur de la mort, l’accord des êtres, la joie fugitive d’un moment, la place du rire pour déstabiliser nos architectures-palissades, aèrent nos esprits, ne formulent aucune injonction. Le seul impératif qu’elle exprime : échapper à nos prisons mentales, ouvrir nos frontières, nous jeter dans les chemins inconnus de nos vies aventureuses, être le plus libre possible.
L’exercice est donc délicat qui consiste à fixer la réflexion sur la question de l’inconnu, du devenir laissé libre d’advenir, par une forme qui évite pourtant de figer l’œuvre, elle qui s’oppose farouchement à tout arrêt du mouvement, à tout enfermement. Comment concilier ces deux exigences contradictoires ? Celle du critique qui pose des noms qui risquent, par son langage discursif, de figer des mécanismes ; celle de l’œuvre, si diverse, vivante et insaisissable, qu’elle court-circuite toutes les tentatives de maîtrise, de classification qu’on voudrait opérer sur le corps du texte 8 ? En respectant le mouvement de l’écriture, je voudrais ici approcher les principes mis en place par Novarina pour construire cette œuvre démesurée, libre et ouverte à l’imprévisible de ce qui n’est ni encore pensé ni pensable. Les grandes entrées dans l’œuvre de Novarina couvrent des champs de savoir multiples et étendus. Les questionnements philosophiques, théologiques, littéraires, esthétiques, psychanalytiques, sont nécessaires pour appréhender l’œuvre, son étendue, sa démesure, et son caractère insaisissablement mouvant. Pour être fidèle au mouvement de cette œuvre qui pratique le « débordre », ne connaît pas la limitation dans un champ de savoir particulier, pas plus que les frontières génériques, l’angle d’approche doit être à la fois précis pour éviter le flou, et large pour que la matière de l’œuvre soit le moins possible réduite. L’analyse transversale s’est imposée comme une évidence. Et c’est en suivant la logique interne de l’œuvre que j’ai été amenée à constater que certaines notions-clés ou entrées dans l’œuvre appartenaient aussi bien à la philosophie qu’à la psychanalyse, à l’analyse littéraire et théâtrale, à l’approche esthétique. Le même et l’autre, l’intérieur et l’extérieur, le sujet et l’objet, le vide et la matière, le fragment et le tout, la présence et l’absence, le mot et la chose, le temps, la naissance, l’être, la singularité, la mélancolie, la mort, le langage : approche philosophique ? psychanalytique ? littéraire ? théâtrale ? Les regards croisés de ces disciplines – et encore faudrait-il en convoquer d’autres pour rendre compte au plus juste de l’étendue des horizons abordés 9 – outre qu’ils manifestent la perception de son étendue, laissent à l’œuvre son ouverture et son inachèvement pour dire le surgissement de l’inconnu.
Qu’est-ce qu’une pièce de Novarina ? Après Artaud, Beckett et Ionesco, l’auteur poursuit le travail de sape d’un théâtre représentant la réalité et l’homme agissant dans cette réalité. Il prend à contre-pied les principes qui régissent le théâtre occidental, tels qu’ils ont été fixés par Aristote. Ses pièces ne racontent pas une histoire, il n’y a pas de nœud ni de dénouement, pas de personnages au sens habituel de ce terme. En effet, en marge d’une pratique théâtrale persistante même après Beckett et Artaud, l’auteur s’attache résolument et avec constance à faire naître la scène « au présent d’apparition » comme il le dit, à faire que, sous les yeux des spectateurs, soit donné un théâtre de l’homme en train de venir au monde par le langage, s’opposant ainsi à figer la pièce dans une histoire close, nécessairement tournée vers le passé. Partant, son œuvre s’ingénie à déjouer les pièges tendus par tous les mécanismes qui pourraient la figer. Michel Corvin écrit de Novarina qu’il cherche à rendre le spectateur « témoin d’une pensée en train de prendre – comme la glace – à l’instant même où elle se transforme en mots 10 ». C’est bien ce « en train de », ce « sur le point de » qui intéresse mon propos. Par définition, l’inconnu ne peut être saisi, sinon il perd sa propriété.
On perçoit dans le geste esthétique novarinien la présence marquante d’une pensée de l’instabilité et de l’impermanence telle qu’elle peut apparaître chez Augustin, Montaigne et Pascal, dont Novarina est lecteur. Dans l’univers novarinien, là où la tranquillité serait porteuse d’immobilité, de mort, de finitude, le mouvant, avec son instabilité et son risque, fait le prix de l’existence, dans le mouvement toujours à recommencer, pour une vie toujours à naître. Le sentiment de la déroute réveille, suscite l’urgence du désir de vivre, fait trouver des issues, provoque l’inconnu. Contre la tranquillitas des philosophes et des sages, Nietzsche s’écriait : « Bâtissez vos maisons au bord du Vésuve 11 ! » Chez Novarina aussi, on est toujours près du volcan, sur le qui-vive 12, non pour fuir en avant névrotiquement mais pour éviter la mort du désir. Le qui-vive implique une vigilance. Être aux aguets dans un mouvement de vie ouvert sans cesse aux possibles d’une vie postulée comme infinie. Mais de ce fait, une question se pose à nous : comment écrire, sans le figer, un théâtre du présent chaotique toujours ouvert à ce qui est à venir ? à ce qui est sur le point de surgir ? à ce qui est appelé par nos mots désirants ?
En écrivant des pièces qui ne s’inféodent pas à une histoire déterminée par cause et conséquence, en laissant advenir l’inconnu, l’auteur s’inscrit dans le sillage philosophique de Nietzsche, philosophe qui combat une vision linéaire du temps, qui, contre l’esprit rétrospectif et frileux de ses contemporains, s’ingénie à ouvrir l’espace du devenir, à remettre en chantier le mouvement de la vie avec ses risques, et à faire du chaos la possibilité d’une création à venir. L’œuvre de Novarina se déploie en effet en réaffirmant sans cesse les commencements insoupçonnés dans un monde intranquille. Le mouvement du devenir, d’un devenir ouvert aux possibles, in-coupable, ne peut exister que si, conjointement, l’inconnu est accepté avec la part de risque fécond qui lui est consubstantielle.
Les principes qui président à l’écriture du théâtre de Novarina sont en effet liés à la philosophie nietzschéenne, à la valorisation qu’elle fait du chaos, du risque 13 et de l’intranquillité. Car c’est de ces notions, habituellement considérées comme porteuses d’anxiété, que peut naître un avenir non formaté, neuf, où les cartes du possible sont à nouveau brassées. On comprend donc que l’allégeance aux principes aristotéliciens de la Poétique ne soit pas viable pour Novarina. S’il n’y a pas de principe qui préside à l’organisation d’un tout, comment le microcosme de l’œuvre pourrait-il, lui, sans trahir le mouvement aléatoire du temps, montrer le sens de l’enchaînement des choses entre un début et une fin ? Mais quoi montrer, dans une pièce, qui ne soit ni une cause, ni une conséquence ? Le choix formel d’un théâtre libre de tout devoir de s’inscrire dans une fable, avec la logique interne qui lui est propre, ne répond pas à une volonté d’affranchissement des conventions, mais à une impossibilité de penser le réel autrement que comme une variation sur des possibles en suspens. En effet, isoler une histoire dans la continuité du temps serait déjà céder à un arbitraire qui fausserait l’idée d’un devenir, toujours présent et à venir. À l’idée du temps, est liée celle d’une cause de « l’événement » que le théâtre aristotélicien se propose de dégager en vue d’un dénouement. Or « l’événement » ne peut avoir lieu, puisque dans l’écoulement du devenir, toujours le même et toujours différent, aucune cause responsable ne peut être isolée qui aurait produit tel ou tel événement identifiable. Car c’est bien l’absence de « responsabilité », de quelque instance que ce soit, qui est ici en jeu, ce que Nietzsche nomme « innocence du devenir 14 ». En privilégiant une vision du devenir « innocent », le philosophe sous-entend aussi que rien n’a de sens préalable, non que tout soit absurde – surtout pas – mais que le ou les sens sont aléatoires. Il n’y a pas de direction du temps. Ainsi le théâtre de Novarina n’obéit-il pas à la règle de la cause, pas plus qu’à celle – qui ne serait que son envers – du non-sens. Le geste d’écriture novarinien va donc porter la marque de l’invention d’un nouveau rapport à ce qui peut être dit et montré sur scène.
Accepter la part de risque d’un futur, incertain 15 certes, mais porteur de possible, comme le fait Novarina, alors même qu’une pratique théâtrale répandue étale aux yeux des spectateurs violence, conflits d’un présent actuel – donc déjà passé –, c’est résolument œuvrer en marge de ses contemporains. L’audace et la constance à miser sur l’ouverture de possibles jamais clos, sur l’aventure inconnue mais infinie – sans déni de la mort –, autant que sur la santé et la joie, font de l’auteur un inactuel, puisant sa force dans l’insoumission aux modes de faire contemporains de l’écriture théâtrale et de la pratique scénique.
Novarina, un hapax dans le théâtre de son temps ? L’œuvre de l’auteur apparaît, à bien des égards, comme singulière dans le paysage littéraire contemporain. N’est-ce pas parce qu’elle sait, par-dessus l’époque et ses questionnements, renouer avec des temps plus anciens, inventer des ancrages pluriels, parmi d’autres écrivains essentiels – l’impact de Beckett, Artaud, Lautréamont, est grand – sans pour autant être mue par un mécanisme passéiste – et donc idéaliste ? Œuvre sans tentation régressive donc, qui ne se sent en aucune façon dépendante des vieilles images, ni du « vieux style », sur lequel ironise Beckett dans Oh les beaux jours. Il est très remarquable que l’auteur pratique un pas de côté qui lui permet de n’être pas pris dans le tourbillon des sujets brûlants de l’actualité. Oser être inactuel est une façon de se dégager d’une certaine vue myope et de redonner du champ à la réflexion. C’est ce point qui sera central dans la première partie. Le fait de prendre de la distance par rapport aux sujets d’actualité et d’échapper ainsi aux affolements médiatiques qui braquent le projecteur sur tel ou tel sujet pourrait laisser penser à un désengagement, politique, par exemple. Mais les notions d’engagement et de désengagement devront être étudiées : et s’il y avait, avant de s’engager ou de se désengager, à se défaire des évidences sur la question de l’humain ? La prise de distance critique de l’inactuel qu’est Novarina, loin d’être un refus de prendre position politiquement, permet à l’auteur d’être plus libre de renouer le dialogue avec tel ou tel penseur : philosophe, théologien, écrivain, poète, qu’il appartienne à l’Antiquité ou aux temps modernes. Ce questionnement philosophique, qui passe par un questionnement philologique, permet donc d’opérer une remise en question large de l’humain.
Il n’y a là aucune attitude de mépris ou de condescendance à l’égard de l’époque, comme on peut la percevoir chez certains écrivains désenchantés. Il ne s’agit en aucun cas chez Novarina d’un retrait amer, qui serait dû à un besoin de fuir une société décevante, pour la solitude et la compagnie d’auteurs anciens, plus dignes d’être lus. Aucune trace de désenchantement, de regret mélancolique, pas plus que d’idéalisation des temps passés. Aucune inquiétude non plus liée à l’idée d’une perte de valeurs qui serait le fait de notre société et de notre temps, aucune insurrection contre la perte de l’autorité ou l’irresponsabilité du sujet 16. Ces questions sociologiques peuvent être présentes dans l’œuvre de Novarina, mais elles ne font pas l’objet d’un débat direct. C’est que, plutôt que de raisonner sur la nature des problèmes d’une société ou les causes de l’état observé, l’écriture novarinienne procède, comme celle de Nietzsche, « à coups de marteau ». Plutôt que de se focaliser sur les nœuds et de fixer le présent malade dans une image qui les fige, elle mise sur le mouvement de la vie, même chaotique, rendant ainsi possible son renouvellement.
L’écriture vise, par-delà bien et mal, à enclencher une nouvelle dynamique qui passe par la remise en chantier de la langue. Si elle poursuit l’entreprise de déconstruction beckettienne, ce n’est, pas plus que chez Beckett d’ailleurs, dans le but de stigmatiser l’homme – coupable, ou victime –, mais dans celui de créer un chaos, en cela différent du but beckettien. Là où Beckett creuse le vide de l’innommable, considère l’idée de fin, Novarina construit sur le chaos, et crée des terrae incognitae de la langue. Pour en finir avec l’idée de fin, l’idée de dévastation, ou avec l’idée de consolation telle que celle-ci peut apparaître chez certains dramaturges, et pour redécouvrir le désir, l’appétit, et la joie, il convient que la langue soit réinterrogée et remise en chantier. C’est par là qu’un mouvement de vie peut reprendre. Le processus qui est remis en marche tend à créer les conditions d’un renouvellement des images, mais non à des fins futures de restauration d’ordre. Pas plus que de lecture crépusculaire il n’y a, chez Novarina, de chant du départ. Ni oiseau de Minerve, ni chantre de l’aube renaissante.
Mais comment écrire le mouvement de la vie ouverte à tous vents ? Quel est le centre d’une pièce de Novarina ? Quel objet en constitue le cœur ? Dans une seconde partie, l’objet des pièces de Novarina retiendra mon attention. Si les sujets d’actualité ne sont pas propres à redonner vie au mouvement, quels sujets peuvent susciter à nouveau l’éveil du désir – celui de vivre, d’aimer, de croire en la joie possible, de laisser l’inconnu entrer dans l’espace ? Sur quoi écrire quand on ne raconte pas une histoire ? Que racontent les pièces de l’auteur ? Par rapport à la crise de l’objet initiée dans les arts au début du xxe siècle et poursuivie, après le traumatisme d’Auschwitz, par une mise en crise de la légitimité du visible, comment le théâtre de Novarina prend-il place ? Si, comme le dit l’auteur, il y a comme un interdit de la représentation qui plane sur son théâtre 17, ce n’est pas tant par rapport à une réalité de l’horreur de la Shoah qui laisse sans voix que par une conviction forte que toute représentation de situations réelles est en elle-même fausse. Tenter de saisir un événement rétrospectivement est un leurre. Ce qui importe, ce n’est pas de représenter l’événement clos, mais de faire naître le présent, et pour ce faire, de l’aérer, de le désenclaver des représentations qui le figent, de ventiler le récit trop normatif qu’on ferait de lui au profit d’une pluralité de récits possibles qui n’arriveront jamais à en faire le tour. Ce qui importe donc, c’est de montrer sur scène l’impossibilité de saisir le présent, de montrer le mouvement « incapturable ». Mais par ce choix, que donne-t-il à voir sur scène, puisque théâtre il y a ? Que voit-on sur scène quand un auteur montre l’inconnu sur le point de surgir ? Ainsi, dans ce théâtre de la parole traversante, aura-t-on à analyser l’objet dérobé, et plus que son absence, le mouvement de l’objet en train de passer. Le passage de l’objet, sa dérobade permanente, assure le maintien du désir.
Si l’objet d’une pièce se dérobe, le lieu, lui aussi, est mouvant. Loin qu’un centre puisse être discernable dans les pièces de l’auteur, le centre est partout, les foyers infinis, ce qui empêche la saisie de l’objet. L’inactualité se double d’une pluralité des centres – temps pluriels, espaces pluriels – pour restituer le caractère mouvant d’un réel vivant, toujours autre, se déployant toujours vers des zones inconnues. Mécanismes de déconstruction, jeu avec les formes dramatiques anciennes permettent à l’œuvre d’éviter de s’immobiliser dans un état qui pourrait devenir statique. Enfin il importe que la langue – chair de l’homme, vrai sang, selon la terminologie novarinienne – ne devienne pas un objet, un instrument de communication banalisé, mais qu’elle retrouve sa prodigieuse capacité de renouvellement imaginaire. On assiste dans l’œuvre de Novarina à une attaque de la langue-objet et de l’ordre figural de la langue.
C’est qu’une certaine idée d’homme est, elle aussi, questionnée, et que si l’œuvre de l’auteur invite à s’interroger sur la question de l’objet, elle est dans le même temps le théâtre d’un questionnement de l’humain. Un troisième temps de la réflexion sera donc consacré à la question du sujet, dans l’œuvre de Novarina. Les notions de « sujet » et d’« objet » sont interdépendantes car le refus novarinien de s’enfermer dans un théâtre de la représentation a pour corollaire l’impossibilité de représenter l’homme, puisque celui-ci est postulé incapturable. Le théâtre novarinien, dans sa peur de l’image fixe, porteuse de mort en ce qu’elle fige un processus, n’en finit jamais de fuir la fable, de déconstruire les histoires, et, dans le même geste, de libérer l’homme des filets de la représentation. Remettre l’humain en question, pratiquer une défiguration 18 de son image, comme cela s’est produit aussi dans les arts plastiques au début de xxe siècle, est un moyen d’en finir avec l’idolâtrie et de renouveler nos représentations. Refus de l’humanisme, refus de l’identité unique, déconstruction critique des mythologies qui nous agissent sont caractéristiques d’un mouvement de libération des images emprisonnantes de l’homme. La stase et son cortège de dangers – l’idolâtrie, le narcissisme, le fétichisme, la mélancolie – sont fuis, parfois même avec violence. Toutes les prisons du moi. Le fait de se refuser à s’enfermer dans la représentation du mal, récent ou ancien, permet de remettre en circulation l’humain, de faire renaître un mouvement que l’appesantissement dans telle ou telle réalité avait arrêté, et de libérer le champ des possibles. Le chaos est pensé comme participant d’une remise en marche qui permet une « sortie de soi ». « Hors de soi », entendu comme saine colère et mouvement extatique vital pour désarticuler les mécanismes identitaires qui nous retiennent prisonniers 19. Surprendre pour réveiller le regard et l’ouïe, atrophiés par l’excès : « Y a trop de tout, / Moi, c’est le rien / Que je préfère », chante dans La Scène La Machine à dire la suite 20. Au fond de l’homme, « personne ». La tâche de l’écrivain s’en trouve modifiée : elle consiste à opérer une sortie du statut de « créateur », et à s’effacer, dans un acte de dépossession, tentant de faire exister les choses par elles-mêmes, tendant à réussir le prodige de laisser parler le langage.
Quelle poétique peut bien embrasser une dramaturgie du mouvement, où l’objet et l’événement sont insaisissables, où l’humain se dérobe à la représentation ? Dans quelle esthétique ce choix du mouvement de la vie toujours à naître peut-il s’inscrire ? J’analyserai, dans un quatrième et dernier temps, le choix novarinien de la santé et de la joie, en tentant de saisir les modalités de ce processus dans l’œuvre du dramaturge contemporain. Il s’agit bien de foi, mais pas de foi en Dieu 21, telle qu’une littérature en accord avec la théologie l’a préconisée, ni de foi en l’homme, comme l’humanisme de la Renaissance, et la philosophie des Lumières ont pu la croire possible. Si DIEU est présent, nous le savons avec Novarina, c’est comme anagramme de VIDE 22. Nul savoir dispensé non plus par un auteur-professeur de vérité. Plutôt un « gai savoir » qui se fait dans le mouvement même du temps, sans certitude définitive, mais avec la jubilation d’un apprentissage jamais clos. On retrouverait dans cette puissance de la joie la trace de la pensée que Clément Rosset développe dans La Force majeure 23. Quelle esthétique assez libre permet de laisser émerger le flux de joie, qui ne soit à son tour figé dans une forme académique ? Quelle parade trouver à la forme fixe du discours pour écrire le mouvement incessant et la circulation des possibles ? Il s’agira de saisir les formes inventées par Novarina pour court-circuiter l’ordre figé du discours et de la langue, pour donner au mouvement son ampleur et lui permettre de se déployer dans le sens d’un renouvellement infini.
L’entreprise démesurée novarinienne allie deux mouvements contraires qui participent d’une poétique de l’inconnu surgissant : un mouvement large vers une totalité, pourtant d’emblée postulée comme inatteignable (toute fabrication de perspective est refusée chez Novarina), et un mouvement de fragmentation kaléidoscopique, brisant en autant d’éclats le mouvement précédent, comme pour barrer la route à un mécanisme qui deviendrait totalitaire, et donc clos et enfermant. Le devenir postule l’inachèvement. La respiration de l’œuvre, pour vivre dans le temps et aller vers le futur, s’appuie alternativement sur les deux mouvements d’inspiration et d’expiration. Deux mouvements contraires, comme les deux étapes de la respiration : mouvement de dissémination, qui irait du moindre vers le large ; mouvement de constriction, de parcellisation.
Participerait du premier mouvement d’élargissement le recyclage interne de l’œuvre, sous la forme de la variation, à partir d’une œuvre-matrice, comme l’étudie Céline Hersant, sur les analyses de qui nous nous fonderons. Ce premier courant contiendrait une postulation implicite du principe de l’Un, en ce que l’œuvre novarinienne, à l’image de la Bible, ou du Livre total mallarméen, a la tentation de tout dire, se livre à l’hybris d’un langage logorrhéique qui recherche l’exhaustivité, revient sur elle-même par auto-citations, « se nourrit de sa propre matière », « installe un temps circulaire, qui est celui de la re-création perpétuelle et d’une logophagie insatiable […] », selon les termes de Céline Hersant 24. La recherche d’unité est donc bien présente, avec ses thématiques obsessionnelles, son ressassement. Au recyclage interne, j’ajouterai le dialogue avec les écrivains et penseurs qui comptent pour Novarina, et qui participe, selon moi, d’une poétique du surgissement de l’inconnu. Le recyclage d’une pensée universelle, avec qui l’auteur est en dialogue, prend des formes diverses. Simple clin d’œil, appel à la pensée de tel ou tel sur un problème philosophique, le procédé peut aller jusqu’au plagiat, revendiqué par Lautréamont, dont les influences sont sensibles dans l’œuvre de Novarina. Le texte novarinien est comme un palimpseste qui porte la trace de pensées diverses et contradictoires. Ce procédé de collage inattendu (et parfois insoupçonné du lecteur) appartient aussi, selon moi, au mouvement d’amplitude d’une œuvre dont « le centre est partout et la circonférence nulle part » et contribue à l’expansion infinie d’un mouvement vers des possibles insoupçonnés.
À une poétique fragmentale appartiendrait le deuxième courant. Un mouvement de séparation et d’éclatement maintient sans cesse ouverte l’œuvre : tout est en effet mis en œuvre, paradoxalement, pour empêcher l’irrespirable de la recherche d’absolu 25. Au mouvement centripète de l’Un, s’oppose ainsi un mouvement centrifuge libérateur, qui aère, par la présence du Multiple, l’espace concentré, en le rendant à sa sauvagerie ouverte. C’est donc le double mouvement de cette poétique du devenir infini 26 qui sera au centre de la dernière partie de ce travail, puisqu’il permet de laisser advenir l’inconnu sans l’enclore et qu’il ouvre le présent impensé, opère un « laisser naître ». L’esthétique de la « désenclôture » inclut une pratique de l’ambiguïté et de la contradiction, puisque les principes du Oui et du Non se partagent le devant de la scène. Les contraires, loin de se résoudre dialectiquement, sont juxtaposés, ce qui crée une dynamique qui lance l’œuvre toujours en avant. Contradiction fructueuse puisqu’en héraclitéen, ici, Novarina permet l’avancée d’une œuvre « polémique » qui, à l’image du fleuve, n’en finit pas de se grossir de l’opposition et de la diversité. L’alliance des contraires ouvre un espace infini, sans solution, ni résolution 27. On aura donc à comprendre la place occupée par le négatif dans l’œuvre de l’auteur, et à faire une distinction essentielle entre les intentions d’une littérature nihiliste et celles de Novarina, qui accorde à la voie négative une place primordiale, sans que la destruction soit une fin en soi. La voie négative – ce que Novarina nomme le niement –, véritable ascèse, permet de veiller au grain, en l’occurrence ici veiller au manque, bien essentiel qui évite la saturation du trop et les certitudes totalitaires.
L’étude du pilier principal de cette architecture aura sa place : le corps de l’acteur, et son appui majeur : le souffle. Si Valère Novarina parle d’« écriture pneumatique », c’est bien que le souffle est central dans sa poétique. Non seulement comme respiration nécessaire à l’acteur pour dire le texte, mais plus profondément comme principe vital, tel qu’il peut apparaître dans la philosophie stoïcienne. Le corps de l’acteur et la musique – l’accordéon de Christian Paccoud – sont l’air nécessaire à l’œuvre. C’est donc le corps de l’acteur, l’esprit-souffle, la musique et le texte, mouvant, qui se rencontrant, face au public, peuvent permettre le surgissement d’un moment de grâce fugace, vite évanoui pour laisser la place libre à un autre temps inadvenu.
Là où d’autres dramaturges peuvent choisir un théâtre de l’exhibition de la violence, de la déploration ou de la consolation pour tenter de dire l’actualité, Novarina privilégie délibérément un théâtre de la naissance, et même, grâce au surgissement de la présence porté sur les planches par l’acteur, c’est à une naissance du théâtre, jamais figé, toujours à naître, qu’il nous est donné de prendre part. Le présent est instable, en métamorphose, ouvert à ce qui n’est pas encore advenu ni pensé. C’est l’inactualité de Novarina – l’inactualité étant à considérer comme une ouverture à la pluralité des temps – qui permet à son œuvre de prendre en compte dans un même mouvement passé et futur, pour naître en devenir. Désancrage temporel, identités archipéliques, nomadisme, intranquillité, empêchent la stase de l’œuvre, sa mort, et lui confèrent l’élan, le rebond, dans un espace où le jeu est infiniment renouvelable, où le rire retrouve sa place, en contrepoint de la gravité. « Gai savoir », l’œuvre est joueuse, elle donne envie de « rentrer dans la danse », comme dit la chanson. Loin que l’espace des possibles ouvert à l’infini inhibe le mouvement, la manière novarinienne dote l’inquiétude d’une vertu essentielle : celle d’accueillir l’inconnu à perpétuité.
1. Maurice Blanchot, « Lautréamont ou l’espérance d’une tête », préface à Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Paris, José Corti, 1973, p. 107.
2. Ibid., p. 109.
3. Ibid., p. 110.
4. Ibid., p. 115. Je souligne.
5. La pièce, créée le 21 septembre 1998 au théâtre Le Quartz à Brest, dans une mise en scène de Claude Buchvald, est reprise en 2010 à L’Odéon avec des acteurs hongrois dans une mise en scène de l’auteur.
6. Michel Corvin parle, lui, non pas d’eau mais de forme « invertébrée » : Michel Corvin, Marchons ensemble, Novarina ! Vade mecum, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, p. 11.
7. Novarina, Je suis, Paris, P.O.L, 1991, réplique de Jean Singulier, p. 29. Id., Pendant la matière, Paris, P.O.L, 1991.
8. L’auteur s’en prend à la pratique de la dissection des textes littéraires. Ce n’est pas « un morceau de littérature [qui] s’offre à nous comme le bœuf en effigie chez le boucher » ou comme « cadavre sur la page, ouvert et prêt à être décortiqué… ». Si tant est que le critique essaie de se servir de sa « panoplie de scalpels », force lui serait de constater que « Seul le cadavre serait atteint… L’utilité d’une dissection est surtout de nous enseigner comment la vie nous échappe : l’esprit du texte ne peut être touché par le scalpel. » : Valère Novarina, Lumières du corps, Paris, P.O.L, 2006, section Brûler les livres, p. 111-113, pour les citations.
9. D’autres champs de savoir pourraient être évoqués : la physique, par exemple, Novarina exprimant l’idée que l’étude du langage devrait être redonnée aux physiciens. Des notions comme la matière et le vide, la singularité, pourraient, à l’évidence, bénéficier de cette approche. Le physicien Étienne Klein a consacré un article à l’ouvrage de Novarina Pendant la matière : « En attendant la matière », dans Alain Berset (dir.), Valère Novarina. Théâtres du verbe, Paris, José Corti, « Les essais », 2001, p. 301. Le champ de la musique pourrait également être exploré au travers des liens que Novarina établit entre pensée et musique (cf. conférence du 19 avril 2019 à la Philharmonie de Paris : « La musique ouvre l’espace où se joue la pensée »).
10. L’écriture serait un « instantané qui immobilise et fixe, comme reçu d’ailleurs, le mouvement incoercible d’une pulsion rythmique » : Michel Corvin, Marchons ensemble, Novarina ! Vade mecum, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, p. 15 et 16.
11. Cité par Stefan Zweig, Nietzsche, Paris, Stock, « La Cosmopolite », 2004, p. 75. Comme Nietzsche, Novarina se refuse à la banalité de vivre.
12. C’est par opposition à l’idéal d’équilibre, au désir de repos, à la tranquillitas de certains philosophes combattus par Nietzsche que je choisis le terme de qui-vive à propos de Novarina. Une « intranquillité » dans un sens proche de celui d’inquiétude. L’Inquiétude est le titre d’une pièce de Novarina.
13. La notion de risque est explorée remarquablement en psychanalyse et en philosophie par Anne Dufourmantelle. Je renvoie à son très beau livre L’Éloge du risque, Paris, Payot, 2011.
14. Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, chapitre : « Les quatre grandes erreurs », paragraphe 8, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1974, p. 46.
15. Novarina aime à citer cette pensée de Pascal et la met dans la bouche du personnage La Parole portant une planche : « Travailler pour l’incertain ; aller sur la mer ; passer sur une planche », écrit Pascal, Pensées, fragment 324, édition de Léon Brunschvicg, Paris, Flammarion, « GF », 1976, p. 161. Je renvoie à l’article de Philippe Di Méo, « Travailler pour l’incertain ; aller sur la mer ; passer sur une planche », L’Infini, n° 19, été 1987, p. 197-198.
16. Plusieurs penseurs s’intéressent à la perte des valeurs. Parmi leurs ouvrages, Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1985 ; Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979 ; George Steiner, Nostalgie de l’absolu, Paris, Éditions 10/18, 2003 ; Richard Millet, Désenchantement de la littérature, Paris, Gallimard, 2007.
17. Novarina, Lumières du corps, Paris, P.O.L, 2006 : « La représentation est interdite » et « Plane peut-être ici quelque chose comme un interdit de la représentation », respectivement, §50, p. 30 et §83, p. 49.
18. Pour la question de la défiguration, je me fonderai sur les analyses d’Évelyne Grossman, La Défiguration. Artaud, Beckett, Michaux, Paris, Éditions de Minuit, 2004.
19. Je renvoie à « L’homme hors de lui », entretien de Valère Novarina avec Jean-Marie Thomasseau, Europe, n° 880-881, août-septembre 2002, p. 162.
20. Novarina, La Scène, Paris, P.O.L, 2003, p. 47.
21. Novarina a écrit, à seize ans, un Contre Pascal, non publié jusqu’à présent.
22. « Dans notre langue, il y a un [sic] splendide anagramme de DIEU, c’est VIDE. » : Valère Novarina, Lumières du corps, op. cit., section « L’esprit respire », paragraphe 88, p. 52.
23. Clément Rosset, La Force majeure, Paris, Éditions de Minuit, 1983.
24. Céline Hersant, « Je cherche la quadrature du langage : Novarina géomètre » dans Pierre Jourde (dir.), La Voix de Valère Novarina, actes du colloque de Valence 2004, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 16 et 32.
25. Rappelons que Mallarmé est victime d’un spasme du larynx. Étouffement de la voix, mots noués dans la gorge, étrange mal qui renvoie à l’aphasie baudelairienne. La poétique novarinienne s’appuie, elle, sur le souffle.
26. À une autre échelle, le texte est lui-même en devenir, le texte imprimé bouge entre les éditions successives d’un même ouvrage, cette inquiétude du texte participant de sa dynamique, jamais achevée. Pour l’analyse génétique des mouvements de l’œuvre, je renvoie à l’étude de Jean-Marie Thomasseau, « Les Manuscrits de théâtre. Essai de typologie », Littérature, n° 138, « Théâtre : Le retour du texte ? », juin 2005, p. 97.
27. La compagnie de Novarina s’appelle « L’Union des contraires ».