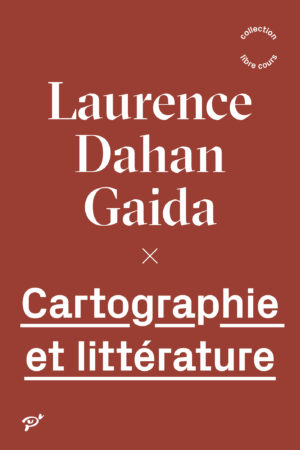Avant-propos :
Sara De Balsi
Quand je lus pour la première fois la Trilogie des jumeaux d’Agota Kristof, je fus frappée, comme tant d’autres, par l’extrême sobriété, l’économie des moyens et en même temps la complexité structurelle de la narration – ce mécanisme parfait dont le lecteur finit par être la victime ; mais ce qui me stupéfia était la parfaite coïncidence entre la violence du récit et la violence faite à la langue, qui me semblait en lien étroit avec l’expérience linguistique singulière de l’auteure, celle d’un apprentissage tardif et difficile de sa langue d’écriture.
Le présent ouvrage poursuit cette intuition première, en proposant une lecture d’Agota Kristof à la lumière de sa situation d’écrivaine francophone translingue : une auteure pour laquelle le français est une langue seconde apprise tardivement et par une démarche individuelle, en l’absence d’une communauté linguistique d’origine partiellement ou totalement francophone.
Le translinguisme, mode d’existence ainsi que thème constant de l’œuvre, constitue un accès privilégié aux textes. Par son prisme, dans les cinq chapitres qui forment ce volume, j’examine l’imaginaire des langues et de la traduction de l’auteure, je propose une analyse sociologique et socio-discursive de l’œuvre, j’étudie son cheminement à travers les genres et interroge la place, en son sein, du thème fondamental de la frontière.
Cet ouvrage est issu d’une partie de ma thèse, intitulée La Francophonie translingue à l’épreuve d’Agota Kristof, soutenue à l’université de Cergy-Pontoise le 4 décembre 2017.
Je remercie les Archives nationales suisses de Berne et en particulier Marie-Thérèse Lathion, ancienne responsable du fonds Agota Kristof, pour m’avoir permis de consulter dans les meilleures conditions possibles les manuscrits kristoviens en avril 2014.
Ce livre est dédié à Riccardo Barontini, pour son soutien indéfectible, pour sa confiance et sa patience, pour son aide, pour son humour, pour sa capacité d’imaginer et de me faire imaginer chaque jour mille autres vies possibles.
Introduction :
Sara De Balsi
La fluidité atavique m’est étrangère. C’est là une nouvelle condition pour la langue elle-même. La fluidité atavique n’est plus qu’un des modes de l’expression de la langue, elle n’en résume pas le « secret ».
Édouard Glissant
Souvent étudiée comme écrivaine déracinée, exilée voire traumatisée, Agota Kristof ne l’est pas encore assez comme écrivaine francophone, et très peu comme écrivaine francophone translingue. La question du changement de langue est néanmoins très présente, à la fois dans son œuvre romanesque, dont l’écriture en langue étrangère est l’un des thèmes principaux, dans son récit autobiographique, centré sur son rapport à l’écriture, et dans ses interventions publiques, qui répondent souvent à la question, fréquente pour les écrivains francophones, « pourquoi écrivez-vous en français ? ».
Si la critique a négligé cet aspect fondamental, c’est, me semble-t-il, en raison de la singularité d’Agota Kristof dans le panorama francophone et translingue contemporain, qui se manifeste par deux caractéristiques particulièrement frappantes : d’une part, une œuvre parfaitement monolingue, là où les textes francophones mettent le plus souvent en scène, par différents moyens, le contact linguistique dont ils sont issus ; d’autre part, un discours résolument à contre-courant de l’imaginaire « classique » de la langue française, tel qu’il est souvent réinvesti par les écrivains translingues, fondé sur les idées de clarté, de logique, d’universalité et de richesse de cette langue, ainsi que sur son potentiel de langue « de liberté ».
Malgré ces particularités, l’expérience du changement de langue – de vie et d’écriture – a contribué de manière décisive à l’élaboration de la poétique de l’auteure.
La littérature francophone translingue
On observe à partir de la fin des années 1980 l’émergence en France de nombreux textes problématisant en leur sein le changement de langue effectué par l’auteur et, de ce fait, le rendant non seulement visible, mais central. Cela n’advient pas en marge de la production littéraire de leur auteur (comme c’était le cas pour les écrivains translingues des générations précédentes, tel Cioran), mais dans des essais, des fictions et des autobiographies. Des textes pionniers de ce point de vue sont l’essai Étrangers à nous-mêmes de Julia Kristeva (1988) et le roman autobiographique Paris-Athènes de Vassilis Alexakis (1989). Au cours des années 1990, des œuvres de ce type accèdent à la reconnaissance littéraire ; en 1995, Le Testament français d’Andreï Makine remporte les prix Goncourt, Goncourt des lycéens et Médicis, ce dernier ex aequo avec Alexakis pour La Langue maternelle. Depuis, le changement de langue et le choix d’écrire dans la langue étrangère ont trouvé une large place dans de nombreux romans, récits autobiographiques et essais, ainsi qu’une vaste reconnaissance.
Comment en vient-on à écrire dans une langue étrangère ? Par quoi ce choix peut-il être motivé ? Quelles conséquences comporte-t-il sur le plan esthétique ? Certains textes se configurent précisément comme des réponses à ces questions : on pense à des œuvres autobiographiques telles que Nord perdu de Nancy Huston, Le Dialogue de François Cheng et Une langue venue d’ailleurs d’Akira Mizubayashi.
Dans d’autres textes la question du changement de langue et de langue d’écriture se pose à l’intérieur d’un cadre plus vaste : celui d’une narration – plus ou moins autobiographique – ou d’un essai. Chez certains – on pense à des ouvrages de Jorge Semprun, Hector Bianciotti, Vassilis Alexakis, ou encore de Brina Svit, Maria Maïlat, Chahdortt Djavann et Rouja Lazarova – c’est la problématique de l’écriture en langue étrangère qui prime ; d’autres, comme Milan Kundera dans L’Ignorance, mettent en scène le changement de langue et ses implications dans la vie des personnes exilées. Les textes d’Agota Kristof, notamment ses romans Le Troisième Mensonge et Hier ainsi que son récit autobiographique L’Analphabète, problématisent à la fois le changement de langue et l’écriture en langue étrangère.
Cette nouvelle visibilité des écrivains francophones translingues s’est traduite par une série de tentatives critiques pour les appréhender en tant qu’objet unitaire.
Dans l’introduction de Poétiques francophones, Dominique Combe est le premier à attirer l’attention sur l’existence d’une « francophonie individuelle ». Pour Combe, des écrivains ayant écrit une partie de leur production en français, tels que Beckford, Wilde, Beckett, Rilke, Strindberg, Istrati, Cioran, avec leurs œuvres en français « remettent en question le postulat selon lequel il n’y a de francophonie que collective ». Ces observations introductives ainsi que le chapitre spécifiquement consacré au changement de langue ont ouvert une réflexion qui a donné lieu à un certain nombre d’études sur la question, chacune d’elles proposant une dénomination différente pour son objet. Le premier de ces ouvrages, Singularités francophones ou choisir d’écrire en français, par Robert Jouanny, paru en 2000, livre une série d’études consacrées à des auteurs particuliers, mais renonce à formuler une théorie générale pour souligner la spécificité irréductible de chaque « singularité » examinée. En 2005, dans Les Exilés du langage, Anne-Rosine Delbart propose pour cet ensemble d’écrivains la définition d’« écrivains français venus d’ailleurs », où l’adjectif « français » est entendu non pas au sens géographique mais – avec un refus du terme « francophone » – au sens linguistique : « un écrivain qui écrit en français, qu’il soit de nationalité française ou non ». Dans Langue française, langue d’adoption, Véronique Porra, évitant à son tour l’adjectif « francophone », définit son corpus d’étude comme « les écrivains allophones d’expression française ». Enfin, les travaux récents d’Alain Ausoni reprennent le néologisme « translingue » introduit par le chercheur états-unien Steven G. Kellman dans The Translingual Imagination, en l’adaptant « pour référer au phénomène d’une écriture acquise tardivement ». Dans Mémoires d’outre-langue, Ausoni élabore une typologie fondée sur la relation des écrivains translingues à la langue française telle qu’elle est rejouée dans l’écriture de soi, genre largement investi.
Je reprends, pour ma part, l’adjectif translingue dans l’acception que lui donne Ausoni d’un passage (trans-) tardif et non nécessairement définitif d’une langue à l’autre, et je l’associe plus directement aux littératures francophones, avec lesquelles les écrivains translingues partagent nombre de caractéristiques : renvoi par l’institution littéraire à une situation d’illégitimité dans la langue, problématisation du choix du français, condition d’insécurité voire de surconscience linguistique, élaboration d’un métadiscours sur la langue et sur la traduction, thématisation des langues et de la traduction, en lien étroit avec les questions de l’identité, de l’étrangeté et de l’exil, dans les œuvres littéraires.
Parmi les études consacrées jusqu’ici aux écrivains francophones translingues, celle d’Ausoni est la seule à consacrer un chapitre à l’œuvre d’Agota Kristof (bien qu’en se limitant à son récit autobiographique L’Analphabète), tandis que les autres se bornent à en relever la singularité (Combe, Jouanny, Delbart) ou l’excluent de leur corpus en raison de sa marginalité géographique par rapport à la France (Porra).
Étudier Agota Kristof en tant qu’écrivaine translingue me semble en revanche nécessaire, non pas pour souligner la singularité de son expérience biographique ou de son écriture, mais, au contraire, pour dé-singulariser sa démarche, en l’insérant dans une réflexion plus vaste sur le choix d’écrire en français et sur ses conséquences esthétiques et poétiques. Loin d’être un principe explicatif de l’œuvre, son appartenance à la francophonie translingue constituera un point de départ pour son questionnement. J’interrogerai par ce biais les positionnements de l’auteure, les transformations de sa poétique, ses stratégies d’écriture.
Cartographie de la critique
Née en 1935 à Csikvánd, dans le nord-ouest de la Hongrie, Agota Kristof grandit avec ses parents et ses deux frères à Kőszeg, près de la frontière avec l’Autriche. C’est de là qu’elle quitte la Hongrie pendant l’insurrection de 1956, avec son mari et sa fille d’à peine quatre mois. Ils s’installent en Suisse romande, dans le canton de Neuchâtel, où Kristof apprend le français, qu’elle ne connaissait pas auparavant et qui deviendra, après une période de coexistence avec le hongrois, sa seule langue d’écriture littéraire. Au cours des années 1970, elle se lance dans l’écriture de pièces pour le théâtre et pour la radio ; en 1986 elle publie aux éditions du Seuil Le Grand Cahier, premier volet d’une trilogie romanesque au succès mondial.
Composée d’une dizaine de pièces de théâtre, de quatre romans, d’un recueil de nouvelles, un récit autobiographique et un recueil bilingue de poèmes publié à titre posthume, l’œuvre kristovienne rencontre l’intérêt à la fois d’un vaste public (elle est traduite en une trentaine de langues et a donné lieu à deux adaptations cinématographiques) et de la critique internationale. Agota Kristof s’est éteinte à Neuchâtel en 2011.
Une rapide cartographie de l’ensemble des études existantes me permettra de mettre en lumière les acquis et les manques d’une critique kristovienne en devenir. Je passerai en revue d’abord les études qui envisagent l’œuvre de Kristof dans sa singularité, ensuite celles qui l’insèrent dans un ensemble.
*
Il existe cinq monographies consacrées à l’œuvre kristovienne, dont trois exclusivement à la Trilogie des jumeaux, une au théâtre et une à l’ensemble de son œuvre. Toutes se concentrent en grande partie sur ses thèmes essentiels : le déracinement, l’exil, le dédoublement identitaire, le mensonge et la manipulation, la survie dans le système totalitaire, l’écriture. Ces études s’attardent en outre sur la question complexe du genre littéraire des trois volets de la Trilogie.
Le translinguisme est traité en tant qu’aspect biographique, sans qu’une enquête approfondie ne soit menée sur ses conséquences poétiques. Rennie Yotova traite la « question de la langue » à des moments précis de son ouvrage, dont le but principal demeure le traitement des grands thèmes de la Trilogie des jumeaux ; l’étude consacrée au théâtre présente, quant à elle, une section sur le translinguisme de l’auteure, pour se concentrer sur la phase théâtrale de son œuvre comme moment d’appropriation et d’expérimentation linguistiques.
La monographie de Simona Cutcan propose une lecture de l’ensemble de l’œuvre kristovienne fondée sur des propositions critiques issues des gender studies. La chercheuse essaie de démontrer que « les niveaux plus profonds de signification chez Kristof se focalisent sur l’interrogation des rôles de genre ». Sans se laisser décourager par le discours de l’auteure, qui refuse avec véhémence l’étiquette d’« écriture féminine », Cutcan rend compte de la présence d’un certain nombre de femmes révoltées dans l’œuvre kristovienne, notamment dans la pièce La Clé de l’ascenseur et dans les nouvelles « L’invitation » et « La hache ».
La plupart des articles ou chapitres d’ouvrages collectifs consacrés à Agota Kristof abordent l’œuvre dans sa singularité, reproduisant assez souvent, au moins en partie, son discours. Je retiens ici les analyses les plus significatives réalisées à partir d’approches originales.
Hélène Vexliard a proposé une lecture psychanalytique suggestive du Grand Cahier, dans laquelle l’expérience totalitaire est envisagée comme le grand traumatisme historique ayant structuré l’œuvre kristovienne. La situation translingue de l’auteure est malheureusement passée sous silence tout au long de l’analyse.
Les catégories de littérature de témoignage et de récit de survivance, par le prisme de ce qu’on désigne largement par l’expression trauma theory, ont donné lieu à des analyses remarquables. En étudiant les textes dans leur dimension de récits cliniques, cependant, ces analyses mettent entre parenthèses les aspects linguistiques et littéraires, comme c’est le cas dans l’article de Christiane Kègle et Claudie Gagné consacré à l’analyse du roman La Preuve comme « récit de survivance ».
Enfin, l’analyse génétique du fonds Kristof conservé aux Archives littéraires suisses a donné lieu à quelques contributions intéressantes. Les études des manuscrits et tapuscrits de l’auteure élucident le processus de création ; cependant, les archives n’ont jamais été prises en compte dans un questionnement plus large, qui prendrait en considération les brouillons en vue d’une appréhension globale de l’œuvre.
*
Les présupposés mêmes de l’histoire littéraire nationale sont remis en question par des écrivains migrants, transnationaux, translingues comme Kristof ; il existe néanmoins des tentatives d’insertion de son œuvre dans l’histoire de la littérature, à la fois en Suisse et Hongrie.
Agota Kristof figure dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande de Roger Francillon. Cependant, son intégration à l’histoire littéraire romande ne va pas sans quelques difficultés, comme en témoigne une collocation différente de l’œuvre kristovienne entre l’édition de 1999 et celle de 2015 de cet ouvrage. En effet, dans la première édition, Kristof est rangée parmi les « figures de l’exil », à côté d’Anna Cuneo, Micha Sofer, Pierre Katz, Mireille Kuttel, Adrien Pasquali, écrivains d’origine étrangère qui « se rejoignent […] dans une manière problématique de considérer l’espace, le rapport à la langue et l’histoire ». Dans le même chapitre sont rangés des écrivains qui, sans être originaires d’un autre pays ou d’une autre langue, « se posent aussi la question de l’origine, de l’identité et de la communication ». Dans l’édition de 2015, ce chapitre disparaît, remplacé par un autre, « De l’exil à l’écriture », focalisé sur un ensemble d’auteurs de l’extrême contemporain. L’œuvre de Kristof est traitée à deux reprises : les pièces sont mentionnées rapidement dans le chapitre consacré au théâtre, tandis que les romans figurent, assez étonnamment, dans un chapitre consacré au roman de formation, à l’intérieur d’une section intitulée « Exils et dépaysements ». Ce changement de place d’une édition à l’autre est emblématique des difficultés que pose l’insertion de l’œuvre kristovienne dans la littérature romande, insertion qui ne semble envisageable que par le prisme de l’exil.
En Hongrie, l’appropriation des auteurs exilés dont l’œuvre est écrite dans une langue étrangère est particulièrement problématique. Si un débat a existé, entre 1989 et les années 2000, sur l’intégration au canon national de la « littérature hongroise de l’Ouest », produite notamment par des écrivains ayant quitté la Hongrie au cours des deux vagues migratoires de 1944-1949 et 1956, ce débat a touché essentiellement les auteurs ayant continué à s’exprimer en hongrois pendant leur exil. La langue d’écriture reste un critère d’appartenance à la littérature nationale difficile à questionner. Les œuvres d’Agota Kristof sont en tout cas toutes traduites en hongrois, à partir du Grand Cahier, dont la traduction paraît en 1989, l’année des grands bouleversements politiques.
Agota Kristof est peu présente dans les ouvrages de littérature comparée, ce qui témoigne à mon sens de la résistance que son œuvre oppose à l’insertion dans les corpus tripartis typiques des thèses en littérature comparée en France. Elle figure néanmoins dans le corpus principal de trois études : l’ouvrage de Michèle Bacholle Un passé contraignant. Double bind et transculturation explore les œuvres de Kristof, Annie Ernaux et Farida Belghoul, toutes les tro